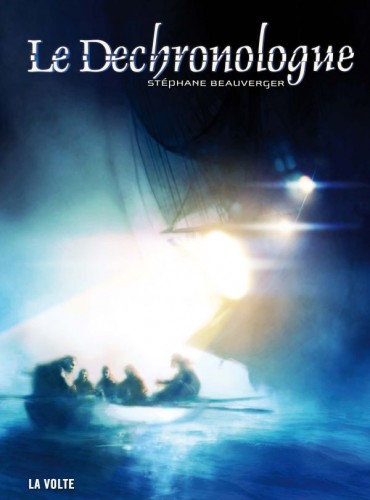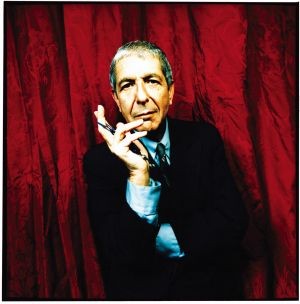Léonard de Vinci, La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne
(Santa Anna Metterza, 1508-1510, Musée du Louvre). Cherchez le vautour !
« Ma joie, mon chagrin, mon espoir, mon amour,
Tout tournait dans ce cercle.
Un cercle étroit. »
Edmund Waller, cité dans La Forteresse vide de Bruno Bettelheim.
« Le sujet s’étale sur le pourtour du cercle dont le moi a déserté le centre. »
Gilles Deleuze & Félix Guattari, L’Anti-Œdipe.
Voici enfin la dernière partie tant attendue ( ?) de cette divagation autour de La Mémoire du Vautour de Fabrice Colin.
La Mémoire du Vautour – 1 – Introduction
La Mémoire du Vautour – 2 – Résumé
La Mémoire du Vautour – 3 – La mort impensable
La Mémoire du Vautour – 4 – JE est un autre
La Mémoire du Vautour – 5 – L'expérience intérieure
La Mémoire du Vautour – 6 – Temps, récit et schizophrénie, première partie
La Mémoire du Vautour – 7 – Temps, récit et schizophrénie, deuxième partie
Il nous reste enfin, au terme de cette longue dérive sur les vagues incertaines de La Mémoire du Vautour, à comprendre comment, dans son univers schizoïde, s’articulent tous ces éléments.
*
* *
D’abord, rafraîchissons-nous la mémoire, voulez-vous ? Au premier chapitre, William Tyron, embauché par une mystérieuse organisation (D_Member), fait la connaissance de Sarah – qu’il est censé observer –, victime d’un crash en Indonésie. Un jour elle disparaît littéralement. Bill se replie dans sa salle de bains. Sarah Daniel Greaves devient la narratrice d’un deuxième chapitre à la chronologie difficile à établir (voir notre résumé). Elle a eu un enfant prénommé Narathan (le père lui a été présenté par un certain Jack Williamson (Williamson : littéralement « fils de William »…). En 1997, observée par un vautour, elle réchappe d’un crash terrible, et subit le lendemain ( ?) une « exérèse » (une sorte d’excision mémorielle) par les services secrets. Le troisième chapitre, « Reeltoy », est lui-même construit comme une chaîne. Le vautour qui observait Sarah est blessé par un congénère avant d’être achevé par un tigre. Le tigre prend la narration à son compte avant d’être blessé par un homme armé. Un autre homme, Setyo (un pirate halluciné), l’abat et prend le relais. Il est intercepté par d’autres pirates, qui le jettent aux requins. Nous suivons alors le requin dans son domaine, mais bientôt celui-ci est tué par des pirates. C’est l’un d’entre eux qui assume le rôle de cinquième maillon de la chaîne Reeltoy (« jouet-bobine ») en mangeant la cervelle du squale. Deux femmes sont prisonnières sur le bateau : la mère est violée puis abattue, mais Reeltoy aide la fille à s’enfuir. Le quatrième chapitre est consacré à Narathan, le fils de Sarah. Il est en compagnie de Reeltoy (le même ?). Au cours d’un voyage en Thaïlande, Narathan assiste sous l’influence de psychotropes à des événements étranges avant d’être tiré d’affaires par un autre Reeltoy ( ?). Le jour du fameux tsunami, Narathan sort son appareil numérique, prêt à immortaliser l’événement. Le narrateur du cinquième et dernier chapitre est un certain Io-Tancrède Violas, artiste et professeur schizophrène. Il est question ici : d’une installation consacrée au tsunami ; d’un mystérieux correspondant qu’il appelle LUI et qui lui transmet des informations biographiques relatives à Bill Tyron ; des mails que lui adresse Narathan ; d’une exposition comprenant cinq œuvres réalisées par ses élèves ; et de sa propre disparition. Io-Tancrède se rend dans une tour, téléphone à Tyron et lui dit : « C’est terminé ». Enfin, dans un épilogue à la troisième personne, Bill Tyron sort de sa salle de bains hors du monde pour s’enfoncer dans le grand blanc…
*
* *
Le personnage-qui-meurt, dans La Mémoire du Vautour, se replie sur lui-même, avons-nous dit. Apparemment destiné au solipsisme, il soumet le réel à son inconscient, et se meut dans une bulle imaginaire enclavée dans le monde « réel ». Oui, mais voilà : en créant son monde-propre, ce repli devient ouverture infinie – le trou noir ouvre sur un cosmos total. « Je » est un autre, souvenez-vous. Dès lors, tout devient possible, y compris cette tectonique des plaques temporelles qui fait se rencontrer Sarah et Tyron alors que le premier, au moins, est censé être mort. Ces liens étranges et discordants (et fort nombreux en vérité : ainsi par exemple, le requin évoque-t-il la mort de Socrate, faisant écho à la mort du singe Socrate dans le chapitre de Sarah, avant de réapparaître dans le chapitre « Io-tancrède » ; ainsi également, Narathan, qui à Patong rencontre un français, Max, qui assure qu’ils se connaissent. Ils se rendent dans une boîte de nuit appelée « le Tiger » et le lendemain, Reeltoy répète devant Narathan les trois mots prononcés par Sarah devant le vautour sur les lieux du crash, page 221…), ces liens irrationnels entre tous les personnages, donc, et le fait que le récit est enchâssé dans la mort de Tyron (le roman commence après sa mort, et s’achève par son accomplissement) nous suggèrent donc d’abord qu’en quelque sorte ils ne font qu’un : Tyron est Sarah, comme il est tous les autres personnages. Sausalito, Sarah, D_Member tout est en lui – tout, sauf peut-être la salle de bain, qui est précisément hors du monde (comprendre : hors du sien comme du nôtre). Et cependant, ils sont bien des personnages distincts, aux existences et aux expériences propres…
Comment nous dépêtrer de cet inextricable réseau de correspondances ? Faisons de nouveau appel à Alan Watts, l’une des figures tutélaires du roman. Comme Raymond Abellio, l’auteur de La structure absolue, Watts croit à l’interdépendance, à « l’idée d’un monde unitaire sans le moindre raccord, tissu d’interactions mutuelles, où une chose ne se comprend que rapportée à une autre et réciproquement. Il est impossible dans cette perspective de considérer l’homme isolément de la nature. » (nous avions déjà cité cet extrait d’Amour et connaissance). Par ailleurs, « [lorsque] l'esprit glisse à son insu dans une attitude réceptive, il lui arrive d'être gratifié d'une perception "magique" du monde. ». Nous retrouvons cette idée, chez Colin, que dans un monde donné tout, absolument, est lié. Le personnage colinien, nous le savons au moins depuis Kathleen, recherche l’illumination intérieure, le saisissement de cette pensée magique, cette connexion, qui n’est que flux continu de perceptions, avec le cosmos dont il fait inextricablement partie (cela n’est pas sans rappeler l’union plotinienne avec l’UN dans l’extase…). Il y a chez Colin une forme certaine de mysticisme, pas totalement diluée dans la métaphore : la croyance, ou la volonté de croire, à l’unité fondamentale du monde. Avant de mourir, le gorille (Socrate) parle par signes à Monika : « le cycle, l’histoire » (129), et le même soir, Sarah perd les eaux et accouche de Narathan. Or Socrate, le philosophe, croit en l’existence d’une « roue des générations » : si la mort fait suite à la vie, la vie fait suite à la mort, ce cycle rappelle à la vie ce qui était la mort. La nature a un devenir sans fin, selon la loi de l’alternance des naissances et des morts. On peut alors parler d’une « Âme du Monde ». Nous verrons plus loin qu’il s’agit là d’une idée centrale du roman.
Et nous sommes dès à présent en mesure de désigner les personnages narrateurs de La Mémoire du Vautour comme des hypostases, semblables, si l’on veut, à la Sainte Trinité chrétienne (et nous verrons plus tard qui est le « dieu » hypostasié).
*
* *
Cependant, le chiffre choisi par Fabrice Colin (qui jusqu’à preuve du contraire n’est pas un écrivain chrétien, même si Io-Tancrède en appelle souvent à Jésus) n’est pas le TROIS de la Trinité, mais le CINQ.
La Mémoire du Vautour comporte cinq chapitres (« Bill », « Sarah », « Reeltoy », « Narathan », « Io-Tancrède »). Le chapitre central, « Reeltoy », est lui-même composé de cinq parties, chacune étant assumée par un narrateur différent (le vautour, le tigre, Setyo, le requin, et le pirate que nous appellerons Reeltoy puisque c’est lui qui semble désigné par ce nom dans le chapitre suivant). Narathan évoque cinq niveaux d’implication dans le jeu : joueur, personnage, intelligence artificielle, observateur et concepteur, et envoie cinq textes à Io-Tancrède, qui lui-même propose cinq œuvres d’art à ses élèves, chacune représentant l’une des cinq conceptions de l’artiste qu’il a préalablement définies (l’avion furtif, le manipulateur, le locataire, l’intelligence, le raconteur). Pourquoi cette omniprésence du chiffre CINQ dans La Mémoire du Vautour ? Peut-être n’y a-t-il pas d’autre origine que l’épigraphe du roman par Bill Viola :
Death by beauty.
Death by sensitivity.
Death by awareness.
Death by experience.
Death by landscape.
Bill Viola
Note, 12 décembre 1986
Cinq manières de mourir. Cinq expériences de la mort. La figure du cercle, elle aussi surdéterminante[1], nous évoque bien sûr le vautour tournant autour de son sujet, la mort (nous avons vu qu’elle ne s’affrontait jamais de front), d’où ce titre initial qui pourrait être celui de tableau, Paysage avec vautour. L’origine de ce roman est peut-être à chercher seulement dans la conjonction de ces cinq lignes de Bill Viola[2] et de quelques chansons du groupe Radiohead. Mais nous ne nous en satisferons pas. Quelle qu’en soit la raison première, connue de lui seul, le choix de Fabrice Colin s’est porté sur le chiffre CINQ. Diantre ! Pourquoi ?!?
*
* *
Selon notre précieux Dictionnaire des symboles, le chiffre CINQ « est signe d’union, nombre nuptial disent les Pythagoriciens ; nombre aussi du centre, de l’harmonie et de l’équilibre. Il sera donc le chiffre des hiérogamies, le mariage du principe céleste (3) et du principe terrestre de la mère (2)[3]. Il est encore le symbole de l’homme (bras écartés, celui-ci paraît disposé en cinq parties en forme de croix : les deux bras, le buste, le centre – abri du cœur – la tête, les deux jambes). Symbole également de l’univers : deux axes, l’un vertical et l’autre horizontal, passant par un même centre ; symbole de l’ordre et de la perfection ; finalement, symbole de la volonté divine qui ne peut désirer que l’ordre et la perfection (CHAS, 243-244). […] Il représente aussi les cinq sens et les cinq formes sensibles de la matière : la totalité du monde sensible. […] L’étoile à cinq branches, la fleur à cinq pétales est placée, dans le symbolisme herméneutique, au centre de la croix des quatre éléments : c’est la quint-essence, ou l’éther. Le 5 par rapport au 6 est le microcosme par rapport au macrocosme, l’homme individuel par rapport à l’Homme universel. […] Dans la plupart des textes irlandais médiévaux cinquante, lit-on encore, ou son multiple triple cent-cinquante (tri coicait, littéralement : trois cinquantaines) est un nombre conventionnel indiquant ou symbolisant l’infini.[4]. […] Sainte Hildegarde de Bingen a développé toute une théorie du chiffre cinq comme symbole de l’homme. […] l’homme possède cinq sens, cinq extrémités (tête, mains, pieds). Plutarque utilise ce nombre pour désigner la succession des espèces. Une telle idée peut se trouver dans la genèse ou il est dit que les poissons et les volatiles furent crées le cinquième jour de la création… »[5]
Symbole d’union, de centre, d’harmonie, de perfection, de quintessence (et, pour finir, de succession des espèces) : l’abondance du CINQ nous paraît désormais justifiée. Est-ce là tout ?... Non, bien sûr. En chiffre romain, CINQ s’écrit V. V comme le roman de Thomas Pynchon (avec lequel, nous le verrons, La Mémoire du Vautour n’est pas sans rapport), V comme V pour Vendetta, V comme Vautour ou Vulture (du latin Vulturius), mais aussi comme le glyphe couramment utilisé pour figurer schématiquement un oiseau – et donc un vautour (V pour Vendetta comporte, bien sûr, un chapitre « Vultures » dans son troisième Livre)… Comme le disait Einstein, Dieu ne joue pas aux dés…
*
* *
V comme Vautour, donc. Remontons à présent le jouet-bobine (« Je termine la cervelle. Tout fond en moi. Tout forme une chaîne ininterrompue et sanglante, pleine d’une sagesse irréelle : du vautour au tigre, du tigre à l’homme, de l’homme au requin, du requin à moi. », 161), qui nous rappelle le jeu de la bobine (ou Fort-Da) chez Freud (jeu répétitif pré-symboliquement lié à la pulsion de mort) et revenons à ce personnage essentiel du roman.
*
* *
Le vautour n’est rien de moins, nous l’avons déjà suggéré, que l’incarnation plumesque du principe vital de La Mémoire du Vautour.
Ah ! Mais il n’est pas seul. Il est, en premier lieu, préfiguré par un chat, Moebius, celui de Sarah, retrouvé mort par Tyron au premier chapitre. Le chat : premier symbole de la mort, qui, cependant, peut vivre neuf vies (donc renaître…). Ensuite, le vautour sera suivi par le tigre et le requin. Tenez, le tigre, celui qui, non loin des lieux du crash, achève le charognard. Pour l’occidental, le tigre est d’abord un mangeur d’hommes, symbole de mort (encore). Mais dans le Bouddhisme (élevons un cierge à la gloire du Dictionnaire des symboles), sa force symbolise celle de la foi, « de l’effort spirituel traversant la jungle des péchés, elle-même figurée par une forêt de bambous. […] Il ne faut pas oublier que dans toute l’Asie du Sud-Est asiatique, le Tigre-Ancêtre mythique est regardé comme l’initiant. C’est lui qui conduit les néophytes dans la jungle pour les initier, en réalité pour les tuer et les ressusciter. »[6] Et les ressusciter ! Nous y sommes ! On trouve d’ailleurs une variation sur ce thème dans le beau film d’Apichatpong Weerasetakul, Tropical Malady – que je n’ai hélas jamais eu le temps ou, allez savoir, le courage d’évoquer ici – et dont une affiche est, plus tard, aperçue par Narathan en Thaïlande (205).[7] Setyo, qui tue le tigre qui a tué le vautour (on meurt beaucoup dans La Mémoire du Vautour mais, et c’est là l’important, ça n’est jamais une fin en soi), délire : « Je suis le personnage. Je comprends la chose noire. Qui enlace la vie. Opérant par cercles concentriques pour la séduction et nous incorporer à sa danse spéciale et savoir/comprendre/c’est voir ce qui se dessine et de quelle façon procèdent les départements concernés les tours hurlantes au sommet des cieux. Comprenons ceci ::: qu’elle va se confondre avec MOI. » (150-151). En mangeant le tigre, Setyo devient le tigre. Pas la mort elle-même, mais « une petite partie de la chaîne » (156). Comme le requin, qui le dévore. Le requin ? Ah, encore une autre image de la mort, dont le poète Lautréamont a fait un double de son Maldoror, en une scène de communion barbare[8]. Ducasse faisait d’ailleurs du requin le frère du tigre[9]. Votre dévoué serviteur, dont la culture étymologique laisse parfois à désirer, a récemment découvert dans le Déchronologue (ce bien beau roman de Stéphane Beauverger dont nous parlerons bientôt ici) que le mot « requin » serait dérivé du latin Requiem, qui comme chacun sait désigne la messe des morts (celle-là même que le malheureux tombé à l’eau peut chanter en guise de dernière prière avant la curée). À l’instar du tigre, le requin est porteur – plus encore depuis Les Dents de la Mer – d’images terrifiantes, de cruauté, de pulsions carnassières pures où noyade et dilacération des chairs s’accouplent dans les ténèbres des profondeurs. Comme son frère de sang Maldoror, le requin n’est qu’un avatar de la mort… Setyo et le pirate Reeltoy, qui mange la cervelle du requin, en sont deux autres. Mais rembobinons encore le jouet (qui a la fâcheuse manie de se dévider) et revenons à notre vulturienne icône.
*
* *
Le Gyps bengalensis que croise Sarah en Indonésie, le vautour Chaugun (un mirage ? Possible : selon le vrai-faux infirmier Frank, Sarah « a dû rêver » [101] « Il n’y a pas de vautours en Indonésie. […] Celui que vous me décrivez, je le connais par cœur, c’est le vautour chaugoun, le cou blanc, c’est ça ? Gyps bengalensis. […] et si je peux vous certifier un truc, c’est qu’il n’y a pas un seul de ces animaux à Sumatra, et certainement pas avec ces incendies. » (102). Pour Frank, le vautour est « un symbole occidental de mort » (102). Symbole de mort ? Oui, mais pas seulement. À la page suivante, Frank évoque les Tours du Silence à Bombay : « On comprend tout quand on les voit. Les vautours, les anges noirs, ennemis de la mort et de la décomposition. » (103). Ennemis de la mort. Pour notre aimé Dictionnaire des symboles, ce brave compagnon de décryptage, le VAUTOUR est certes symbole de mort, mais « se nourrissant de charognes et d’immondices, il peut également être considéré comme un agent régénérateur des forces vitales, qui sont contenues dans la décomposition organique et les déchets de toute sorte, autrement dit comme un purificateur, un magicien qui assure le cycle du renouveau, en transmutant la mort en vie nouvelle. »[10] De même chez les Bambara, où il est associé aux épreuves initiatiques, symbole de renaissance, « mais dans le domaine transcendantal de Dieu, dont la sagesse revêt, aux yeux des profanes, les apparences de la folie et de l’innocence. […] il a le pouvoir de transmuer la pourriture en or philosophal. »[11] Commencez-vous à comprendre ?... Sentez-vous le souffle de la révélation glisser sur votre nuque ? Allons ! Pour les égyptiens, le vautour « absorbe les cadavres et redonne la vie, symbolisant le cercle de la mort et de la vie dans une perpétuelle transmutation. »[12] Pensons aussi, s’il vous plaît, au vautour de Prométhée, dont le foie, dévoré chaque nuit, chaque jour se reconstituait !… C’est ça, la clé du roman. Le cycle ! La transmutation ! (au fait, Herakles tua le griffon). C’est au sommet des Tours du Silence de Mumbai, évoquées dans le livre, que les Parsis (Zoroastrisme), refusant de souiller la terre, déposent les dépouilles de leurs morts à l’intention des corbeaux et des vautours, qui font dès lors partie de la chaîne. « Nous sommes les fossoyeurs, les nettoyeurs, les anges grisâtres de la blancheur. » (136) Tuer le vautour, par exemple, indirectement, au Diclofenac (« C’est un anti-inflammatoire utilisé pour le bétail. Une saloperie hyper-toxique. Le bétail meurt, les vautours dévorent les carcasses, le Diclofenac passe dans leur sang, et ils crèvent à leur tour. » 102), c’est briser le cycle de vie, et non celui de mort (qui n’en est qu’un maillon).
Purificateur et fécondant (oh, et signalons aussi le V de la Cène[13], « ancien symbole de la déesse-planète Vénus »[14], emblème de l’utérus, de la féminité, de la maternité, de la fécondité ! Trouverai-je Dieu dans La Mémoire du Vautour ?... Il y en a un en vérité, mais j’ai bien peur qu’il ne s’agisse que d’un prête-nom…), le vautour fait disparaître les morts pour laisser la place aux vivants. Dépeçant, il incarne le lien[15].
*
* *
Le CINQ, symbole d’harmonie (et de succession des espèces). Le VAUTOUR, symbole de mort mais aussi et surtout du cycle de vie. Comme Kathleen, La Mémoire du Vautour est un roman de la transmission. L’on comprend alors que la chaîne des narrateurs n’introduit pas seulement la notion de succession, mais bien celle d’engendrement, ou de renaissance[16], selon une logique interne, propre au récit, mais que le chapitre « Reeltoy » restitue presque à la lettre. Le pirate qui a mangé le requin qui a mangé l’homme qui a tué le tigre qui a tué le vautour qui a mangé le bébé du crash, conserve des traces de ses prédécesseurs (« Deviens ce que tu manges », dira plus tard Io-Tancrède, 261).
*
* *
Sarah, juste avant son exérèse mémorielle : « J’essai de me concentrer sur l’idée que je ne vais pas être triste, qu’on ne peut pas perdre ce qu’on a oublié. Et je pense ceci : la mort dessine une carte dont nous sommes l’unique point mouvant, jusqu’à ce que nous nous immobilisions et trouvions notre place, mais nous laissons des traces, c’est sûr. L’amour, les mots, la vie : notre passage n’est pas vain. » (131-132)
*
* *
Comme le vautour nous tournons en cercles concentriques autour de la mort, jusqu’à nous y abîmer. Mais nous laissons des traces. Nous imprimons le réel. Non seulement l’univers est une trame formée d‘éléments enchaînés, mais encore, chacun de ces éléments est lié à l’ensemble, et inversement (Sarah est née en 1959, année de la théorie des dominos d’Eisenhower). Setyo : « La rougeur je suis un cri au milieu d’une flaque écarlate le pétrole qui s’en va de mes veines le pétrole sanglant et le trou béant là où se trouvait ma cuisse avant et ces lambeaux les filaments les connexions perdus je comprends. Que je suis une petite partie de la chaîne pas vraiment la mort elle-même. » (156) Et la mort fait partie du processus de perpétuation du vivant. (Io-Tancrède au téléphone à Narathan, qui vient de lui faire part de ses rêveries sur la finitude : « Et aujourd’hui, vous avez pris votre téléphone. Votre geste est un maillon d’une chaîne éminemment complexe de causes et de conséquences, mais il reste un maillon ; comme tel, il est indispensable. Vous m’avez appelé ; vous participez à l’œuvre. […] La mort. », 232-234) Et la mort elle-même est indispensable, en tant qu’elle prépare le terrain aux vivants (est-ce pour cette raison que des deux hollandaises prisonnières des pirates, Reeltoy choisit de sauver la fille, celle qui lui confie ses espoirs, pendant que sa mère est violée puis tuée ? ). La mort d’une vie, est justement pour Eugène Minkowski ce qui fait surgir la notion d’une vie. « La mort en tant que destruction engendre un devenir et non point un être »[17] « Ainsi la mort, en venant mettre fin à la vie, l’encadre tout entière, tout le long de son parcours »[18] Et Bill Tyron ne parvient à son immortalité schizophrénique qu’à sa mort. La mort est ce qui révèle la vie.
*
* *
« Je pense que nous vivons tous aux dépens les uns des autres. Pour qu’une fleur éclose, l’autre doit faner. » (255)
*
* *
Mourir en laissant une trace. Et vivre à travers ceux qui restent. Et bien entendu, faire un enfant, c’est, en principe, laisser une telle trace. Ainsi Reeltoy reconnaît-il Sarah en Narathan (Le cas de Sarah et Narathan est assez intéressant. Page 15, Sarah est définie par D_Member comme « célibataire sans enfant ». Simple oubli causé par l’exérèse ? Référence biblique cachée[19] ?... Toujours est-il qu’effectivement, comme la Sarah du Livre, Sarah Daniel – autre prénom biblique – Greaves aura un enfant, Narathan – dont le h exprime l’idée de Dieu –, au travers duquel elle continue d’exister).
*
* *
Mais la véritable grande idée du roman, celle qui est restée étrangement inaperçue, c’est que cette problématique est aussi celle de l’écriture, celle de la littérature. Les personnages eux aussi naissent, ou apparaissent, puis disparaissent, remplacés par d’autres, auxquels ils demeurent irrémédiablement liés. L’écrivain n’est-il pas créateur et destructeur de mondes ?... (Qu’on songe aux auteurs de space opera…) Chaque personnage est un monde, qui hérite du précédent quelque chose, qui lui fait écho par quelque mystérieuse alchimie, par association d’idée, ou parce qu’il en constitue une autre version. Voilà pourquoi tant d’éléments, apparemment dénués de toute logique, relient entre eux les personnages de La Mémoire du Vautour : ils sont tous créés par le même « dieu ». Bien entendu, telle affirmation sonne à vos oreilles comme une navrante lapalissade. Il faut alors que compreniez que lorsque nous écrivions plus haut que Bill, Sarah (à qui Patrick dit, page 165 : « Tu es une incarnation »), Reeltoy, Narathan et Io-Tancrède étaient des hypostases, nous l’entendions au sens littéral, et surtout pas comme une métaphore !
Cette idée ne relève pas que de l’interprétation, ou, comme certains l’imaginent sans doute déjà, de la surinterprétation. J’en veux pour preuve l’importance souterraine, dans La Mémoire du Vautour, de l’entité D_Member (écho au V de Thomas Pynchon, autre entité multiple et mystérieuse de la littérature dite « postmoderne »), qui n’est que l’un des multiples noms du dieu de ce livre, le double imaginal de l’auteur Fabrice Colin. Le seul lien authentique entre Tyron, Sarah, Io-Tancrède, Narathan et Reeltoy, c’est lui, D_Member. L’Énonciateur. Le Raconteur. Le Concepteur. Le Dieu hypostasié !
Et les personnages le pressentent. Pour Narathan, nous le savons, il y aurait trois niveaux d‘implication dans le jeu vidéo : « joueur, personnage, intelligence artificielle » auxquels il ajoute une quatrième, « celle de l’observateur, du type qui regarde de haut », puis une cinquième postures : « le concepteur qui maîtrise tous les codes, celui qui éteint la lumière si ça lui chante et fait disparaître le ghost in the shell. » (174) Les cinq catégories d’artistes de Io-Tancrède sont tout à fait semblables :
« Premier artiste : l’avion furtif. […] L’observateur. Toujours en mouvement. […] Plus d’ateliers, mais une bombe de peinture, mais un appareil numérique, mais des mains, une voix, des yeux. »
« Artiste deux : le manipulateur. Entrons à l’intérieur du système. […] Nous provoquons des accidents de pensée. Nous orchestrons des crashs : boursiers, sexuels, conceptuels, de voitures. Nous rejetons le mot « naturel ». Nous rions au nez de l’Eternel. L’action politique par excellence, et l’art ne peut être que politique en ce qu’il organise la vie dans la Cité […]. »
« Figure trois, […] le locataire ! L’habitant des formes d’art. […] Vous êtes personnifié. On vous reconnaît, on vous voit, on vous veut parfois. A vous d’élaborer les stratégies d’évitement. Cela va de pair avec l’utilisation des structures, la création, je le disais, de matrices nouvelles à partir des matières premières, ou de ce qui nous est donné comme tel.
« Artiste quatre. L’intelligence. Ce qui fait sens. […] nous ne voulons pas seulement laisser des traces, nous voulons être le véhicule, n’est-ce pas ? »
« Cinquième incarnation, […] le raconteur. Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes sortis du mythe de l’objet parfait et autonome à l’abri de l’histoire. Le discours n’est pas l’art. La forme n’est pas le contenu, une information ne saurait se passer de support ou se résumer à lui seul, bla-bla, et le mouvement n’est pas la vie. Le problème, […] c’est que l’histoire n’est plus donnée. C’est au spectateur, au visiteur, c’est au lecteur de la trouver. » (247-248).
Et ce raconteur, ce concepteur, celui du roman, qui est-ce sinon l’écrivain lui-même ? Fabrice Colin, l’auteur, intervient directement dans son propre texte, dans les premier et cinquième chapitres, sous le nom de D_Member, ou, dans le chapitre de Io-Tancrède, celui qui n’a pas de nom, « LUI ». C’est lui, le commanditaire de Bill Tyron. C’est LUI, le mystérieux Ian-le-Tigre rencontré par Sarah en Thaïlande, « des dreadlocks jusqu’aux fesses, et une main en moins » (115) (une main en main : dis-member). C’est LUI, le Dieu (« D » Member) de La Mémoire du Vautour, c’est LUI, l’entité aux « cinquante noms » (254), c’est LUI « Le Dieu™ dans la machine » (261, 281) évoqué par les mails envoyé par LUI à Io-Tancrède, qui ressemblent à des notes prises par l’auteur pour préparer le roman (« Rencontre BEE[20] (Google + catastrophes), 261 ; « Alan Watts ~ une bibliothèque non déterminée : Illumination. […] La. Voiture. Explose. Ggate : RIP. », 281-282) C’est LUI, encore, qui demande à Io-Tancrède de l’invoquer, de le faire apparaître « pour de bon » (238), LUI qui organise « tout ce bordel insensé sur la mort » (273), c’est LUI qui « contrôle les leviers et les amas globulaires. » (271), LUI qui voit le monde où évoluent les personnages (Io-Tancrède : « Je lève les yeux, lentement. Dieu, je – Les rues. Les rues sont vides. Les gens autour de moi. Ce n’est pas moi qui ne vois pas le monde. », 275) et qui, en « sémionaute », invente les « trajectoires parmi les signes » (244).
Le personnage, quel qu’il soit, n’est jamais que le « véhicule » (238), le « porte-parole » (ibid), la « pointe du stylet » (220) qui « trace à la ligne », « à toutes les étapes du processus » (ibid). L’auteur seul peut faire disparaître l’enfant des caméras de surveillance (241). « [Je] suis la conscience d’un autre, mais cet autre n’est pas Dieu. » (227) dit Io-Tancrède, le professeur hébéphrène. Pas Dieu, non, pas de notre point de vue, mais le créateur ! Et celui-ci vit en chacun des personnages (« Il y a cinq ans, j’ai commencé à LE voir. D’abord une sensation – l’impression d’être suivi. Puis une certitude. IL était là. Chez moi. En moi. », 285).
L’auteur, donc, intervient. Mais il ne peut tout assumer : son œuvre ne vit que par ses incarnations : « Je représente […] la force agissante d’une entreprise aux vocations démesurées. La mort est ce qui nous occupe. Certains défunts dégagent en rendant leur dernier souffle une énergie narrative. Cette énergie est le carburant de notre art. Nous l’utilisons pour créer des histoires. » (285) Io-Tancrède est donc chargé d’une mission : « mettre un terme à l’une de ces histoire. […] La personne dont vous devez vous occuper est déjà morte. Vous devrez juste le lui signifier. » […] Pour finir, je LUI ai demandé pourquoi IL ne pouvait pas se charger de cette tâche LUI-même. Impossible, a-t-IL rétorqué. Contrairement à vous, je vis dans un monde stable. » (285)
Quand Narathan veut rencontrer Io-Tancrède[21], ce dernier l’en dissuade : « De plus, il est probable que le monde dans lequel nous évoluons vous et moi, ce monde imparfait, lardé d’occurrences irréelles et de coïncidences forcées – il est probable que ce monde cesse demain d’exister. Ne gaspillez pas vos forces. » (288) Narathan veut lui parler de réincarnation, mais Io-Tancrède raccroche… Et c’est avec la carte de D_Member dans sa poche qu'il appelle Bill pour lui annoncer enfin : « C’est terminé. » (295). Les personnages de La Mémoire du Vautour sont des fictions dans la fiction : « Vous n’êtes pas là, dit-elle. Ceci n’est pas en train d’arriver. » (290)
*
* *
Le roman est une métaphore du roman (qui fixe les événements). Pour Colin, écrire ce n’est pas figer, c’est créer un monde, c’est mourir.
*
* *
La Mémoire du Vautour ne prétend pas décrire objectivement l’Instant mortel, mais seulement, en tournant autour de la mort et de son territoire, donner vie à des êtres mortels. Si la mort est indicible, apoétique, absolument inénarrable, les mourants ne le sont pas.
*
* *
Créer, écrire, pour ne pas mourir… Fabrice Colin écrit pour continuer d’exister ensuite, mais aussi pour continuer à vivre – et cependant la mort frappe quand elle veut. Peut-on alors voir en Narathan une référence au propre fils de l’auteur ?... Narathan… Étrange prénom en vérité… S’agirait-il d’une transformation du prénom du fils de l’auteur lui-même, Nathan ? Nathan, Narathan… Narathan/narration… Faut-il comprendre que ce livre serait comme un fils pour l’auteur, un enfant narré plutôt qu’incarné ?... Une trace pour exister quand, pour lui aussi, tout sera terminé ?
*
* *
Fabrice Colin cherche à donner un sens à la mort. Et la meilleure réponse qu’il a trouvée, c’est de la métamorphoser en fiction. Écrire. Mourir, c’est devenir une fiction, où l’on ne vit qu’à travers la narration de ceux qui restent. La mort, en tant qu’événement pur, unique et singulier (en tant qu’hapax), serait un processeur d’histoires (le terme est emprunté à Serge Lehman). Ainsi du tsunami (ou, dans sa BD World Trade Angels, les attentats du 11 septembre 2001), qui devient ici un moteur, un élément important du récit. Bill, Sarah, Narathan, Io-Tancrède, n’existent pas ? Peu importe, car « Sacha [Bronwasser] affirme ceci : au sein d’une société médiatisée, la frontière entre réalité et fiction est difficile à distinguer. […] Tout ce qui compte, c’est que l’histoire soit crédible. » (244)
Remarquons que ce que nous écrivons là est explicite dans le texte, ainsi qu’en témoignent les extraits suivants.
*
* *
« Les gens ne s’arrêtent jamais de marcher, de parler, de penser. Même lorsqu’ils dorment, ils réfléchissent. Leur existence est un film à trois cents images/seconde. Plus on regarde en arrière, plus les images se font rares. […] Toute cette production vouée à l’oubli. Pour qui, pour quoi ? » (235-236)
*
* *
« […] nous sommes des histoires racontées pour personne. […] continue, et ton histoire se mêlera à la mienne, et nous composerons la symphonie du monde. » (236-237)
*
* *
« Ce processus, c’est un homme qui l’a enclenché. La mort d’un homme. Sans cette mort, rien n’existerait. Et après-demain, tout ça prendra fin. » (282)
*
* *
« La mort est une fable. La mort ne met fin à rien parce qu’elle n’existerait pas sans la vie. Il n’y a ni passé, ni avenir et toutes les vies valent la peine d’être contées et nous ne sommes que ça, finalement – des possibilités. » (283)
*
* *
« Face à un événement d’une telle ampleur [le tsunami], seules deux possibilités artistiques me paraissent pertinentes : le témoignage (œuvre d’observateur neutre) ou la fusion (devenir la conscience du drame). […] j’ai opté pour la seconde. La mort, contrairement à ce que pensent ceux qui ne pensent pas, n’est pas la fin de l’histoire : elle est, au contraire, porteuse de narration. Et c’est par son truchement salvateur que l’imagination se libère. » (231)
*
* *
« Tu sais, ce n’est pas ma maladie qui me fit peur et qui fait peur aux psychiatres. Ce n’est même pas son existence à LUI. C’est me dire que je ne suis pas ici, en train de te parler. Me dire que le monde dans lequel nous vivons n’est pas le bon. Seulement une création, imparfaite, bourrée de fautes et de répétitions. [… La mort est une histoire. La mort crée une histoire, comme une dernière giclée. Nous faisons partie de cette histoire. Moi, je suis chargé de la boucler. […] Je suis la fin de l’histoire. Je ne suis pas plus réel qu’elle. Et nul ici ne peut prétendre l’être. » (262)
*
* *
Il nous faut aussi dire un mot de l’épilogue du roman, seul passage à être narré à la troisième personne. L’être-qui-meurt en première personne, avons-nous dit précédemment, se replie sur une atemporalité qui peut aussi bien être décrit comme un présent éternel. À l’exception de cet épilogue, le roman est tout entier produit par Tyron-qui-meurt, c’est une bulle d’espace-temps qui aurait pu se poursuivre sans fin. Pour achever son œuvre, pour, littéralement, en sortir, Colin devait impérativement quitter la singularité, se retirer de son personnage. Le déposséder. En changeant de perspective, en abandonnant le « Je » pour le « Il » (qui pour l’auteur, intime du personnage puisqu’il en est le géniteur, est un « Tu »), Colin permet au récit de retrouver une temporalité classique, de quitter l’incommunicable expérience directe de la mort pour en restituer plutôt le bouleversant hapax. Bill a eu un grave accident, donc Bill meurt et, logiquement, le roman s’arrête, dans un grand blanc qui est, bien sûr, celui de la page. Celui du livre.
« Elle lui montre le ciel. Il regarde le soleil crucifié et il se regarde lui, évanescent et quand il veut la rejoindre et qu’elle tourne les talons et court et disparaît, il réalise une chose élémentaire : qu’il n’a jamais vécu ici, ou seulement il y a longtemps, dans un autre monde, un monde de sensations et de contacts, un monde qu’il pouvait toucher et aimer – et qu’il est en train de quitter, en une vertigineuse désincorporation.
Il cligne des yeux dans la torpeur. Le blanc s’avance partout. Le blanc mange les images et dévore le mouvement. Ce n’est pas du brouillard. Ce n’est pas quelque chose que l’on voit. C’est quelque chose que l’on sait. Il n’y a plus rien après ça. » (299)
*
* *
« Tout est blanc, si blanc, et si vide, qu’il en ressent une joie intense, presque douloureuse – et autre chose aussi, une chose libératrice : il y a ce vide au-dessus, une connaissance qui n’a pas de nom et ne possède pas de fin – et il vole à présent, s’enfonce dans le grand blanc, il ne s’arrêtera plus, le vent traverse son corps, il hurle et personne ne l’entend […] mais pour lui, cela n’a plus aucune importance parce que, dans quelques secondes, pour la première fois, pour la première et unique fois de ce qui a été sa présence en ce monde, William Tyron va être libre. » (300) Ainsi s’achève le roman. Bill est enfin libre, affranchi de son créateur, mais qui vivra encore en lui, à travers lui, comme à travers ses œuvres futures.
*
* *
Nous ne prétendons pas avoir percé tous les secrets de La Mémoire du Vautour. Souvent avons-nous fait erreur, soyons-en sûr. Mais du moins en avons-nous révélé les forces vives, celles qui en font une œuvre certes imparfaite, mais fascinante. (Schizo)roman sur la mort, l’oubli et la filiation, La Mémoire nous parle aussi de la nécessité d’écrire, c’est-à-dire, donner vie aux morts passés et à venir.
[1] Il y a bien entendu les cercles déjà évoqués dans notre sixième chapitre : les cercles concentriques du vol du vautour (« [J]e me tiens au bord du cercle et de là, tout est visible », 133), répétés par Setyo (« Je suis le personnage. Je comprends la chose noire. Qui enlace la vie. Opérant par cercles concentriques » 150-151) ; les cercles tracés à la craie par le singe Socrate (127) ; les cercles dont Maxime parle à Narathan (« La compréhension de la nature des cercles et des traces laissées. Nous prenons de la hauteur. Tracer les cercles sur les traces, c’est comprendre l’inéluctabilité qui nous attend. La précision de l’horloge. », 187) ; les cercles de Narathan (« tout s’ordonne autour d’un point central, […] je suis le cercle, le disque et, très bientôt, je prendrai mon envol. », 209) ; ou encore le cercle tracé à la craie par une vieille femme dans une installation artistique (280). Ajoutons (sur les conseils de l’auteur) le signe du gyrophare de Io-Tancrède (245).
[2] Bill Viola, artiste américain auquel on doit l’image à l’origine de celle qui figure en haut à droite de ce blog.
[3] Et la Trinité revient au galop, chers amis !
[4] Et nous reviennent en mémoire les occurrences, jusqu’alors incompréhensibles, du nombre CINQUANTE (cinquante sortes de thé, p. 239, les cinquante noms de D_Member, p. 254 !)
[5] J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, R. Laffont / Jupiter, (1969) 1982, pp. 254-255.
[6] J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 949.
[7] Selon E. Aeppli, « Voir déambuler un tigre dans ses rêves signifie être dangereusement exposé à la bestialité de ses élans instinctifs. » (J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, ibid.) Il symbolise également « l’obscurcissement de la conscience, submergée par le flot des désirs élémentaires déchaînés. » (ibid.) Et selon Freud, « le père redouté est symbolisé par de méchants animaux […]. On pourrait dire que les animaux sauvages servent à représenter la libido redoutée par le moi, combattue par le refoulement. La névrose elle-même, la “personnalité morbide”, sont souvent séparée par le rêveur et présentée comme une personnalité indépendante. » Mais si je vous rapporte cela, c’est avant tout par plaisir. Nous pourrions bien entendu trouver quelque écho à ces lignes dans La Mémoire du Vautour, mais l’on nous accuserait encore de surinterpréter. La vérité, pourtant, difficile à entendre pour les apôtres de la Raison Impure, est que ce livre fait plus que se prêter à notre jeu : il l’encourage, il le suscite, il le déhisce ! Ah, mais soyons indulgents avec ces chevaliers blancs aux armes en papier brouillon. Ils ne savent pas ce qu’ils font.
[8] « Alors, d’un commun accord, entre deux eaux, ils glissèrent l’un vers l’autre, avec une admiration mutuelle, la femelle de requin écartant l’eau de ses nageoires, Maldoror battant l’onde avec ses bras ; et retinrent leur souffle, dans une vénération profonde, chacun désireux de contempler, pour la première fois, son portrait vivant. » (Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Chant II).
[9] « Au reste, que m’importe d’où je viens ? Moi, si cela avait pu dépendre de ma volonté, j’aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont la faim est amie des tempêtes, et du tigre, à la cruauté reconnue : je ne serais pas si méchant. » (Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Chant I).
[10] J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 994.
[11] Ibid.
[12] Op. cit., p. 995.
[13] Dans Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », trad. de l’allemand par J. Altounian, A. et O. Bourguignon, P. Cotet et A. Rauzy, 1987 [1910]), Freud se réfère à un rêve évoqué par Léonard (« Il semble qu’il m’était déjà assigné auparavant de m’intéresser aussi fondamentalement au vautour, car il me vient à l’esprit comme tout premier souvenir qu’étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu’à moi, m’a ouvert la bouche de sa queue et, à plusieurs reprises, a heurté mes lèvres de cette même queue. », p. 89). La queue (« coda »), représente bien sûr le sexe masculin. Mais, pour diverses raisons, Freud interprète cette fantaisie homosexuelle comme une réminiscence d’une jouissance bien antérieure : celle de la tétée (nous vous épargnons ici les développements du sémillant psychanalyste viennois), comprise comme relation érotique à la mère (dont le sourire qui caractérise les tableaux de Léonard – et plus que tout autre, la Joconde – serait une autre représentation). Et les éléments de cette fantaisie se seraient retrouvés dès les premières toiles du peintre… Et dans une note ajoutée en 1919, Freud évoque une image-devinette trouvée par Pfister dans La Vierge, l’Enfant et sainte Anne exposé, au Musée du Louvre : dans le drapé un peu étrange de Marie se cachent en effet les contours d’un vautour dont la queue est précisément en contact avec la bouche de l’enfant (une fois la silhouette détectée, l’effet est assez impressionnant)… Pour Freud, cela ne fait aucun doute, le vautour du rêve de Leonard est indissociable de la mère (voir aussi la déesse-vautour égyptienne Mout, la Mère – dont Freud, dans son enthousiasme, souligne l’homophonie avec le mot allemand Mutter).
Cependant, on a relevé dès 1923 une erreur commise par Freud. Celui-ci aurait en effet traduit le mot nibio, employé par Leonard, par « vautour », alors que la traduction exacte est « milan ». « On en vient à se demander, écrit Pontalis dans sa préface, si ce qui fut d’abord salué comme un “tour de force” n’était pas un exercice d’illusionniste victime de sa propre illusion » (op. cit., p. 33). Délire d’analyste ? Pas sûr. Cette erreur pourrait bien être volontaire ou, du moins, relever du lapsus. Pontalis rappelle la légende égyptienne, peut-être à l’origine de la représentation de la Mère en déesse vautour, selon laquelle les vautours seraient tous femelles, fécondés par le vent ! En traduisant nibio par vautour (Geier), Freud aurait ainsi cherché à retrouver l’idée d’immaculée conception indissociable de toute représentation de la Vierge. Néanmoins le psychanalyste Christophe Bormans, dans un séminaire – qui bizarrement prétend n’avoir jamais vu de vautour dans le drapé de Marie –, porte à notre attention le V formé, dans La Cène, par le Christ et la femme à sa droite (Marie-Madeleine, selon Dan Brown). Le Da Vinci Code y voyait apparemment le symbole du Calice (du Graal), mais pour Bormans il s’agit surtout du Féminin sacré, « l’ancien symbole de la déesse-planète Vénus, emblème de l’utérus, disons de la fécondité »…
[14] Cf. note précédente.
[15] À propos de la lettre V, reproduisons ces mots de Thomas Pynchon : « Ce que sont pour le libertin les cuisses ouvertes, ce qu’est un vol d’oiseaux migrateurs pour l’ornithologue, ce qu’est la tenaille pour l’ajusteur, voilà ce qu’était pour le jeune Stencil la lettre V. »
[16] Dans La Forteresse vide : l’autisme infantile et la naissance du Soi (Gallimard, « Folio Essais », trad. de l’anglais par R. Humery, 1969 [1967]), Bruno Bettelheim consacre un chapitre à l’enfant Joey. Celui-ci imitait sans cesse les mouvements de l’hélice avec sa tête ou avec ses mains. Les mouvements circulaires symbolisent souvent chez les autistes – et Joey l'a confirmé lui-même dans un entretien (« […] j’avais l’impression que ma vie était un cercle vicieux et que c’était là une façon de le dire », op. cit., p. 608) – le cercle vicieux dans lequel ils sont enfermés.
[17] E. Minkowski, Le Temps vécu : Études phénoménologiques et psychopathologiques, P.U.F., 1995 [1933], p. 123.
[18] Ibid, p. 124.
[19] Cf. Pentateuque, Genèse : Sarah (Sarai), épouse (et sœur) d’Abram, quitte son pays pour suivre Abraham, sur ordre de Dieu. Elle est stérile. Mais elle offre sa servante, Agar, à Abraham, qui lui donne Ismael. Par l’Alliance offerte par Dieu, Abram devient Abraham, et Sarai devient Sarah. À 90 ans, elle accouche d’Isaac. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils (Genèse 22, 1 : Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t-en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je t’indiquerai. »). Sarah en meurt à 127 ans à Hebron. Mais un message arrête Abraham dans son geste.
[20] BEE = Bret Easton Ellis, comme l’indique la référence au roman Informers (Zombies en VF), qui est aussi le nom du groupe de Tyron : « The INFoRMERs = 2 Lps, 3 Eps » (281)
[21] Io : dans la mythologie grecque, prêtresse d’Héra qui, à sa mort, devient une constellation…