
Cet été 2012 devrait paraître le nouveau roman de Maurice G. Dantec, Satellite Sisters. À l'image de Marc-Édouard Nabe, Dantec avait d'abord choisi l'autoédition, ce qui n'était pas sans soulever quelques interrogations. On pouvait craindre une écriture en roue libre, sans le travail éditorial nécessaire. Finalement, cette suite de Babylon Babies paraîtra aux éditions Ring et devrait être disponible dans toutes les librairies. Quoi qu'il en soit, la perspective de voyager à nouveau en compagnie de Toorop et des jumelles Zorn m'enchante réellement.
Le texte qui suit, qui s'orbite autour de Babylon babies, est une version remaniée d'un article paru dans La Presse Littéraire, Hors Série spécial « écrivains infréquentables », sous la direction de Juan Asensio, en 2007.
« Joie de l’aveuglement. – “Mes pensées, dit le Voyageur à son ombre, doivent m’indiquer où je me trouve : mais elles ne doivent pas me révéler où je vais. J’aime l’ignorance de l’avenir et je ne veux pas périr à m’impatienter et à goûter par anticipation les choses promises.” »
Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, Livre quatrième.
 Dans La Sirène rouge (Gallimard, coll. Série Noire, 1993), Hugo Cornelius Toorop traversait l’Europe en compagnie de la petite Alice, pourchassée par les troupes de sa furie de mère, tête pensante d’un réseau de snuff movies particulièrement atroces. Objectif : gagner le Portugal, dernière destination connue du père d’Alice. Malgré ses énormes ficelles, son récit cousu de fil blanc, ses dialogues parfois empesés et ses brouettes entières de clichés du genre, La Sirène rouge laissait pourtant de profondes traces dans son sillage. La construction, le rythme, le style, y étaient déjà d’une grande efficacité. Et même si Dantec n’y avait pas encore développé ses idées spéculatives, ce premier roman témoignait d’une intéressante tentative de rendre compte du chaos occidental de cette fin de siècle. Toorop envisageait d’ailleurs d’écrire le roman de sa lutte contre le mal mondialisé – « De la nécessité d’une littérature-en-direct. Là, tout de suite, maintenant. », confiait-il alors à son dictaphone… Ce qui frappait de prime abord dans cette œuvre aussi imparfaite que prometteuse, c’était la fuite incessante de Toorop, son mouvement perpétuel, son voyage, son odyssée aux confins de l’Europe millénariste gangrenée par le mal. Son impermanence. Il ne s’agissait pas seulement d’une convention narrative, mais bien d’une nécessité vitale, presque ontologique. La stase, la fixité, sont mortifères pour Toorop. Fuir, pourchasser ; proie ou prédateur. Bouger c’est être encore vivant, c’est encore résister au mal, c’est encore refuser sa prolifération virale. Dans les toutes dernières lignes du roman, Toorop franchit une frontière et s’éloigne lentement sur la route. Pour exister, Toorop doit être le témoin, et le scribe, du chaos et de l’histoire. Il se déplace sans cesse pour échapper aux balles ennemies, pour sa propre survie – le mal se déplace, lui aussi –, mais aussi pour celle de la civilisation. La survie de l’Homme. Dresser le portrait de l’époque, aussi complexe soit-elle : tel était, sous-jacent, le projet littéraire de Dantec. Voilà pourquoi La Sirène rouge, en dépit de sa grâce un rien pachydermique, avait réveillé en nous quelque lueur.
Dans La Sirène rouge (Gallimard, coll. Série Noire, 1993), Hugo Cornelius Toorop traversait l’Europe en compagnie de la petite Alice, pourchassée par les troupes de sa furie de mère, tête pensante d’un réseau de snuff movies particulièrement atroces. Objectif : gagner le Portugal, dernière destination connue du père d’Alice. Malgré ses énormes ficelles, son récit cousu de fil blanc, ses dialogues parfois empesés et ses brouettes entières de clichés du genre, La Sirène rouge laissait pourtant de profondes traces dans son sillage. La construction, le rythme, le style, y étaient déjà d’une grande efficacité. Et même si Dantec n’y avait pas encore développé ses idées spéculatives, ce premier roman témoignait d’une intéressante tentative de rendre compte du chaos occidental de cette fin de siècle. Toorop envisageait d’ailleurs d’écrire le roman de sa lutte contre le mal mondialisé – « De la nécessité d’une littérature-en-direct. Là, tout de suite, maintenant. », confiait-il alors à son dictaphone… Ce qui frappait de prime abord dans cette œuvre aussi imparfaite que prometteuse, c’était la fuite incessante de Toorop, son mouvement perpétuel, son voyage, son odyssée aux confins de l’Europe millénariste gangrenée par le mal. Son impermanence. Il ne s’agissait pas seulement d’une convention narrative, mais bien d’une nécessité vitale, presque ontologique. La stase, la fixité, sont mortifères pour Toorop. Fuir, pourchasser ; proie ou prédateur. Bouger c’est être encore vivant, c’est encore résister au mal, c’est encore refuser sa prolifération virale. Dans les toutes dernières lignes du roman, Toorop franchit une frontière et s’éloigne lentement sur la route. Pour exister, Toorop doit être le témoin, et le scribe, du chaos et de l’histoire. Il se déplace sans cesse pour échapper aux balles ennemies, pour sa propre survie – le mal se déplace, lui aussi –, mais aussi pour celle de la civilisation. La survie de l’Homme. Dresser le portrait de l’époque, aussi complexe soit-elle : tel était, sous-jacent, le projet littéraire de Dantec. Voilà pourquoi La Sirène rouge, en dépit de sa grâce un rien pachydermique, avait réveillé en nous quelque lueur.
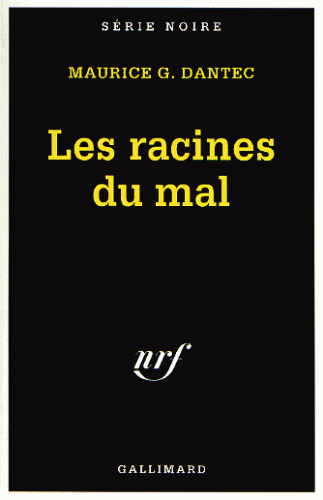 Les Racines du Mal (Gallimard, coll. Série Noire, 1995), deuxième roman de Maurice G. Dantec,nous plonge d’emblée dans le cerveau dérangé d'Andreas Schaltzmann, schizophrène franco-allemand persuadé que le monde est manipulé par les aliens nazis de Vega. « Andreas Schaltzmann avait commencé à tuer parce que son estomac pourrissait » (p. 15). Le délire de Schaltzmann, dopée aux accélérateurs neuroniques, le pousse à commettre une série de meurtres particulièrement sanglants au cours d’une cavale suicidaire en banlieue parisienne. Cette première partie, vraiment éprouvante, emprunte autant à Philip K. Dick qu’à Bret Easton Ellis et James Ellroy, pour livrer un tableau apocalyptique de la France moderne. Puis le récit bascule. Arthur Darquandier, dit « Dark », un jeune scientifique, a mis au point avec son collègue Stefan Gombrowicz la « neuromatrice », un logiciel « neurocognitif », c’est-à-dire une intelligence artificielle expérimentale dotée d’un « noyau de chaos actif », et conçue comme un cerveau humain, connectée en permanence aux réseaux d’information. Darquandier, de retour en France, est confronté à l’invraisemblable jeu criminel – car il s’agit bien d’un jeu, avec règles, contraintes et comptage de points – auquel se livrent de mystérieux tueurs. Avec l’aide de la neuromatrice, capable de simuler le fonctionnement mental des serial killers (à commencer par Schatzmann) – c’est la « schizoanalyse », fondée sur les travaux de Mandelbraut et de Prigogine, et qui renvoie directement à Deleuze et Guattari –, Darquandier remonte peu à peu aux racines de l’Arbre de Mort, jusqu’à ce réseau de tueurs millénaristes. Avec Les Racines du Mal, Dantec s’imposait comme l’un des rares écrivains français à embrasser l’époque dans son ensemble, comme si Dantec lui-même se comportait comme une neuromatrice biologique, accumulant les informations, dressant des listes (comme Romanenko dans Babylon Babies), et, tel un personnage de William Gibson, cherchant de nouvelles connexions, des points nodaux inattendus mais possibles. Cette méthode culminera dans son livre suivant.
Les Racines du Mal (Gallimard, coll. Série Noire, 1995), deuxième roman de Maurice G. Dantec,nous plonge d’emblée dans le cerveau dérangé d'Andreas Schaltzmann, schizophrène franco-allemand persuadé que le monde est manipulé par les aliens nazis de Vega. « Andreas Schaltzmann avait commencé à tuer parce que son estomac pourrissait » (p. 15). Le délire de Schaltzmann, dopée aux accélérateurs neuroniques, le pousse à commettre une série de meurtres particulièrement sanglants au cours d’une cavale suicidaire en banlieue parisienne. Cette première partie, vraiment éprouvante, emprunte autant à Philip K. Dick qu’à Bret Easton Ellis et James Ellroy, pour livrer un tableau apocalyptique de la France moderne. Puis le récit bascule. Arthur Darquandier, dit « Dark », un jeune scientifique, a mis au point avec son collègue Stefan Gombrowicz la « neuromatrice », un logiciel « neurocognitif », c’est-à-dire une intelligence artificielle expérimentale dotée d’un « noyau de chaos actif », et conçue comme un cerveau humain, connectée en permanence aux réseaux d’information. Darquandier, de retour en France, est confronté à l’invraisemblable jeu criminel – car il s’agit bien d’un jeu, avec règles, contraintes et comptage de points – auquel se livrent de mystérieux tueurs. Avec l’aide de la neuromatrice, capable de simuler le fonctionnement mental des serial killers (à commencer par Schatzmann) – c’est la « schizoanalyse », fondée sur les travaux de Mandelbraut et de Prigogine, et qui renvoie directement à Deleuze et Guattari –, Darquandier remonte peu à peu aux racines de l’Arbre de Mort, jusqu’à ce réseau de tueurs millénaristes. Avec Les Racines du Mal, Dantec s’imposait comme l’un des rares écrivains français à embrasser l’époque dans son ensemble, comme si Dantec lui-même se comportait comme une neuromatrice biologique, accumulant les informations, dressant des listes (comme Romanenko dans Babylon Babies), et, tel un personnage de William Gibson, cherchant de nouvelles connexions, des points nodaux inattendus mais possibles. Cette méthode culminera dans son livre suivant.
« Vivre était donc une expérience incroyable, où le plus beau jour de votre existence pouvait s’avérer le dernier, où coucher avec la mort vous garantissait de voir le matin suivant, et où quelques règles d’or s’imposaient avec constance : ne jamais marcher dans le sens du vent, ne jamais tourner le dos à une fenêtre, ne jamais dormir deux fois de suite au même endroit, rester toujours dans l’axe du soleil, n’avoir confiance en rien ni en personne, suspendre son souffle avec la perfection du mort vivant à l’instant de libérer le métal salvateur. »
 Ainsi commence Babylon Babies, (Gallimard, coll. La Noire, 1999, puis Folio SF, 2001) le troisième roman de Maurice G. Dantec, formidable synthèse esthétique et – d'une certaine manière – philosophique de La Sirène rouge et des Racines du Mal. Conscience aiguë de la mort, lutte pour la survie, nomadisme : en une seule phrase, Dantec renoue avec la puissante dynamique de La Sirène rouge, et avec son personnage Hugo Cornelius Toorop, dont l’existence, nous le verrons (et en attendant Satellite Sisters en 2012), ne révèle son sens véritable qu’au terme de sa nouvelle cavale. Dantec élargit encore les frontières de sa cartographie sauvage. Le mal n’est plus circonscrit à un cercle d’initiés postmodernes. Les déviances biotechnologiques décrites dans Les Racines du Mal se sont étendues à l’échelle du globe, d’un monde que toute droiture et toute noblesse paraissent avoir déserté, à l’infernal profit des mafias, des sectes et des criminels.
Ainsi commence Babylon Babies, (Gallimard, coll. La Noire, 1999, puis Folio SF, 2001) le troisième roman de Maurice G. Dantec, formidable synthèse esthétique et – d'une certaine manière – philosophique de La Sirène rouge et des Racines du Mal. Conscience aiguë de la mort, lutte pour la survie, nomadisme : en une seule phrase, Dantec renoue avec la puissante dynamique de La Sirène rouge, et avec son personnage Hugo Cornelius Toorop, dont l’existence, nous le verrons (et en attendant Satellite Sisters en 2012), ne révèle son sens véritable qu’au terme de sa nouvelle cavale. Dantec élargit encore les frontières de sa cartographie sauvage. Le mal n’est plus circonscrit à un cercle d’initiés postmodernes. Les déviances biotechnologiques décrites dans Les Racines du Mal se sont étendues à l’échelle du globe, d’un monde que toute droiture et toute noblesse paraissent avoir déserté, à l’infernal profit des mafias, des sectes et des criminels.
Le récit débute en Asie centrale, où nous retrouvons Toorop vingt ans après les événements relatés dans La Sirène rouge, guerrier toujours alerte mais dont certaines blessures restent béantes, mercenaire fatigué – nous sommes en 2013 –, hanté par l’horreur de Grozny, aux prises avec le chaos mondial du XXIe siècle. La mort peut surgir de toutes parts. Plus rarement, mais d’autant plus remarquable, la beauté. « Ce qui importe, ce n’est même pas d’être le plus fort, mais le survivant », selon Bertolt Brecht (Dans la jungle des villes, cité dans La Sirène rouge). Précisément, Toorop est « le survivant de la 108e brigade bosniaque, où de nombreux volontaires occidentaux furent incorporés » (Le Théâtre des opérations. Journal métaphysique et polémique, 1999, Gallimard, 2000, p. 395). Il est le survivant de l’horreur, l’homme qui sait que cette humanité-là, celle à laquelle il appartient (et sa violence avec), a brûlé toutes ses cartouches depuis Auschwitz, Hiroshima et Nagasaki. Toorop, tueur implacable et monolithique dans La Sirène rouge, devient dans Babylon Babies le personnage le plus dense de l’œuvre dantécienne, parce qu’il concentre en lui le chaos du monde, ses contradictions, sa violence comme sa poésie, son intelligence comme sa folie, son nihilisme comme sa grâce. Parce qu’il est une neuromatrice trop humaine. Parce qu’il est Hugo Cornelius Toorop, nom trop singulier pour ne pas éveiller l’attention de l'onomasticateur.
HUGO. Du germanique « Hug », intelligence. Hugo, comme l’ouragan qui dévasta la Guadeloupe en 1989. Hugo, comme Victor, qui dans sa célèbre préface de Cromwell, s’en prenait violemment aux conventions classiques qui sclérosaient la littérature de son temps. Hugo, comme Gernsback, l’inventeur du terme « science-fiction », et comme le prestigieux prix de SF. Ou encore Hugo comme Pratt, créateur de Corto Maltese, l’aventurier anarchiste et romantique qui étudia la Torah, le Talmud, le Zohar et l’Arbre de Vie à l’âge de douze ans.
CORNELIUS. Archéologue de La Planète des singes de Pierre Boulle ; fantastique personnage de Gustave Le Rouge – Toorop est un tueur philosophe pop ; son deuxième prénom est sans doute le plus intéressant. Cornelius, donc, comme Jansenus, auteur de l’Agustinus, comme l’évêque de Rome entre 251 et 253 après J.-C., Cornelius comme Hoogworst, le torçonnier balzacien. Cornelius, comme l’incarnation de l’héroïsme (volonté, maîtrise de soi), ou encore d’un dilemme (survivre, pour précipiter la fin des temps – et donc sa fin propre) cornéliens…Cornelius, enfin et surtout, comme Jerry, ou Jeremiah, version postmoderne du Champion éternel de Michael Moorcock. Jerry Cornelius, assassin anglais, dandy psychédélique et messie destroy qui s’est aussi invité chez d’autres auteurs comme Brian Aldiss, Norman Spinrad (ami de Dantec) ou M. John Harrison (et même, paraît-il, dans un roman cyberpunk de Jonathan Littell, l’auteur des Bienveillantes), était/sera présent sur tous les fronts, dans toutes les guerres, au cœur de tous les massacres ; il n’y avait aucune raison pour que l’ex-Yougoslavie et les guérillas urbaines lui échappent. Comme Jeremiah, Hugo Cornelius Toorop est le témoin – et l’agent – privilégié de la chute de la civilisation. Jerry Cornelius endossait chez Moorcock de multiples identités : Jherek Carnelian (Danseurs de la fin des temps), Karl Glogauer (qui dans Voici l’homme devient le Christ) ou encore John Cornell. Toorop, alias Jonas Osterlinck, alias Zukor dans La Sirène rouge, rescapé des Colonnes Liberty Bell en ex-Yougoslavie, emprunte dans Babylon Babies les noms de Thorpe, Zhornik et… Cornell Zoorpe ! En reprenant le personnage moorcockien à son compte, Dantec fait plus que lui rendre hommage : d’une part il s’inscrit délibérément dans une littérature pop, psychédélique, rock and roll, ne reniant jamais les héritages du roman noir et de la SF ; d’autre part, en envoyant Jerry Cornelius (dont les initiales christiques n'échapperont à personne) dans le chaos mondialisé du XXIe siècle, il stigmatise secrètement notre époque.
TOOROP. Le trooper, le Tour op(erator), le moine-soldat, le voyageur organisé. Bien plus qu’un simple mercenaire hard boiled, Hugo Cornelius Toorop est celui par qui l’avenir de l’homme doit passer. Doté de facultés physiques et intellectuelles hors du commun, Toorop est avant tout une implacable machine de guerre. Tuer, brûler, éliminer. Détruire. Toorop est l’homme ultime – en-deçà du surhomme nietzschéen – et sa propre fin. Lorsque, enfin, il songe que la vie peut s’accomplir également dans la paix, il est évidemment trop tard.
2013, donc. Depuis Sarajevo et Srebrenica, le mal s’est répandu comme un virus. Guerres, mafias, luttes sans pitié pour le contrôle de l’eau – une denrée rare, par les temps qui courent. Sans oublier les cyclones…. La Chine est déchirée par une guerre civile. La Sibérie fait sécession. Nous retrouvons Toorop à la frontière sino-sibérienne. L’Art de la guerre de Sun Tzu dans son barda, avec les Carnets de voyage de Guevara, Les Sept piliers de la sagesse de T. E. Lawrence, La Guerre des Gaules de Jules César, et, bien entendu, Le Gai savoir de Nietzsche, livre de chevet de Maurice G. Dantec. Mercenaire sans gloire après une défaite cuisante. Forcé de remplir un contrat pour le compte d’un colonel mafieux des services de renseignements de l’armée russe, Romanenko. La mission, apparemment simple : convoyer une jeune femme, Marie Zorn, de l’Asie centrale à Montréal (le Québec est devenu indépendant), et patienter avec un commando dont les membres lui sont imposés. Toorop flaire le coup fourré quand Romanenko le charge d’enquêter sur la jeune femme. Qui est donc le vrai commanditaire ? Toorop découvre que Marie Zorn est schizophrène. Et enceinte. Et cobaye d’expériences interdites, dirigées par l’un des scientifiques responsables du clonage de la célèbre brebis, Dolly. Pourquoi sectes, mafias et militaires s’intéressent-ils tant à la jeune femme ? Transporterait-elle un virus ?... Des animaux mutants ?... Aux factions en présence, viennent s’ajouter une secte post-millénariste dirigée par une cinglée, des gangs de bikers à la solde de sectes rivales, les chamans et autres rastas de la Cyborg-Nation, des robots homosexuels, un écrivain de science-fiction visionnaire nommé Boris Dantzik, et, surtout, l’intelligence artificielle Joe/Jane, ainsi que son concepteur Darquandier, génie rescapé des Racines du Mal. C’est rien de moins que l’avenir de l’humanité qui se joue quand Marie Zorn la schizophrène et Joe/Jane la schizomachine entrent en contact via le cerveau de Toorop, qui surfe alors, avec elles, sur le Serpent Cosmique, le réseau d’ADN universel. Marie Zorn, porte grande ouverte sur la mémoire génétique du monde, meurt en donnant naissance à deux jumelles. Mutantes. Radicalement, définitivement post-humaines...
Mieux encore que Les Racines du Mal, Babylon Babies brasse l’ensemble des domaines de la connaissance, pour en faire jaillir quelque chose de neuf, foutraque et beau : la réponse de Dantec à la déroute de la civilisation. Il fallait un certain cran, tout de même, pour faire ainsi coïncider, et de fort belle manière, schizophrénie et cybernétique, ou, dans le sillage de Jeremy Narby, les dernières découvertes génétiques et les hallucinations des chamans, dont la forme évoquerait étrangement la double hélice de l’ADN. Pour aller vite, disons que ceux-ci sauraient depuis des temps immémoriaux, au moyen de drogues spéciales, se connecter directement à l’Arbre de la connaissance, c'est-à-dire au réseau génétique du monde. Dantec cherche les signes, et les confronte, et les consigne, comme le font, sur un tout autre mode, en un sens beaucoup plus hermétique – et, soyons justes, avec une autre classe –, les grands écrivains postmodernes, Nabokov, DeLillo ou Pynchon. Le XXIe siècle est un inextricable nœud de nihilismes en tous genres (« individualisme hyperconsumériste, massmédiatisation générale, désagrégations nationales, tribales, et maffieuses, sectarisme néoreligieux, positivisme eugéniste, traçage biotechnologique des individus, anarchisme cybernétique, post-humanité cyborg, percée quasi accidentelle d’une science émergente (rencontre de Dantzig et de Darquandier), et production cataclysmique d’une nouvelle branche évolutionniste d’Homo […] » écrit-il dans son laboratoire de catastrophe générale (Le théâtre des opérations. Journal métaphysique et polémique, 2000-2001, Gallimard, 2001, pp. 309-310) mais pour l’écrivain, tout fait sens. « Est-ce que l’homme contrôle son développement dans le monde et dans l’histoire ? J’en doute. Les idéologies, quelles qu’elles soient, qui ont pensé qu’on pouvait avoir un contrôle absolu ou même relatif sur le développement me semblent problématiques. C’est plus chaotique que ça. Le problème est de savoir contre quoi on résiste. J’ai tendance à penser que la résistance est une forme de retournement des valeurs. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle du romancier de résister à l’économie générale du monde. Son rôle est d’embrasser tout ça, d’en faire une matière romanesque. Ensuite, c’est aux acteurs sociaux, impliqués dans la société de voir contre quoi et comment on peut résister. Dans le roman, effectivement, tout semble ravagé par un flot » (Dantec dans L’Humanité, 13 avril 1999).
Il semblerait bien, après Les Racines du Mal, que pour Dantec, en une relecture spéculative de L'Anti-Oedipe de Deleuze, Guattari et leurs machines désirantes, les schizophrènes soient le vecteur privilégié de la nouvelle humanité. En effet leur cerveau serait « directement précâblé pour pouvoir se connecter à une intelligence artificielle » (BB, op. cit., p. 558). « C’est presque le sujet principal du livre, écrit-il encore dans l’entretien déjà cité, essayer de décrypter les comportements déviants par rapport à nos normes sociales que sont les prétendus grands malades mentaux. […] On ne sait pas à quoi servent ces cerveaux qui ne fonctionnent pas dans notre économie mais qui pourraient avoir un rôle à jouer dans une économie future. Est-ce que les schizophrènes sont des malades mentaux ou des productions de la nature pour le futur humain ? ». Philip K. Dick s’était lui aussi penché sur la question dans plusieurs romans, comme Glissement de temps sur Mars et, surtout, Les Clans de la lune Alphane où les malades, dotés de pouvoirs psys, étaient exilés sur un satellite isolé, divisés en clans (les hébéphrènes, les schizos, les maniaco-dépressifs, etc.) dont la vision du monde, si elle différait radicalement de celles des hommes prétendument sains, n’en était pas moins réelle. Les spécialistes estiment que 1% environ de la population mondiale a déjà souffert, ou souffrira, de schizophrénie. Plusieurs millions, donc. Quel est le sens d'un tel chiffre ? « Nous pensons que la mutation schizophrénique n’est qu’une étape transitoire […]. Une étape nécessaire, mais une étape, le schizophrène, pont entre l’homme et le surhomme » (BB, p. 314). Dans l’imaginaire dantécien donc, le schizo serait le fruit déhiscent d’un accident évolutionniste, mutation anthropique aux conséquences imprévisibles ; autrement dit, un fait néoténique, anomalie a priori inutile à la survie de l’espèce, mais qui, un jour, pourrait être justifiée du point de vue même de l’évolution. Mais pourquoi le schizo ? Vers quel Surhomme formerait-il un « pont » ? Ce sont les chamans, et Jeremy Narby, qui ont mis Dantec sur la voie. L'altération de la conscience par l’absorption de certaines drogues, comme celles utilisées par les chamans, n’est pas sans rappeler le fonctionnement mental du schizophrène délirant : ils déchirent, un temps, le voile qui les sépare du monde, en un sens, ils deviennent le monde. Le schizo est un pont parce qu'il lutte contre ses propres organes – comme la vie elle-même, par ses accidents évolutionnistes, essaie de renaître sous une nouvelle forme.
Nous l'avons vu, dans les romans de Dantec, le monde humain file sur l'autoroute de l'enfer, tout droit vers son extinction. Et de cette fosse de Babel évoquée par Kafka et Abellio, et que nous creusons en toute hâte, pourrait s’ériger, sans crier gare, l'enfant du chaos déterministe, notre Successeur post-humain. Le seul post-humain acceptable, du point de vue de Dantec, est précisément celui-là, surgi du chaos, « accident » évolutionniste issu de mutations génétiques et d’interventions humaines, mais dont le résultat n’est pas – jamais – celui escompté. Tout autre post-humain, pour Dantec, n’est pas un surhomme (l’éclair du sombre nuage homme chez Zarathoustra) mais un sursinge, un « animal doué de raison » (American Black Box. Le Théâtre des opérations, 2002-2006, Albin Michel, p. 109), « un chimpanzé jouant avec une machine à écrire » (Ibid.). Et ce Surhomme ne fait sens que par l'ouverture indéterminée aux possibles. Or ce Successeur, cette nouvelle forme de conscience, cette nouvelle humanité, sont annoncées, dans Babylon Babies, par Marie Zorn et la schizomachine Joe/Jane (conçue selon les principes chaotiques) : « Son cerveau-cosmos savait tout des mystères de l’univers car il en épousait les contours, se perdait dans ses infinitudes, dans le moindre de ses replis. » (BB, p. 363). Dès lors les jumelles Zorn, rejetons mutants de Marie, sont bien les « Babylon babies » (Marie Zorn – colère en allemand –, dont le nom de code est Marie Alpha, est une polyglotte spontanée…), les bébés de l’humanité décadente, les Enfants de Putain, les premiers post-humains, les homo sapiens neuromatrix, nées du Corps sans Organe de Marie/Joe/Jane. L’humanité agonise, mais son Successeur, qu’on imagine (ou qu'on espère) incapable de vendre son âme au diable – un CsO évolue au-delà du bien et du mal –, vient au monde. D’un point de vue purement évolutionniste, il ne s’agit que de la création d’une nouvelle « clade », d’un nouveau rameau dont les membres abandonneront l’humanité obsolète (lire Schismatrice+ de Bruce Sterling) « comme le squame d’une mue depuis trop longtemps attendue, espérée » (BB, p. 488).
L’épilogue-Genèse, qui marque l’avènement de Sara et Ieva Zorn, ces nouvelles Èves, ouvre une fenêtre vers l’avenir. Pour la première et, jusqu'à preuve du contraire, pour la dernière fois (à moins que les Satellite Sisters ?...), Dantec résiste au présent et à son horizon nucléaire ; il fait même preuve d’un certain optimisme, ou plutôt (considérant que l'optimisme est trop lié au progressisme) à une certaine joie,non pour l’humanité, d’ores et déjà condamnée, mais pour son enfant naturel. Babylon Babies est le roman de Dantec où s’exprime pour la dernière fois le fol espoir qu’à l’autodestruction de l’humanité survivra son descendant, ici incarné par les jumelles Zorn. « Comme j’espère l’avoir esquissé avec justesse dans Babylon Babies, c’est de cette dégradation terminale, de ce degré de désintégration ultime atteint par le schizoprocessus de la civilisation marchande qu’un accident synthétique et proprement cataclysmique, une métamorphose, un métaprocessus “miraculant” pourra surgir pour venir briser le cycle de l’hyperstase marchande, et qu’à nouveau le Temps cosmobiologique reprendra son cours, selon des processus nouveaux qu’il s’agit précisément de décrypter si nous voulons avoir la chance d’un jour les actualiser au cœur même du métacontrôle opératif. » (Laboratoire de catastrophe générale, op. cit., pp. 202-203).
On comprend que Dantec, désormais catholique, ne se satisfasse plus de cette idée pourtant belle (s’il y revient à la fin d’American Black Box, c’est pour en énoncer l’inanité hors d’un projet spirituel, philosophique, élevé…). Dès Villa Vortex, Dantec refuse de n’être que le témoin extatique du chaos global : il choisira de lui résister, d'opposer la transcendance divine au nihilisme. Le Chaos créateur devient Chute, expulsion du jardin d'Eden. Après Babylon Babies, l’œuvre de Dantec semble se resserrer, se contracter sur elle-même, concentrant ses intrigues sur des territoires de plus en plus précis, fixes, étroits : Paris et sa « conurbation » dans Villa Vortex, le Cosmodrome et Grande Jonction dans les deux romans suivants. Cette contraction s’accomplit alors que Dantec se rapproche du catholicisme, non sans frayer avec le gnosticisme, glissant d’une vision alternative du monde à l’idée de révélation. Au nomadisme, au déplacement spatial de ses personnages, principe logique de construction du récit depuis La Sirène rouge, se substitue l’intériorité, que Dantec assimile un peu vite, dans son Laboratoire de catastrophe générale, au Temps et à la Conscience. S’il conserve intacte dans Cosmos Incorporated et Grande Jonction sa capacité unique à traduire la tendance générale de notre civilisation à s’hyperstasier, à s’enfoncer inéluctablement dans le totalitarisme soft de la machine relativiste, le remplacement progressif des préoccupations et sources d’inspiration scientifiques par d’autres, théologiques, modifie radicalement le rapport de sa littérature au monde. Parce qu’à la dynamique spéculative, au doute (qu’il opposait jadis à l’idiotie de la foi : « Ces pauvres idiots qui pensent que croire en Dieu est encore une manière pertinente de L’honorer, alors qu’on se rapproche bien plus de Sa lumière en osant douter de Lui. », Le Théâtre des opérations, op. cit., p. 46), au Chaos, se sont substitués la Vérité, Dieu, l’Apocalypse. Est-ce regrettable ? Certes non. Mais simplement, dès lors que, dans une perspective gnostique, « le monde désincarné de la Technique », « la Technique-Monde » n’est qu’une copie de la Création, un simulacre, une contre-création diabolique, alors le passage du réel dans la boîte noire, aussi américaine soit-elle, n’est plus vraiment opérant.
Dans Les Racines du Mal, des IA s’envolaient vers la lune. Des IA, c’est-à-dire des consciences totalement inhumaines. Dans Babylon Babies, ce sont des clones mutants, des post-humains, les jumelles Zorn, qui s’en vont essaimer le système solaire, puis au-delà. Dans Grande Jonction, chassés par l’Antéchrist, ce sont les derniers hommes qui quittent la planète Terre. L’idée de post-humain semble peu à peu se confondre avec le Christ ; dès lors, son avènement ne peut coïncider qu’avec le parachèvement du Corps mystique. Les enfants de Babylone sont mort-nés. Ressusciteront-elles dans Satellite Sisters ?



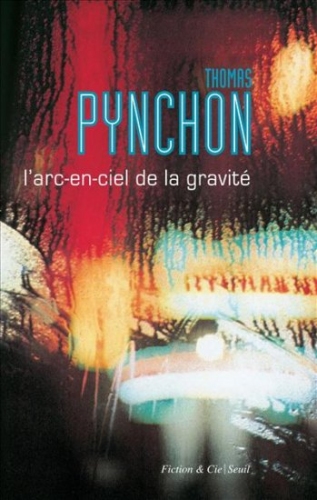

 Dans La Sirène rouge (Gallimard, coll. Série Noire, 1993), Hugo Cornelius Toorop traversait l’Europe en compagnie de la petite Alice, pourchassée par les troupes de sa furie de mère, tête pensante d’un réseau de snuff movies particulièrement atroces. Objectif : gagner le Portugal, dernière destination connue du père d’Alice. Malgré ses énormes ficelles, son récit cousu de fil blanc, ses dialogues parfois empesés et ses brouettes entières de clichés du genre, La Sirène rouge laissait pourtant de profondes traces dans son sillage. La construction, le rythme, le style, y étaient déjà d’une grande efficacité. Et même si Dantec n’y avait pas encore développé ses idées spéculatives, ce premier roman témoignait d’une intéressante tentative de rendre compte du chaos occidental de cette fin de siècle. Toorop envisageait d’ailleurs d’écrire le roman de sa lutte contre le mal mondialisé –
Dans La Sirène rouge (Gallimard, coll. Série Noire, 1993), Hugo Cornelius Toorop traversait l’Europe en compagnie de la petite Alice, pourchassée par les troupes de sa furie de mère, tête pensante d’un réseau de snuff movies particulièrement atroces. Objectif : gagner le Portugal, dernière destination connue du père d’Alice. Malgré ses énormes ficelles, son récit cousu de fil blanc, ses dialogues parfois empesés et ses brouettes entières de clichés du genre, La Sirène rouge laissait pourtant de profondes traces dans son sillage. La construction, le rythme, le style, y étaient déjà d’une grande efficacité. Et même si Dantec n’y avait pas encore développé ses idées spéculatives, ce premier roman témoignait d’une intéressante tentative de rendre compte du chaos occidental de cette fin de siècle. Toorop envisageait d’ailleurs d’écrire le roman de sa lutte contre le mal mondialisé – 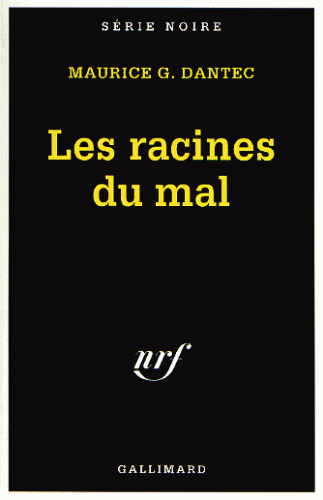 Les Racines du Mal (Gallimard, coll. Série Noire, 1995), deuxième roman de Maurice G. Dantec,nous plonge d’emblée dans le cerveau dérangé d'Andreas Schaltzmann, schizophrène franco-allemand persuadé que le monde est manipulé par les aliens nazis de Vega. « Andreas Schaltzmann avait commencé à tuer parce que son estomac pourrissait » (p. 15). Le délire de Schaltzmann, dopée aux accélérateurs neuroniques, le pousse à commettre une série de meurtres particulièrement sanglants au cours d’une cavale suicidaire en banlieue parisienne. Cette première partie, vraiment éprouvante, emprunte autant à Philip K. Dick qu’à Bret Easton Ellis et James Ellroy, pour livrer un tableau apocalyptique de la France moderne. Puis le récit bascule. Arthur Darquandier, dit « Dark », un jeune scientifique, a mis au point avec son collègue Stefan Gombrowicz la « neuromatrice », un logiciel « neurocognitif », c’est-à-dire une intelligence artificielle expérimentale dotée d’un « noyau de chaos actif », et conçue comme un cerveau humain, connectée en permanence aux réseaux d’information. Darquandier, de retour en France, est confronté à l’invraisemblable jeu criminel – car il s’agit bien d’un jeu, avec règles, contraintes et comptage de points – auquel se livrent de mystérieux tueurs. Avec l’aide de la neuromatrice, capable de simuler le fonctionnement mental des serial killers (à commencer par Schatzmann) – c’est la « schizoanalyse », fondée sur les travaux de Mandelbraut et de Prigogine, et qui renvoie directement à Deleuze et Guattari –, Darquandier remonte peu à peu aux racines de l’Arbre de Mort, jusqu’à ce réseau de tueurs millénaristes. Avec Les Racines du Mal, Dantec s’imposait comme l’un des rares écrivains français à embrasser l’époque dans son ensemble, comme si Dantec lui-même se comportait comme une neuromatrice biologique, accumulant les informations, dressant des listes (comme Romanenko dans Babylon Babies), et, tel un personnage de William Gibson, cherchant de nouvelles connexions, des points nodaux inattendus mais possibles. Cette méthode culminera dans son livre suivant.
Les Racines du Mal (Gallimard, coll. Série Noire, 1995), deuxième roman de Maurice G. Dantec,nous plonge d’emblée dans le cerveau dérangé d'Andreas Schaltzmann, schizophrène franco-allemand persuadé que le monde est manipulé par les aliens nazis de Vega. « Andreas Schaltzmann avait commencé à tuer parce que son estomac pourrissait » (p. 15). Le délire de Schaltzmann, dopée aux accélérateurs neuroniques, le pousse à commettre une série de meurtres particulièrement sanglants au cours d’une cavale suicidaire en banlieue parisienne. Cette première partie, vraiment éprouvante, emprunte autant à Philip K. Dick qu’à Bret Easton Ellis et James Ellroy, pour livrer un tableau apocalyptique de la France moderne. Puis le récit bascule. Arthur Darquandier, dit « Dark », un jeune scientifique, a mis au point avec son collègue Stefan Gombrowicz la « neuromatrice », un logiciel « neurocognitif », c’est-à-dire une intelligence artificielle expérimentale dotée d’un « noyau de chaos actif », et conçue comme un cerveau humain, connectée en permanence aux réseaux d’information. Darquandier, de retour en France, est confronté à l’invraisemblable jeu criminel – car il s’agit bien d’un jeu, avec règles, contraintes et comptage de points – auquel se livrent de mystérieux tueurs. Avec l’aide de la neuromatrice, capable de simuler le fonctionnement mental des serial killers (à commencer par Schatzmann) – c’est la « schizoanalyse », fondée sur les travaux de Mandelbraut et de Prigogine, et qui renvoie directement à Deleuze et Guattari –, Darquandier remonte peu à peu aux racines de l’Arbre de Mort, jusqu’à ce réseau de tueurs millénaristes. Avec Les Racines du Mal, Dantec s’imposait comme l’un des rares écrivains français à embrasser l’époque dans son ensemble, comme si Dantec lui-même se comportait comme une neuromatrice biologique, accumulant les informations, dressant des listes (comme Romanenko dans Babylon Babies), et, tel un personnage de William Gibson, cherchant de nouvelles connexions, des points nodaux inattendus mais possibles. Cette méthode culminera dans son livre suivant. Ainsi commence Babylon Babies, (Gallimard, coll. La Noire, 1999, puis Folio SF, 2001) le troisième roman de Maurice G. Dantec, formidable synthèse esthétique et – d'une certaine manière – philosophique de La Sirène rouge et des Racines du Mal. Conscience aiguë de la mort, lutte pour la survie, nomadisme : en une seule phrase, Dantec renoue avec la puissante dynamique de La Sirène rouge, et avec son personnage Hugo Cornelius Toorop, dont l’existence, nous le verrons (et en attendant Satellite Sisters en 2012), ne révèle son sens véritable qu’au terme de sa nouvelle cavale. Dantec élargit encore les frontières de sa cartographie sauvage. Le mal n’est plus circonscrit à un cercle d’initiés postmodernes. Les déviances biotechnologiques décrites dans Les Racines du Mal se sont étendues à l’échelle du globe, d’un monde que toute droiture et toute noblesse paraissent avoir déserté, à l’infernal profit des mafias, des sectes et des criminels.
Ainsi commence Babylon Babies, (Gallimard, coll. La Noire, 1999, puis Folio SF, 2001) le troisième roman de Maurice G. Dantec, formidable synthèse esthétique et – d'une certaine manière – philosophique de La Sirène rouge et des Racines du Mal. Conscience aiguë de la mort, lutte pour la survie, nomadisme : en une seule phrase, Dantec renoue avec la puissante dynamique de La Sirène rouge, et avec son personnage Hugo Cornelius Toorop, dont l’existence, nous le verrons (et en attendant Satellite Sisters en 2012), ne révèle son sens véritable qu’au terme de sa nouvelle cavale. Dantec élargit encore les frontières de sa cartographie sauvage. Le mal n’est plus circonscrit à un cercle d’initiés postmodernes. Les déviances biotechnologiques décrites dans Les Racines du Mal se sont étendues à l’échelle du globe, d’un monde que toute droiture et toute noblesse paraissent avoir déserté, à l’infernal profit des mafias, des sectes et des criminels.
