Julien Offroy de la Mettrie, L’homme-machine
 L’exemple le plus frappant de la désinvolture guillebaudienne reste celui de l’origine de la conscience. L’hypothèse matérialiste, selon Jean-Claude, serait une négation de l’esprit, de la raison, de l’intention… Cette critique est infondée : nous postulons seulement que le monde des idées, dont nul en effet n’est en mesure de nier l’existence, serait exclusivement celui des phénomènes engendrés par des processus théoriquement modélisables, et donc théoriquement reproductibles. Définir l’humain comme un être dont la pensée, l’intelligence, le libre-arbitre, sont des propriétés induites par ces processus quantiques, génétiques, biologiques, sociaux, n’est pas le réduire à ses mécanismes, mais au contraire l’exalter. Même à supposer que notre univers n’ait d’autre existence que virtuelle, nous n’aurions pas moins de mérite pour nous être élevés au-dessus de notre condition de simulacre. Nous savons même depuis plusieurs décennies que le Principe d’incertitude d’Heisenberg qui s’applique à la mécanique quantique s’oppose à une vision déterministe de l’univers : puisque nous sommes incapables de connaître l’état absolu du monde à un moment précis, comment pourrions-nous en effet prédire exactement l’avenir ? D’autant que la conscience, nous le savons, est un espace d’indétermination par défaut où les éléments déterminants sont tellement nombreux – infiniment nombreux – et leurs relations tellement complexes, que les productions de l’esprit échappent à toute tentative de détermination. Ce qui fait la valeur de l’humanité ne tient donc pas à sa nature mais aux productions « anaturelles » de l’esprit. « Chose incroyable, [résume Guillebaud dans l’article du Monde diplomatique déjà cité] ces nouvelles mises en cause de l’humanisme [c’est-à-dire, comme nous le verrons plus loin, les mises en cause des spécificités de l’homme telles qu’elles étaient admises avant que la science ne s’en mêle] ne sont pas exprimées, comme jadis, par des dictateurs barbares ou des despotes illuminés, elles sont articulées par la technoscience elle-même en ses nouveaux états. […] Mettre l’homme en question pour mieux le guérir... De la biologie aux neurosciences, de la génétique aux recherches cognitives, tout un pan de l’intelligence contemporaine travaille ainsi à ébranler les certitudes auxquelles nous sommes encore agrippés. » Ce à quoi Jean-Claude Guillebaud est encore « agrippé », ce ne sont pas tant des « certitudes », en vérité, que des illusions consolatrices. Il tente ainsi de travestir une légitime interrogation scientifique – qu’est-ce qui définit l’homme ? – en une idéologie suspecte, alors que lui-même prétend imposer ce qui demeure jusqu’à preuve du contraire une croyance, contre l’objectivité scientifique. Ce qui est en jeu n’est donc pas tant l’homme – ce « sursinge » qui dans l’esprit de Guillebaud continue d’assurer le rôle de « berger de l’Être » que lui assigna Heidegger – que sa spécificité, ou plutôt les processus par lesquels se manifeste cette spécificité – car en définitive, peu importe que le monde, et, partant, la conscience, aient été créés ou non par un Dieu, un Superordinateur ou le cerveau humain : l’essentiel réside plutôt dans la connaissance des systèmes qui président à l’émergence de la conscience que nous avons de cet univers. Or selon Guillebaud la conscience serait inimitable, elle définirait ce principe d’humanité, ce dont je déduis qu’il n’a pas lu Alan Turing (ni même ses commentateurs comme Jean Lassègue) qui avait réfuté de manière fort convaincante, avant même le développement effectif des ordinateurs, les objections mathématique, métaphysique et ontologique à la capacité théorique d’une machine de penser. Cette querelle est au cœur du problème. Car selon que le monde des idées est considéré dans le monde ou hors du monde, notre appréhension des sciences et des techniques prend des directions très différentes. La conscience, selon Guillebaud, serait distincte des processus cérébraux ; le cerveau ne saurait être assimilé à un processeur – une « machine-esprit » qui aurait besoin du corps non seulement pour fonctionner, mais encore pour fonctionner pleinement –, mais à un véritable réceptacle de l’âme. Nous pouvons assurément prédire, à l’instar des scientifiques vilipendés par Guillebaud, (Alan Turing, Hugo de Garis, Hans Moravec…), que l’homme sera capable, dans un futur relativement proche, de reproduire les processus d’émergence de la conscience. Il suffit pour s’en convaincre de comparer la puissance des ordinateurs actuels les plus performants à celle des premières machines, nées au milieu du vingtième siècle, autant dire hier [21] …
L’exemple le plus frappant de la désinvolture guillebaudienne reste celui de l’origine de la conscience. L’hypothèse matérialiste, selon Jean-Claude, serait une négation de l’esprit, de la raison, de l’intention… Cette critique est infondée : nous postulons seulement que le monde des idées, dont nul en effet n’est en mesure de nier l’existence, serait exclusivement celui des phénomènes engendrés par des processus théoriquement modélisables, et donc théoriquement reproductibles. Définir l’humain comme un être dont la pensée, l’intelligence, le libre-arbitre, sont des propriétés induites par ces processus quantiques, génétiques, biologiques, sociaux, n’est pas le réduire à ses mécanismes, mais au contraire l’exalter. Même à supposer que notre univers n’ait d’autre existence que virtuelle, nous n’aurions pas moins de mérite pour nous être élevés au-dessus de notre condition de simulacre. Nous savons même depuis plusieurs décennies que le Principe d’incertitude d’Heisenberg qui s’applique à la mécanique quantique s’oppose à une vision déterministe de l’univers : puisque nous sommes incapables de connaître l’état absolu du monde à un moment précis, comment pourrions-nous en effet prédire exactement l’avenir ? D’autant que la conscience, nous le savons, est un espace d’indétermination par défaut où les éléments déterminants sont tellement nombreux – infiniment nombreux – et leurs relations tellement complexes, que les productions de l’esprit échappent à toute tentative de détermination. Ce qui fait la valeur de l’humanité ne tient donc pas à sa nature mais aux productions « anaturelles » de l’esprit. « Chose incroyable, [résume Guillebaud dans l’article du Monde diplomatique déjà cité] ces nouvelles mises en cause de l’humanisme [c’est-à-dire, comme nous le verrons plus loin, les mises en cause des spécificités de l’homme telles qu’elles étaient admises avant que la science ne s’en mêle] ne sont pas exprimées, comme jadis, par des dictateurs barbares ou des despotes illuminés, elles sont articulées par la technoscience elle-même en ses nouveaux états. […] Mettre l’homme en question pour mieux le guérir... De la biologie aux neurosciences, de la génétique aux recherches cognitives, tout un pan de l’intelligence contemporaine travaille ainsi à ébranler les certitudes auxquelles nous sommes encore agrippés. » Ce à quoi Jean-Claude Guillebaud est encore « agrippé », ce ne sont pas tant des « certitudes », en vérité, que des illusions consolatrices. Il tente ainsi de travestir une légitime interrogation scientifique – qu’est-ce qui définit l’homme ? – en une idéologie suspecte, alors que lui-même prétend imposer ce qui demeure jusqu’à preuve du contraire une croyance, contre l’objectivité scientifique. Ce qui est en jeu n’est donc pas tant l’homme – ce « sursinge » qui dans l’esprit de Guillebaud continue d’assurer le rôle de « berger de l’Être » que lui assigna Heidegger – que sa spécificité, ou plutôt les processus par lesquels se manifeste cette spécificité – car en définitive, peu importe que le monde, et, partant, la conscience, aient été créés ou non par un Dieu, un Superordinateur ou le cerveau humain : l’essentiel réside plutôt dans la connaissance des systèmes qui président à l’émergence de la conscience que nous avons de cet univers. Or selon Guillebaud la conscience serait inimitable, elle définirait ce principe d’humanité, ce dont je déduis qu’il n’a pas lu Alan Turing (ni même ses commentateurs comme Jean Lassègue) qui avait réfuté de manière fort convaincante, avant même le développement effectif des ordinateurs, les objections mathématique, métaphysique et ontologique à la capacité théorique d’une machine de penser. Cette querelle est au cœur du problème. Car selon que le monde des idées est considéré dans le monde ou hors du monde, notre appréhension des sciences et des techniques prend des directions très différentes. La conscience, selon Guillebaud, serait distincte des processus cérébraux ; le cerveau ne saurait être assimilé à un processeur – une « machine-esprit » qui aurait besoin du corps non seulement pour fonctionner, mais encore pour fonctionner pleinement –, mais à un véritable réceptacle de l’âme. Nous pouvons assurément prédire, à l’instar des scientifiques vilipendés par Guillebaud, (Alan Turing, Hugo de Garis, Hans Moravec…), que l’homme sera capable, dans un futur relativement proche, de reproduire les processus d’émergence de la conscience. Il suffit pour s’en convaincre de comparer la puissance des ordinateurs actuels les plus performants à celle des premières machines, nées au milieu du vingtième siècle, autant dire hier [21] …Le philosophe Thomas Hobbes, sans doute l’un des édificateurs de notre approche matérialiste de la conscience, écrivait que « […] nous pouvons définir (c'est-à-dire déterminer) ce qui est signifié par ce mot de raison quand nous mettons celle-ci au nombre des facultés de l'esprit. Car la RAISON, en ce sens, n'est rien que le calcul (autrement dit l’addition et la soustraction) des conséquences des noms généraux acceptés pour consigner et signifier nos pensées. Je dis consigner, quand nous élaborons nos pensées pour nous-mêmes, et signifier quand nous en faisons la démonstration ou la preuve pour les autres. » [22] . Et, plus loin : « On voit que la raison n’est pas née avec nous, comme la sensation ou la mémoire » [23] . On voit aussi que les scientifiques actuels, qu’ils soient cognitivistes ou généticiens, ont quelque peu nuancé cette radicale hypothèse mécaniste. Mais il reste que la raison, la conscience s’acquièrent par combinaison, par complexification de la matière en réseaux, par échanges d’informations. Plus qu’un calcul, pas moins qu’un système.
En d’autres termes Guillebaud, sans doute malgré lui – ne doutons pas de son incapacité cognitive à manipuler des concepts dont Dieu est irrémédiablement exclu – proclame la fin de l’homme en tant que machine évolutive : en réclamant comme Habermas le retour du projet Moderne (dont Lyotard écrivait qu’il « n’a pas été abandonné, oublié, mais détruit, liquidé » [24] ) il entérine la pétrification d’une espèce en perpétuelle mutation, jamais achevée, toujours à la poursuite de son successeur. Il ne cesse de vaticiner, de prophétiser la « chosification » de l’homme, quand lui-même œuvre ouvertement à sa réification spirituelle, à sa crucifixion sur l’autel de la déraison et des peurs millénaristes. Jean-Claude Guillebaud peut bien s’égosiller, asséner ses prédications, vernir sa morale de gentil humaniste d’une couche aussi mince que bon marché d’érudition : si l’on veut bien accorder quelque importance aux travaux de Richard Dawkins, qui montrent que « la véritable fonction d'utilité de la vie, ce vers quoi tout tend dans la Nature, c'est la survie de l'ADN » [25] et à la mémétique, c’est-à-dire la propagation sociale d’unités d’informations réplicatives et mutantes (les mèmes) transmises par imitation au cerveau humain, alors les arguments métaphysiques de notre chantre de la confiance en l’avenir ne tiennent plus. Selon la mémétique – que l’on pourrait, non sans précaution, assimiler à l’équivalent de la génétique appliqué au champ des idées [26] – la « révolution » sociale et technologique tant redoutée par notre mauvais prédicateur favorise la réplication automatique de ses propres mèmes, un peu à la façon du robot de Von Neumann. Elle serait, en d’autres termes, non pas inéluctable mais implacable – je veux dire par là qu’elle obéit à une logique mathématique, donc irréfutable, mais de même que nous sommes déjà capables de manipuler les gènes, nous pouvons d’autant plus agir sur les mèmes que ceux-ci sont nos propres créations. Je n’entrevois notre devenir qu’inorganique, mais nos cerveaux, partiellement libérés du joug des gènes et des mèmes, auront évidemment leur mot à dire.
Tandis que certains, trop en avance sur leur temps, se penchent déjà sur le statut juridique des « copies » numériques des individus, Guillebaud – pour qui ces copies n’auraient sans doute aucune valeur – demande quant à lui que les religions soient plus écoutées et s’indigne contre la « haine du religieux » [27] . Ce benêt, taraudé par des questions d’un autre âge, s’interroge (je reformule) : comment tous ces scientistes incroyants expliquent-ils l’apparition « d’un coup d’un seul », chez l’embryon, de la conscience ? Si la cervelle de notre humaniste n’avait pas quitté son siège naturel pour échapper à sa mort future, celui-ci aurait au moins compris que du point de vues scientifique la conscience n’apparaît pas mais se forme progressivement à mesure que la matière s’organise selon un programme génétique bien précis ; elle émerge alors que s’établissent les liaisons synaptiques, et que le cerveau et le reste du corps sont confrontés au monde extérieur. L’esprit n’est pas machine, mais la machine peut se faire esprit. L’important est de comprendre que l’organique n’a pas le monopole de la vie. Stephen Hawking va d’ailleurs jusqu’à considérer les virus informatiques comme de véritables organismes vivants.
Fidèle à sa méprisable méthode, Guillebaud rend concomitantes l’idée d’une origine « machinique » de la conscience d’une part, et la hiérarchisation des hommes telle que suggérée selon lui par Julien Offroy de La Mettrie, l’auteur pourtant essentiel de L’Histoire naturelle de l’âme (1745) et de L’Homme-machine (1748). La Mettrie, philosophe raillé de ses pairs (sauf de Diderot et de quelques autres) et persécuté par le pouvoir, a pourtant constamment recadré ses écrits dans une perspective humaniste – et, hélas pour lui, athée. Nous avons vu plus haut cependant avec la notion d’imago que c’est justement cette exploration poussée des spécificités humaines – dont ce que nous nommons la conscience, autrefois appelée « âme », n’est que la plus haute manifestation – qui devrait permettre, en théorie, d’établir une fois pour toute la qualité d’être humain. Je crois ainsi, comme le baron d’Holbach, que « la morale et la politique pourraient retirer du matérialisme des avantages, que le dogme de la spiritualité ne leur fournira jamais, et auxquels il les empêche même de songer. » [28] . Il faut bien comprendre que si La Mettrie accordait une « âme » aux animaux – et même, en un sens, aux végétaux [29] –, c’est uniquement dans ce sens que ceux-ci sont faits de la même matière que nous puisque « il n’y a dans tout l’Univers qu’une seule substance diversement modifiée. » [30] C’est aussi ce qu’écrit Joël de Rosnay dans L’Homme symbiotique : « L’univers apparaît ainsi comme une conscience qui se crée en prenant conscience d’elle-même. L’énergie et l’esprit sont deux faces d’une même réalité, et la frontière qui les sépare n’est autre que le temps. » [31] . Pour de Rosnay, l’humanité et sa technique s’organiseraient peu à peu – mais de plus en plus rapidement, d’où cette mention de décalage temporel – en cybionte, macro-organisme planétaire dont l’individu – forcément déshumanisé – serait une cellule – « ni plus, ni moins » [32] ne peut s’empêcher d’ajouter Guillebaud en toute malhonnêteté : de Rosnay précise bien dans son ouvrage que le cybionte n’est qu’une métaphore « rétroprospective », c’est-à-dire qu’en « imaginant – ou mieux, en visualisant – les relations symbiotiques entre l’homme et le cybionte, il devient possible de choisir telle voie, telle structure, telle étape intermédiaire. » [33]
C’est que Jean-Claude Guillebaud, à force de chercher un principe supérieur à des phénomènes systémiques, finit par idéologiser – ou spiritualiser, selon les cas – toute démarche scientifique ou philosophique. Prenons l’exemple de Karl Popper, qu’il invoque à plusieurs reprises comme s’il avait besoin d’un démon protecteur – Popper était ouvertement matérialiste. Dans La Connaissance objective[34], Popper a entre autres imaginé que l’univers serait constitué non seulement du « monde physique » (le Monde 1), mais aussi d’un deuxième monde (le « monde mental », celui des sensations, des « états mentaux ») et d’un troisième (le monde des « intelligibles », celui du contenu objectif des pensées, le monde des théories). Guillebaud n’a vraisemblablement rien compris à la théorie poppérienne des trois mondes qui s’oppose résolument à la « connaissance subjective » – qui elle-même repose sur l’assimilation de contenus identifiés comme des éléments de croyance. Or si Popper concède une certaine autonomie au Troisième monde (celui des idées), cela ne suppose en aucune manière que les idées préexistent à la réalité physique, mais seulement qu’elles préexistent virtuellement à leur appréhension par l’homme. Elles seraient Probabilités, non Monades divines. Et si Popper n’aimait pas comparer le cerveau à l’ordinateur, c’était avant tout en raison du caractère éminemment servile de ce dernier.
Les réponses aux questions qui torturent le pauvre Guillebaud – à propos, entre autres, de la recherche sur les embryons surnuméraires, ou de l’avortement – sont justement à chercher dans ce caractère systémique (théoriquement modélisable) de la vie et de la conscience. Envisager l’homme comme une machine de quatrième type – comme une « coupure de flux par rapport à celle à laquelle elle est connectée, mais flux elle même ou production de flux par rapport à celle qui lui est connectée. » [35] selon la terminologie deleuzienne – ou plus précisément, comme nous le verrons dans la dernière partie, comme une structure anaturelle, n’équivaut donc absolument pas à le « réduire à ses organes ».
L’homme est Machine désirante, le monde est Corps sans organe.
[21] Lire cette étonnante interview de Francis Chateauraynaud, sociologue, à propos du logiciel Marlowe.
[22] T. Hobbes [1660], Léviathan (Gallimard, Folio essai, 2000), p. 111.
[23] Ibid, p. 118.
[24] J.-F. Lyotard [1988], Le Postmodernisme expliqué aux enfants (Le Livre de poche, biblio essais, 1993), p.32.
[25] R. Dawkins, « La loi des gènes » in Pour la science (janvier 1996), p. 73.
[26] Ainsi, Dawkins écrivait dans Le Gène égoïste [The Selfish Gene, 1976] (A. Colin, 1990) p. 201, que « nous avons le pouvoir de nous retourner contre nos créateurs. Nous sommes les seuls sur terre à pouvoir nous rebeller contre la tyrannie des réplicateurs égoïstes. ». Mèmes et gènes seraient ainsi deux réplicateurs concurrents
[27] Op. cit., p. 98-103.
[28] Paul T. d’Holbach [1770], Le Système de la nature, t. 1, c. 12.
[29] Lire J. O. de La Mettrie [1748], L’homme-plante (Le corridor bleu, 2003).
[30] J. O. de La Mettrie [1747], L’homme-machine (Gallimard, Folio « essais », 1981) p. 214.
[31] J. de Rosnay [1995], L’homme symbiotique, regards sur le troisième millénaire (Seuil, Points « essai », 2000) p. 377.
[32] J.-C. Guillebaud [2001], Le Principe d’humanité (Seuil, Points « essai », 2002) p. 211.
[33] Op. cit., pp. 19-20.
[34] K. Popper, La connaissance objective (Flammarion, Champs, 1991).
[35] G. Deleuze & F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie 1. L’anti-oedipe (Minuit, Critique, 1973).


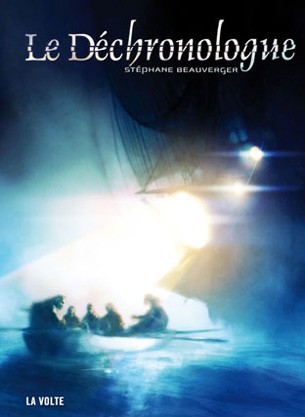
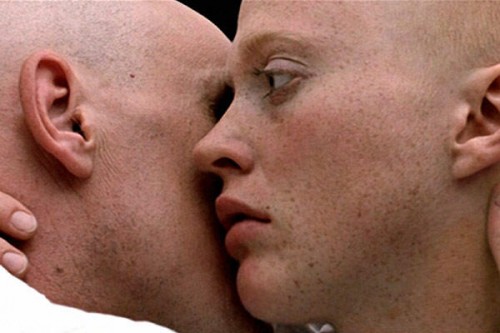
 « Durcir, lentement, lentement, comme une pierre précieuse – et rester finalement là, tranquille, pour la joie de l'éternité. » F. Nietzsche, Aurore. « La vie m’apparaît comme une fluctuation de la matière. » I. Prigogine, De l'être au devenir. « La vérité, je crois, a un avenir ; que l’homme en ait un est beaucoup moins clair. Mais je ne puis m’empêcher d’avoir une petite idée sur ce qui importe le plus. » G. Steiner, Nostalgie de l’absolu. Avec Totalement inhumaine paru en 2001 aux Empêcheurs de penser en rond, approfondissant les réflexions amorcées dans son roman Le Successeur de pierre,
« Durcir, lentement, lentement, comme une pierre précieuse – et rester finalement là, tranquille, pour la joie de l'éternité. » F. Nietzsche, Aurore. « La vie m’apparaît comme une fluctuation de la matière. » I. Prigogine, De l'être au devenir. « La vérité, je crois, a un avenir ; que l’homme en ait un est beaucoup moins clair. Mais je ne puis m’empêcher d’avoir une petite idée sur ce qui importe le plus. » G. Steiner, Nostalgie de l’absolu. Avec Totalement inhumaine paru en 2001 aux Empêcheurs de penser en rond, approfondissant les réflexions amorcées dans son roman Le Successeur de pierre, 