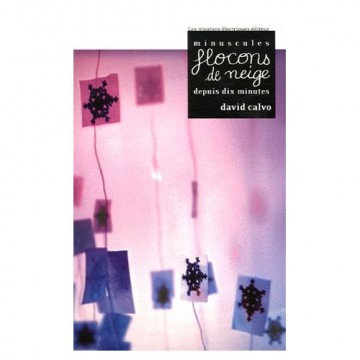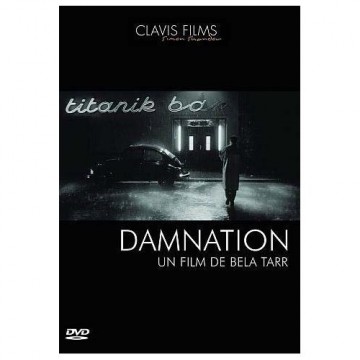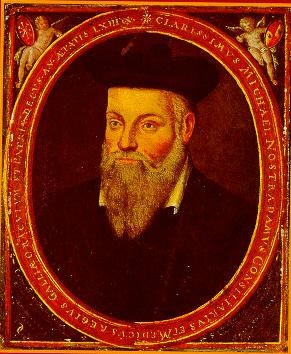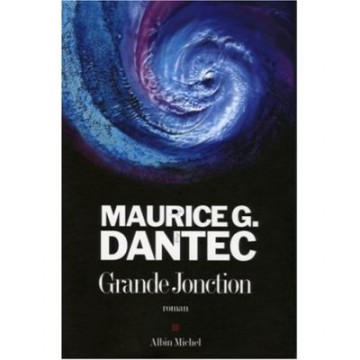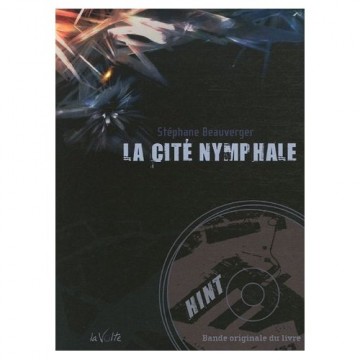
« Ceci est l’instant de notre épiphanie. Ici s’élève notre cité nymphale. »
Les éditions la Volte, auxquelles nous devons la publication d’un chef d’œuvre, La horde du contrevent d’Alain Damasio (que j’évoquais en juin 2005 chez le Stalker), ont depuis entrepris la publication des romans inclassables de Jeff Noon (Vurt et Pollen, bientôt suivis par d’autres inédits), et nous ont fait découvrir un jeune écrivain prometteur, auteur d’une excellente trilogie d’anticipation, Stéphane Beauverger. Il y a tout juste un an, je vous parlais avec enthousiasme de Chromozone et des Noctivores, les deux premiers tomes du triptyque, dont le dernier volet, La cité nymphale, est paru en novembre 2006. Le silence insistant de la presse et des webzines critiques me plonge dans des abîmes de perplexité. Certes, nous allons y revenir, La cité nymphale ne constitue pas le paroxysme attendu, le feu d’artifice final espéré, l’apocalypse désirée. Mais elle ne méritait certainement pas telle inattention. Doit-on incriminer les fêtes de Noël ?... La surcharge de travail des critiques ? Une méfiance illégitime envers un éditeur qui avait d’emblée placé la barre très haut ? Mystère. Toujours est-il que La cité nymphale existe et, en dépit des réserves que je vais vous livrer dans un instant, mérite d’être lue. Non seulement lue, mais encore, écoutée. Et même, pour une fois, regardée : les explosions de lumière sur fond noir de la couverture – conçue par la graphiste Corinne Billon – sont tout simplement superbes. Entre nous, ça nous change du tout-venant de l’illustration SF, mais les couvertures des deux volumes précédents, réalisées par la même graphiste, n’étaient pas moins réussies – la Volte sait y faire.
 Quant au CD qui accompagne le roman, il est l’œuvre d’un groupe que je croyais disparu, Hint, dont j’avais écouté un excellent album il y a déjà de longues années. Leur musique, tour à tour abrasive et éthérée, électrique et planante, ne craint pas d’emprunter à tous les genres pour construire un univers d’une cohérence et d’une intensité rares, plutôt inattendues dans le cadre de la « bande originale » d’un roman d’anticipation. À son écoute, c’est tout un pan de ma discothèque idéale qui défile. Ici, un écho de Painkiller, voire de Naked City, avec le clone du saxo mutant de John Zorn. Là, le fantôme ambient de la drum and bass étouffante du meilleur Scorn, Evanescence. De loin en loin, des constructions presque post-rock qui pourraient évoquer Mogwai ou Mono, si elles n’étaient empoisonnées par un spleen industriel aux riffs décharnés, descendants de Neurosis, Pitchshifter ou Godflesh. À l’horizon, bizarrement précédé d’un titre à la Ministry période Psalm 69, je discerne les bribes d’un chant tibétain ou mongol, ainsi que la silhouette de Michael Gira, dont les Swans sont pourtant bien morts, mais dont les glauques expérimentations nous hanteront à jamais (je vous parlerai un jour de son recueil de nouvelles, La bouche de Francis Bacon, sans doute l’œuvre littéraire la plus tourmentée, la plus violente qui soit). « Eyes in axis (diaphonic interferences mix) », treizième titre de ce CD qui en compte vingt-trois, tiré de l’album 100% white puzzle mais largement modifié, en constitue le point d’orgue, tour à tour calme, dépressions électriques sur un tempo trip-hop, puis corrosif, déchiré par un hurlement libérateur et des riffs assassins, avant de nous renvoyer au royaume du delirium tremens. Bref, Phago[cité], l’album de Hint enregistré pour La cité nymphale, est l’un des meilleurs CD de l’année. En ce qui me concerne, l’écoute du CD et la lecture du roman n’ont pas coïncidé, chronologiquement parlant. Pour m’immerger dans les aventures de Cendre, Gemini et consort, j’avais choisi le métal instrumental de Pelican, le doom-drone maladif et shoegaze de Jesu, le post-rock dramatique de Godspeed You Black Emperor! (Moya) et le doom expérimental du Black one de Sunn O))) (imaginez des démons black metal psalmodiant leurs malédictions d’outre-tombe sur des riffs d’une lenteur extrême soutenus par les nappes ambient d’un Otomo Yoshihide)…
Quant au CD qui accompagne le roman, il est l’œuvre d’un groupe que je croyais disparu, Hint, dont j’avais écouté un excellent album il y a déjà de longues années. Leur musique, tour à tour abrasive et éthérée, électrique et planante, ne craint pas d’emprunter à tous les genres pour construire un univers d’une cohérence et d’une intensité rares, plutôt inattendues dans le cadre de la « bande originale » d’un roman d’anticipation. À son écoute, c’est tout un pan de ma discothèque idéale qui défile. Ici, un écho de Painkiller, voire de Naked City, avec le clone du saxo mutant de John Zorn. Là, le fantôme ambient de la drum and bass étouffante du meilleur Scorn, Evanescence. De loin en loin, des constructions presque post-rock qui pourraient évoquer Mogwai ou Mono, si elles n’étaient empoisonnées par un spleen industriel aux riffs décharnés, descendants de Neurosis, Pitchshifter ou Godflesh. À l’horizon, bizarrement précédé d’un titre à la Ministry période Psalm 69, je discerne les bribes d’un chant tibétain ou mongol, ainsi que la silhouette de Michael Gira, dont les Swans sont pourtant bien morts, mais dont les glauques expérimentations nous hanteront à jamais (je vous parlerai un jour de son recueil de nouvelles, La bouche de Francis Bacon, sans doute l’œuvre littéraire la plus tourmentée, la plus violente qui soit). « Eyes in axis (diaphonic interferences mix) », treizième titre de ce CD qui en compte vingt-trois, tiré de l’album 100% white puzzle mais largement modifié, en constitue le point d’orgue, tour à tour calme, dépressions électriques sur un tempo trip-hop, puis corrosif, déchiré par un hurlement libérateur et des riffs assassins, avant de nous renvoyer au royaume du delirium tremens. Bref, Phago[cité], l’album de Hint enregistré pour La cité nymphale, est l’un des meilleurs CD de l’année. En ce qui me concerne, l’écoute du CD et la lecture du roman n’ont pas coïncidé, chronologiquement parlant. Pour m’immerger dans les aventures de Cendre, Gemini et consort, j’avais choisi le métal instrumental de Pelican, le doom-drone maladif et shoegaze de Jesu, le post-rock dramatique de Godspeed You Black Emperor! (Moya) et le doom expérimental du Black one de Sunn O))) (imaginez des démons black metal psalmodiant leurs malédictions d’outre-tombe sur des riffs d’une lenteur extrême soutenus par les nappes ambient d’un Otomo Yoshihide)…
Revenons à la littérature à présent, et faisons le point. Chromozone plantait le décor de la trilogie. L’avenir proche de la France, cauchemardesque. Les « nouvelles » technologies anéanties par un mégavirus qui, par-dessus le marché, s’attaque aussi à l’homme, exacerbant ses pulsions de mort, transformant l’individu lambda en foutu berserker. Le pays divisé en territoires communautaires férocement gardés. Tuer pour survivre. Leitmotiv : « il n’y a plus de place en ce monde pour la bêtise ». Chromozone nous bombardait d’idées – dont la moindre n’était pas Khaleel, l’un des plus fantastiques personnages de la science-fiction moderne, mais citons aussi la faction Orage et le système de communication phéromonique –, multipliait les registres, nous baladait de camps de prisonniers en Bretagne en réunions au sommet du pouvoir économique, avec un sens du rythme et de l’action digne des premiers Dantec. Les Noctivores surprenait moins par sa forme, mais lesdits Noctivores, entité collective réunissant des milliers d’individus au prix de leur individualité, constituaient à eux seuls une putain d’idée. Leitmotiv : « il est peut-être temps d’en finir avec la violence ». Voici ce que j’écrivais à la fin de ma critique : « L’enjeu du triptyque est ainsi le choix impossible que l’humanité s’apprête à faire malgré elle, et auquel nous confrontent tous les grands romans d’anticipation : soit nous suivons la voie de la déshumanisation, la servitude volontaire, l’engloutissement dans la Machine-Monde qui caractérise l’Occident moderne, soit nous lui résistons, l’arme au poing, au risque du terrorisme et de la barbarie – mais avec l’espoir d’une illumination. Combattre le Mal par le Mal, ou épouser sa cause... Comme pour Dantec, le salut n’est ici sans doute possible que par un inflexible réenchantement du monde. » En finir avec la violence, au prix de notre humanité ?... Il semble que je me sois trompé, du moins en partie. Nous y reviendrons.
Ce réenchantement, pour Beauverger, ne passe pas par la religion – l’Église est souvent moquée, voire conspuée dans La cité nymphale (ah, que j’aurais aimé écrire, le premier, un blasphème comme : « L’enculée conception » !). Il ne passe pas non plus, ou si peu, par la littérature. Certes la Parispapauté est installée dans les bâtiments hideux de la Grande Bibliothèque de Tolbiac, et Cendre, personnage principal du roman, découvre ou redécouvre ce que nous transmettent les grands écrivains – il relit par exemple Moby Dick (version Giono ; je ne saurais trop vous encourager à découvrir la traduction d’Armel Guerne, infiniment plus puissante). Mais le verbe, pour Stéphane Beauverger – qui d’ailleurs préfère travailler le rythme du récit plutôt que la musique d’une phrase –, n’est pas une réponse en soi. Il n’est pas lumière. Il n’est pas feu. Il est moyen de communication, tisseur de liens. La réponse, c’est l’amour, la réponse, c’est l’éthique. Le salut par l’amour, et par l’éthique. S’il fallait ne retenir qu’un mot du roman, ce serait celui-là. Éthique.
Il n’y a que peu d’idées nouvelles dans La cité nymphale, qui se contente pour l’essentiel de dévider les bobines déjà employées dans les tomes précédents. Le parcours de Gemini sur un rivage désert, en compagnie d’un jeune Moken nommé Salamah, qui attend de pouvoir enfin rencontrer celle qui est à l’origine du cataclysme Chromozone, n’a que peu d’intérêt et, si l’on excepte la pirouette finale qui pourrait éventuellement laisser la porte ouverte à une suite, les révélations obtenues en fin de parcours ne font que confirmer ce que nous pressentions déjà : le virus peut être vaincu par une volonté de fer. Cette histoire de virus commençait d’ailleurs à me chiffonner. Le Chromozone était à la fois omniprésent, car à l’origine de cette France post-apocalyptique, et étrangement absent, n’influant finalement que modérément sur les comportements des personnages infectés. Le virus n’est qu’un leurre, un alibi, un révélateur. Bref, rien de neuf. Et les aventures de Lucie au pays de Keltiks, si elles démontrent une nouvelle fois le talent de Beauverger pour l’action menée tambour battant, n’apportent pas non plus d’éléments déterminants. On est en terrain connu. La source se tarit. L’ennui guette.
Il en est une d’idée, cependant, qui doit retenir l’attention du critique, comme celle du lecteur. Une idée forte, qui conditionne la construction du récit et les choix de l’écrivain. Cette idée, la voici : l’entité noctivore évolue, s’émancipe du joug de son créateur Peter Lerner, et développe une intelligence collective qui ne serait pas que logique, mathématique : elle serait aussi « éthiquement viable » : une « entité globale éthique, mue par des pulsions secrètes visant à la satisfaction de notre nous… De notre moi. »… Des entités collectives, la science-fiction nous en a déjà donné de nombreux exemples. Dans La lune seule le sait de Johan Heliot, ce que Bruno Gaultier avait décrit comme « la refonte des consciences individuelles des êtres décédés dans un amalgame Ishkiss millénaire et condamné à errer dans l’espace à la recherche de nouvelles aides pour survivre », était une évidente métaphore politique, et n’ouvrait sur aucune réflexion métaphysique. En revanche, les post-humains de La ruche d’Hellstrom de Frank Herbert, comme les légions de l’Anome de Grande Jonction, étaient comme sortis de l’humanité. Vivre ensemble, mais en ruinant le sens de cet « ensemble ». Lutter pour la survie de la ruche, au détriment de toute autre intelligence. Détruire la singularité divine, pour régner en maître sur une terre dévastée. Des intelligences « totalement inhumaines », pour reprendre les termes de Jean-Michel Truong. Si dans le deuxième tome de sa trilogie les Noctivores de Stéphane Beauverger paraissaient appartenir à cette dernière catégorie, alternative inhumaine et, comment dire, diabolique, à la folie humaine, ils s’apparentent plus, ici, au Gestalt des Plus qu’humain de Theodore Sturgeon. La cité nymphale du titre, c’est l’imminence annoncée d’un contrat social d’un nouveau type. L’apocalypse, certes, puisque l’homme ancien est amené à disparaître, mais une apocalypse dorée, tant les Noctivores, derrière leur apparence de zombies, se montrent habiles, intelligents, capables des plus grandes prouesses techniques. Et, surtout, ils ne cherchent plus à éliminer leurs dissemblables. Leur conscience, d’abord froidement logique, est désormais alimentée par un inconscient collectif qui, semble-t-il, leur garantit une certaine humanité (jusqu’au sens de l’humour).
Les meilleurs passages du livre, ceux où Beauverger s’affranchit le plus des conventions romanesques, sont une conséquence directe de cette évolution inattendue des Noctivores. Il s’agit de courts chapitres, intercalés dans la trame principale, où nous suivons les « sauts de conscience » d’un tueur noctivore. Pour figurer son mode de pensée radicalement différent du nôtre, Beauverger s’autorise des descriptions synesthésiques du plus bel effet : « Encore un pas. Encore deux. Scintillement jaune. Un puits flamboyait quelque part devant lui, au loin. Il avait tellement hâte d’y être. Un air oublié reprit dans sa tête cabossée. Scintillement jaune soutenu par un accord grave, mi majeur, en x, en y et en z. » Dans ces interludes, dont l’importance ne vous sera révélée qu’au dénouement, Beauverger fait montre d’une inventivité vraiment jubilatoire, qui ne se retrouve que sporadiquement dans le reste d’un récit secrètement tendu vers sa propre expérience de la synthèse éthique des Noctivores. En effet, si la violence est évidemment présente dans La cité nymphale, elle est le plus souvent désamorcée. Beauverger joue avec nos attentes, et c’est délibérément qu’il les déçoit. Ses personnages, son roman lui-même, doivent domestiquer leur propre violence, et s’ouvrir enfin aux autres et au monde. Et lorsque la violence se manifeste brutalement, par le canon du flingue de Lucie ou par les pensées dégénérées d’une laissée-pour-compte enragée, nous sommes gênés, mal à l’aise, confrontés à notre banale complaisance.
On peut alors regretter que la réussite de ce projet ambitieux, se fasse au prix de ce qui forçait l’enthousiasme dans Chromozone et Les Noctivores, cet art de la castagne, ce rythme insensé, cette capacité à maintenir une étincelle de lumière dans l’enfer des armes. Ce style tranchant, sans fioritures mais redoutablement efficace, sied moins au tissage de liens fraternels qu’à l’équarrissage d’autrui à la machette… Par ailleurs, cette volonté louable de reconstruire après avoir tout fait exploser, se traduit dans La cité nymphale par une simplification des données. Hormis les mystérieux agents de Derb Ghallef, dont nous ne saurons rien sinon qu’ils ne sont pas l’ennemi supposé, nous connaissons quasiment d’emblée toutes les forces en présence, ainsi que leurs dirigeants. Et si quelques événements viennent troubler les relations diplomatiques, au point d’en arriver à une situation de crise qui permet à Beauverger d’en réunir enfin tous les protagonistes, aucune évolution majeure ne permet au récit de décoller – jusqu’au surgissement inoubliable du tueur, prélude tragicomique aux révélations sur la nouvelle éthique des Noctivores. Situation figée, donc, et dont les éléments ne sont jamais qu’effleurés. Comme les personnages du reste, dont l’essence se dilue tandis que leurs doutes laissent place à une nouvelle détermination. Aucun, en vérité, ne parvient à émouvoir, aucun ne nous invite au vertige. Même le Roméo, traître professionnel rencontré dans le volume précédent, n’est plus intéressant dès lors qu’il devient trop humain. Chacun joue son rôle à la perfection, comme à l’Actor’s Studio, mais où est la chair ? Où est le sang ? Où est l’âme ? Dépecée et synthétisée par les Noctivores ? Idée séduisante, mais infondée.
Pour autant, Stéphane Beauverger ne choisit pas la beauté plus qu’humaine des Noctivores (la référence du titre au monde des insectes – la cité nymphale – ne saurait être fortuite). Avec la communauté secrète réunie autour de Laurie Deane, c’est une nouvelle fraternité qui est en train de naître. D’un côté, la ruche éthique des Noctivores. De l’autre, les hommes libres. Beauverger ne juge pas les Noctivores, qu’il paraît contempler avec tristesse, comme s’il pressentait que l’avenir de l’univers par lui créé, leur appartient. Mais il choisit évidemment de clore son texte en compagnie de Cendre et Lucie, nouvel Adam, nouvelle Ève, sur un navire – possibilité d’une île. Le dernier mot du roman, c’est « vie ». Où est l’âme, demandais-je à l’instant. Elle surgit in extremis, l’âme, dans une « larme de joie triste ».