Suite de l’entretien avec Stéphane Beauverger (lire la première partie).
ON : Tes romans sont très rythmés. Les chapitres sont courts, souvent entrecoupés d’étranges monologues intérieurs, ça percute, tu recoures souvent à l’ellipse, les dialogues fusent… Rien d’étonnant à ce que tu cites les Young Gods, ou que tu confies la création de la « bande originale » de La Cité nymphale à Hint ! Peux-tu nous parler de ta manière d’écrire ? La musique joue-t-elle un rôle important ?... Le cinéma ?...
SB : Je ne sais pas si j’ai une « manière » d’écrire. J’avoue avoir un côté un peu casanier, « quand faut y aller, faut y aller ». Prosaïquement, au quotidien, j’écris parce que ça doit être fait. Non, plus vicelard, j’écris parce que j’ai hâte de voir ce qui se passe après. Le chapitre suivant. Le livre suivant. Après, j’ai quelques rituels, qui passent par le sifflement de la bouilloire et l’odeur du café chaud. Le besoin de silence aussi, qui fait que j’écris soit la nuit, soit avec des boules Quies. La musique est bannie – j’en écoute énormément par ailleurs – sauf si je cherche à atteindre une émotion particulière que je sais que tel ou tel air ou chanson me procure à chaque fois. Mais c’est un exercice limité, qui demeure marginal. Je me souviens d’avoir relu récemment une intervention de Jean-Claude Dunyach sur un forum, à propos du style, acquis ou inné ? Il faisait une différence que je trouve assez juste entre la « voix » et le « style », toutes deux composantes à part égale de la manière d’écrire. La première étant immatérielle, impalpable, peut-être inscrite dans chaque auteur depuis son premier texte, et le second, plus charnel, physique, inscrit dans une confrontation au temps, au rythme, à la cadence. Ce point de vue me parle. Cette espèce de point de convergence, presque quantique, entre l’objectif souhaité et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre et le cerner. Ensuite, je dirais aussi qu’en tant qu’enfant de la culture de l’image (cinéma, publicité, télévision, jeu vidéo), j’ai la chance de pouvoir puiser dans un inconscient collectif – décidément, on y revient – afin de susciter facilement des images dans l’esprit du lecteur. J’aime bien jouer de références croisées pour générer des images inédites. La culture de l’image, la connaissance implicite de la technique du montage audiovisuelle par le public, me permettent aussi de manipuler plus facilement des ellipses ou des inserts. Notre cerveau, qui baigne dans ce jus narratif depuis notre naissance ou presque, est habitué à ce genre de gymnastique. J’en suis gavé, je le régurgite à mon tour. Après, je ne peux que constater mon vieillissement ou ma fatigue croissante, quand je visionne des films récents, visiblement montés et rythmés pour séduire un public ado en quête de montage « clipesque », et qui me donnent la nausée. Je pense par exemple à Moulin Rouge qui change de plan toutes les deux secondes. Je suis physiquement malade, j’ai du mal à le regarder jusqu’au bout. La transgression technique, oui, la débauche foutraque d’effets gratuits, non.
ON : Nous sommes bien d’accord ! Ce n’est d’ailleurs pas le nombre de plans qui est cause (je me souviens d’un stupéfiant court-métrage de Guy Maddin, peut-être « The Heart of the world », au montage tellement frénétique qu’il devait compter plus de plans que les plus insupportables productions Bruckenheimer), que leur agencement inepte, « gratuit » en effet. De la production de sens, censée naître de la succession de deux plans, on passe, dans ces longs-métrages de la génération MTV, à une soustraction : il ne reste rien d’autre que l’effet… Tout le contraire, en somme, de films pourtant aussi différents (quoique tous deux tournés en vidéo) que Honor de Cavalleria, le beau premier film d’Albert Serra (un Don Quichotte minimaliste, en catalan), et Inland Empire, la dernière œuvre, splendide, de David Lynch. Mais, quelles sont tes références cinématographiques ?...
SB : Il y en a tellement que, s’il ne devait en rester qu’un, ce serait sans doute Akira Kurosawa, à la fois pour la qualité visuelle, technique, narrative, humaine de ses œuvres. Rashomon, bien sûr, mais aussi Les Sept Samouraï, Le Chien enragé, L’Ange Ivre, Scandale, Vivre, Les Bas-Fonds, Barberousse, Le Château de l‘Araignée, La légende du Grand Judo... Bon, bref, tout, quoi… En plus, il a travaillé avec Toshiro Mifune, raaah ! Le seul reproche que je ferais à son cinéma, c’est la place et le rôle des femmes, quasi-absentes ou bien presque immanquablement mesquines, manipulatrices, forces d’entropie et sources de malheur. Il y aurait aussi Scorsese, pour La Valse des Pantins et Taxi Driver, et puis Takeshi Kitano pour L’été de Kikujiro. Côté français, Le Corbeau de Clouzot, Ça commence aujourd’hui de Bertrand Tavernier. Et tant d’autres, dont le nom m’échappe, mais dont les films m’ont touché. Ah, si, un dernier, que j’ai découvert récemment grâce à une rétrospective sur le câble : Claude Sautet, ne serait-ce que pour ses scènes de bar. Sautet filmait des bars avec de la vie, pas des décors avec des acteurs qui boivent.
ON : Ah ! Si je veux voir des bars avec de la vie, je cherche plutôt du côté de Cassavetes ! Sautet a su, un temps, saisir l’essence de son époque. Je pense par exemple à Max et les ferrailleurs et à Vincent, François, Paul et les autres qui, pour ce que j’en sais, montrent superbement certaine réalité des années Pompidou et Giscard, en même temps qu’une autre, plus universelle, celle des « choses de la vie ». Mais le Sautet des décennies suivantes, de Garçon ! à Nelly et monsieur Arnaud, m’ennuie trop. Maurice Pialat m’a toujours davantage enthousiasmé. L’Enfance nue, La Gueule ouverte, c’est d’une autre trempe ! En revanche je partage sans réserve ton admiration pour Kurosawa. C’est vrai qu’il n’était pas le grand cinéaste des femmes ! Son cinéma était même aussi exclusivement masculin que celui de Mizoguchi était féminin. Mais doit-on le lui reprocher ? Si je ne m’abuse, tes livres – y compris leurs personnages féminins – sont eux-mêmes très masculins… Mais chez toi la femme n’est pas mesquine ou manipulatrice : tu la prives tout simplement de l’idée même de maternité. Tes personnages féminins sont des révoltées qui suppriment la vie bien plus qu’elles ne la donnent ! Si l’amour n’est pas absent de la trilogie, l’enfantement n’y est jamais envisagé. Cendre est condamné, Gemini castré, et les seules figures paternelles reconnaissables sont un pape iconoclaste, et Peter Lerner bien sûr, aussi puissant qu’absent, qui sera assassiné par ses « enfants », les Noctivores… Je devine d’ailleurs que ces derniers ne procréeront plus par les voies naturelles… D’ailleurs, procréeront-ils, ou se reproduiront-ils ? Et de surcroît, l’émergence de leur Gestalt n’est-elle pas menacée par leur expansion même ?... En effet, les Noctivores ne sont susceptibles d’échapper à l’intelligence machinique, en essaim, totalement inhumaine, qu’en tant qu’ils assimilent des singularités, des expériences individuelles dont le nombre diminuera jusqu’au dernier homme libre…
 SB : En fait, j’ai envisagé fortement pendant quelques temps de faire avoir un enfant à Lucie et Cendre. J’étais intéressé par l’idée de « valider » leur couple en leur offrant une progéniture – puisque, n’est-ce pas, ma bonne dame, les enfants, tout de même, ah, quelle joie… Finalement, je n’ai conservé cet hypothétique personnage que sous la forme d’un fœtus mort-né. Ils ont failli avoir un enfant, au moins ils ont essayé. Mais ça n’a pas marché. Deux raisons principales m’ont poussé vers ce choix narratif : d’abord, un bébé viable aurait amené explicitement la notion de combat « pour les générations futures » et ce genre de bêtises, ça faussait ce que je voulais raconter dans cette trilogie. Je ne voulais pas leur accorder cet espoir-là. Justification trop facile de trop d’actes et de décisions. Ensuite, la mort du bébé ramenait Cendre à sa réalité de viande trafiquée et vérolée, capable seulement de donner la mort. Par contre, si j’avais exploré cette voie, j’avoue que ça aurait pu être amusant de confronter le « messie » à son héritier, certainement aussi porteur d’espoir que son papa, jusqu’à peut-être lui voler la vedette dans l’esprit des fidèles. Voilà un aspect du rapport filial, dans le cadre de la société dévastée de l’univers du Chromozone, que j’aurais aimé explorer. Une autre fois, peut-être. Pour ce qui est de la sexualité des Noctivores, j’avoue que je n’ai pas creusé le sujet. À mon avis, ils se tapent une partouze planétaire et cérébrale permanente, si on en croit ce que Justine a pu percevoir de leur monde quand elle s’est infiltrée dans leur champ de perception. Le plaisir du partage et le partage du plaisir, comme je le disais plus haut, sont les meilleures carottes proposées par la Synthèse pour fidéliser ses membres. Pour ce qui est de la question du point critique d’expansion de leur Gestalt, n’est-ce pas la nature de toute entreprise (in)humaine ? Atteindre l’apogée, et commencer à dévaler l’autre versant vers le point de départ. Puis recommencer. L’effondrement, s’il est pénible à vivre et expérimenter, n’est pas la dernière étape. C’est le terreau où puiser l’énergie nécessaire à la progression suivante. C’est aussi pour ça, peut-être, qu’il n’y a pas d’apocalypse à la fin de la trilogie. Au début de Chromozone, la civilisation connaît ses derniers soubresauts avant la pulvérisation. À la fin de La Cité nymphale, de nouvelles forces ont émergé, prêtes à disputer une nouvelle partie. Bon, ensuite, ma nature cynique va prendre le dessus sur ce que je viens de dire, et je ne pourrai m’empêcher de susurrer que c’est bien joli, le « terreau fertile où puiser les forces nécessaires à la prochaine glorieuse élévation », mais la loi de l’épuisement des sols, c’est pas pour les chiens, non plus. Des efforts de plus en plus rudes pour une récolte de plus en plus maigre, c’est une constatation qui n’est pas pour me déplaire, hé, hé, hé… Mais, ma bonne dame, tant qu’il y a de la vie, hein, n’est-ce pas, il y a de l’espoir, tout ça, et trois qui nous font un kilo. Au suivant !
SB : En fait, j’ai envisagé fortement pendant quelques temps de faire avoir un enfant à Lucie et Cendre. J’étais intéressé par l’idée de « valider » leur couple en leur offrant une progéniture – puisque, n’est-ce pas, ma bonne dame, les enfants, tout de même, ah, quelle joie… Finalement, je n’ai conservé cet hypothétique personnage que sous la forme d’un fœtus mort-né. Ils ont failli avoir un enfant, au moins ils ont essayé. Mais ça n’a pas marché. Deux raisons principales m’ont poussé vers ce choix narratif : d’abord, un bébé viable aurait amené explicitement la notion de combat « pour les générations futures » et ce genre de bêtises, ça faussait ce que je voulais raconter dans cette trilogie. Je ne voulais pas leur accorder cet espoir-là. Justification trop facile de trop d’actes et de décisions. Ensuite, la mort du bébé ramenait Cendre à sa réalité de viande trafiquée et vérolée, capable seulement de donner la mort. Par contre, si j’avais exploré cette voie, j’avoue que ça aurait pu être amusant de confronter le « messie » à son héritier, certainement aussi porteur d’espoir que son papa, jusqu’à peut-être lui voler la vedette dans l’esprit des fidèles. Voilà un aspect du rapport filial, dans le cadre de la société dévastée de l’univers du Chromozone, que j’aurais aimé explorer. Une autre fois, peut-être. Pour ce qui est de la sexualité des Noctivores, j’avoue que je n’ai pas creusé le sujet. À mon avis, ils se tapent une partouze planétaire et cérébrale permanente, si on en croit ce que Justine a pu percevoir de leur monde quand elle s’est infiltrée dans leur champ de perception. Le plaisir du partage et le partage du plaisir, comme je le disais plus haut, sont les meilleures carottes proposées par la Synthèse pour fidéliser ses membres. Pour ce qui est de la question du point critique d’expansion de leur Gestalt, n’est-ce pas la nature de toute entreprise (in)humaine ? Atteindre l’apogée, et commencer à dévaler l’autre versant vers le point de départ. Puis recommencer. L’effondrement, s’il est pénible à vivre et expérimenter, n’est pas la dernière étape. C’est le terreau où puiser l’énergie nécessaire à la progression suivante. C’est aussi pour ça, peut-être, qu’il n’y a pas d’apocalypse à la fin de la trilogie. Au début de Chromozone, la civilisation connaît ses derniers soubresauts avant la pulvérisation. À la fin de La Cité nymphale, de nouvelles forces ont émergé, prêtes à disputer une nouvelle partie. Bon, ensuite, ma nature cynique va prendre le dessus sur ce que je viens de dire, et je ne pourrai m’empêcher de susurrer que c’est bien joli, le « terreau fertile où puiser les forces nécessaires à la prochaine glorieuse élévation », mais la loi de l’épuisement des sols, c’est pas pour les chiens, non plus. Des efforts de plus en plus rudes pour une récolte de plus en plus maigre, c’est une constatation qui n’est pas pour me déplaire, hé, hé, hé… Mais, ma bonne dame, tant qu’il y a de la vie, hein, n’est-ce pas, il y a de l’espoir, tout ça, et trois qui nous font un kilo. Au suivant !
ON : L’humanité serait donc au bout du rouleau… Considérant cela, est-ce que chercher à faire entendre sa Voix a encore un sens ?... Non, je ne te crois pas si cynique. D’ailleurs, de l’apaisement, à la fin de la trilogie, j’ai une autre interprétation, plus pessimiste : la nouvelle domination des Noctivores. Et, en un sens, c’est une Apocalypse, la révélation de la Cité nymphale, la fin du monde humain, le triomphe de nouveaux élus. Et si je pousse le bouchon plus loin, à travers la communion des Noctivores (leur partouze planétaire, si tu préfères !), ce pourrait être le corps – sans organe – du Christ qui est reconstitué, à la fois Un, indivisible, et Multiple, infiniment divisé… À chaque nouvelle « absorption », c’est une Eucharistie que célèbreraient donc les Noctivores… Sauf que, en l’occurrence, il s’agirait plutôt de la chair de l’Antéchrist ! Les Noctivores ont beau montrer un certain sens de l’humour, et se prétendre « éthiquement viables », ils n’en rappellent pas moins les légions de l’Anome de Grande Jonction, le dernier roman de Maurice G. Dantec : si l’entité est constituée de chaque individu, l’individu n’existe plus en tant que tel, et ne contient plus l’entité – il devient le rouage d’une machine ! J’en reviens donc à ma question. Puisque tu écris, puisque tu entends nous faire partager tes visions, c’est que tu imagines, d’une manière ou d’une autre, que ta Voix est importante… N’est-ce pas ?
SB : Est-ce que c’est si important que cela, la survie de l’individu ? Qu’est-ce qu’il y aurait donc de si noble, de si beau, de si unique et sacré, qui mériterait de ne pas sacrifier son individualité à l’extirpation de la bêtise abyssale qui semble définir notre espèce ? Je me souviens d’un trait d’esprit d’un cartooniste américain – Bill Watterson, je crois – qui disait « la meilleure preuve de l’existence d’une intelligence extra-terrestre, c’est qu’elle n’a pas essayé de nous contacter. » Je souris et j’opine. Je vomis les hommes et ce dont ils sont capables, je méprise notre bassesse congénitale – oui, oui, je me compte dans le lot – parfois traversée par un éclair d’abnégation ou de bonté. Je n’ai pas lu Grande Jonction, mais s’il s’agit de faire entrer chaque individu dans une petite alvéole de ruche, au sein d’une conscience d’essaim ou d’une machine biologique dont chaque élément constituerait un rouage, ce n’est pas mon propos. La Synthèse n’a pas de plan, pas de dessein, pas de politburo. Son créateur échoue quand il tente de la plier à Sa volonté. Elle est de nature « cerveau droit », intuitive, sensible, instinctive. Je la crois capable de création artistique – si tant est que le geste de création soit la définition de l’individualité et de l’autonomie souveraine de chaque être. En tout cas, c’est ainsi que je la vois. Ensuite, libre à chaque lecteur d’y percevoir ce qu’il veut. Je répéterai donc ici que mon but n’est pas d’apporter une réponse, je me contente de poser des questions qui me préoccupent, et c’est déjà assez compliqué. Ce qui, au passage, te donne une idée de l’importance que j’accorde à ma Voix.
ON : La Cité nymphale m’a un peu surpris. L’apex de violence attendu n’a pas lieu. Des feux démarrent de toutes part, mais tu parais prendre plaisir à les éteindre les uns après les autres. L’éveil des Noctivores à l’éthique, la fragile tentative de reconstruction de Lucie, Gemini et des quelques derniers résistants, nécessitaient-ils d’emblée, pour toi, de susciter le désir, puis la frustration, du lecteur ? Il me semble que ça n’est, alors, qu’en partie réussi... Tout m’a paru plus figé que dans les volumes précédents. Aux tempêtes d’images de ceux-ci, succède une sorte de long épilogue, dont les linéaments ne sont jamais vraiment approfondis – sinon, comme je l’ai déjà écrit, dans les « sauts de conscience » qui s’intercalent parfois entre les chapitres. Quel était non seulement ton projet d’ensemble, pour la trilogie, mais encore ton projet sur La Cité nymphale en particulier ?
SB : Tu aurais raison de deviner mon plaisir à prendre le lecteur à contre-pied. Je voulais réinjecter de la petitesse dans cette histoire, éviter l‘escalade wagnérienne ou la déflagration à la Akira , en tout cas, pour cette saga-ci. Les héros sont fatigués. Le statu quo s’impose peu à peu. C’est vrai que c’est plus figé et amidonné. Le soufflé retombe. C’est un exercice un peu délicat de traiter du vide et du retour au calme sans écrire « le vide et le calme se font. » Peut-être est-ce aussi un hoquet de tendresse de ma part envers mes personnages, va savoir… Je me rappelle d’une très belle scène au début de Chasseur blanc, cœur noir, quand le réalisateur et le scénariste débattent de la fin du script de leur prochain film. Au terme des épreuves abominables traversées par les héros, le réalisateur veut les tuer, tandis que le scénariste souhaite leur accorder une fin heureuse. Démiurge ou dramaturge ? Pour la Cité nymphale, j’avais envie d’étouffer les trompettes au moment de sonner l’hallali, de renvoyer les walkyries au vestiaire, la guerre de Troie n’aura pas lieu, tout ça. Game over, please insert coin. Qui sait, peut-être suis-je un optimiste qui s’ignore, hé, hé, hé… En même temps, éradiquer l’humanité, c’eut été me débarrasser de ma problématique principale liée à sa violence. Trop facile, tellement peu humain… Non, une petite pincée de mesquinerie, un petit goût d’inachevé avant de refaire les mêmes conneries, c’est tellement plus dans notre nature, niark, niark.

Illustrations tirées de La Cité nymphale, de Chromozone et des Noctivores © Corinne Billon
Première partie.
Troisième partie.
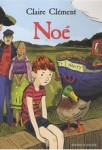 Noé, délicat roman de Claire Clément (Bayard, coll. Estampille) pour le jeune public, autour de la mort d'une mère et du monde fluvial ;
Noé, délicat roman de Claire Clément (Bayard, coll. Estampille) pour le jeune public, autour de la mort d'une mère et du monde fluvial ; Nous disparaissons, roman de Scott Heim (Mysterious Skin) au Diable Vauvert, sur la mort et la fiction ;
Nous disparaissons, roman de Scott Heim (Mysterious Skin) au Diable Vauvert, sur la mort et la fiction ; Dans la colonie pénitentiaire, subtile adaptation en bande dessinée de la nouvelle de Kafka par Maël et Sylvain Ricard chez Delcourt (coll. Ex-libris) ;
Dans la colonie pénitentiaire, subtile adaptation en bande dessinée de la nouvelle de Kafka par Maël et Sylvain Ricard chez Delcourt (coll. Ex-libris) ; Incarnations enfin, roman beaucoup trop désincarné de Xavier Bruce au Bélial', qui m'aura néanmoins permis, malgré lui, de commettre le plus affligeant calembour de la décennie et de multiplier les métaphores douteuses...
Incarnations enfin, roman beaucoup trop désincarné de Xavier Bruce au Bélial', qui m'aura néanmoins permis, malgré lui, de commettre le plus affligeant calembour de la décennie et de multiplier les métaphores douteuses...



 SB :
SB :

 SB : En fait, j’ai envisagé fortement pendant quelques temps de faire avoir un enfant à Lucie et Cendre. J’étais intéressé par l’idée de « valider » leur couple en leur offrant une progéniture – puisque, n’est-ce pas, ma bonne dame, les enfants, tout de même, ah, quelle joie… Finalement, je n’ai conservé cet hypothétique personnage que sous la forme d’un fœtus mort-né. Ils ont failli avoir un enfant, au moins ils ont essayé. Mais ça n’a pas marché. Deux raisons principales m’ont poussé vers ce choix narratif : d’abord, un bébé viable aurait amené explicitement la notion de combat « pour les générations futures » et ce genre de bêtises, ça faussait ce que je voulais raconter dans cette trilogie. Je ne voulais pas leur accorder cet espoir-là. Justification trop facile de trop d’actes et de décisions. Ensuite, la mort du bébé ramenait Cendre à sa réalité de viande trafiquée et vérolée, capable seulement de donner la mort. Par contre, si j’avais exploré cette voie, j’avoue que ça aurait pu être amusant de confronter le « messie » à son héritier, certainement aussi porteur d’espoir que son papa, jusqu’à peut-être lui voler la vedette dans l’esprit des fidèles. Voilà un aspect du rapport filial, dans le cadre de la société dévastée de l’univers du Chromozone, que j’aurais aimé explorer. Une autre fois, peut-être. Pour ce qui est de la sexualité des Noctivores, j’avoue que je n’ai pas creusé le sujet. À mon avis, ils se tapent une partouze planétaire et cérébrale permanente, si on en croit ce que Justine a pu percevoir de leur monde quand elle s’est infiltrée dans leur champ de perception. Le plaisir du partage et le partage du plaisir, comme je le disais plus haut, sont les meilleures carottes proposées par la Synthèse pour fidéliser ses membres. Pour ce qui est de la question du point critique d’expansion de leur Gestalt, n’est-ce pas la nature de toute entreprise (in)humaine ? Atteindre l’apogée, et commencer à dévaler l’autre versant vers le point de départ. Puis recommencer. L’effondrement, s’il est pénible à vivre et expérimenter, n’est pas la dernière étape. C’est le terreau où puiser l’énergie nécessaire à la progression suivante. C’est aussi pour ça, peut-être, qu’il n’y a pas d’apocalypse à la fin de la trilogie. Au début de Chromozone, la civilisation connaît ses derniers soubresauts avant la pulvérisation. À la fin de La Cité nymphale, de nouvelles forces ont émergé, prêtes à disputer une nouvelle partie. Bon, ensuite, ma nature cynique va prendre le dessus sur ce que je viens de dire, et je ne pourrai m’empêcher de susurrer que c’est bien joli, le « terreau fertile où puiser les forces nécessaires à la prochaine glorieuse élévation », mais la loi de l’épuisement des sols, c’est pas pour les chiens, non plus. Des efforts de plus en plus rudes pour une récolte de plus en plus maigre, c’est une constatation qui n’est pas pour me déplaire, hé, hé, hé… Mais, ma bonne dame, tant qu’il y a de la vie, hein, n’est-ce pas, il y a de l’espoir, tout ça, et trois qui nous font un kilo. Au suivant !
SB : En fait, j’ai envisagé fortement pendant quelques temps de faire avoir un enfant à Lucie et Cendre. J’étais intéressé par l’idée de « valider » leur couple en leur offrant une progéniture – puisque, n’est-ce pas, ma bonne dame, les enfants, tout de même, ah, quelle joie… Finalement, je n’ai conservé cet hypothétique personnage que sous la forme d’un fœtus mort-né. Ils ont failli avoir un enfant, au moins ils ont essayé. Mais ça n’a pas marché. Deux raisons principales m’ont poussé vers ce choix narratif : d’abord, un bébé viable aurait amené explicitement la notion de combat « pour les générations futures » et ce genre de bêtises, ça faussait ce que je voulais raconter dans cette trilogie. Je ne voulais pas leur accorder cet espoir-là. Justification trop facile de trop d’actes et de décisions. Ensuite, la mort du bébé ramenait Cendre à sa réalité de viande trafiquée et vérolée, capable seulement de donner la mort. Par contre, si j’avais exploré cette voie, j’avoue que ça aurait pu être amusant de confronter le « messie » à son héritier, certainement aussi porteur d’espoir que son papa, jusqu’à peut-être lui voler la vedette dans l’esprit des fidèles. Voilà un aspect du rapport filial, dans le cadre de la société dévastée de l’univers du Chromozone, que j’aurais aimé explorer. Une autre fois, peut-être. Pour ce qui est de la sexualité des Noctivores, j’avoue que je n’ai pas creusé le sujet. À mon avis, ils se tapent une partouze planétaire et cérébrale permanente, si on en croit ce que Justine a pu percevoir de leur monde quand elle s’est infiltrée dans leur champ de perception. Le plaisir du partage et le partage du plaisir, comme je le disais plus haut, sont les meilleures carottes proposées par la Synthèse pour fidéliser ses membres. Pour ce qui est de la question du point critique d’expansion de leur Gestalt, n’est-ce pas la nature de toute entreprise (in)humaine ? Atteindre l’apogée, et commencer à dévaler l’autre versant vers le point de départ. Puis recommencer. L’effondrement, s’il est pénible à vivre et expérimenter, n’est pas la dernière étape. C’est le terreau où puiser l’énergie nécessaire à la progression suivante. C’est aussi pour ça, peut-être, qu’il n’y a pas d’apocalypse à la fin de la trilogie. Au début de Chromozone, la civilisation connaît ses derniers soubresauts avant la pulvérisation. À la fin de La Cité nymphale, de nouvelles forces ont émergé, prêtes à disputer une nouvelle partie. Bon, ensuite, ma nature cynique va prendre le dessus sur ce que je viens de dire, et je ne pourrai m’empêcher de susurrer que c’est bien joli, le « terreau fertile où puiser les forces nécessaires à la prochaine glorieuse élévation », mais la loi de l’épuisement des sols, c’est pas pour les chiens, non plus. Des efforts de plus en plus rudes pour une récolte de plus en plus maigre, c’est une constatation qui n’est pas pour me déplaire, hé, hé, hé… Mais, ma bonne dame, tant qu’il y a de la vie, hein, n’est-ce pas, il y a de l’espoir, tout ça, et trois qui nous font un kilo. Au suivant !

 SB
SB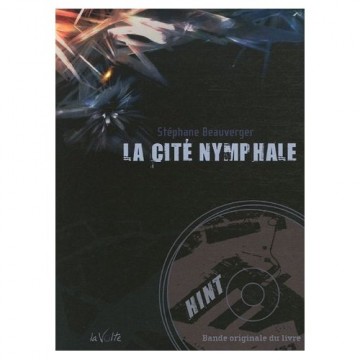
 Quant au CD qui accompagne le roman, il est l’œuvre d’un groupe que je croyais disparu, Hint, dont j’avais écouté un excellent album il y a déjà de longues années. Leur musique, tour à tour abrasive et éthérée, électrique et planante, ne craint pas d’emprunter à tous les genres pour construire un univers d’une cohérence et d’une intensité rares, plutôt inattendues dans le cadre de la « bande originale » d’un roman d’anticipation. À son écoute, c’est tout un pan de ma discothèque idéale qui défile. Ici, un écho de Painkiller, voire de Naked City, avec le clone du saxo mutant de John Zorn. Là, le fantôme ambient de la drum and bass étouffante du meilleur Scorn, Evanescence. De loin en loin, des constructions presque post-rock qui pourraient évoquer Mogwai ou Mono, si elles n’étaient empoisonnées par un spleen industriel aux riffs décharnés, descendants de Neurosis, Pitchshifter ou Godflesh. À l’horizon, bizarrement précédé d’un titre à la Ministry période Psalm 69, je discerne les bribes d’un chant tibétain ou mongol, ainsi que la silhouette de Michael Gira, dont les Swans sont pourtant bien morts, mais dont les glauques expérimentations nous hanteront à jamais (je vous parlerai un jour de son recueil de nouvelles, La bouche de Francis Bacon, sans doute l’œuvre littéraire la plus tourmentée, la plus violente qui soit). « Eyes in axis (diaphonic interferences mix) », treizième titre de ce CD qui en compte vingt-trois, tiré de l’album 100% white puzzle mais largement modifié, en constitue le point d’orgue, tour à tour calme, dépressions électriques sur un tempo trip-hop, puis corrosif, déchiré par un hurlement libérateur et des riffs assassins, avant de nous renvoyer au royaume du delirium tremens. Bref, Phago[cité], l’album de Hint enregistré pour La cité nymphale, est l’un des meilleurs CD de l’année. En ce qui me concerne, l’écoute du CD et la lecture du roman n’ont pas coïncidé, chronologiquement parlant. Pour m’immerger dans les aventures de Cendre, Gemini et consort, j’avais choisi le métal instrumental de Pelican, le doom-drone maladif et shoegaze de Jesu, le post-rock dramatique de Godspeed You Black Emperor! (Moya) et le doom expérimental du Black one de Sunn O))) (imaginez des démons black metal psalmodiant leurs malédictions d’outre-tombe sur des riffs d’une lenteur extrême soutenus par les nappes ambient d’un Otomo Yoshihide)…
Quant au CD qui accompagne le roman, il est l’œuvre d’un groupe que je croyais disparu, Hint, dont j’avais écouté un excellent album il y a déjà de longues années. Leur musique, tour à tour abrasive et éthérée, électrique et planante, ne craint pas d’emprunter à tous les genres pour construire un univers d’une cohérence et d’une intensité rares, plutôt inattendues dans le cadre de la « bande originale » d’un roman d’anticipation. À son écoute, c’est tout un pan de ma discothèque idéale qui défile. Ici, un écho de Painkiller, voire de Naked City, avec le clone du saxo mutant de John Zorn. Là, le fantôme ambient de la drum and bass étouffante du meilleur Scorn, Evanescence. De loin en loin, des constructions presque post-rock qui pourraient évoquer Mogwai ou Mono, si elles n’étaient empoisonnées par un spleen industriel aux riffs décharnés, descendants de Neurosis, Pitchshifter ou Godflesh. À l’horizon, bizarrement précédé d’un titre à la Ministry période Psalm 69, je discerne les bribes d’un chant tibétain ou mongol, ainsi que la silhouette de Michael Gira, dont les Swans sont pourtant bien morts, mais dont les glauques expérimentations nous hanteront à jamais (je vous parlerai un jour de son recueil de nouvelles, La bouche de Francis Bacon, sans doute l’œuvre littéraire la plus tourmentée, la plus violente qui soit). « Eyes in axis (diaphonic interferences mix) », treizième titre de ce CD qui en compte vingt-trois, tiré de l’album 100% white puzzle mais largement modifié, en constitue le point d’orgue, tour à tour calme, dépressions électriques sur un tempo trip-hop, puis corrosif, déchiré par un hurlement libérateur et des riffs assassins, avant de nous renvoyer au royaume du delirium tremens. Bref, Phago[cité], l’album de Hint enregistré pour La cité nymphale, est l’un des meilleurs CD de l’année. En ce qui me concerne, l’écoute du CD et la lecture du roman n’ont pas coïncidé, chronologiquement parlant. Pour m’immerger dans les aventures de Cendre, Gemini et consort, j’avais choisi le métal instrumental de Pelican, le doom-drone maladif et shoegaze de Jesu, le post-rock dramatique de Godspeed You Black Emperor! (Moya) et le doom expérimental du Black one de Sunn O))) (imaginez des démons black metal psalmodiant leurs malédictions d’outre-tombe sur des riffs d’une lenteur extrême soutenus par les nappes ambient d’un Otomo Yoshihide)…