« L’enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule d’elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation.
Oui, pour le jeu de la création, ô mes frères, il faut une sainte affirmation : l’esprit veut maintenant sa propre volonté, celui qui est perdu au monde veut gagner son propre monde. »
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.
« Sourde pulsion lumineuse des quasars ; plus près des galaxies miroitent. Des astres flamboyants se perdent dans les abîmes d’antimatière, des planètes se consument autour de soleils transformés en novae. Là, des océans de néant lèchent des prairies du vide, des comètes sombrent en gerbe, des météores glissent silencieusement, vite absorbés par le noir de l’espace. Ici, des créatures invraisemblables rampent sur des lacs de boue, des fleurs aux pétales cornus vomissent des insectes-pollen, les arbres se font vivants et marchent à l’aide de racines molles, des minéraux émettent des pensées malodorantes, des madrépores de mille mètres de haut créent des musiques liquides. À travers ce fantastique carrousel de l’énergie et de la matière où tout se mêle et se confond, où les absurdes lois de l’humanité sont bafouées par la logique même de la vie, je me déploie, je gagne en puissance, je me nourris du cosmos. Je mûris. Tout est possible. »
Philippe Curval, L’Homme à rebours.
 En attendant la mise en ligne, imminente – je n’attends plus qu’une autorisation de reproduction d’une œuvre photographique très particulière… –, d’une critique-fiction du dernier livre d’Éric Bénier-Bürckel, Un peu d’abîme sur vos lèvres, je vous propose un article, revu et corrigé, initialement publié dans le numéro 32 de la revue Galaxies (printemps 2004), consacré à l’œuvre remarquable de Philippe Curval, dont Lothar Blues, le prochain roman (qui réactualise le thème du robot), est annoncé chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs & Demain, pour le second semestre 2007. Je reproduis en préambule un portrait de ce remarquable écrivain, paru en décembre 2004 sur le défunt site Mauvais Genres en Bibliothèques.
En attendant la mise en ligne, imminente – je n’attends plus qu’une autorisation de reproduction d’une œuvre photographique très particulière… –, d’une critique-fiction du dernier livre d’Éric Bénier-Bürckel, Un peu d’abîme sur vos lèvres, je vous propose un article, revu et corrigé, initialement publié dans le numéro 32 de la revue Galaxies (printemps 2004), consacré à l’œuvre remarquable de Philippe Curval, dont Lothar Blues, le prochain roman (qui réactualise le thème du robot), est annoncé chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs & Demain, pour le second semestre 2007. Je reproduis en préambule un portrait de ce remarquable écrivain, paru en décembre 2004 sur le défunt site Mauvais Genres en Bibliothèques.
 S’il vous arrive d’arpenter l’asphalte parisien, d’observer la vie qui anime cette ville envers et contre tout, alors vous apercevrez peut-être, surplombant un grand boulevard du haut de son balcon, un homme immobile et barbu, dont les yeux acérés contemplent le monde avec une ironie et un amour qui sont la marque des sages. Mais prenez garde à ne point détourner le regard, ou la silhouette disparaît après un rapide haussement d’épaules, vous laissant seul avec la géométrie urbaine.
S’il vous arrive d’arpenter l’asphalte parisien, d’observer la vie qui anime cette ville envers et contre tout, alors vous apercevrez peut-être, surplombant un grand boulevard du haut de son balcon, un homme immobile et barbu, dont les yeux acérés contemplent le monde avec une ironie et un amour qui sont la marque des sages. Mais prenez garde à ne point détourner le regard, ou la silhouette disparaît après un rapide haussement d’épaules, vous laissant seul avec la géométrie urbaine.
« Je me sens plus metteur en scène qu’écrivain », m’a un jour confié cet homme, Philippe Curval. Boutade ? Pas seulement. C’est que, bien que seules ses activité d’écrivain et de critique soient connues de tous, Philippe Curval est aussi photographe, homme d’images, ou plutôt d’une dialectique, toujours à réinventer, entre image et langage. Certains de ses romans, comme Attention les yeux, ont même été écrits d’après des séries de clichés, inversant le processus habituel d’illustration. Étranges en vérité sont les photographies plasticiennes qu’il réalise à ses heures perdues, mises en scène de la réalité non pas consensuelle mais intérieure, futuriste, surréaliste. Ce goût pour l’artifice, pour le leurre, figure évidemment au premier plan dans ses romans de science-fiction. Les derniers livres de Philippe Curval, qui empruntent au polar comme au space opera, sont ceux d’un illusionniste maître de son art, d’un homme dont le plaisir de créer ne parvient pas à dissimuler tout à fait une certaine mélancolie, ne réussit pas à obombrer complètement l’éclat crépusculaire du regard lucide qu’il porte sur ses contemporains. Dans ses textes, Curval prend un malin plaisir à inventer un jeu de masques et de miroirs dont les règles ne nous sont qu’à moitié dévoilées, et dont le sens est en fait contenu dans la forme même : comme avec ses photographies, il montre la réalité telle qu’il la voit, à travers le prisme de sa perception propre.
Cette réalité, Philippe Curval ne la voit pas en noir, contrairement à nombre d’auteurs de science-fiction, mais plutôt – est-ce l’influence du photographe ? – avec toutes les nuances de gris, du blanc le plus virginal aux ténèbres les plus impénétrables. Car s’il ne tait pas son inquiétude devant la dispersion de la pensée au bénéfice de la consommation, et s’il n’hésite pas à vitupérer contre l’emprise de la fantasy – qu’il juge souvent réactionnaire – sur la science-fiction dans les rayons des librairies, si encore il n’apprécie que modérément l’appellation de « littératures de l’imaginaire », Philippe fait surtout preuve d’un immarcescible enthousiasme quand il s’agit d’imaginer le monde à venir, d’extrapoler les évolutions de la science et d’en inférer les possibles conséquences. Libre penseur, il ne réduit jamais son discours à quelques slogans livrés clés en main par les pourvoyeurs (politiques, religieux...) du prêt-à-penser. Les biotechnologies, par exemple, lui inspirent une éthique intransigeante, voire « radicale » ; et néanmoins, il concède volontiers que c’est la nature même de l’homme, de jouer aux apprentis sorciers : « L’heure est à la mobilisation générale de tous les esprits, écrit-il dans Galaxies n°32 (mars 2004), pour que le surhomme qui hante déjà certains esprits ne se transforme pas en sous-homme. ». Cette attitude, qui me paraît la plus saine, la plus légitime qui soit, n’étonne pas de la part de l’auteur de L’Homme à rebours, qui a toujours défendu un farouche individualisme et s’est toujours attaqué aux diverses formes d’asservissement de l’homme. Pour saisir à quel point cette position relève d’une véritable démarche intellectuelle et non d’une posture d’humanisme bien-pensant, il suffit de considérer combien cet hédoniste pourrait céder, le plus facilement du monde, aux sirènes du repli réactionnaire, se couler dans la douceâtre nostalgie d’une humanité dont il pressent non sans effroi qu’elle se transmue peu à peu en une post-humanité réifiée. Et s’il n’en est rien, si Philippe Curval bannit la nostalgie de son champ de conscience, c’est que, toute explosive qu’elle soit, cette humanité qui lui est chère, comprise comme la somme de tous les hommes et de toutes les femmes, reste encore capable des plus grandes et des plus belles choses.
Ses prochains romans, n’en doutons pas, seront animés du même feu glacé, témoigneront de la même vivacité de ce « metteur en scène » qui se dit pourtant plus lent qu’auparavant. Plus lent peut-être, plus circonspect sans doute, mais pas moins vigoureux.
 Dès ses premiers écrits dans les années cinquante, Philippe Curval mêle des thèmes très dickiens – perception du réel, univers parallèles – et une sensibilité volontiers surréaliste. « L’œuf d’Elduo » (1955) par exemple, est un texte assez caractéristique de sa démarche : une créature d’un autre monde, métaphysique, trouve en l’homme le moyen de s’incarner enfin. C’est l’esprit fertile d’un amateur de science-fiction qu’elle choisit de féconder, pour son imagination à nulle autre pareille ! Et dans « C’est du billard » (1959), une simple compétition de flipper acquiert une dimension cosmique avant d’exploser en une rêverie surréaliste, où faire Tilt a des conséquences inimaginables... Dionysiaques, animés par une authentique et positive volonté de puissance, les personnages curvaliens ne peuvent supporter l’immobilisme, le conformisme, le triomphe nihiliste de la réaction, comme l’idée même de déterminisme. Pour eux la stase est synonyme de mort, au sens métaphorique comme au sens propre. Philippe Curval n’est pas un âne, ou un chameau, il n’est pas encore un enfant : il est un lion qui, au « Tu dois ! » du dragon de Zarathoustra, répond « Je veux ! ». Notre auteur redoute, et combat avec acharnement, la muséification des choses, des êtres – de l’Être – et de son propre acte créatif.
Dès ses premiers écrits dans les années cinquante, Philippe Curval mêle des thèmes très dickiens – perception du réel, univers parallèles – et une sensibilité volontiers surréaliste. « L’œuf d’Elduo » (1955) par exemple, est un texte assez caractéristique de sa démarche : une créature d’un autre monde, métaphysique, trouve en l’homme le moyen de s’incarner enfin. C’est l’esprit fertile d’un amateur de science-fiction qu’elle choisit de féconder, pour son imagination à nulle autre pareille ! Et dans « C’est du billard » (1959), une simple compétition de flipper acquiert une dimension cosmique avant d’exploser en une rêverie surréaliste, où faire Tilt a des conséquences inimaginables... Dionysiaques, animés par une authentique et positive volonté de puissance, les personnages curvaliens ne peuvent supporter l’immobilisme, le conformisme, le triomphe nihiliste de la réaction, comme l’idée même de déterminisme. Pour eux la stase est synonyme de mort, au sens métaphorique comme au sens propre. Philippe Curval n’est pas un âne, ou un chameau, il n’est pas encore un enfant : il est un lion qui, au « Tu dois ! » du dragon de Zarathoustra, répond « Je veux ! ». Notre auteur redoute, et combat avec acharnement, la muséification des choses, des êtres – de l’Être – et de son propre acte créatif.
 Julia, l’héroïne candide des Fleurs de Vénus (1960) ne désire rien tant que fuir son carcan familial et faire exploser le système de castes qui régit la planète. Les Marais-Océan vénusiens, cette « zone du dehors » où se terrent les rebelles autochtones, sont à la fois un lieu de mort (la nuit, ces fleurs mystérieuses qui hantent les marais exhalent des spores extrêmement toxiques, au point que les humains doivent s’en protéger sous des dômes) et de renaissance (il est en fait possible d’accoutumer son organisme à la toxicité des fleurs, qui deviennent ainsi un vecteur inattendu de réconciliation des deux peuples). En dépit de dialogues exagérément dramatiques et de quelques raccourcis maladroits, Les Fleurs de Vénus déclinait déjà, sous une forme romanesque très classique, certains thèmes qui sous-tendront l’œuvre de l’auteur, au premier rang desquels ces velléités anticonformistes, ce rejet de l’ordre établi, cette expérience intime de l’éternel Retour nietzschéen (« Le Même ne revient pas, c’est le revenir seulement qui est le Même de ce qui devient. ») que La Forteresse de coton et L'Homme à rebours illustreront si bien.
Julia, l’héroïne candide des Fleurs de Vénus (1960) ne désire rien tant que fuir son carcan familial et faire exploser le système de castes qui régit la planète. Les Marais-Océan vénusiens, cette « zone du dehors » où se terrent les rebelles autochtones, sont à la fois un lieu de mort (la nuit, ces fleurs mystérieuses qui hantent les marais exhalent des spores extrêmement toxiques, au point que les humains doivent s’en protéger sous des dômes) et de renaissance (il est en fait possible d’accoutumer son organisme à la toxicité des fleurs, qui deviennent ainsi un vecteur inattendu de réconciliation des deux peuples). En dépit de dialogues exagérément dramatiques et de quelques raccourcis maladroits, Les Fleurs de Vénus déclinait déjà, sous une forme romanesque très classique, certains thèmes qui sous-tendront l’œuvre de l’auteur, au premier rang desquels ces velléités anticonformistes, ce rejet de l’ordre établi, cette expérience intime de l’éternel Retour nietzschéen (« Le Même ne revient pas, c’est le revenir seulement qui est le Même de ce qui devient. ») que La Forteresse de coton et L'Homme à rebours illustreront si bien.
 Philippe Curval franchit ensuite un cap d’importance avec Le Ressac de l’espace (1962, Prix Jules Verne), où il préfère la précision du style aux atermoiements psychologiques. La Terre est envahie par les Txalqs, des extraterrestres parasitiques qui se servent des humains comme de supports symbiotiques – la symbiose restant sous leur contrôle absolu, les hommes ayant abdiqué toute volonté propre. Cette acculturation forcée aboutit rapidement à l’érection d’une société utopique, où, comme plus tard dans Congo Pantin, l’abandon du libre-arbitre est le prix à payer pour un bonheur illusoire. Pour Philippe Curval, l’individualisme est un humanisme. Jacques Dureur, le héros, porté par son besoin de liberté et par une mauvaise réceptivité (une immunisation) à l’emprise télépathique des Txalqs, encouragera les résistants à exterminer les extraterrestres, avant d’enfin réaliser son rêve : l’exploration spatiale. Les Txalqs, métaphore des forces négatives qu'encouragent nos États modernes, sont les premiers extraterrestres marquants, importants, de l’œuvre curvalienne. Beaucoup d’autres suivront. Notre auteur leur a en effet toujours manifesté un vif intérêt. L’alien lui permet de mettre notre réel en perspective, de décliner la « gamme des possibles », mais aussi d’exprimer sa liberté fondamentale de « créateur de formes », dans tous les sens du terme. Les nombreux êtres insolites qui hantent les pages de ses textes, jusqu’au récent Rasta solitude (les Diamoniens masochistes de Ovni soit qui mal y pense, l’entité polymorphe du Sourire du chauve ou encore l’extraordinaire machine-créature de Barre/Watis) en témoignent largement.
Philippe Curval franchit ensuite un cap d’importance avec Le Ressac de l’espace (1962, Prix Jules Verne), où il préfère la précision du style aux atermoiements psychologiques. La Terre est envahie par les Txalqs, des extraterrestres parasitiques qui se servent des humains comme de supports symbiotiques – la symbiose restant sous leur contrôle absolu, les hommes ayant abdiqué toute volonté propre. Cette acculturation forcée aboutit rapidement à l’érection d’une société utopique, où, comme plus tard dans Congo Pantin, l’abandon du libre-arbitre est le prix à payer pour un bonheur illusoire. Pour Philippe Curval, l’individualisme est un humanisme. Jacques Dureur, le héros, porté par son besoin de liberté et par une mauvaise réceptivité (une immunisation) à l’emprise télépathique des Txalqs, encouragera les résistants à exterminer les extraterrestres, avant d’enfin réaliser son rêve : l’exploration spatiale. Les Txalqs, métaphore des forces négatives qu'encouragent nos États modernes, sont les premiers extraterrestres marquants, importants, de l’œuvre curvalienne. Beaucoup d’autres suivront. Notre auteur leur a en effet toujours manifesté un vif intérêt. L’alien lui permet de mettre notre réel en perspective, de décliner la « gamme des possibles », mais aussi d’exprimer sa liberté fondamentale de « créateur de formes », dans tous les sens du terme. Les nombreux êtres insolites qui hantent les pages de ses textes, jusqu’au récent Rasta solitude (les Diamoniens masochistes de Ovni soit qui mal y pense, l’entité polymorphe du Sourire du chauve ou encore l’extraordinaire machine-créature de Barre/Watis) en témoignent largement.
 La Forteresse de coton, chef d’œuvre baroque, inclassable, ode au désir et à l’amour fou portée par un souffle dont fort peu d’écrivains peuvent aujourd’hui se réclamer, délaisse les extraterrestres pour nous plonger dans les profonds abîmes intérieurs du cerveau d’un homme, victime d’un dédoublement de personnalité. De retour de Turquie, dans l’ombre d’une Venise glauque, matricielle et mortifère, un géologue, Blaise Canehan – à moins qu’il ne s’appelle Julien Cholle –, rencontre une femme, Sarah, dont il lui semble avoir de très intimes souvenirs. Les circonstances les éloignent, mais même inaccessibles l’un à l’autre, Sarah et Canehan paraissent liés par un même fil mystérieux – la passion. C’est au sein des eaux fangeuses des canaux vénitiens, matrice pernicieuse, à la fois lieu de genèse et de mort (comme les Marais-Océan des Fleurs de Vénus) où l’on se suicide, où l’on est assassiné, et où Cholle/Canehan accouche de sa nouvelle identité, c’est au sein de ces eaux, donc, que Canehan, confronté à l’étrange blessure au ventre de Sarah qui leur interdit de s’aimer, enfin débarrassé d’un passé trop encombrant, accouchera littéralement de sa nouvelle identité, assassiné par son propre double… Lisons alors La Forteresse de coton comme un urgent manifeste esthétique ; de la nécessité pour l’artiste de tuer son œuvre pour sans cesse la réinventer. L’art comme déhiscence éternellement recommencée, ou la folie – et la mort… La vie selon Philippe Curval est une grossesse dangereuse et permanente. Roman après roman, il accorde à ses personnages les moyens de leurs ambitions ; leur individualisme absolu, leur haine de l’habitude, leur besoin de faire table rase du passé, les amène à modeler le réel selon leurs désirs – ce qui a fait dire à Denis Guiot, non sans raison, s’appuyant sur les références explicites contenues entre autres dans l’admirable nouvelle « Un souvenir de Pierre Loti » (in Utopies 75, 1975), que Curval était un écrivain existentialiste. Philippe Curval semble en effet croire fondamentalement en ce pouvoir créateur de l’esprit humain – sa volonté de puissance. La Forteresse de coton inaugurait ainsi une nouvelle esthétique – issue du mariage inattendu des expérimentations formelles du Nouveau Roman et de la science-fiction moderne – qui sera désormais développée dans tous ses textes majeurs. Il faut remarquer que La Forteresse de coton, comme la plupart des romans de Philippe Curval, est écrit à la troisième personne, ce qui n’a évidemment rien de fortuit : ses personnages doivent s’affranchir de leur créateur. Ils existent indépendamment de leur auteur, tout démiurge soit-il...
La Forteresse de coton, chef d’œuvre baroque, inclassable, ode au désir et à l’amour fou portée par un souffle dont fort peu d’écrivains peuvent aujourd’hui se réclamer, délaisse les extraterrestres pour nous plonger dans les profonds abîmes intérieurs du cerveau d’un homme, victime d’un dédoublement de personnalité. De retour de Turquie, dans l’ombre d’une Venise glauque, matricielle et mortifère, un géologue, Blaise Canehan – à moins qu’il ne s’appelle Julien Cholle –, rencontre une femme, Sarah, dont il lui semble avoir de très intimes souvenirs. Les circonstances les éloignent, mais même inaccessibles l’un à l’autre, Sarah et Canehan paraissent liés par un même fil mystérieux – la passion. C’est au sein des eaux fangeuses des canaux vénitiens, matrice pernicieuse, à la fois lieu de genèse et de mort (comme les Marais-Océan des Fleurs de Vénus) où l’on se suicide, où l’on est assassiné, et où Cholle/Canehan accouche de sa nouvelle identité, c’est au sein de ces eaux, donc, que Canehan, confronté à l’étrange blessure au ventre de Sarah qui leur interdit de s’aimer, enfin débarrassé d’un passé trop encombrant, accouchera littéralement de sa nouvelle identité, assassiné par son propre double… Lisons alors La Forteresse de coton comme un urgent manifeste esthétique ; de la nécessité pour l’artiste de tuer son œuvre pour sans cesse la réinventer. L’art comme déhiscence éternellement recommencée, ou la folie – et la mort… La vie selon Philippe Curval est une grossesse dangereuse et permanente. Roman après roman, il accorde à ses personnages les moyens de leurs ambitions ; leur individualisme absolu, leur haine de l’habitude, leur besoin de faire table rase du passé, les amène à modeler le réel selon leurs désirs – ce qui a fait dire à Denis Guiot, non sans raison, s’appuyant sur les références explicites contenues entre autres dans l’admirable nouvelle « Un souvenir de Pierre Loti » (in Utopies 75, 1975), que Curval était un écrivain existentialiste. Philippe Curval semble en effet croire fondamentalement en ce pouvoir créateur de l’esprit humain – sa volonté de puissance. La Forteresse de coton inaugurait ainsi une nouvelle esthétique – issue du mariage inattendu des expérimentations formelles du Nouveau Roman et de la science-fiction moderne – qui sera désormais développée dans tous ses textes majeurs. Il faut remarquer que La Forteresse de coton, comme la plupart des romans de Philippe Curval, est écrit à la troisième personne, ce qui n’a évidemment rien de fortuit : ses personnages doivent s’affranchir de leur créateur. Ils existent indépendamment de leur auteur, tout démiurge soit-il...
 Dès lors, Philippe Curval évolue dans une interzone littéraire où la frontière qui sépare science-fiction et littérature générale est inopérante, où science-fiction et littérature deviennent quasiment synonymes. Notre auteur a compris qu’écrire, c’est non pas représenter le monde, mais le créer, littérairement (« réelliser des idées », dirait aujourd’hui Alain Damasio, l’autre grand romancier de la vie en mouvement). Pour Roland Barthes, « [l]’écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire. » La spéculation de Philippe Curval, précisément, ne concerne pas seulement son imaginaire : elle est au cœur de son langage, elle est plus formelle que scientifique – en cela, sa démarche est à rapprocher du mouvement surréaliste, comme l’auteur le fit remarquer lui-même. Curval s’attaque aux structures mêmes de son art et cherche à transmuer le réalisme mimétique en réalisme littéraire. Ce travail de sape du matériau littéraire est d’ailleurs l’un des enjeux du rocambolesque space opera Les sables de Falun (1970), dont la structure déroutante, inspirée de Raymond Roussel, conduisit l’auteur à en proposer une version plus linéaire. Mais c’est surtout avec Attention les yeux et L’Homme à rebours que Philippe Curval va trouver la pleine mesure de ses ambitions et confirmer le génie à l’œuvre dans La Forteresse de coton.
Dès lors, Philippe Curval évolue dans une interzone littéraire où la frontière qui sépare science-fiction et littérature générale est inopérante, où science-fiction et littérature deviennent quasiment synonymes. Notre auteur a compris qu’écrire, c’est non pas représenter le monde, mais le créer, littérairement (« réelliser des idées », dirait aujourd’hui Alain Damasio, l’autre grand romancier de la vie en mouvement). Pour Roland Barthes, « [l]’écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire. » La spéculation de Philippe Curval, précisément, ne concerne pas seulement son imaginaire : elle est au cœur de son langage, elle est plus formelle que scientifique – en cela, sa démarche est à rapprocher du mouvement surréaliste, comme l’auteur le fit remarquer lui-même. Curval s’attaque aux structures mêmes de son art et cherche à transmuer le réalisme mimétique en réalisme littéraire. Ce travail de sape du matériau littéraire est d’ailleurs l’un des enjeux du rocambolesque space opera Les sables de Falun (1970), dont la structure déroutante, inspirée de Raymond Roussel, conduisit l’auteur à en proposer une version plus linéaire. Mais c’est surtout avec Attention les yeux et L’Homme à rebours que Philippe Curval va trouver la pleine mesure de ses ambitions et confirmer le génie à l’œuvre dans La Forteresse de coton.
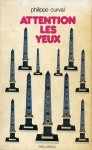 Guillaume Coiranne, le photographe de Attention les yeux (1972), éprouve comme les autres personnages curvaliens une peur compulsive de contracter la moindre habitude, la moindre routine ; il voue alors sa vie à se réinventer lui-même – et à réinventer le monde – en déambulant dans le Paris des années soixante (on pense souvent aux films de la Nouvelle Vague), rendu ici avec une rare acuité. La défiance de Coiranne envers toute forme de déterminisme est telle que celui-ci attribue arbitrairement des vertus prophétiques à ses parties de flipper (comme dans « C’est du billard »), et qu’il se crée un passé fictif, engageant des acteurs pour jouer une sœur ou un oncle imaginaires – pour donner corps à son fantasme –, comme s’il désirait, à défaut, choisir ses propres contingences. Coiranne est donc un « homme à rebours » qui met en scène ses propres origines, dans le seul but de se dégager de nouveaux horizons. « Dès qu’il avait eu conscience de cette faculté de s’abstraire en totalité du monde, il avait placé en lui une petite bombe mentale à retardement qui lui permettrait de revenir à la surface. Elle s’amorçait au moindre événement extérieur. » Cette faculté – ici seulement métaphorique – de créer des univers parallèles, annonce le Félix Giarre de L’Homme à rebours et poursuit la réflexion esthétique entamée avec La Forteresse de coton. Attention les yeux, cet hommage au pouvoir de l’esprit et de l’imagination, traduit aussi un regard effrayé sur la mort : Coiranne, en se dérobant à la réalité consensuelle, veut surtout échapper à sa condition de mortel. Il est aussi, plus encore que le Cholle/Canehan de La Forteresse de coton, la figure métaphorique de l’écrivain, du créateur de fiction qui doit sans cesse réinventer le monde – sous peine de disparaître.
Guillaume Coiranne, le photographe de Attention les yeux (1972), éprouve comme les autres personnages curvaliens une peur compulsive de contracter la moindre habitude, la moindre routine ; il voue alors sa vie à se réinventer lui-même – et à réinventer le monde – en déambulant dans le Paris des années soixante (on pense souvent aux films de la Nouvelle Vague), rendu ici avec une rare acuité. La défiance de Coiranne envers toute forme de déterminisme est telle que celui-ci attribue arbitrairement des vertus prophétiques à ses parties de flipper (comme dans « C’est du billard »), et qu’il se crée un passé fictif, engageant des acteurs pour jouer une sœur ou un oncle imaginaires – pour donner corps à son fantasme –, comme s’il désirait, à défaut, choisir ses propres contingences. Coiranne est donc un « homme à rebours » qui met en scène ses propres origines, dans le seul but de se dégager de nouveaux horizons. « Dès qu’il avait eu conscience de cette faculté de s’abstraire en totalité du monde, il avait placé en lui une petite bombe mentale à retardement qui lui permettrait de revenir à la surface. Elle s’amorçait au moindre événement extérieur. » Cette faculté – ici seulement métaphorique – de créer des univers parallèles, annonce le Félix Giarre de L’Homme à rebours et poursuit la réflexion esthétique entamée avec La Forteresse de coton. Attention les yeux, cet hommage au pouvoir de l’esprit et de l’imagination, traduit aussi un regard effrayé sur la mort : Coiranne, en se dérobant à la réalité consensuelle, veut surtout échapper à sa condition de mortel. Il est aussi, plus encore que le Cholle/Canehan de La Forteresse de coton, la figure métaphorique de l’écrivain, du créateur de fiction qui doit sans cesse réinventer le monde – sous peine de disparaître.
 Avec L’Homme à rebours (Grand Prix de l’Imaginaire 1975), Philippe Curval ne se contente plus de cette vision métaphorique de l’individu créateur d’univers. Ce roman – que l’on peut sans peine considérer comme l’un des plus envoûtants de la SF française – est encore une histoire d’amour fou (désir et passion, manifestations patentes de l’inconscient, sont aussi au cœur de sa littérature) en même temps qu’une authentique aventure spéculative à l’imaginaire débordant et au style aussi brut qu'halluciné. Cette fois, nous quittons définitivement les rivages de la réalité conventionnelle : les émanations de l’esprit prennent ici valeur de Création pure, au sens théologique du terme ; Félix Giarre, le héros naufragé sur un monde parallèle à la suite de ses « voyages analogiques », est investi de pouvoirs divins : il comprend alors que tout cela provient de son propre esprit, qu’il en est le suprême créateur. Giarre, qui a renié son père et tué sa mère, rejette le rôle de grand ordonnateur qu’un superordinateur lui a imposé. Il hurle, revendique son libre-arbitre d’individu enfin vierge de tout souvenir et de toute attache, et explose en une infinité de possibles. Dans une critique, Michel Jeury, autre grand romancier de science-fiction plus connu aujourd'hui pour ses romans du terroir, reprochait à L’Homme à rebours une certaine préciosité de style qui, selon lui, phagocyterait l’impact du roman. Or ici la recherche formelle – éclatement du récit, style incandescent – est un enjeu majeur : Philippe Curval consacre la toute-puissance de l’écriture, comme il le fait la même année dans « Un souvenir de Pierre Loti », où la quête de l’harmonie universelle se heurte à l'évènement le plus égoïste et le plus beau qui soit : l’amour d’une femme. On sent bien, à la lecture de L’Homme à rebours, que son auteur l’a écrit dans un état de fièvre créatrice, comme s’il s’était momentanément confondu avec son personnage – d’où une narration à la première personne. Quelques années plus tard, en 1977, l’auteur nous offrira une version ludique et distanciée de L’Homme à rebours avec Un soupçon de néant, hommage appuyé à la science-fiction classique (Van Vogt, Asimov, Simak…) et jeu virtuose sur les rapports entre réel et fiction, sur le modèle de L’univers en folie de Fredric Brown.
Avec L’Homme à rebours (Grand Prix de l’Imaginaire 1975), Philippe Curval ne se contente plus de cette vision métaphorique de l’individu créateur d’univers. Ce roman – que l’on peut sans peine considérer comme l’un des plus envoûtants de la SF française – est encore une histoire d’amour fou (désir et passion, manifestations patentes de l’inconscient, sont aussi au cœur de sa littérature) en même temps qu’une authentique aventure spéculative à l’imaginaire débordant et au style aussi brut qu'halluciné. Cette fois, nous quittons définitivement les rivages de la réalité conventionnelle : les émanations de l’esprit prennent ici valeur de Création pure, au sens théologique du terme ; Félix Giarre, le héros naufragé sur un monde parallèle à la suite de ses « voyages analogiques », est investi de pouvoirs divins : il comprend alors que tout cela provient de son propre esprit, qu’il en est le suprême créateur. Giarre, qui a renié son père et tué sa mère, rejette le rôle de grand ordonnateur qu’un superordinateur lui a imposé. Il hurle, revendique son libre-arbitre d’individu enfin vierge de tout souvenir et de toute attache, et explose en une infinité de possibles. Dans une critique, Michel Jeury, autre grand romancier de science-fiction plus connu aujourd'hui pour ses romans du terroir, reprochait à L’Homme à rebours une certaine préciosité de style qui, selon lui, phagocyterait l’impact du roman. Or ici la recherche formelle – éclatement du récit, style incandescent – est un enjeu majeur : Philippe Curval consacre la toute-puissance de l’écriture, comme il le fait la même année dans « Un souvenir de Pierre Loti », où la quête de l’harmonie universelle se heurte à l'évènement le plus égoïste et le plus beau qui soit : l’amour d’une femme. On sent bien, à la lecture de L’Homme à rebours, que son auteur l’a écrit dans un état de fièvre créatrice, comme s’il s’était momentanément confondu avec son personnage – d’où une narration à la première personne. Quelques années plus tard, en 1977, l’auteur nous offrira une version ludique et distanciée de L’Homme à rebours avec Un soupçon de néant, hommage appuyé à la science-fiction classique (Van Vogt, Asimov, Simak…) et jeu virtuose sur les rapports entre réel et fiction, sur le modèle de L’univers en folie de Fredric Brown.
 Cette critique de l’utopie ébauchée dans Le Ressac de l’espace et « Un souvenir de Pierre Loti » est développée dans Cette chère humanité (1976, Prix Apollo 1977), qui reste encore aujourd’hui son plus célèbre roman. Cette chère humanité opère en quelque sorte la jonction entre les préoccupations individualistes de notre auteur, et sa volonté de puissance, son désir de soumettre le réel au feu de sa volonté (et de son inconscient). De cette rencontre naît un récit brillant et inventif qui a marqué les mémoires. Le Marcom (marché commun regroupant treize riches états européens, coupés du reste du monde par une barrière d’armes neurologiques réputée infranchissable) est une société ultraconservatrice fondée sur l’autarcie et la stabilité. Les arts n’existent plus, taxés de décadence parce qu’ils introduiraient le changement, source de dégénérescence. Au Marcom tout est aseptisé, hygiénique, régulé. C’est donc à l’implosion d’un monde muséifié (le passe-temps favoris des citoyens du Marcom est d’ailleurs l’accumulation de biens), autrement dit au spectacle du nihilisme moderne selon Nietzsche, que nous convie l’auteur. Les « cabines de temps ralenti », où les citoyens peuvent vivre un temps objectif toujours plus étiré, sont une superbe métaphore de la paresse, du protectionnisme, de la frilosité qui menacent nos sociétés occidentales de plus en plus repliées sur elles-mêmes – ce « monde d’avachis » évoqué par Antonin Artaud dans Vang Gogh le suicidé de la société. La fin du roman, apothéose surréaliste, est un véritable tour de force en même temps qu’une peinture ironique du danger qui nous guette : le Marcom, perturbé par une trop grande distorsion temporelle, se replie littéralement sur lui-même ; l’univers est alors contenu tout entier dans une cabine ! Le cycle de « l’Europe après la pluie » – qui tire son titre d’un magnifique tableau de Max Ernst et qui est constitué de Cette chère humanité, de Le dormeur s’éveillera-t-il (1979) et de En souvenir du futur (1986) –, est un plaidoyer pour un renouvellement constant du monde, un hymne baroque à l’imaginaire.
Cette critique de l’utopie ébauchée dans Le Ressac de l’espace et « Un souvenir de Pierre Loti » est développée dans Cette chère humanité (1976, Prix Apollo 1977), qui reste encore aujourd’hui son plus célèbre roman. Cette chère humanité opère en quelque sorte la jonction entre les préoccupations individualistes de notre auteur, et sa volonté de puissance, son désir de soumettre le réel au feu de sa volonté (et de son inconscient). De cette rencontre naît un récit brillant et inventif qui a marqué les mémoires. Le Marcom (marché commun regroupant treize riches états européens, coupés du reste du monde par une barrière d’armes neurologiques réputée infranchissable) est une société ultraconservatrice fondée sur l’autarcie et la stabilité. Les arts n’existent plus, taxés de décadence parce qu’ils introduiraient le changement, source de dégénérescence. Au Marcom tout est aseptisé, hygiénique, régulé. C’est donc à l’implosion d’un monde muséifié (le passe-temps favoris des citoyens du Marcom est d’ailleurs l’accumulation de biens), autrement dit au spectacle du nihilisme moderne selon Nietzsche, que nous convie l’auteur. Les « cabines de temps ralenti », où les citoyens peuvent vivre un temps objectif toujours plus étiré, sont une superbe métaphore de la paresse, du protectionnisme, de la frilosité qui menacent nos sociétés occidentales de plus en plus repliées sur elles-mêmes – ce « monde d’avachis » évoqué par Antonin Artaud dans Vang Gogh le suicidé de la société. La fin du roman, apothéose surréaliste, est un véritable tour de force en même temps qu’une peinture ironique du danger qui nous guette : le Marcom, perturbé par une trop grande distorsion temporelle, se replie littéralement sur lui-même ; l’univers est alors contenu tout entier dans une cabine ! Le cycle de « l’Europe après la pluie » – qui tire son titre d’un magnifique tableau de Max Ernst et qui est constitué de Cette chère humanité, de Le dormeur s’éveillera-t-il (1979) et de En souvenir du futur (1986) –, est un plaidoyer pour un renouvellement constant du monde, un hymne baroque à l’imaginaire.
 Après Rut aux étoiles (1979), réjouissant space opera où les hommes « croissent et se multiplient […] pour être éjaculés un jour dans la galaxie, ou ailleurs, afin de peupler l’univers. », Philippe Curval retrouve la veine schizoïde de La Forteresse de coton avec le très introspectif Y a quelqu’un ? (1979). Clément Volgré, un marginal farouchement individualiste, entrevoit une réalité parallèle où les extraterrestres envahissent Paris à notre insu. L’auteur dépeint ici un Paris déliquescent, dégénérescent, dont l’architecture adopte des formes inquiétantes, inhumaines – la ville devient un labyrinthe inextricable, reflet incertain de l’esprit instable de Volgré. En ce sens, Y a quelqu’un ? est un Solaris urbain où Volgré, hanté par ses visions fantasmatiques, est confronté à l’énigme de sa propre psyché et au souvenir de sa compagne volatilisée. Le déphasage naît à la fois des excès éthyliques de Volgré, et de l’explosion originelle de téléviseurs dans une boutique – comme si alcool et télévision lui avaient offert le refuge d’une nouvelle dimension (plus tard, dans la nouvelle « Regarde, fiston, s’il n’y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin », le delirium tremens ouvrira encore les portes de la perception…). Puissante métaphore de la décadence urbaine, Y a quelqu’un ? hante longtemps après sa lecture.
Après Rut aux étoiles (1979), réjouissant space opera où les hommes « croissent et se multiplient […] pour être éjaculés un jour dans la galaxie, ou ailleurs, afin de peupler l’univers. », Philippe Curval retrouve la veine schizoïde de La Forteresse de coton avec le très introspectif Y a quelqu’un ? (1979). Clément Volgré, un marginal farouchement individualiste, entrevoit une réalité parallèle où les extraterrestres envahissent Paris à notre insu. L’auteur dépeint ici un Paris déliquescent, dégénérescent, dont l’architecture adopte des formes inquiétantes, inhumaines – la ville devient un labyrinthe inextricable, reflet incertain de l’esprit instable de Volgré. En ce sens, Y a quelqu’un ? est un Solaris urbain où Volgré, hanté par ses visions fantasmatiques, est confronté à l’énigme de sa propre psyché et au souvenir de sa compagne volatilisée. Le déphasage naît à la fois des excès éthyliques de Volgré, et de l’explosion originelle de téléviseurs dans une boutique – comme si alcool et télévision lui avaient offert le refuge d’une nouvelle dimension (plus tard, dans la nouvelle « Regarde, fiston, s’il n’y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin », le delirium tremens ouvrira encore les portes de la perception…). Puissante métaphore de la décadence urbaine, Y a quelqu’un ? hante longtemps après sa lecture.
 Nous l’avons vu, Philippe Curval n’aime rien tant qu’inventer des extraterrestres avec leur mode de vie, leurs particularités physiques et comportementales. Ils sont l’Autre, le Différent, ils augmentent le monde, ils le renouvellent. Dans La Face cachée du désir (1980), roman sous forme de trois nouvelles étroitement liées et situées sur la planète Chula, il quitte l’univers faussement réaliste de Y a quelqu’un ? pour camper un monde foncièrement original. Il y est question, entre autres, d’un rite initiatique et onirique où l’enfant s’invagine dans une matrice géante, d’où naît alors un homme nouveau, délivré de sa vie antérieure, évident symbole de la renaissance – l’éternel Retour centrifuge, ou sélectif, de Nietzsche – si chère à l’auteur. Lorsqu’ils ne sont plus en contact avec le sol, les Chulies se subliment : ils disparaissent, littéralement. Ils créent leur réel, et Philippe Curval, avec ses livres, nous propose lui aussi une phénoménologie singulière. Il fait siens les mots de Philip K. Dick cités épigraphe du Temps incertain de Michel Jeury : « J’ai le sentiment profond qu’à un certain degré il y a presque autant d’univers qu’il y a de gens, que chaque individu vit en quelque sorte dans un univers de sa propre création : c’est un produit de son être, une œuvre personnelle dont peut-être il pourrait être fier. ».
Nous l’avons vu, Philippe Curval n’aime rien tant qu’inventer des extraterrestres avec leur mode de vie, leurs particularités physiques et comportementales. Ils sont l’Autre, le Différent, ils augmentent le monde, ils le renouvellent. Dans La Face cachée du désir (1980), roman sous forme de trois nouvelles étroitement liées et situées sur la planète Chula, il quitte l’univers faussement réaliste de Y a quelqu’un ? pour camper un monde foncièrement original. Il y est question, entre autres, d’un rite initiatique et onirique où l’enfant s’invagine dans une matrice géante, d’où naît alors un homme nouveau, délivré de sa vie antérieure, évident symbole de la renaissance – l’éternel Retour centrifuge, ou sélectif, de Nietzsche – si chère à l’auteur. Lorsqu’ils ne sont plus en contact avec le sol, les Chulies se subliment : ils disparaissent, littéralement. Ils créent leur réel, et Philippe Curval, avec ses livres, nous propose lui aussi une phénoménologie singulière. Il fait siens les mots de Philip K. Dick cités épigraphe du Temps incertain de Michel Jeury : « J’ai le sentiment profond qu’à un certain degré il y a presque autant d’univers qu’il y a de gens, que chaque individu vit en quelque sorte dans un univers de sa propre création : c’est un produit de son être, une œuvre personnelle dont peut-être il pourrait être fier. ».
 Durant les années 80 furent publiés pas moins de cinq recueils de nouvelles (Le Livre d’or de Philippe Curval, 1980, Regarde, fiston, s’il n’y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin, 1980, Debout, les morts ! le train fantôme entre en gare, 1984, Comment jouer à l’homme invisible en trois leçons, 1986, et Habite-t-on réellement quelque part ?, 1989), une anthologie (Superfuturs, 1986) et cinq romans. Tous vers l’extase (1981) d’abord, où notre auteur érige le désir en principe esthétique (ouvertement érotique – mais sur un mode ludique –, Tous vers l’extase est une réponse hédoniste à la pudibonderie qui marquait alors la SF ; faut-il rappeler que « Curval » est, à l’origine, le nom d’un des psychopathes sexuels des 120 jours de Sodome, du Marquis de Sade ?...) ; L’odeur de la bête (1981) ensuite, dans lequel un homme s’éprend d’un Naonyth, sorte de kangourou intelligent et sensuel ; Ah ! que c’est beau New York (1986), roman dépressif sur la dérive états-unienne d’un schizophrène ; En souvenir du futur, déjà évoqué, et Akiloë (1988), beau roman sur un jeune indien guyanais confronté au monde moderne, que Philippe Curval considère comme son Grand Œuvre inachevé (et dont nous devrions peut-être découvrir la version intégrale dans les années qui viennent). De ces années, nous retiendrons surtout la consécration d’un nouvelliste d’exception. Son Livre d’or en particulier, présenté par André Ruellan, réunit les meilleurs textes de l’auteur depuis ses débuts, et figure parmi les plus belles réussites de la prestigieuse collection.
Durant les années 80 furent publiés pas moins de cinq recueils de nouvelles (Le Livre d’or de Philippe Curval, 1980, Regarde, fiston, s’il n’y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin, 1980, Debout, les morts ! le train fantôme entre en gare, 1984, Comment jouer à l’homme invisible en trois leçons, 1986, et Habite-t-on réellement quelque part ?, 1989), une anthologie (Superfuturs, 1986) et cinq romans. Tous vers l’extase (1981) d’abord, où notre auteur érige le désir en principe esthétique (ouvertement érotique – mais sur un mode ludique –, Tous vers l’extase est une réponse hédoniste à la pudibonderie qui marquait alors la SF ; faut-il rappeler que « Curval » est, à l’origine, le nom d’un des psychopathes sexuels des 120 jours de Sodome, du Marquis de Sade ?...) ; L’odeur de la bête (1981) ensuite, dans lequel un homme s’éprend d’un Naonyth, sorte de kangourou intelligent et sensuel ; Ah ! que c’est beau New York (1986), roman dépressif sur la dérive états-unienne d’un schizophrène ; En souvenir du futur, déjà évoqué, et Akiloë (1988), beau roman sur un jeune indien guyanais confronté au monde moderne, que Philippe Curval considère comme son Grand Œuvre inachevé (et dont nous devrions peut-être découvrir la version intégrale dans les années qui viennent). De ces années, nous retiendrons surtout la consécration d’un nouvelliste d’exception. Son Livre d’or en particulier, présenté par André Ruellan, réunit les meilleurs textes de l’auteur depuis ses débuts, et figure parmi les plus belles réussites de la prestigieuse collection.
 La déconvenue éditoriale d’Akiloë explique peut-être le silence radio de Philippe Curval durant la première moitié des années 90. Il revient cependant sur le devant de la scène en 1995 avec L’éternité n’est pas la vie, roman intéressant mais inabouti sur l’Égypte, et surtout avec une œuvre inclassable : Les évadés du mirage (réédité en Folio SF sous le titre Congo Pantin). Un vaisseau extraterrestre s’est écrasé sur Pantin, en banlieue parisienne. Les aliens pixellisés, les « Neutres », prodiguent des flashes oniriques aux humains, par simple contact ; ces flashes agissent comme les shoots d’une drogue dure : ils provoquent un choc proche de l’orgasme, entraînant une véritable dépendance et annihilant toute volonté. Philippe Curval, nous le savons, ne déteste rien tant que le confort de la servitude volontaire. C’est pourquoi l’ambivalence règne sans partage sur le roman – dont le territoire latent est sans aucun doute l’inconscient (celui de l’auteur, celui des personnages, celui du lecteur). Ainsi Congo et Zaïre – ce dernier est aussi noir que Congo est albinos – sont les deux faces d’un même individu. Ils incarnent non pas le réel et la fiction, mais deux facettes d’une même réalité – ou d’une même fiction. Mieux : ils sont eux-mêmes explicitement confrontés à leur statut de créatures fictionnelles, ce que l’auteur n’avait jamais osé jusque là. En existentialiste facétieux, Curval prend ainsi Descartes à la lettre et illustre son cogito par l’absurde : « je pense donc je suis » signifie pour lui : j’existe parce qu’au préalable, je me suis pensé (paradoxe déjà développé magistralement dans « Un souvenir de Pierre Loti »). Congo Pantin est une œuvre totalement surréaliste, virtuose, où l’extraterrestre, figure emblématique de l’œuvre de Philippe Curval, joue un rôle éminemment symbolique de révélateur de l’inconscient, avec tout ce que cela suppose de désirs et de peurs refoulés.
La déconvenue éditoriale d’Akiloë explique peut-être le silence radio de Philippe Curval durant la première moitié des années 90. Il revient cependant sur le devant de la scène en 1995 avec L’éternité n’est pas la vie, roman intéressant mais inabouti sur l’Égypte, et surtout avec une œuvre inclassable : Les évadés du mirage (réédité en Folio SF sous le titre Congo Pantin). Un vaisseau extraterrestre s’est écrasé sur Pantin, en banlieue parisienne. Les aliens pixellisés, les « Neutres », prodiguent des flashes oniriques aux humains, par simple contact ; ces flashes agissent comme les shoots d’une drogue dure : ils provoquent un choc proche de l’orgasme, entraînant une véritable dépendance et annihilant toute volonté. Philippe Curval, nous le savons, ne déteste rien tant que le confort de la servitude volontaire. C’est pourquoi l’ambivalence règne sans partage sur le roman – dont le territoire latent est sans aucun doute l’inconscient (celui de l’auteur, celui des personnages, celui du lecteur). Ainsi Congo et Zaïre – ce dernier est aussi noir que Congo est albinos – sont les deux faces d’un même individu. Ils incarnent non pas le réel et la fiction, mais deux facettes d’une même réalité – ou d’une même fiction. Mieux : ils sont eux-mêmes explicitement confrontés à leur statut de créatures fictionnelles, ce que l’auteur n’avait jamais osé jusque là. En existentialiste facétieux, Curval prend ainsi Descartes à la lettre et illustre son cogito par l’absurde : « je pense donc je suis » signifie pour lui : j’existe parce qu’au préalable, je me suis pensé (paradoxe déjà développé magistralement dans « Un souvenir de Pierre Loti »). Congo Pantin est une œuvre totalement surréaliste, virtuose, où l’extraterrestre, figure emblématique de l’œuvre de Philippe Curval, joue un rôle éminemment symbolique de révélateur de l’inconscient, avec tout ce que cela suppose de désirs et de peurs refoulés.
Notre infatigable écrivain publie ensuite deux romans mineurs, Macno emmerde la mort (1998) et Voyance aveugle (1998). Passons rapidement sur le premier, plutôt dispoensable (mais lisez sans crainte la nouvelle, excellente, dont il est tiré, « Permis de mourir »). L’idée de base de Voyance aveugle était autrement intéressante : le monde des rêves (l’univers du « rêve incréé ») serait gouverné par les anciens dieux aztèques, qui ne seraient autres que des extraterrestres bannis de leur monde originel…. Hélas, passée une première partie dépaysante, qui rappelle les meilleurs textes courts de l’auteur, le récit ne tient pas toutes ses promesses et s’enlise dans une intrigue confuse.
 Plus complexe est le cas de Voyage à l’envers (2000), qui propose quelques réflexions sur les médias et la civilisation occidentale moderne. L’absence de grand conflit fédérateur et la mort des religions, la fin des phénomènes de rassemblement populaire, auraient causé une névrose schizophrénique de la société, comme chez J.G. Ballard, que seule la menace d’une invasion extraterrestre sauve in extremis de la catatonie générale… Notre auteur exploite également la dépendance de notre civilisation à la technologie. Les rayonnements extraterrestres parasitent en effet les systèmes informatiques, si bien que le chaos menace la planète. Les gouvernements lancent alors le programme spatial Colomb : quelques hommes triés sur le volet iront résoudre le problème à sa source, vers Proxima du Centaure. À son retour sur Terre, après un voyage périlleux mais infructueux, l’équipage découvre que les extraterrestres ont déjà envahi la planète et ont soumis l’humanité à leur contrôle. Curieusement, les Centaures semblent avoir reconstitué le monde des années 70, mais sous une forme pervertie, comme s’il était contemplé à travers le miroir déformant de nos fantasmes. Le roman s’achève (trop) abruptement, alors que Piscop, le héros et narrateur, organise la résistance.
Plus complexe est le cas de Voyage à l’envers (2000), qui propose quelques réflexions sur les médias et la civilisation occidentale moderne. L’absence de grand conflit fédérateur et la mort des religions, la fin des phénomènes de rassemblement populaire, auraient causé une névrose schizophrénique de la société, comme chez J.G. Ballard, que seule la menace d’une invasion extraterrestre sauve in extremis de la catatonie générale… Notre auteur exploite également la dépendance de notre civilisation à la technologie. Les rayonnements extraterrestres parasitent en effet les systèmes informatiques, si bien que le chaos menace la planète. Les gouvernements lancent alors le programme spatial Colomb : quelques hommes triés sur le volet iront résoudre le problème à sa source, vers Proxima du Centaure. À son retour sur Terre, après un voyage périlleux mais infructueux, l’équipage découvre que les extraterrestres ont déjà envahi la planète et ont soumis l’humanité à leur contrôle. Curieusement, les Centaures semblent avoir reconstitué le monde des années 70, mais sous une forme pervertie, comme s’il était contemplé à travers le miroir déformant de nos fantasmes. Le roman s’achève (trop) abruptement, alors que Piscop, le héros et narrateur, organise la résistance.
 Blanc comme l’ombre (2003), son dernier roman en date, laisse une toute autre impression. Dans ce roman élégiaque, l’auteur développe les thèmes du double et de la multiplicité du réel, comme dans Congo Pantin, mais avec un style épuré à l’extrême. Blanc comme l’ombre débute comme un roman noir. Un détective désabusé, Robert Crive, enquête sur Victor Berre, homme de l’ombre du gouvernement dont les traits sont flous, comme si son visage etait illuminé de l’intérieur. Peu à peu, Crive découvrira le secret qui le lie irrémédiablement à Victor Berre. Les deux personnages aux noms en anagramme seraient-ils un seul et même individu ?... Philippe Curval a parsemé son récit d’allusions ludiques et poétiques à la l’ambivalence du réel (cette réplique, prononcée par un personnage qui a écrit une nouvelle, vaut pour manifeste : « Je l’ai écrite pour que le lecteur se sente mal à l’aise, perturbé, qu’il doute de ses convictions, de son environnement, de la société, je souhaiterais qu’il soupçonne une autre réalité. »). L’homme qui a trouvé Victor enfant dans une forêt, guidé par une étoile filante, se prénomme Marie, ce qui ne manque pas d’ajouter à l’ambiguïté générale, et confère une dimension christique à Victor Berre – indice de sa véritable nature. Dans un final éblouissant, Berre se révèle, en effet, être notre Créateur, pas moins ! L’univers tel que nous le connaissons serait ainsi le fruit de son imagination – et de celle d’autres « voyageurs imprudents ». Blanc comme l’ombre ne cesse d’étonner par sa tonalité métaphysique et poétique. Il est vrai que la peur de la mort, sous-jacente dans toute l’œuvre de notre auteur, enveloppe ce récit d’une lueur mélancolique. Que faire de notre vie, avant de disparaître ?... Découvrir, aimer, et jouir, répond Philippe Curval ! Vivre ! Il suffit pour s’en convaincre d’admirer cet authentique alexandrin, facétieusement glissé au cœur du texte : « Danaé cessa de se poudrer le corps dont le velouté faisait bander Victor. »…
Blanc comme l’ombre (2003), son dernier roman en date, laisse une toute autre impression. Dans ce roman élégiaque, l’auteur développe les thèmes du double et de la multiplicité du réel, comme dans Congo Pantin, mais avec un style épuré à l’extrême. Blanc comme l’ombre débute comme un roman noir. Un détective désabusé, Robert Crive, enquête sur Victor Berre, homme de l’ombre du gouvernement dont les traits sont flous, comme si son visage etait illuminé de l’intérieur. Peu à peu, Crive découvrira le secret qui le lie irrémédiablement à Victor Berre. Les deux personnages aux noms en anagramme seraient-ils un seul et même individu ?... Philippe Curval a parsemé son récit d’allusions ludiques et poétiques à la l’ambivalence du réel (cette réplique, prononcée par un personnage qui a écrit une nouvelle, vaut pour manifeste : « Je l’ai écrite pour que le lecteur se sente mal à l’aise, perturbé, qu’il doute de ses convictions, de son environnement, de la société, je souhaiterais qu’il soupçonne une autre réalité. »). L’homme qui a trouvé Victor enfant dans une forêt, guidé par une étoile filante, se prénomme Marie, ce qui ne manque pas d’ajouter à l’ambiguïté générale, et confère une dimension christique à Victor Berre – indice de sa véritable nature. Dans un final éblouissant, Berre se révèle, en effet, être notre Créateur, pas moins ! L’univers tel que nous le connaissons serait ainsi le fruit de son imagination – et de celle d’autres « voyageurs imprudents ». Blanc comme l’ombre ne cesse d’étonner par sa tonalité métaphysique et poétique. Il est vrai que la peur de la mort, sous-jacente dans toute l’œuvre de notre auteur, enveloppe ce récit d’une lueur mélancolique. Que faire de notre vie, avant de disparaître ?... Découvrir, aimer, et jouir, répond Philippe Curval ! Vivre ! Il suffit pour s’en convaincre d’admirer cet authentique alexandrin, facétieusement glissé au cœur du texte : « Danaé cessa de se poudrer le corps dont le velouté faisait bander Victor. »…
 Nous nous sommes peu étendus sur les nouvelles, exercice où Philippe Curval excelle pourtant. Qu’il nous soit néanmoins permis d’évoquer brièvement Rasta solitude, magnifique recueil de onze « fictions rastaquouères » traversées par la solitude de l’apatride, la solitude de celui que l’auteur désigne, dans sa préface, comme un « étranger en terre étrangère ». La nouvelle « La vie est courte, la nature hostile et l’homme ridicule », par exemple, par sa langue précise comme un scalpel, par sa poésie de l’étrange, par sa construction impeccable, suscite un fort sentiment d’inquiétante étrangeté. La nouvelle est à l’image de son auteur : discrète (un homme, une plage, des méduses), toute en nuances, mais aussi ambitieuse et porteuse de toute une philosophie « rastaquouère ». Une philosophie plutôt contemplative au demeurant, que l’auteur avait jadis anticipé : « Alors ensemble, nous pourrions nous taire, afin d’écouter le silence du monde. ». Avec Philippe Curval, levons les yeux vers le ciel étoilé, ou bien fermons-les sur notre espace intérieur, et, ensemble, écoutons le silence du monde.
Nous nous sommes peu étendus sur les nouvelles, exercice où Philippe Curval excelle pourtant. Qu’il nous soit néanmoins permis d’évoquer brièvement Rasta solitude, magnifique recueil de onze « fictions rastaquouères » traversées par la solitude de l’apatride, la solitude de celui que l’auteur désigne, dans sa préface, comme un « étranger en terre étrangère ». La nouvelle « La vie est courte, la nature hostile et l’homme ridicule », par exemple, par sa langue précise comme un scalpel, par sa poésie de l’étrange, par sa construction impeccable, suscite un fort sentiment d’inquiétante étrangeté. La nouvelle est à l’image de son auteur : discrète (un homme, une plage, des méduses), toute en nuances, mais aussi ambitieuse et porteuse de toute une philosophie « rastaquouère ». Une philosophie plutôt contemplative au demeurant, que l’auteur avait jadis anticipé : « Alors ensemble, nous pourrions nous taire, afin d’écouter le silence du monde. ». Avec Philippe Curval, levons les yeux vers le ciel étoilé, ou bien fermons-les sur notre espace intérieur, et, ensemble, écoutons le silence du monde.
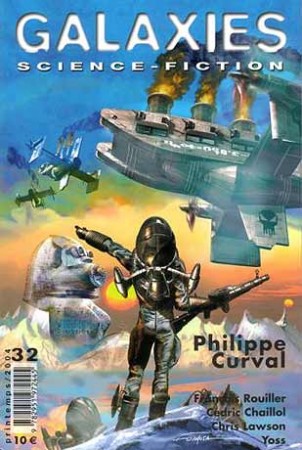
G. DELEUZE, Nietzsche, P.U.F., coll. Philosophes, 1990 [1965], p. 36.
D. GUIOT, « Axes de la perspective curvalienne » in Fiction n°268. R. BARTHES, « Écrivains et écrivants » in Essais critiques, Seuil, coll. Tel Quel, 1964. P. CURVAL, « Surréalisme et science-fiction » in Europe n°870, octobre 2001.
Dans le recueil du même nom. On pense beaucoup, à la lecture de La Face cachée du désir, au Monde inverti de Christopher Priest. Dans Le Livre d’or de Philippe Curval. Ces mots ferment le recueil Debout les morts ! le train-fantôme entre en gare.
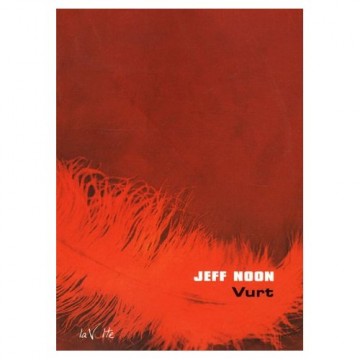




 En attendant la mise en ligne, imminente – je n’attends plus qu’une autorisation de reproduction d’une œuvre photographique très particulière… –, d’une critique-fiction du dernier livre d’Éric Bénier-Bürckel, Un peu d’abîme sur vos lèvres, je vous propose un article, revu et corrigé, initialement publié dans le numéro 32 de la revue
En attendant la mise en ligne, imminente – je n’attends plus qu’une autorisation de reproduction d’une œuvre photographique très particulière… –, d’une critique-fiction du dernier livre d’Éric Bénier-Bürckel, Un peu d’abîme sur vos lèvres, je vous propose un article, revu et corrigé, initialement publié dans le numéro 32 de la revue  S’il vous arrive d’arpenter l’asphalte parisien, d’observer la vie qui anime cette ville envers et contre tout, alors vous apercevrez peut-être, surplombant un grand boulevard du haut de son balcon, un homme immobile et barbu, dont les yeux acérés contemplent le monde avec une ironie et un amour qui sont la marque des sages. Mais prenez garde à ne point détourner le regard, ou la silhouette disparaît après un rapide haussement d’épaules, vous laissant seul avec la géométrie urbaine.
S’il vous arrive d’arpenter l’asphalte parisien, d’observer la vie qui anime cette ville envers et contre tout, alors vous apercevrez peut-être, surplombant un grand boulevard du haut de son balcon, un homme immobile et barbu, dont les yeux acérés contemplent le monde avec une ironie et un amour qui sont la marque des sages. Mais prenez garde à ne point détourner le regard, ou la silhouette disparaît après un rapide haussement d’épaules, vous laissant seul avec la géométrie urbaine. Dès ses premiers écrits dans les années cinquante, Philippe Curval mêle des thèmes très dickiens – perception du réel, univers parallèles – et une sensibilité volontiers surréaliste. «
Dès ses premiers écrits dans les années cinquante, Philippe Curval mêle des thèmes très dickiens – perception du réel, univers parallèles – et une sensibilité volontiers surréaliste. «  Julia, l’héroïne candide des Fleurs de Vénus (1960) ne désire rien tant que fuir son carcan familial et faire exploser le système de castes qui régit la planète. Les Marais-Océan vénusiens, cette «
Julia, l’héroïne candide des Fleurs de Vénus (1960) ne désire rien tant que fuir son carcan familial et faire exploser le système de castes qui régit la planète. Les Marais-Océan vénusiens, cette «  Philippe Curval franchit ensuite un cap d’importance avec Le Ressac de l’espace (1962, Prix Jules Verne), où il préfère la précision du style aux atermoiements psychologiques. La Terre est envahie par les Txalqs, des extraterrestres parasitiques qui se servent des humains comme de supports symbiotiques – la symbiose restant sous leur contrôle absolu, les hommes ayant abdiqué toute volonté propre. Cette acculturation forcée aboutit rapidement à l’érection d’une société utopique, où, comme plus tard dans Congo Pantin, l’abandon du libre-arbitre est le prix à payer pour un bonheur illusoire. Pour Philippe Curval, l’individualisme est un humanisme. Jacques Dureur, le héros, porté par son besoin de liberté et par une mauvaise réceptivité (une immunisation) à l’emprise télépathique des Txalqs, encouragera les résistants à exterminer les extraterrestres, avant d’enfin réaliser son rêve : l’exploration spatiale. Les Txalqs, métaphore des forces négatives qu'encouragent nos
Philippe Curval franchit ensuite un cap d’importance avec Le Ressac de l’espace (1962, Prix Jules Verne), où il préfère la précision du style aux atermoiements psychologiques. La Terre est envahie par les Txalqs, des extraterrestres parasitiques qui se servent des humains comme de supports symbiotiques – la symbiose restant sous leur contrôle absolu, les hommes ayant abdiqué toute volonté propre. Cette acculturation forcée aboutit rapidement à l’érection d’une société utopique, où, comme plus tard dans Congo Pantin, l’abandon du libre-arbitre est le prix à payer pour un bonheur illusoire. Pour Philippe Curval, l’individualisme est un humanisme. Jacques Dureur, le héros, porté par son besoin de liberté et par une mauvaise réceptivité (une immunisation) à l’emprise télépathique des Txalqs, encouragera les résistants à exterminer les extraterrestres, avant d’enfin réaliser son rêve : l’exploration spatiale. Les Txalqs, métaphore des forces négatives qu'encouragent nos  La Forteresse de coton
La Forteresse de coton Dès lors, Philippe Curval évolue dans une interzone littéraire où la frontière qui sépare science-fiction et littérature générale est inopérante, où science-fiction et littérature deviennent quasiment synonymes. Notre auteur a compris qu’écrire, c’est non pas représenter le monde, mais le créer, littérairement (« réelliser des idées », dirait aujourd’hui Alain Damasio, l’autre grand romancier de la vie en mouvement). Pour Roland Barthes, « [l]’écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire. »
Dès lors, Philippe Curval évolue dans une interzone littéraire où la frontière qui sépare science-fiction et littérature générale est inopérante, où science-fiction et littérature deviennent quasiment synonymes. Notre auteur a compris qu’écrire, c’est non pas représenter le monde, mais le créer, littérairement (« réelliser des idées », dirait aujourd’hui Alain Damasio, l’autre grand romancier de la vie en mouvement). Pour Roland Barthes, « [l]’écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire. »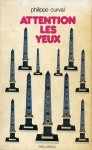 Guillaume Coiranne, le photographe de Attention les yeux
Guillaume Coiranne, le photographe de Attention les yeux  Avec L’Homme à rebours (Grand Prix de l’Imaginaire 1975), Philippe Curval ne se contente plus de cette vision métaphorique de l’individu créateur d’univers. Ce roman – que l’on peut sans peine considérer comme l’un des plus envoûtants de la SF française – est encore une histoire d’amour fou (désir et passion, manifestations patentes de l’inconscient, sont aussi au cœur de sa littérature) en même temps qu’une authentique aventure spéculative à l’imaginaire débordant et au style aussi brut qu'halluciné. Cette fois, nous quittons définitivement les rivages de la réalité conventionnelle : les émanations de l’esprit prennent ici valeur de Création pure, au sens théologique du terme ; Félix Giarre, le héros naufragé sur un monde parallèle à la suite de ses « voyages analogiques », est investi de pouvoirs divins : il comprend alors que tout cela provient de son propre esprit, qu’il en est le suprême créateur. Giarre, qui a renié son père et tué sa mère, rejette le rôle de grand ordonnateur qu’un superordinateur lui a imposé. Il hurle, revendique son libre-arbitre d’individu enfin vierge de tout souvenir et de toute attache, et explose en une infinité de possibles. Dans une critique
Avec L’Homme à rebours (Grand Prix de l’Imaginaire 1975), Philippe Curval ne se contente plus de cette vision métaphorique de l’individu créateur d’univers. Ce roman – que l’on peut sans peine considérer comme l’un des plus envoûtants de la SF française – est encore une histoire d’amour fou (désir et passion, manifestations patentes de l’inconscient, sont aussi au cœur de sa littérature) en même temps qu’une authentique aventure spéculative à l’imaginaire débordant et au style aussi brut qu'halluciné. Cette fois, nous quittons définitivement les rivages de la réalité conventionnelle : les émanations de l’esprit prennent ici valeur de Création pure, au sens théologique du terme ; Félix Giarre, le héros naufragé sur un monde parallèle à la suite de ses « voyages analogiques », est investi de pouvoirs divins : il comprend alors que tout cela provient de son propre esprit, qu’il en est le suprême créateur. Giarre, qui a renié son père et tué sa mère, rejette le rôle de grand ordonnateur qu’un superordinateur lui a imposé. Il hurle, revendique son libre-arbitre d’individu enfin vierge de tout souvenir et de toute attache, et explose en une infinité de possibles. Dans une critique Cette critique de l’utopie ébauchée dans
Cette critique de l’utopie ébauchée dans Après Rut aux étoiles
Après Rut aux étoiles  Nous l’avons vu, Philippe Curval n’aime rien tant qu’inventer des extraterrestres avec leur mode de vie, leurs particularités physiques et comportementales. Ils sont l’Autre, le Différent, ils augmentent le monde, ils le renouvellent. Dans La Face cachée du désir (1980), roman sous forme de trois nouvelles étroitement liées et situées sur la planète Chula, il quitte l’univers faussement réaliste de Y a quelqu’un ? pour camper un monde foncièrement original. Il y est question, entre autres, d’un rite initiatique et onirique où l’enfant s’invagine dans une matrice géante, d’où naît alors un homme nouveau, délivré de sa vie antérieure, évident symbole de la renaissance – l’éternel Retour centrifuge, ou sélectif, de Nietzsche – si chère à l’auteur. Lorsqu’ils ne sont plus en contact avec le sol, les Chulies se subliment : ils disparaissent, littéralement. Ils créent leur réel
Nous l’avons vu, Philippe Curval n’aime rien tant qu’inventer des extraterrestres avec leur mode de vie, leurs particularités physiques et comportementales. Ils sont l’Autre, le Différent, ils augmentent le monde, ils le renouvellent. Dans La Face cachée du désir (1980), roman sous forme de trois nouvelles étroitement liées et situées sur la planète Chula, il quitte l’univers faussement réaliste de Y a quelqu’un ? pour camper un monde foncièrement original. Il y est question, entre autres, d’un rite initiatique et onirique où l’enfant s’invagine dans une matrice géante, d’où naît alors un homme nouveau, délivré de sa vie antérieure, évident symbole de la renaissance – l’éternel Retour centrifuge, ou sélectif, de Nietzsche – si chère à l’auteur. Lorsqu’ils ne sont plus en contact avec le sol, les Chulies se subliment : ils disparaissent, littéralement. Ils créent leur réel Durant les années 80 furent publiés pas moins de cinq recueils de nouvelles (Le Livre d’or de Philippe Curval, 1980, Regarde, fiston, s’il n’y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin, 1980, Debout, les morts ! le train fantôme entre en gare, 1984, Comment jouer à l’homme invisible en trois leçons, 1986, et Habite-t-on réellement quelque part ?, 1989), une anthologie (Superfuturs, 1986) et cinq romans. Tous vers l’extase (1981) d’abord, où
Durant les années 80 furent publiés pas moins de cinq recueils de nouvelles (Le Livre d’or de Philippe Curval, 1980, Regarde, fiston, s’il n’y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin, 1980, Debout, les morts ! le train fantôme entre en gare, 1984, Comment jouer à l’homme invisible en trois leçons, 1986, et Habite-t-on réellement quelque part ?, 1989), une anthologie (Superfuturs, 1986) et cinq romans. Tous vers l’extase (1981) d’abord, où  La déconvenue éditoriale d’Akiloë explique peut-être le silence radio de Philippe Curval durant la première moitié des années 90. Il revient cependant sur le devant de la scène en 1995 avec L’éternité n’est pas la vie, roman intéressant mais inabouti sur l’Égypte, et surtout avec une œuvre inclassable : Les évadés du mirage (réédité en Folio SF sous le titre Congo Pantin). Un vaisseau extraterrestre s’est écrasé sur Pantin, en banlieue parisienne. Les aliens pixellisés, les « Neutres », prodiguent des flashes oniriques aux humains, par simple contact ; ces flashes agissent comme les shoots d’une drogue dure : ils provoquent un choc proche de l’orgasme, entraînant une véritable dépendance et annihilant toute volonté. Philippe Curval, nous le savons, ne déteste rien tant que le confort de la servitude volontaire. C’est pourquoi l’ambivalence règne sans partage sur le roman – dont le territoire latent est sans aucun doute l’inconscient (celui de l’auteur, celui des personnages, celui du lecteur). Ainsi Congo et Zaïre – ce dernier est aussi noir que Congo est albinos – sont les deux faces d’un même individu. Ils incarnent non pas le réel et la fiction, mais deux facettes d’une même réalité – ou d’une même fiction. Mieux : ils sont eux-mêmes explicitement confrontés à leur statut de créatures fictionnelles, ce que l’auteur n’avait jamais osé jusque là. En existentialiste facétieux, Curval prend ainsi Descartes à la lettre et illustre son cogito par l’absurde : « je pense donc je suis » signifie pour lui : j’existe parce qu’au préalable, je me suis pensé (paradoxe déjà développé magistralement dans « Un souvenir de Pierre Loti »). Congo Pantin est une œuvre totalement surréaliste, virtuose, où l’extraterrestre, figure emblématique de l’œuvre de Philippe Curval, joue un rôle éminemment symbolique de révélateur de l’inconscient, avec tout ce que cela suppose de désirs et de peurs refoulés.
La déconvenue éditoriale d’Akiloë explique peut-être le silence radio de Philippe Curval durant la première moitié des années 90. Il revient cependant sur le devant de la scène en 1995 avec L’éternité n’est pas la vie, roman intéressant mais inabouti sur l’Égypte, et surtout avec une œuvre inclassable : Les évadés du mirage (réédité en Folio SF sous le titre Congo Pantin). Un vaisseau extraterrestre s’est écrasé sur Pantin, en banlieue parisienne. Les aliens pixellisés, les « Neutres », prodiguent des flashes oniriques aux humains, par simple contact ; ces flashes agissent comme les shoots d’une drogue dure : ils provoquent un choc proche de l’orgasme, entraînant une véritable dépendance et annihilant toute volonté. Philippe Curval, nous le savons, ne déteste rien tant que le confort de la servitude volontaire. C’est pourquoi l’ambivalence règne sans partage sur le roman – dont le territoire latent est sans aucun doute l’inconscient (celui de l’auteur, celui des personnages, celui du lecteur). Ainsi Congo et Zaïre – ce dernier est aussi noir que Congo est albinos – sont les deux faces d’un même individu. Ils incarnent non pas le réel et la fiction, mais deux facettes d’une même réalité – ou d’une même fiction. Mieux : ils sont eux-mêmes explicitement confrontés à leur statut de créatures fictionnelles, ce que l’auteur n’avait jamais osé jusque là. En existentialiste facétieux, Curval prend ainsi Descartes à la lettre et illustre son cogito par l’absurde : « je pense donc je suis » signifie pour lui : j’existe parce qu’au préalable, je me suis pensé (paradoxe déjà développé magistralement dans « Un souvenir de Pierre Loti »). Congo Pantin est une œuvre totalement surréaliste, virtuose, où l’extraterrestre, figure emblématique de l’œuvre de Philippe Curval, joue un rôle éminemment symbolique de révélateur de l’inconscient, avec tout ce que cela suppose de désirs et de peurs refoulés. Plus complexe est le cas de Voyage à l’envers (2000), qui propose quelques réflexions sur les médias et la civilisation occidentale moderne. L’absence de grand conflit fédérateur et la mort des religions, la fin des phénomènes de rassemblement populaire, auraient causé une névrose schizophrénique de la société, comme chez J.G. Ballard, que seule la menace d’une invasion extraterrestre sauve in extremis de la catatonie générale… Notre auteur exploite également la dépendance de notre civilisation à la technologie. Les rayonnements extraterrestres parasitent en effet les systèmes informatiques, si bien que le chaos menace la planète. Les gouvernements lancent alors le programme spatial Colomb : quelques hommes triés sur le volet iront résoudre le problème à sa source, vers Proxima du Centaure. À son retour sur Terre, après un voyage périlleux mais infructueux, l’équipage découvre que les extraterrestres ont déjà envahi la planète et ont soumis l’humanité à leur contrôle. Curieusement, les Centaures semblent avoir reconstitué le monde des années 70, mais sous une forme pervertie, comme s’il était contemplé à travers le miroir déformant de nos fantasmes. Le roman s’achève (trop) abruptement, alors que Piscop, le héros et narrateur, organise la résistance.
Plus complexe est le cas de Voyage à l’envers (2000), qui propose quelques réflexions sur les médias et la civilisation occidentale moderne. L’absence de grand conflit fédérateur et la mort des religions, la fin des phénomènes de rassemblement populaire, auraient causé une névrose schizophrénique de la société, comme chez J.G. Ballard, que seule la menace d’une invasion extraterrestre sauve in extremis de la catatonie générale… Notre auteur exploite également la dépendance de notre civilisation à la technologie. Les rayonnements extraterrestres parasitent en effet les systèmes informatiques, si bien que le chaos menace la planète. Les gouvernements lancent alors le programme spatial Colomb : quelques hommes triés sur le volet iront résoudre le problème à sa source, vers Proxima du Centaure. À son retour sur Terre, après un voyage périlleux mais infructueux, l’équipage découvre que les extraterrestres ont déjà envahi la planète et ont soumis l’humanité à leur contrôle. Curieusement, les Centaures semblent avoir reconstitué le monde des années 70, mais sous une forme pervertie, comme s’il était contemplé à travers le miroir déformant de nos fantasmes. Le roman s’achève (trop) abruptement, alors que Piscop, le héros et narrateur, organise la résistance. Blanc comme l’ombre (2003), son dernier roman en date, laisse une toute autre impression. Dans ce roman élégiaque, l’auteur développe les thèmes du double et de la multiplicité du réel, comme dans Congo Pantin, mais avec un style épuré à l’extrême. Blanc comme l’ombre débute comme un roman noir. Un détective désabusé, Robert Crive, enquête sur Victor Berre, homme de l’ombre du gouvernement dont les traits sont flous, comme si son visage etait illuminé de l’intérieur. Peu à peu, Crive découvrira le secret qui le lie irrémédiablement à Victor Berre. Les deux personnages aux noms en anagramme seraient-ils un seul et même individu ?... Philippe Curval a parsemé son récit d’allusions ludiques et poétiques à la l’ambivalence du réel (cette réplique, prononcée par un personnage qui a écrit une nouvelle, vaut pour manifeste : « Je l’ai écrite pour que le lecteur se sente mal à l’aise, perturbé, qu’il doute de ses convictions, de son environnement, de la société, je souhaiterais qu’il soupçonne une autre réalité. »). L’homme qui a trouvé Victor enfant dans une forêt, guidé par une étoile filante, se prénomme Marie, ce qui ne manque pas d’ajouter à l’ambiguïté générale, et confère une dimension christique à Victor Berre – indice de sa véritable nature. Dans un final éblouissant, Berre se révèle, en effet, être notre Créateur, pas moins ! L’univers tel que nous le connaissons serait ainsi le fruit de son imagination – et de celle d’autres « voyageurs imprudents ». Blanc comme l’ombre ne cesse d’étonner par sa tonalité métaphysique et poétique. Il est vrai que la peur de la mort, sous-jacente dans toute l’œuvre de notre auteur, enveloppe ce récit d’une lueur mélancolique. Que faire de notre vie, avant de disparaître ?... Découvrir, aimer, et jouir, répond Philippe Curval ! Vivre ! Il suffit pour s’en convaincre d’admirer cet authentique alexandrin, facétieusement glissé au cœur du texte : « Danaé cessa de se poudrer le corps dont le velouté faisait bander Victor. »…
Blanc comme l’ombre (2003), son dernier roman en date, laisse une toute autre impression. Dans ce roman élégiaque, l’auteur développe les thèmes du double et de la multiplicité du réel, comme dans Congo Pantin, mais avec un style épuré à l’extrême. Blanc comme l’ombre débute comme un roman noir. Un détective désabusé, Robert Crive, enquête sur Victor Berre, homme de l’ombre du gouvernement dont les traits sont flous, comme si son visage etait illuminé de l’intérieur. Peu à peu, Crive découvrira le secret qui le lie irrémédiablement à Victor Berre. Les deux personnages aux noms en anagramme seraient-ils un seul et même individu ?... Philippe Curval a parsemé son récit d’allusions ludiques et poétiques à la l’ambivalence du réel (cette réplique, prononcée par un personnage qui a écrit une nouvelle, vaut pour manifeste : « Je l’ai écrite pour que le lecteur se sente mal à l’aise, perturbé, qu’il doute de ses convictions, de son environnement, de la société, je souhaiterais qu’il soupçonne une autre réalité. »). L’homme qui a trouvé Victor enfant dans une forêt, guidé par une étoile filante, se prénomme Marie, ce qui ne manque pas d’ajouter à l’ambiguïté générale, et confère une dimension christique à Victor Berre – indice de sa véritable nature. Dans un final éblouissant, Berre se révèle, en effet, être notre Créateur, pas moins ! L’univers tel que nous le connaissons serait ainsi le fruit de son imagination – et de celle d’autres « voyageurs imprudents ». Blanc comme l’ombre ne cesse d’étonner par sa tonalité métaphysique et poétique. Il est vrai que la peur de la mort, sous-jacente dans toute l’œuvre de notre auteur, enveloppe ce récit d’une lueur mélancolique. Que faire de notre vie, avant de disparaître ?... Découvrir, aimer, et jouir, répond Philippe Curval ! Vivre ! Il suffit pour s’en convaincre d’admirer cet authentique alexandrin, facétieusement glissé au cœur du texte : « Danaé cessa de se poudrer le corps dont le velouté faisait bander Victor. »… Nous nous sommes peu étendus sur les nouvelles, exercice où Philippe Curval excelle pourtant. Qu’il nous soit néanmoins permis d’évoquer brièvement Rasta solitude, magnifique recueil de onze « fictions rastaquouères » traversées par la solitude de l’apatride, la solitude de celui que l’auteur désigne, dans sa préface, comme un « étranger en terre étrangère ». La nouvelle « La vie est courte, la nature hostile et l’homme ridicule », par exemple, par sa langue précise comme un scalpel, par sa poésie de l’étrange, par sa construction impeccable, suscite un fort sentiment d’inquiétante étrangeté. La nouvelle est à l’image de son auteur : discrète (un homme, une plage, des méduses), toute en nuances, mais aussi ambitieuse et porteuse de toute une philosophie « rastaquouère ». Une philosophie plutôt contemplative au demeurant, que l’auteur avait jadis anticipé : « Alors ensemble, nous pourrions nous taire, afin d’écouter le silence du monde. »
Nous nous sommes peu étendus sur les nouvelles, exercice où Philippe Curval excelle pourtant. Qu’il nous soit néanmoins permis d’évoquer brièvement Rasta solitude, magnifique recueil de onze « fictions rastaquouères » traversées par la solitude de l’apatride, la solitude de celui que l’auteur désigne, dans sa préface, comme un « étranger en terre étrangère ». La nouvelle « La vie est courte, la nature hostile et l’homme ridicule », par exemple, par sa langue précise comme un scalpel, par sa poésie de l’étrange, par sa construction impeccable, suscite un fort sentiment d’inquiétante étrangeté. La nouvelle est à l’image de son auteur : discrète (un homme, une plage, des méduses), toute en nuances, mais aussi ambitieuse et porteuse de toute une philosophie « rastaquouère ». Une philosophie plutôt contemplative au demeurant, que l’auteur avait jadis anticipé : « Alors ensemble, nous pourrions nous taire, afin d’écouter le silence du monde. »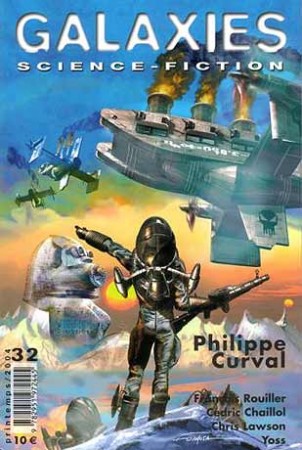
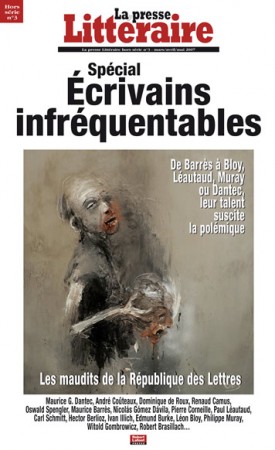
 À propos d’American Black Box, je vous encourage vivement à lire la
À propos d’American Black Box, je vous encourage vivement à lire la 

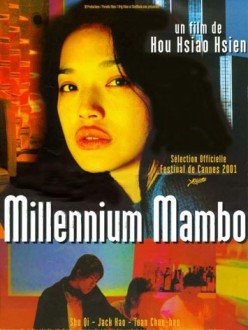
 Dans son quinzième film, Millenium Mambo (2001), Hou Hsiao-hsien immerge sa caméra et le spectateur dans l’univers figé de la jeunesse taïwanaise, sans passé, sans futur, sans autre liens qu’automatiques, au narcissisme exacerbé, sans autre communion que stroboscopique, égarée dans sa quête de sens. Il ne s’agit pas tant, cependant, d’exprimer un point de vue moral, réactionnaire, sur l’évolution des villes modernes et d’une certaine frange de leurs habitants, que d’en capter l’essence, d’en comprendre l’impasse, de l’aimer (« j’ai voulu montrer que l’existence des hommes peut être comparable à des feuilles qui tombent d’un arbre. Si je n’ai pas filmé tout l’arbre, j’en ai isolé quelques feuilles. […] Je voulais juste filmer un moment de leur vie ; et filmer également mes sentiments envers eux. »
Dans son quinzième film, Millenium Mambo (2001), Hou Hsiao-hsien immerge sa caméra et le spectateur dans l’univers figé de la jeunesse taïwanaise, sans passé, sans futur, sans autre liens qu’automatiques, au narcissisme exacerbé, sans autre communion que stroboscopique, égarée dans sa quête de sens. Il ne s’agit pas tant, cependant, d’exprimer un point de vue moral, réactionnaire, sur l’évolution des villes modernes et d’une certaine frange de leurs habitants, que d’en capter l’essence, d’en comprendre l’impasse, de l’aimer (« j’ai voulu montrer que l’existence des hommes peut être comparable à des feuilles qui tombent d’un arbre. Si je n’ai pas filmé tout l’arbre, j’en ai isolé quelques feuilles. […] Je voulais juste filmer un moment de leur vie ; et filmer également mes sentiments envers eux. »