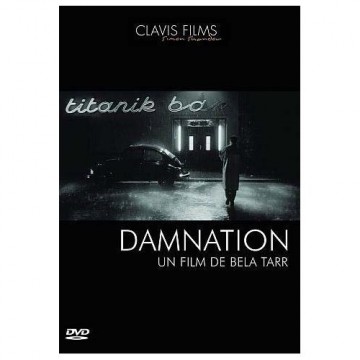« Traduire le vent invisible par l’eau qu’il sculpte en passant. »
Robert Bresson, Notes sur le cinématographe.
Il y a de quoi être sidéré par la calamiteuse réception de L’Homme de Londres, le nouveau chef d’œuvre du cinéaste hongrois Béla Tarr (coréalisé par Agnès Hranitzky) conspué après la projection de presse à Cannes en 2007. Plus que Les Harmonies Werckmeister, Damnation ou même Satantango, L’Homme de Londres traîne dans son sillage un impressionnant cortège de malentendus. Chacun souligne, comme il se doit, les difficultés presque insurmontables – décès du producteur Humbert Balsan, longue interruption du tournage, problèmes techniques liés aux exigences du réalisateur (vider le port de Bastia, construire un pont, etc.) – qui ont longtemps hypothéqué sa finalisation, mais certains en font un argument en défaveur d’une œuvre dès lors jugée, à tort, gibbeuse et malfichue !... Un certain nombre de critiques, professionnels et amateurs, ont en effet souligné le caractère définitivement « ennuyeux » du film… Philippe Azoury ouvre le bal dans Libération en 2007, évoquant son « calvaire » et sa « lutte acharnée contre le sommeil »… Pierre Murat, dans Télérama, loue la beauté plastique du film mais préfère nous faire part d’un sentiment d’« indifférence admirable »… Sur le site Yozone, le dénommé Tom Décembre est davantage préoccupé dans son affligeant compte-rendu par sa propre somnolence, que par un film qu’il n’a donc sans doute pas vraiment vu – il compare par exemple la technique du Hongrois à celle de… « Gaspard Noé » (sic), sans autre forme de procès et sans égard pour l’orthographe de Gaspar… Même constat sur le site de France 3 dans le texte de Jacky Bornet, qui évoque une « complaisance égocentrique », confondant manifestement l’égo du réalisateur avec son propre nombril outragé de cinéphile à pop-corn télépathique (selon Jacky, « L’Homme de Londres perd vite le spectateur, alors que le cinéaste pense avoir entretenu un suspense métaphysique »… Ah ? Qu’est-ce, au juste, qu’un « suspense métaphysique » ?... Et comment être sûr, au point de l’affirmer comme une vérité établie, que Béla Tarr pensait ceci ou pensait cela ?)... Même Chronic’art, par la voix de Vincent Malausa, se fourvoie allègrement, voyant en L’Homme de Londres, je cite, une « sorte de Sin City bouseux et sartrien » décevante et pontifiante !... Comment dès lors Malausa ose-il encore proclamer que Béla Tarr reste « l’un des cinéastes importants de ces trente dernières années » ?... Qu’a-t-il pu comprendre à Damnation ou à Satantango s’il s’est bidonné à la vision de L’Homme de Londres ?... Comme l’écrit fort à propos Cyril Neyrat dans les Cahiers du cinéma n° 637 (septembre 2008), il y a dans le rejet des uns, et, ajouterais-je, dans la méprise des autres, « le symptôme d’un blocage esthétique, d’une forme de beauté au cinéma qui heurte ou irrite le jugement de goût dominant ». On ne saurait mieux dire. De toute évidence, L’Homme de Londres est l’un de ces films dont la forme n’est pas conçue comme un piège destiné à plaire au public et à lui soutirer quelques euros, en satisfaisant tous ses goûts sans scrupule, mais comme une authentique expression artistique, comme la représentation plastique d’idées et d’émotions avec un matériau dont aucun langage n’assure la maîtrise, le cinématographe.

Pour Malausa, comme pour d’autres commentateurs, l’intrigue importerait peu à Béla Tarr, qui se serait donc seulement concentré sur le travail formel… C’est mal saisir, je crois, combien chez Béla Tarr la forme est au contraire inextricablement liée aux enjeux fondamentaux de l’intrigue (le scénario est co-signé par l’excellent László Krasznahorkai). Certes, L’Homme de Londres ne se préoccupe guère de maintenir un quelconque suspense, et ne présente pas les attraits d’un thriller bien « ficelé »… Une œuvre de Béla Tarr, répétons-le, n’a rien d’une machine implacable. Mais il ne s’agit pas seulement, comme le laissent entendre plusieurs critiques, que d’errance, de vide et de chaos : l’esthétique de ce film se nourrit aussi et surtout à une autre source : le cas de conscience du personnage principal, Maloin, dont L’Homme de Londres adopte clairement le point de vue (nous « voyons le monde avec ses yeux », selon les mots du réalisateur). Exit, cependant, la voix off de la version d’Henri Decoin réalisée sous l’occupation : Béla Tarr fait partie de ces trop rares cinéastes qui n’ont plus besoin des mots pour traduire une émotion ou même pour raconter une histoire, et qui, pour reprendre une formule de Robert Bresson, aux tactiques de vitesse et de bruit préfèrent des tactiques de lenteur et de silence.

Dans un port, la nuit. Du haut de sa tourelle, Maloin, aiguilleur d’une gare portuaire, surplombe les quais. Observant le ballet des passagers, il voit lutter deux silhouettes, se disputant apparemment une valise. L’un des deux hommes tombe à l’eau avec le bagage et disparaît. Ni vu ni connu, Maloin descend récupérer la valise et reprend sa routine quotidienne – son travail nocturne et solitaire, sa famille sans le sou, la convivialité fruste du bar. C’est alors qu’entrent en scène l’enquêteur anglais Morrison et la femme du meurtrier, Mrs Brown… L’Homme de Londres se déroule sur quelques jours, dans un périmètre très restreint, comprenant la tourelle de Maloin, le port, son appartement, quelques rues, un café… Cette unité de lieu, de temps et d’action – certains éléments dramaturgiques du roman de Simenon ont disparu –, de même qu’un certain respect des « règles de bienséance » rapproche le film du théâtre classique et de la tragédie – ce que la fin confirmera. Mais Béla Tarr n’est pas un cinéaste de la parole. Le cas de conscience de Maloin, au cœur du film, n’est pas exposé comme chez Decoin par la voix off, simple décalque littéraire des tergiversations du héros, mais par l’image, par le son, autrement dit par la seule mise en scène – par des moyens spécifiquement cinématographiques. « Le rythme d’un film, écrivait Andrei Tarkovski dans Le Temps scellé, ne réside […] pas dans la succession métrique de petits morceaux collés bout à bout, mais dans la pression du temps qui s’écoule à l’intérieur même des plans. Ma conviction profonde est que l’élément fondateur du cinéma est le rythme, et non le montage comme on a tendance à la croire ». Et l’individualité du réalisateur s’exprime avant tout au travers de ce « sens du temps », c’est-à-dire, en d’autres termes, de sa vision personnelle du monde. Ainsi la lenteur mortuaire de L’Homme de Londres, que d’aucuns qualifient d’extrême – le film compte une trentaine de plans mais certains journalistes, sans doute trompés par leur somnolence, n’en ont compté que dix ! –, n’est que la nécessaire expression d’une temporalité singulière, celle de l’univers de Maloin – exacerbée par ses déchirements intérieurs. Le plan-séquence qui ouvre le film, où l’on observe avec Maloin les passagers du ferry s’affairer, descendre à terre et se diriger vers le train ou vers l’autre quai, jusqu’au crime qui perce les brumes de la grisaille quotidienne, est caractéristique du rythme élégiaque du cinéma de Béla Tarr. Pour celui-ci en effet, le monde prolétarien de Maloin, dans lequel il nous fait entrer après la longue séquence initiale, n’est qu’un cercle de répétitions monotones – des gestes, des trajets, des situations –, symbolisé dans l’espace par la tourelle mais aussi, comme le remarque Cyril Neyrat dans Les Cahiers du cinéma, par la plateforme du port où est lancée la valise ; cercle routinier que traduit magnifiquement, parfois aux limites de l’excès, la musique lancinante et mélancolique de Mihály Vig. Les sons eux-mêmes, qui résonnent étrangement dans le silence de la nuit, participent pleinement à l’instauration de cette ambiance hypnotique, où le tic-tac d’une horloge coïncide avec la lourde pulsation intérieure de Maloin et de ses démons. Mais son espace-temps subjectif est avant tout caractérisé par son absence d’horizon. La nuit, il travaille – seul – dans sa tourelle. Le reste du temps il dort, partage de tristes repas avec sa femme au bout du rouleau (Tilda Swinton, étonnante) et avec sa fille Henriette au visage inexpressif (Erika Bok), ou à boire et à jouer aux échecs avec d’autres pauvres bougres dans le bar du port. Enfermé dans sa routine, Maloin n’a ni ailleurs, ni lendemain. Même la découverte de la mallette ne lui est d’aucun secours. L’argent qu’elle contient est même maudit, ainsi que le suggèrent ce passage bressionien qui montre Maloin déposer les billets détrempés sur le poêle – donc sur le feu… – pour les faire sécher… Du reste, l’on connaît le rôle décisif joué par l’argent et le matérialisme dans les films du cinéaste, comme Almanach d’automne, Damnation ou Satantango. Mais en vérité la damnation frappe Maloin (dont les trois premières lettres du nom ne sont pas gratuites) dès l’instant où il quitte les hauteurs de sa tourelle panoptique. En effet, après la scène de crime, l’aiguilleur abandonne son poste d’observation et descend sur le quai pour y récupérer la fameuse valise. Béla Tarr insiste sur ce mouvement descendant, nous montrant Maloin lentement dévaler son échelle, puis sonder les eaux du port, plus basses encore, pour y remonter la valise. Comme dans Damnation, comme dans Satantago, L’Homme de Londres multiplie les oppositions entre les hautes sphères et les bas-fonds, en les associant à d’autres, omniprésentes, entre d’une part l’ombre, la ténèbre où le mal et la mort rodent, et d’autre part la lumière céleste. Béla Tarr ne renonce pas complètement à nous montrer la violence, mais celle-ci n’est que la funeste conséquence du travail systématique de corruption qui entraîne l’humanité dans la boue de ses origines. Si l’altercation entre les deux hommes au début du film nous est inévitablement montrée, le vaincu disparaît totalement dans des eaux noires – sa mort nous est dissimulée – avant d’être repêché, sans vie, par la police. Le second meurtre, celui de Brown (désincarné par un Janos Derzsi spectral), se fera dans l’obscurité d’une cabane, hors du champ d’une caméra contrainte à filmer la cloison extérieure d’où rien ne nous parvient. Comme à l’époque du muet, nous comprenons quel acte terrible a été commis lorsque Maloin – l’homme de l’ombre – ressort de la cabane, plus sombre que jamais… Une seule fois, Béla Tarr le montre nimbé de la lumière du jour, alors qu’il s’apprête à se coucher, dans la clarté matinale. Mais quelqu’un prend soin de fermer les volets, le laissant se dans sa pénombre et ses doutes. L’exemple le plus frappant de cette opposition systématique nous est offert dans un plan d’une grande simplicité géométrique qui condense les enjeux du film. Marchant dans les traces de Brown, Maloin s’avance au centre d’une ruelle étroite, au centre de l’écran également, le long d’une rigole sombre. À gauche et à droite s’élèvent les façades d’immeubles crasseux. Soudain, la caméra s’élève par un mouvement panoramique, pour aboutir à l’image symétrique inversée de celle déjà décrite : à droite et à gauche, les immeubles ; au centre, une bande lumineuse formée par le ciel. Par ce contraste entre la ligne sombre du caniveau et celle, blanche, du ciel, Béla Tarr force l’interprétation : c’est dans les immondices que marchent Brown et Maloin – dans des bas-fonds plus sombres encore que ceux de Kurosawa. Le cinéma de Béla Tarr ne laisse, il est vrai, aucune place à l’espoir d’un monde meilleur : on ne sort pas du cercle tracé par la caméra, et au centre duquel règne Morrison (Istvan Lenart, sépulcral), le flic londonien à la voix caverneuse venu récupérer l’argent. Comme Irimias dans Satantango, comme le Prince des Harmonies Werckmeister, Morrison s’impose comme une authentique figure démoniaque et, au propre comme au figuré, corruptrice. Associé au feu – il réchauffe ses mains au-dessus du poêle qui a servi à sécher les billets –, il sillonne les lieux et tisse son œuvre maléfique, ne laissant personne indemne.

Que l’on se rappelle alors les étranges premières images du film, au début du plan-séquence inaugural : sur une bande-son que n’aurait pas reniée le Lynch d’Eraserhead, la caméra remonte très lentement par un travelling ascendant le long de la proue du ferry, dont les deux côtés, l’un sombre, l’autre lumineux, scindent l’écran en deux ; l’image est cependant traversée à intervalles réguliers par des ombres effilées – les barreaux d’une grille ? Les montants de fenêtres ?... (pour Cyril Neyrat, cette grille, ou les vitres du plan suivant, forment comme une membrane qui « divise l’espace dans la profondeur et fait coexister dans le plan intérieur et extérieur »). Verticalité, ombres et lumière : tout était annoncé dans ce premier plan. L’Homme de Londres est ainsi entièrement construit autour du dilemme moral de Maloin – magnifiquement campé par Miroslav Krobot, dont le visage déjà monolithique se durcit de plus en plus –, désireux de garder l’argent, d’offrir de beaux vêtements à sa fille, de l’arracher à sa condition de bonne à tout faire à la boucherie, mais rongé par le doute et la culpabilité, hanté par sa conscience du bien et du mal qui lui fait rendre l’argent in extremis, pour un illusoire salut… Pour Maloin, il n’y a sans doute aucune rédemption. Vivre, pour Béla Tarr, c’est choisir, en toute conscience. Une affaire de morale, en somme. L’une des conséquences esthétiques de la voie sans issue, du voyage au bout de la nuit – la route – où s’engagent les personnages de Béla Tarr, est qu’ils évoluent dans des villes, dans des univers intemporels, détachés du présent. Rien ne distingue vraiment le village des Harmonies, par exemple, du port de L’Homme de Londres, censé être situé à Dieppe mais filmé à Bastia. Partout, les mêmes bougres, les mêmes mines renfrognées, les mêmes danses d’ivrogne (joués par les mêmes acteurs) qui tournoient comme des planètes ou comme des boules de billard. Ce sentiment d’étrangeté, voire d’étrangéité, est renforcé dans L’Homme de Londres par le doublage en français, le plus souvent altéré par des accents slaves (mais pas toujours : ainsi le patron du bar-hôtel est-il doublé par le grand Michael Lonsdale). En France, en Hongrie ou dans un pays imaginaire, nous sommes toujours en terre étrangère, au royaume du mal. En Enfer ! Et si l’ombre est son domaine, la lumière est un privilège réservé aux justes, comme la malheureuse veuve de Brown (Agi Szirtes), dont le visage défait, en gros plan, s’efface dans un fondu au blanc final – tandis que Maloin, tiraillé entre les bas-fonds du crime et les valeurs transcendantes, restera toujours l’homme de l’ombre. Ce fondu au blanc désigne Mrs Brown comme l’innocente, celle qui a tout perdu et qui ne mérite pas l’obscurité, mais ne nous renvoie in fine qu’à la surface vierge de l’écran, comme si après le noir terminal de Satantango – caveau scellé qui nous ferme la vue, selon Guillaume Orignac – Béla Tarr voulait briser la frontière qui sépare en théorie le spectateur de l’univers du film. Comme si, après tout, nous étions tous foutus.