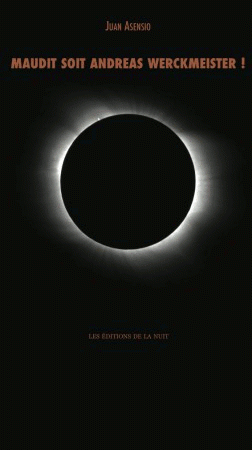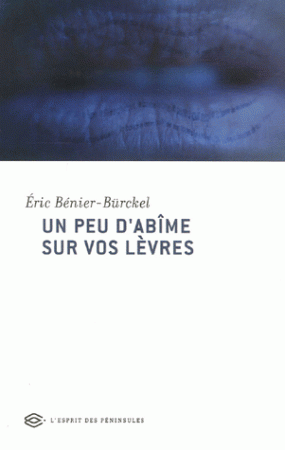Joel Peter Witkin, "Le Baiser", 1982
© tout droit réservé galerie baudoin lebon
À Éric Bénier-Bürckel
« Si je vous écorche avec ma langue râpeuse et brûlante, c’est pour rappeler à la vie le malheureux Lazare qui se putréfie dans les vagues mourantes et les élans brisés de vos entrailles ! Qu’il se lève et marche, ce dépossédé, et qu’il prenne part au monde, dans tout ce qui se fait sous le soleil ! Dieu n’est pas dieu de morts, mais dieu de vivants !
Enivrez-vous d’infini, levez-vous et allez à la beauté ! N’avez-vous donc pas compris ce que signifie le miracle de la résurrection ? Il suffit d’un peu d’abîme sur vos lèvres, sur vos yeux et sur vos oreilles, pour que, merveille des merveilles, renforcés jusqu’aux entrailles, vous en recouvriez aussitôt l’usage ; oui, il suffit d’un peu de souffle auroral dans vos charognes attaquées de toutes parts par le ver de la désespérance pondu par le Mal pour que, relancés à votre pointe du jour offerte comme une femme aux puissantes fontaines du plus que possible, ce oui déferlant et primordial qui pourrait aussi bien vous briser, vous reveniez à la vie, méchamment libres et ardents comme la foudre. »
Éric Bénier-Bürckel, Un peu d’abîme sur vos lèvres.
« Pah, ils sont tranquilles, je suis emmuré de leurs vociférations, personne ne saura jamais ce que je suis, personne ne me l’entendra dire, même si je le dis, et je ne le dirai pas, je ne pourrai pas, je n’ai que leur langage à eux, si si, je le dirai peut-être, même dans leur langage à eux, pour moi seul, pour ne pas avoir vécu en vain, et puis pour pouvoir me taire, si c’est ça qui donne droit au silence, et rien n’est moins sûr, c’est eux qui détiennent le silence, qui décident du silence, toujours les mêmes, de mèche, de mèche, tant pis, je m’en fous du silence, je dirai ce que je suis, pour ne pas ne pas être né inutilement, je le leur arrangerai leur sabir, après je dirai n’importe quoi, tout ce qu’ils voudront, avec joie, pendant l’éternité, enfin avec philosophie. »
Samuel Beckett, L’Innommable.
« C’est l’esprit libre qu’on blâme en moi, le briseur d’idoles, la méchanceté sans tabou, le vaurien, que dis-je, la canaille sans foi ni loi à qui la douleur ne fait pas froid au verbe »
Ah ! Ce sont là tes premiers mots ! Tes premières armes ! Tout un programme, vraiment, ton plan anti-larbins textuels ! J’ai vite compris, en les lisant, que j’allais, d’abord, devoir subir l’harassante complainte d’un Marchenoir en papier calque, sa complaisante étreinte, sa litanie de bile, de rage, de haine au ras des pâquerettes… Un Everest d’ordures entassées pêle-mêle, avec talent mais sans génie, en toute hâte, d’où, cependant, miraculeusement surgirait – peut-être – une flamme, aussi pure que ténue, aussi pâle qu’inextinguible, le vif acéré de ton être ! Une âme d’écorché, à nu ! À cru ! Toute crasse décrochée, plus rien à reluire… J’en aurai mis ma main au feu, vois-tu, je l’aurai cuite, ma main, et me serais tranché l’oreille en sus, et, autant m’en vanter, je ne me suis pas trompé... Enfonçons-nous donc dans tes précipices intérieurs, dévalons dans tes enfers, sans crainte de ce qui affleure, sans peur de ce qui suinte. Et commençons par t’écouter....
« Examiner l’infamie sous toutes les coutures et, inlassablement, en développer le caractère, loin des rigueurs hivernales de la science, tout près de la chaleur tropicale des fortes fièvres ; favoriser l’activité de la passion la plus forte, élever la température, enflammer, consumer, être généreux avec tout ce qui en l’homme réclame l’esprit par le feu ; sensibiliser les hommes aux charmes inqualifiables de leur méchanceté, les initier à ce qu’il y a de formidablement sain en elle, de vivant, de luxuriant, de fabuleusement prodigue ; hisser le mystère viscéral dans la pensée, en révéler le corps convulsif, qu’il se conjugue à tout ce qui en eux étouffe sous la trop grande retenue des idées pâlissantes ; retenir la page qui traite de leurs travers d’un ferme index, au lieu de la tourner rapidement avec ce doigt méprisant rempli de l’austère bonne conscience du vertueux que se plaît à lever fièrement l’homme de bien quand il aperçoit la plus petite ombre de saleté en lui et que, pour ne point se souiller l’âme de son opprobre, il balaye d’une pichenette, voilà tout le sens de mon humble ouvrage. »
Voilà précisément ce que le premier roman de ton créateur, L’Air de rien, publié, sans qu’il y soit pour quelque chose, sous le titre bien pâlot d’Un prof bien sous tout rapport, réussissait si bien. Et si Maniac et Pogrom, ces autoportraits monstrueux, dorianesques, miroirs de leur époque, s’ils creusaient la même veine, leur plongée dans l’abject, le sordide le plus trivial, le moins transcendant, avait surtout le don de m’attrister, de me toucher, mais certes pas celui de m’allumer les entrailles – ah, ça non ! –, et de me consumer en-dedans ! Et puis, il y eût l’affaire Pogrom, lamentable, livre injustement conspué, compissé, conchié par les vertueux gardiens du moralement correct, les Rolin, les Comment, les Bourmeau, les Raffarin, les crieurs d’orfraie, les obstrués du cul – puis attaqué en justice, avant que ton créateur soit, heureusement, relaxé. « Tout créateur au premier mot se trouve à présent écrasé de haines, concassé, vaporisé. Le monde entier tourne critique, donc effroyablement médiocre. Critique collective, torve, larbine, bouchée, esclave absolue », écrivait Céline dans Mea culpa. C’est son lot, à ton créateur ! Il est voué à être haï ! Et souviens-toi, il n’y a que des malheurs dans l’existence… Intelligemment, parce qu’il croit encore, malgré tout, au Verbe vivant et rédempteur, ton créateur a choisi de répondre à ses agresseurs par la fiction. Louable et courageuse décision. Mais toi, mon ami ! Toi, mon trou ! De quel côté es-tu ? Dans quel camp ? Du côté du Verbe qui sauve, ou de celui du verbe qui « rapetisse », « qui anéantit, une parodie de Verbe ; celui de la haine et du ressentiment, celui du cynisme, celui du populisme, celui du fanatisme, celui du nihilisme » ?...
Car enfin ! Croyais-tu m’enivrer, croyais-tu m’amouracher, croyais-tu m’amenuiser la vigilance, avec ta saignée verbale, avec ta logorrhée, avec ton suintant logos ?... Ah, mais j’en ai encaissé moi aussi des vitupérations véhémentes, des orages, des horreurs à n’en plus pouvoir dormir ! Mais c’est comme ça qu’on s’éloigne de la glace brûlante, qu’on oublie les exquises voluptés ! C’est comme ça qu’on renonce à embrasser la beauté… « C’est le monde », dis-tu, « l’immense charnier des pauvres ». La pauvreté, le malheur, la mort, anéantissent toute beauté, tout projet littéraire, toute idée même d’esthétique… La réalité t’écœure, nous y sommes ! Elle a fini par avoir raison du roman, dis-tu. Les fictions sont partout, hein ?... Partout, sauf dans ton livre ! Non !... C’est faux !... C’est vrai !... J’ai tort !... Arrête donc !... Mais pour qu’enfin la fiction jaillisse, il m’a fallu attendre ! Arriver à mi-parcours ! Admets que c’est fâcheux…
« C’est dans l’immonde que j’ai connu la grâce d’écrire. […] Épingler le Mal sur la langue, sur son verbe, voilà la tâche de l’écrivain, du romancier ; agenouiller la bêtise et la bassesse dans le Verbe, humilier l’abjection dans le Bien qui l’illumine, noyer le péché dans la Lumière qui le subsume, voilà le défi, la vocation et le sacerdoce de l’écrivain, du romancier. »
Sur des dizaines et des dizaines de pages, tu craches tes glaires, le trou ! Tu vomis ton verbe rauque ! Tu glougloutes ! Tu transpires ton amertume ! Tu pleures ta défaite ! Tu nous englues dans tes humeurs jusqu’à la glotte ! Tu nous aspires dans tes déclivités ! Tu chantes pour les ordures !... Ta parole n’est qu’une horrible dégoûtation. Oh, je sais, tu voulais m’énucléer, m’aveugler pour m’asservir à ta vision concave, mais c’est un échec ! Sais-tu pourquoi ?... Les trous j’en fais mon affaire, moi, c’est ma spécialité. Je les creuse, les trous, je les crée, je suis une perceuse, un marteau-piqueur, je suis une foreuse ! Une excavatrice ! Qu’une surface plane se présente, lisse, et je m’y précipite, je m’y vrille, féroce, je coupe, je tranche, je perce, je pénètre, j’écartèle, j’écarte, j’élargis, je dilate, je déchire ! Alors, quoi ?... Tu me crois perdu, condamné à conforter ta nature ignoble d’homme-trou ? Erreur ! Je suis plus malin que ça… Les trous, quand ça me chante, je les rebouche. Facile : il me suffit de creuser un autre trou, au bon endroit. Regarde autour de toi, regarde ! Le vois-tu ? Quelque part dans ta grisaille, là, juste à ta gauche ? Pas le Christ, imbécile ! Mais ce petit tertre boueux ! Tu le vois ? À mesure que ta voix s’épanche hors de tes parois, chacun de mes ricanements muets suffit à faire dégringoler une pincée de terre, et bientôt, mon trou, ta voix ne m’atteindra plus, étouffée par mon œuvre, emmurée vivante – mais n’était-elle pas déjà morte ? –, anéantie. D’autres trous surgiront sous mes coups de boutoir, mais ces trous-là, je les aurai appelés de mes vœux, je les aurai accouchés, je les aimerai !
« Le propre du roman, » écrivait Philippe Muray, « ça devrait être de s’acharner à dévoiler, dans cette néo-réalité, tout ce qui tend maintenant à rendre les romans impossibles. Le roman ne peut réussir à “incarner” le présent caché par les médias qu’au prix d’une hostilité aussi ferme que constante et sereine. » Pas instable, pas enragée ! Mais constante ! Et sereine ! Admets que tes arguments sont bien légers, tout de même... C’est à peine si je ne t’entends pas penser, mon trou : Ah, mais, ma foreuse chérie ! J’ai lu Muray, et plus, et mieux que toi encore ! Toi qui te crois critique, toi en qui je faisais confiance, écoute la voix de mon maître : « Ça pourrait être cela, en fin de compte, le propre de la critique : repérer ce qui tend à rendre le roman impossible. » Oui, mais, tu sais quoi ? Muray n’avait pas toujours les yeux en face des trous ! Ah ! Le roman n’est pas impossible, c’est une évidence, à condition, précisément, de se sortir du vortex, de s’extraire de la centrifugeuse. « Sérieusement », avançait-il encore, « comment écrire aujourd’hui un roman sans raconter, d’une façon ou d’une autre, la métamorphose des moindres événements en sitcom ou en soap ? ». Bien sûr, mon trou, évidemment, honorable intention ! J’admire ton courage, si si, hurler dans le désert n’est pas donné à tout le monde, et aussi pathétique soit-elle, ton écume d’abîme vaut mieux que la prose angotique de bon nombre de tes pairs, aimables et fins, ces bateleurs, ces écumeurs de pots de chambre. Il en faut du courage, mon ami, ma crevasse, pour ainsi se mettre à nu, pour s’écorcher sur la place publique, dans le seul but, pourtant dérisoire, de donner des cauchemars à tes ennemis. Ça fait rire, mais ça force le respect ! Mais le projet murayien, n’est autre que le roman comme boîte noire, comme trou noir, comme trou, comme toi ! Le roman doit élever nos âmes, pas les emporter par le fond ! Un chef d’œuvre ne « poétifie » pas le réel, ni ne le poétise, il ne fait pas comme si les grandes aventures, les grands espaces, existaient encore : il les suscite, il les enracine dans nos chairs, il les crée, tout puissant, par la seule force du verbe !... Il « réellise » !... Toi, tu es le narrateur paradoxal d’un roman du roman impossible – du roman indésiré, charnier immonde parmi d’autres que Ducasse rougissait de nommer.
Et souviens-toi de l’injonction des Poésies : « Si vous êtes malheureux, il ne faut pas le dire au lecteur. Gardez cela pour vous. »
Que ne prends-tu ton courage à deux mains, mon ami, si tant est qu’un trou en possède – des mains, pas du courage – ! Pourquoi écrire, dis-moi ?... Pourquoi hurler ?... Pourquoi montrer tes dents ?... Si ce n’est, précisément, pour surmonter ce dégoût et entretenir, envers et contre tout, la beauté, le feu divin, la vie ?... Tu es comme le tableau d’Edvard Munch, tu cries mais personne ne t’entend puisque tu n’es qu’un trou, une minuscule anfractuosité, de celles que je creuse à tout crin, quand d’autres, qu’anime un esprit à nul autre pareil, créent avec toute leur rage, mais aussi tout leur amour, avec la gniaque, mon trou ! La gniaque ! La volonté, inébranlable, terrifiante, de changer le monde, de bouleverser l’ordre établi, de nous transformer ! Nous ébranler ! En travaillant la langue au corps ! En écrivant la chair ! Dis-nous le sens de la vie, petite fosse ! Réapprends-nous ce qu’exister veut dire ! Fais-moi mal, mais pas comme ça mon trou ! Abandonne le vice morne et normé de la provocation, et invente de nouvelles formes ! De nouvelles tortures ! Équarris-moi ! Vitrifie-moi ! Avec pour seules armes, ton cerveau incandescent, et ton verbe ! Crée un monde, crée notre monde ! Renverse les montagnes !
Mais… qu’entends-je ?... Écoute, trou, écoute la voix d’Antonin ! « C’est que Van Gogh en était arrivé à ce stade de l’illuminisme, où la pensée en désordre reflue devant les décharges envahissantes de la matière, / et où penser, n’est plus s’user, / et n’est plus, / et où il ne reste que de ramasser corps, je veux dire / ENTASSER DES CORPS. / Ce n’est plus le monde de l’astral, c’est celui de la création directe qui est repris ainsi par delà la conscience et le cerveau. / Et je n’ai jamais vu qu’un corps sans cerveau ait été fatigué par d’inertes trumeaux. »
Ne pense plus ! Assez de récriminations ! Assez de tes odieuses brutalités ! Nous n’en pouvons plus de tes blessures narcissiques – ou solipsistes – ! Tu t’en prends, avec une colère dont on ne saurait dire, jamais, si elle est sincère ou calculée, aux « envoûteurs », aux « Merlins véreux » qui nous « grisent aux sodomies » et nous coloscopent à la croissance, à la richesse, à la démocratie, à la mondialisation… « Contre la faim dans le monde ? La croissance ! Contre le licenciement en masse et la baisse du pouvoir d’achat par tête de pipe ? La croissance ! Contre la pollution et le réchauffement de la planète ? La croissance ! Contre la mort du roman ? La croissance ! Contre la connerie universelle ? La croissance ! / C’est le nouveau Dieu de l’univers, la Croissance , la revanche de toutes les dégradations, le diabolique antidote au péché originel. » Charitable avertissement, mais, de grâce, contrôle tes sphincters ! Tu es dans un roman, mon trou, pas sur la table de dissection du cadavre de la littérature ! Tu brandis le glaive à la face de Mammon, tu lui vomis dans la gueule, à Mammon ! Ah, bravo ! Écris donc au Monde Diplo ! Postule à Charlie Hebdo, à la rubrique des Grands Fauves ! Soutiens José Bové ! Rédige ses tracts ! Prépare ses discours ! Fais-toi aduler au forum de Davos ! Comment ça, « non » ?... Pourquoi, « non » ?... Ah, j’ai compris, fourbe ! Tu mens ! Tu affabules ! Tu ruses ! Tu louvoies, traître ! Félon ! Sombre mystificateur ! Langue de vipère ! Tu simules ! Tu nous entourloupes aux artifices ! Tu tapines ton verbe ! Tes impuissances, tes trous d’air, tes déflagrations cérébrales, tes lamentations, tes sanglots de bad lieutenant, c’est la faute du Capital ?... Pas celle des Juifs, tout de même !... « C’est riche qu’on veut devenir. Ni homme, ni citoyen, ni catholique, ni protestant, ni rien, mais domestique de la finance, violemment maniaque de la marchandise, accroché à sa voiture, sa maison, son téléphone, sa télé, son apéritif, comme un chien à son maître. Atome sans attache. Sans mystique. Sans Idéal. […] Le voilà le sens de l’histoire : que tous les temps courent au pognon. Il n’y en a pas d’autre. L’avenir est aux riches, le pauvre n’a qu’à s’enrichir. La fin des temps, c’est le début de la fortune pour tous. » Mais, va donc dire ça au nain présidentiable, à la greluche et à leurs roitelets ! Merde ! Qu’est-ce que tu veux ? Buter une classe ?... Comme disait Céline, « fusiller les privilégiés, c’est plus facile que des pipes !... » Ah, et puis, on s’en fout ! Écris ton Crime et châtiment, ton Roman avec cocaïne, ta Famille royale ! Écoute la prophétie d’Antonin, mon trou, et franchis l’horizon de la folie, pour nous illuminer, tous, de ton génie ! Écoute, aussi, les vibrations de mon rotor, qui s’apprête à en finir avec toi !
À force de faire du rappel dans tes gouffres, « là où se décide le temps qu’il fait dans la chair », ta langue, cette chienne retorse, finit en effet par t’étouffer !... Ta vie était vouée dès la naissance à la lumière, mais le Verbe t’a plongé dans la nuit où tu erres, damné, dans la fosse que tu as toi-même creusée. « C’est à la pauvre lueur de nos cécités que nous voyons les choses », dis-tu. Alléluia ! Mais qui est aveugle ici ? Moi ?... Toi, plutôt, toi, le trou ! Toi, la caverne ! Toi, qui n’a pas d’yeux pour voir, pas d’oreilles pour entendre, seulement tes muqueuses nécrosées !
Tu peux bien vitupérer, personne ne t’entend ! La faute à mon moteur de foreuse ?... Tais-toi donc ! « La provocation pique comme l’aiguille pour faire passer le fil de la colère dans la chair de la bêtise. » Ah ! La provocation, oui, « une façon de remettre la réalité sur ses pieds », comme le disait Brecht… C’est vrai que tu sens le pourri ! Que ton souffle nous oppresse d’un relent odieux. Mais ne crois surtout pas, coquin, que le moindre d’entre nous fasse dans son froc, comme tu te plais à l’imaginer ! Tu n’es pas une lame, mon ami, tu n’es pas un pieu, pas même une épine, encore moins un désespéré !... Seulement un trou ! Un pore indélicat d’où nous pouvons t’extirper comme un vulgaire comédon !
Et cette façon mesquine de te présenter en victime ! « Ah, oui, c’est moi, je l’avoue, c’est bien moi, ç’a toujours été moi, tous les crimes, tous les massacres, tous les génocides, tous les charniers, c’est moi, moi le trébuché des abîmes ! / J’ai gazé les Juifs, j’ai tués les Kurdes, j’ai anéanti les Arméniens, j’ai vendu des Nègres, j’ai empalé des Indiens, j’ai torturé des résistants, j’ai égorgé des enfants, j’ai ouvert des ventres de femmes avec leurs fœtus à l’intérieur, j’ai coupé des têtes et des membres à la hache, j’ai mangé du vagin de fillette, bu du sang de trisomique, j’ai brûlé vivants des tziganes et des homosexuels, j’ai tiré sur la pape, j’ai poignardé Abel, j’ai accusé Socrate, j’ai livré Jésus aux grands prêtres, je l’ai lapidé, mutilé, supplicié, je l’ai cloué sur la croix, je lui ai transpercé la poitrine et j’ai pouffé de rire en voyant le Roi des Juifs crever comme un chien ! / Le Massacre des Innocents, c’est moi ! Les martyrs de Lyon, c’est moi ! La Saint-Barthélemy , c’est moi ! Auschwitz, c’est moi ! Hiroshima, c’est moi ! Sabra et Chatila, c’est moi ! Le génocide Tutsi, c’est moi ! Le 11 septembre, c’est encore moi ! » Ah, elle est belle, ta provocation, elle est efficace, ta prose de combat ! Du name-dropping !... Personne ne t’accuse plus de rien, mon pauvre, surtout pas moi ! Tu jouis, en aparté, de te croire honni, mais tu t’es cuit la main tout seul ! Alors, plutôt que de te couper l’oreille, pourquoi verses-tu encore ces larmes salopes ? Un croisé du Verbe, toi ? Non. Un trou de ver, au mieux…
Tu t’es donné comme mission – non : le Fils de l’Homme (« Une main naguère s’est posée sur mon épaule […]. Je me suis retourné. C’était Lui, le sublime Hébreu, avec sa face douloureuse. […] C’est le lendemain de cette rencontre décisive que ma métamorphose en trou a commencé. »), le Christ donc, Dieu le fils en personne, Celui qui t’a fait Trou –, t’a confié la mission, de « remonter les bretelles à ceux qui ont pourri l’âme » de ton pays… Quoi, j’affabule ?... Bas les pattes, la cuvette ! Ça va finir l’imposture ! En l’air l’abomination ! Mais qui sont-ils, ces démons, ces Nazgûls, ces corrupteurs ?... Et, soyons sérieux, quelles bretelles peux-tu bien voir, autour de toi, trou trônant dans ton tas d’ordures ? Tu veux encore enlever les péchés du monde, « donner la paix » ! Tu n’es qu’un creux, un « immonde siphon vide » ! Un vagin fripé ! Mais tu le sais bien, au fond : tu es conscient de ton insignifiance, tu la sens : « je suis normal », tu dis, « normal et trou » ! Mais tu n’es jamais plus lucide que quand tu t’avoues, dans un souffle, que « [l]a France n’a aucune raison de se fasciner pour [tes] vanités. » Elle a même toutes les raisons de s’en battre la Gaule, la France, de tes vanités, de tes humanités, de tes insanes inanités !
« C’est à la selle qu’on mesure la santé des vivants », dis-tu encore. Mais alors, tu me parais bien mort !... Bien crevé !... Ou plutôt non, vivant encore, mais tout jaune, tout puant ! Le miracle d’une rémission te sera peut-être accordé, si j’en crois la suite – la fin, superbe, qui rachète ta chute invraisemblable ! Dieu ! Comment ton alter ego de chair et d’os a-t-il pu, de livre en livre, dans de tels tourments, sombrer ?... Bucadal, ton baptiste, aurait-il eu raison de toi ?... Te désigne-t-il, interdit, comme l’anus de Dieu ?... Le vois-tu passer, ton monstre, cycliquement, à proximité de ton tas d’ordures, comme un fantôme ?... Et le maniaque sans nom, le schizophrène au salami, l’as-tu aperçu ?... Et ton pote, l’inqualifiable, est-il venu te narguer ?... Bien sûr, que tu les vois ! Évidemment, tu n’as pas le choix ! Ils te hantent. Ils passent et repassent, ils tournent autour de ton Golgotha de pestilence, ils ne t’accordent pas un regard. Aucun ne se penche sur ton sort – c’est ta damnation. Tu t’es pas dupe, n’est-ce pas ? Ils t’ont fait perdre ton temps… Rater ta peine, en te permettant de parler d’eux, quand il fallait seulement parler de toi, afin de pouvoir te taire !...
Je n’en veux pas de ton abîme, mon ange, le mien me suffit. Ma langue hélicoïdale n’a que faire du sang de Dieu – elle préfère celui du monde. Si je perce, si je perfore, si je pénètre, c’est pour prendre la fiente par les cornes et la trouer de part en part !
Tu n’as pas supporté le silence... Il fait noir… Tout est vide… Tu as peur… Dieu et les hommes… Le Verbe et l’ordure… Les élans de l’âme et le moyen de comprendre… Lâchement tu les as inventés ! Sans l’aide de personne ! Pour retarder l’heure de parler de toi… Assez, homme-trou ! N’est pas innommable qui veut ! Moi seul suis homme et tout le reste divin. As-tu jamais approché telle vérité ?... As-tu jamais compris cette phrase sublime ? T’es-tu jamais senti écrasé par son poids titanesque ?...
Tu fais comme si tu étais seul au monde, alors que tu en es le seul absent.
La laideur ! La beauté ! Crois-tu que l’art les ignore ?... À quoi te sert de ruer dans des brancards déjà à la poussière retournés ?... Pourris par la politique … Par la démocratie !... Par la république des lettres !... Tu t’es perdu…. Le théâtre de la cruauté, celui des opérations, ne sont pas là où tu les cherches. Crois-tu que tes maîtres, des écrivains sans peur, sans reproche, sont aussi impuissants que tes ennemis, ou que toi-même ?... Non bien sûr. Notre culture est une charogne, un tombeau, peu importe, quand eux sont définitivement vivants !
« Ce ne sont pas des livres et des mouroirs qu’il faut laisser derrière soi, […] mais des énigmes, des questions généreuses, des réponses ouvertes, des sources vives, surtout pas des tombes, des impasses […] mais des pistes, des foyers, des forges, des débuts d’incendie, des commencements du monde, des divulgations de secrets terribles, des Moby Dick de parturitions à venir ! »
Moby Dick ? Mais tu serais plutôt Bartleby, tu préfèrerais ne pas, tu would prefer not to, sans cesse le grand plongeon tu diffères, tu procrastines !
Tu n’en veux pas de la culture des élites ! Bienheureux ! Tu veux toucher les simples d’esprit directement au cœur, mais tes provocations incessantes ne choquent que les élites, précisément ! Tu as raison : l’homme moderne est une loque ! Une lopette ! Un robot sans autres désirs, sans autres tremblements, que ceux qu’on a soigneusement sélectionnés pour lui. Tu veux réveiller notre monde d’avachis, c’est ça ! « C’est à coups de tonnerre et de feux d’artifice que l’abîme parle aux sens flasques et endormis en les crevant, en les perforant, en les pénétrant de l’intérieur avec bonté. Laissez-vous porter par lui et vous vivrez subtils comme de grands vents, voisins du soleil et des étoiles qui dansent, ennemis des petites obéissances impuissantes et des solennités qui alourdissent le monde, adversaires des petits scrupules qui sans cesse freinent la cadence de ces monstrueuses proliférations. »
« Reclus dans ce cauchemar climatisé où seul est de mise le commerce avec le néant et tous les simulacres de l’autre monde qu’il engendre infatigablement, pareils à des touristes braillards en bob, tongs et bermudas face aux pyramides, vous allez toujours au devant de ce que vous vous attendez à voir, tournant le dos à ce qui vous surprend et vous désarme, incapables de sentir ne serait-ce qu’une seconde comment ce qui n’existe pas encore vous cherche. » J’applaudis de tous mes rouages, de toutes mes courroies ! Mais qu’attends-tu pour renverser la vapeur ? Crois-tu qu’il suffit de brailler pour changer le monde ?... De bramer ?... « Qui ne sent pas la bombe cuite et le vertige comprimé n’est pas digne d’être vivant », chuchote Antonin au-dessus de toi. Écoute, écoute-le.
Planter des banderilles, ce n’est pas réveiller, c’est préparer la mise à mort.
Et ce lyrisme grotesque avec ton Ophélie (« Fais-moi l’orage, fais-moi l’amour, ô mon homme, chuchote-t-elle comme en rêve, pénètre dans le tourbillon de mes plaisirs, empare-toi de mes trésors et démonte mes profondeurs, que je sente une à une s’effondrer mes retenues, va, cours, vole […] »), d’où le sors-tu celui-là ? De tes tréfonds ramollos ?... De tes entrailles de midinette ?... Du fondement à Christine Angot ?... Tu n’es jamais aussi mauvais que dans l’excès de sucre – ou de boue…. « Je rote l’infection de l’époque, je sens le vilain, je pue tellement de la bouche qu’on ne peut pas me sentir ! »
Quand on écrit un roman – je te paraphrase –, on n’est pas contre, mais dans un trou…
Et, cependant…
…Cependant, quand surgit ton tas d’ordures – les tiennes comme celles de tous les hommes (« Le mal est sur la terre et j’en ramasse les répugnantes rinçures partout où il s’enorgueillit de les avoir fait triompher du bien qu’il combat sans trêve afin d’en consigner le sortilège dans le purgatoire des mots que Dieu m’a donnés ») –, quand enfin ton homélie se disloque, quand la fiction reprend ses droits, se rebiffe et tente de s’imposer, ta parole décolle, folle, et laisse espérer un feu d’artifice aussi puissant que ton voyage dans tes entrailles était, lui, pesant…. Elles t’emmènent à la décharge, tes harpies. « Où allez-vous, je hoquette, secoué, branlé, carrousel de bosses et d’ecchymoses, tout le verbe démantibulé tellement ils me voyagent vite dans la nuit.
À la décharge, qu’on me répond, à l’endroit où tout finit par se dissiper, là où est ta place, avec toutes les ordures de ton espèce qui fatiguent la terre ! »
« [..] J’y découvre des perles de chagrin à la décharge, ce glossaire de toutes les dévastations, mille souillures, mille traces du vécu, mille lambeaux de vie, des usures et des corrosions, des corruptions, des prostitutions, […], et bien d’autres décompositions encore, idoles pantelantes démasquées, toutes prostrées dans la désolation d’être sans lumière. »
« […] Pourquoi là ? je demande.
C’est ton tas d’ordures à toi. C’est là que tu règneras désormais, sur ta pourriture ! »
« Illisibles, dégueulasses, crasseux, mes heures, mes rêves avortés, mes rages d’entrailles, mes paludismes de moelle, j’ai donc jeté tout ça moi, je me récapitule dans ce Golgotha d’ordures, tout ce que j’ai bouffé rendu, cette colline, cette boursouflure infecte, […] mon édifice, mon œuvre involontaire, l’ultime écho de mes errances, de mes vices, de mon égoïsme, de tous mes crimes, une cathédrale d’immondices, le tableau hideux de ma sublime sombre époque ! »
« […] De ces ordures je ferai le temple de ma renaissance. »
Enfin tu commences à voir, le trou, de tes yeux fous ! Enfin, crucifié sur l’autel de tes abîmes, tu entrevois la vérité du monde !... Sa beauté !... Celle à laquelle, désormais, tu dois sacrifier toute ton âme ! Tu me bouleverses, sais-tu, quand tu mets bas tes masques, quand enfin tu te révèles, dans toute ta nudité d’écorché vif, quand, voyant s’éloigner ton Ophélie, soudain tu paniques…
« Je suis là, je hurle, je suis là, au rond-point du néant, viens par là, je hurle, regarde-moi, je sais que ça va être dur à avaler, mais c’est moi, c’est bien moi, ce trou dans la terre, cette fente entre les ordures, c’est moi, c’est bien moi ! […] Cette chose, je me dis en moi-même, cette chose affreuse que tu fixes, c’est l’homme que tu aimes, c’est l’homme qui te chérit, c’est l’homme que tu as épousé. »
Enfin ! Tu n’as plus rien de ridicule, alors, desquamé, équarri jusqu’à l’âme, tu deviens splendide, tragique, alors, dans ta pudique indécence, tu deviens vrai ! Tu n’es plus trou alors, mais homme ! Et, seulement, tu peux renaître, comme mort peut-être, comme suicidé peut-être, mais vivant, enfin, et apaisé.
« Je ne fais plus qu’un avec la colère de l’eau, une furie sans haine, la simple volonté d’aller de l’avant et de rompre les obstacles, avec la joie enfantine d’affirmer sa force au reste de l’univers ainsi que le plaisir innocent de triompher de l’impossible. […] Ça murmure des secrets au creux de l’oreille. Ça chante, ça houle, l’air est lourd, gluant, pourvu que de gros doigts spongieux qui se glissent tout contre le visage, s’agite autour des yeux, tâte le mou des lèvres, cajole le dur des dents. C’est mon jour de noces avec l’univers. »
Dieu ! Que c’est beau ! Que j’aime ce dénouement qui est aussi renouement, si paisible, si serein, enfin. Traquer la lumière, jusque dans l’ordure, voilà ton secret dessein ! Je m’incline, l’homme, je me retire, je te laisse t’épanouir, j’irai creuser mes trous ailleurs. « C’est moi l’amoureux fou des clartés sublimes, des mille et mille prodiges du cosmos. » Et tu la trouves, la lumière, ou plutôt, elle te trouve in extremis, la lumière, à la toute fin, au dernier mot.
« Je suis arrivé dans la paix du monde, là où la beauté, immense comme le ciel, se serre avec amour contre le cœur de la Lumière. »
Éric Bénier-Bürckel, Un peu d’abîme sur vos lèvres, L’Esprit des Péninsules, 2007.

 Le dispositif formel d’Entre les murs (Palme d’Or à Cannes) est extrêmement simple. Certains ont noté le positionnement des caméras, toujours du même côté de la classe, en arbitre impartial du jeu qui se déroule sous nos yeux. Nous avons d’une part le professeur, avec sa personnalité propre, ses idées, ses méthodes – bonnes ou mauvaises –, son système pédagogique, ses positions sur la discipline, ses errements et ses dérapages, un professeur, en somme, qui fait ce qu’il peut pour faire son travail, transmettre un savoir et éveiller ces adolescents à la réflexion, à la curiosité, bref, à l’intelligence en acte ; nous avons de l’autre les élèves agités, inattentifs, parfois violents, avec leur tchatche, leurs insultes, leur langage spécifique – un langage rompu aux arcanes du combat, comme le note justement Pierre Cormary dans une critique à charge par ailleurs très confuse, dont je ne partage pas du tout les conclusions –, leurs railleries incessantes et leur tragique incapacité à assimiler les leçons de leurs enseignants, mais aussi avec leur incroyable vitalité. François Marin/Bégaudeau n’incarne pas l’excellence. Il n’a même pas valeur d’exemple. À l’inverse de son collègue professeur d’histoire et géographie, il ne se drape pas dans les principes, alors il tâtonne, multipliant les erreurs, « charriant » plus qu’à son tour, jusqu’à comparer le comportement de deux greluches à celui de « pétasses », provoquant alors de sérieux remous…
Le dispositif formel d’Entre les murs (Palme d’Or à Cannes) est extrêmement simple. Certains ont noté le positionnement des caméras, toujours du même côté de la classe, en arbitre impartial du jeu qui se déroule sous nos yeux. Nous avons d’une part le professeur, avec sa personnalité propre, ses idées, ses méthodes – bonnes ou mauvaises –, son système pédagogique, ses positions sur la discipline, ses errements et ses dérapages, un professeur, en somme, qui fait ce qu’il peut pour faire son travail, transmettre un savoir et éveiller ces adolescents à la réflexion, à la curiosité, bref, à l’intelligence en acte ; nous avons de l’autre les élèves agités, inattentifs, parfois violents, avec leur tchatche, leurs insultes, leur langage spécifique – un langage rompu aux arcanes du combat, comme le note justement Pierre Cormary dans une critique à charge par ailleurs très confuse, dont je ne partage pas du tout les conclusions –, leurs railleries incessantes et leur tragique incapacité à assimiler les leçons de leurs enseignants, mais aussi avec leur incroyable vitalité. François Marin/Bégaudeau n’incarne pas l’excellence. Il n’a même pas valeur d’exemple. À l’inverse de son collègue professeur d’histoire et géographie, il ne se drape pas dans les principes, alors il tâtonne, multipliant les erreurs, « charriant » plus qu’à son tour, jusqu’à comparer le comportement de deux greluches à celui de « pétasses », provoquant alors de sérieux remous… Au centre, donc, la caméra. D’autres critiques ont par ailleurs évoqué le morcellement de l’espace par le montage. Au plan d’ensemble, Laurent Cantet préfère ici le plan rapproché et le gros plan : c’est avec la même neutralité que sont non pas jugés mais observés François Marin/Bégaudeau, ses élèves, ses collègues dans la salle des profs ou au conseil de classe… Observés, non froidement comme les cobayes de quelque expérience, non comme des figures générales (« prof », « élèves ») mais avec empathie, c’est-à-dire considérés comme des individus à part entière, dans toute leur singularité. S’il y a bien confrontation, donc, entre une classe et un professeur, cette classe n’en est pas moins constituée d’élèves d’origines sociales et ethniques diverses, qui eux aussi ont leur histoire, leurs préoccupations, et leur personnalité propres. Le jeu de champs et contrechamps serrés qui fusent au rythme quasi slamé des répliques, vise moins à « donner raison » aux méthodes de Marin (par exemple lors de ses face-à-face avec son rival idéologique, le prof d’histoire), dont nous avons vu qu’elles étaient pour le moins discutables – surtout en matière de discipline –, qu’à nous faire reconsidérer les débats autour de l’école – malgré toutes les réserves, souvent d’une violence hors de propos, que suscitent ses choix pédagogiques, Marin/Bégaudeau parvient parfois à ses fins mieux que quiconque –, ainsi qu’à mettre en scène un rapport de force – à chacun son territoire : s’ils tolèrent tout juste l’autorité du professeur dans l’enceinte de la salle de cours, les élèves s’opposent violemment à lui lorsque ce dernier, dans une séquence d’une rare intensité, s’en prend à eux dans la cour, leur domaine… Reste que cette fragmentation de l’espace tend à égaliser la parole (« Pour vous, enculé, c’est comme pour nous, pétasse »), à relativiser l’importance des uns et des autres, à embrasser avec la même bienveillance la parole du professeur et celle des élèves. C’est d’ailleurs le principal reproche fait au film par ses détracteurs, souvent professeurs eux-mêmes… Ils ont tort : si Entre les murs épouse le point de vue de Marin/Bégaudeau, il n’en montre pas moins ses inquiétantes impasses. À cette fragmentation paritaire et égalitaire de l’espace, qui fait clairement écho à la perte de pouvoir du professeur, s’ajoute un troisième choix essentiel de mise en scène, d’autant plus discret qu’il n’est pas visible, et décisif pour la compréhension du film : l’aplatissement temporel.
Au centre, donc, la caméra. D’autres critiques ont par ailleurs évoqué le morcellement de l’espace par le montage. Au plan d’ensemble, Laurent Cantet préfère ici le plan rapproché et le gros plan : c’est avec la même neutralité que sont non pas jugés mais observés François Marin/Bégaudeau, ses élèves, ses collègues dans la salle des profs ou au conseil de classe… Observés, non froidement comme les cobayes de quelque expérience, non comme des figures générales (« prof », « élèves ») mais avec empathie, c’est-à-dire considérés comme des individus à part entière, dans toute leur singularité. S’il y a bien confrontation, donc, entre une classe et un professeur, cette classe n’en est pas moins constituée d’élèves d’origines sociales et ethniques diverses, qui eux aussi ont leur histoire, leurs préoccupations, et leur personnalité propres. Le jeu de champs et contrechamps serrés qui fusent au rythme quasi slamé des répliques, vise moins à « donner raison » aux méthodes de Marin (par exemple lors de ses face-à-face avec son rival idéologique, le prof d’histoire), dont nous avons vu qu’elles étaient pour le moins discutables – surtout en matière de discipline –, qu’à nous faire reconsidérer les débats autour de l’école – malgré toutes les réserves, souvent d’une violence hors de propos, que suscitent ses choix pédagogiques, Marin/Bégaudeau parvient parfois à ses fins mieux que quiconque –, ainsi qu’à mettre en scène un rapport de force – à chacun son territoire : s’ils tolèrent tout juste l’autorité du professeur dans l’enceinte de la salle de cours, les élèves s’opposent violemment à lui lorsque ce dernier, dans une séquence d’une rare intensité, s’en prend à eux dans la cour, leur domaine… Reste que cette fragmentation de l’espace tend à égaliser la parole (« Pour vous, enculé, c’est comme pour nous, pétasse »), à relativiser l’importance des uns et des autres, à embrasser avec la même bienveillance la parole du professeur et celle des élèves. C’est d’ailleurs le principal reproche fait au film par ses détracteurs, souvent professeurs eux-mêmes… Ils ont tort : si Entre les murs épouse le point de vue de Marin/Bégaudeau, il n’en montre pas moins ses inquiétantes impasses. À cette fragmentation paritaire et égalitaire de l’espace, qui fait clairement écho à la perte de pouvoir du professeur, s’ajoute un troisième choix essentiel de mise en scène, d’autant plus discret qu’il n’est pas visible, et décisif pour la compréhension du film : l’aplatissement temporel.