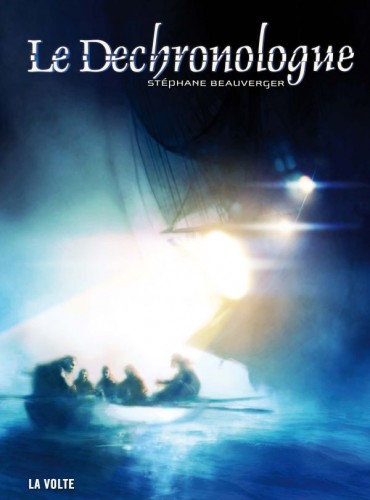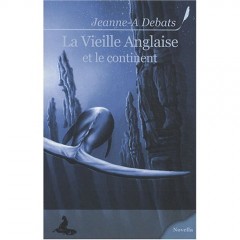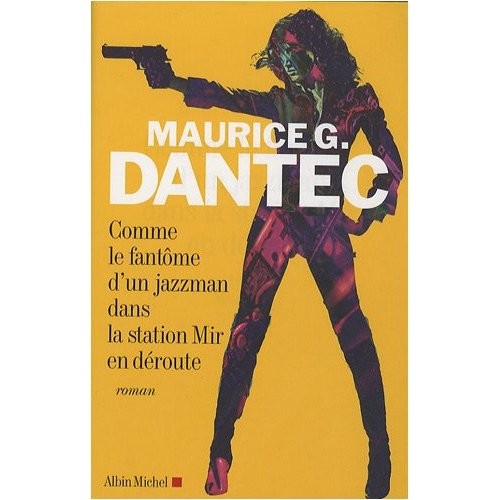« Ceux qui servent des vanités trompeuses,
c’est leur grâce qu’ils abandonnent »
Jonas, 2:9.
« Tant va le cachalot qu’à la fin il se casse. »
Le Dit du Transhumain
La Vieille anglaise et le continent, tel était le titre de l’improbable opuscule de soixante-dix pages, publié chez Griffe d’Encre, qu’acquit récemment le signataire de cet article à la faveur d’un trajet à grande vitesse entre Nancy et la Gare de l’Est. L’auteur de l’ouvrage (et amie des animaux), « Jeanne-A Debats » – ce bizarre nom d’emprunt (le A fait toute la différence) ne manquera pas de susciter dans les alcôves les jeux de mots les plus irrespectueux où il sera question, soyez-en sûrs, de deux francs et peut-être six sous (on me dit en coulisse que cette allusion aux deux balles est vraiment lamentable : j'en conviens sans peine) –, sévit sur divers forums sous le sobriquet de « dracosolis » et a remporté avec ce texte le Grand Prix de l’Imaginaire 2009 de la meilleure nouvelle francophone, ainsi qu’un « Prix du Lundi » – qui récompense traditionnellement les mêmes lauréats que son aîné. En jetant mon dévolu sur ces quelques feuillets, je n’étais donc pas guidé par le seul hasard. Du reste il n’est pas impossible que la décision du Destin ait été influencée par le fait que le critique de son choix venait alors, par extraordinaire, de refermer la merveilleuse traduction de Moby Dick par Armel Guerne aux éditions Phébus. Autant dire que s’il n’avait aucune autorité pour poser en spécialiste, votre serviteur n’était pas tout à fait ignorant des mœurs et coutumes des mammifères marins, et en particulier de ceux que nos amis anglo-saxons appellent joliment Sperm whales.
Par malheur, mon plaisir fut de courte durée. Un titre aux accents trompeusement hemingwo-truffaldiens, une baleine écologiste et plus ou moins homosexuelle, quelques creuses références au chef d’œuvre de Melville, une idée de science-fiction abracadabrantesque et pour finir une poignée d’images à la poésie un peu mièvre, avaient apparemment suffi à séduire nos facétieux jurys, mais en ce qui me concerne, gentil lecteur, la cause est entendue : aussi artificielle que le pseudonyme de son auteur (« JAD » est aussi le nom d’un décompilateur), la novella n’est pas à la hauteur de sa réputation, ni en termes esthétiques, ni, ainsi que nous le montrerons plus loin, en termes spéculatifs.
La vieille anglaise, c’est Lady Ann Kelvin. Atteinte d’un cancer en phase terminale, celle-ci accepte la proposition insensée de son ancien amant : une transmnèse dans un cachalot mort – c’est-à-dire la « transplantation de l’esprit » (nous y reviendrons) d’un cerveau à un autre – à des fins éco-terroristes : réincarnée en baleine albinos, elle doit répandre chez ses nouveaux congénères un virus dont les consommateurs humains sont la véritable cible. Une fois sous l’eau, Ann cliquette et batifole avec un autre mâle, démantèle un réseau clandestin impliquant des braconniers sans scrupules et des ignobles trafiquants de clones transmnésiques, et plane béatement, en bon cachalot gnostique, dans les Courants du Rêve qui mènent au continent cétacé – une sorte de jardin d’éden sous-marin auquel les baleines, qui passent leur temps à rêvasser, seraient universellement connectées…
L’on passera rapidement, si vous le permettez, sur les lieux communs, clichés et autres platitudes (« Lorsque je l’avais connue, elle avait passé le stade de la consternation devant l’épouvantable gâchis que l’humanité était en train de commettre avec les ressources vitales de l’océan ») dont souffre parfois un texte relativement fluide mais encore alourdi par des dialogues beaucoup trop démonstratifs (et qui réussissent néanmoins à rester extrêmement vagues quant aux explications scientifiques). Par exemple, était-il bien utile de préciser que les coques métalliques sont plus difficiles à défoncer, pour un cachalot, que les « antiques membrures de cèdre ou de chêne » ?... Il ne nous semble pas. Et après avoir mentionné les numéros de série tatoués sur l’épiderme des clones de transmnèse, est-il seulement possible , mon Dieu, d’avoir jugé opportun d’ajouter, au cas pourtant improbable où le parallèle nous échapperait, que « ces tatouages en évoquaient d’autres plus anciens qu’elle ne pouvait s’empêcher de trouver tout à fait similaires » ?... N’est-ce pas délicieusement consternant ?
Mais venons-en enfin, mes amis, au cœur du problème qui nous préoccupe aujourd’hui. La transmnèse, donc – dont il est dit qu’elle tient rarement plus de cinq ou six ans –, serait une « transplantation d’esprit » (p. 11), généralement opérée sur un clone prévu à cet effet, produit « avec le minimum de connexions neuronales » (p. 21). Il s’agirait d’implanter « une mnèse de “personna” complète – désirs, peurs, souvenirs, pulsions apprises, innées, compétences, tout ce qui fait de nous des individus, tout ce qui a façonné notre cerveau physiquement […] – sur un support qui n’est pas adapté et qui, surtout, n’a pas la place, pourrait-on dire, d’accueillir ces nouvelles. […] Si on greffe la “personna” sur un clone enfant, le résultat n’est pas bon parce que la souplesse corticale est contrebalancée par le stress psychologique et les réapprentissages moteurs les plus primaires. Et dans un corps artificiellement mené à l’âge adulte, la matière grise n’a plus, de fait, sa plasticité infantile. […] Toujours est-il, que lorsqu’on a tenté de greffer une mnèse sur un cerveau mature et formé, témoin les expériences sur les gorilles, la place manquait encore plus parce que nous ignorions comment “évacuer” les aptitudes et la “personna” du receveur. Et la mnèse tenait encore moins » (pp. 21-22). Concrètement, « on injecte au patient un composé très radioactif qui va permettre de réaliser un travail de cartographie cérébrale extrêmement précis. C’est cette image qui nous intéresse et qui va être transférée. […] C’est également cela qui va causer la mort physique du mnésique dans les minutes à venir. » (p. 33) Le greffon, obtenu après prélèvement d’une « fine carotte du cortex préfrontal » (p. 34) et développement cellulaire accéléré, doit ensuite « [croître] dans les espaces vides » et « reproduire l’intégralité du système auquel il appartenait ». « Nous capturons réellement l’âme, vous savez » (ibid), ajoute encore notre sympathique spécialiste.
Voilà qui ne laisse pas de poser un certain nombre de problèmes… D’abord, cette idée de provoquer le développement d’une copie de la “personna” avec les seules données d’une « fine carotte » corticale, est une aberration scientifique. Reconstituer souvenirs et connexions neuronales à l’identique à partir d’un prélèvement limité est bien entendu rigoureusement impossible, du fait même du mode de développement de la personnalité et du cerveau lui-même. Sauver trois pages d’un roman n’a jamais permis à l’infortunée victime d’un incendie ou d’une perte de données, d’en retrouver le texte intégral !
Mais d’ailleurs, pourquoi ces deux « n » à “personna” ? C’est en vérité une question essentielle, parce que de la conception qu’a l’auteur de la personnalité individuelle (c’est-à-dire de l’identité : qui suis-je ?) dépendait la réussite de la fiction. En ajoutant ce « n » à la persona jungienne – qui désignait le masque social –, l’auteur assimile la personne, l’individu en tant que tel à sa seule « âme » (le mot revient très souvent), autant dire de l’information pure. La première conséquence d’une conception aussi réductrice de l’être est d’évacuer totalement l’importance pourtant essentielle du corps et de l’environnement. Même incarnée dans la lourde cervelle d’un grand cachalot, même immergée dans un univers radicalement autre, Lady Ann Kelvin (au patronyme en cela faussement solaristique) conserve toute son intelligence humaine, tous ses souvenirs et, sans dommage, la structure de son langage – sans parler de son (agaçant) sens de l’humour et de la répartie, comme si, en définitive, être de telle ou telle forme, dans tel ou tel monde, n’avait qu’une incidence secondaire sur notre identité ! Pourtant « Jeanne-A Debats » sent confusément combien la question du corps est importante : après la transmnèse, Ann conserve toutes ses facultés intellectuelles et psychiques antérieures mais n’en bénéficie pas moins (sans la plus petite ombre de justification scientifique) des caractères innés du corps de cachalot, comme par exemple son sens de l’orientation. Autre exemple : son corps massif « se souvenait » que ses ancêtres éperonnaient jadis les navires des baleiniers. Cette mémoire du corps entre en contradiction avec le concept de transmnèse, qui prétend, rappelons-le, transplanter la « “personna” complète – désirs, peurs, souvenirs, pulsions apprises, innées, compétences » : les caractères innés font-ils partie de « l’âme » du patient, toute entière supportée par le cerveau, comme le suggère le théoricien de la transmnèse, ou bien relèvent-ils du corps, ainsi que le suppose le comportement de Lady Cachalot ?… Celle-ci en effet, en dépit de certaines adaptations nécessaires à la vie aquatique, continue de raisonner et de se comporter en être humain. Elle anthropomorphise même ses congénères, avec qui elle tient de banales conversations, inventant pour l’occasion l’humour cachalotier (qui en vérité ne fait rire personne, hommes ou marsouins).
Et que la transplantation d’âme se fasse dans un cerveau mature ou dans un cerveau encore jeune, il s’agit dans tous les cas de transférer une personnalité complète, elle-même déjà mature, dans un autre cerveau. Autrement dit l’auteur ne se pose jamais la question du siège de l’âme : où réside l’identité de l’individu ? Pour « JAD » la personnalité est tenue pour le cerveau, ou plutôt résiderait dans le cerveau, c’est-à-dire qu’elle existerait, en théorie, indépendamment du cerveau lui-même – simple support –, indépendamment du corps, et indépendamment de l’environnement…
De manière générale, la science-fiction ne s’est que trop rarement penchée sur la question de l’identité-ipséité (au sens ricœurien de maintien de soi) et du « corps propre ». Comme le rappelle Sylvie Allouche dans « Identité, ipséité et corps propre en science-fiction » (in Alliage n° 60, juin 2007), le concept de corps propre est relativement simple :
« parmi l’ensemble des corps qui sont dans le monde, choses inertes, choses vivantes, objets artificiels, etc., il en existe un avec lequel j’ai un rapport tout particulier de possession ; ce corps est le mien : au “corps comme mien” s’oppose mon corps comme “corps parmi les corps”. L’étroitesse de relation que j’ai avec lui peut même me conduire à soutenir que “je suis ce corps” ou plutôt que “je suis mon corps”. Mais restons-en à la formulation courante, mois radicale, j’ai un corps, ce corps est le mien. S’il y a bien quelque chose de l’ordre de la mêmeté dans la notion de corps, le point crucial reste que l’existence d’un corps propre apparaît comme l’expression la plus manifeste de l’ipséité […] »
Greg Egan, lui, s’y est intéressé. Certes, dans La Cité des permutants les personnalités sont copiées dans des environnements virtuels, mais l’absence de corps véritable, en partie palliée par des contraintes elles-mêmes purement virtuelles, révélait explicitement la différence entre l’être d’origine et sa copie : il ne s’agissait pas, tout simplement, de la même personne, parce que, pour reprendre la terminologie de Ricœur, la mêmeté (la stabilité des caractères) n’est pas suffisante. Dans sa nouvelle « Le Réserviste », Egan mettait déjà en scène la transplantation d’une partie du cerveau d’un milliardaire – celle où résiderait le noyau de sa personnalité – dans un clone de substitution. Egan ne se posait pas la question très terre-à-terre de la durée de vie du greffon, comme le fait « Jeanne-A Debats », mais celle, philosophique, de l’ipséité : être un autre, n’est-ce pas déjà n’être plus soi-même ?...
Si l’on s’en tenait à une simple définition de l’ipséité – cette faculté de se reconnaître soi-même à travers le temps, sans noyau permanent identifiable : j’étais jadis un bébé, je suis aujourd’hui un adulte : ce je est permis par l’ipséité –, La Vieille anglaise et le continent ne serait, sur ce point, nullement critiquable : j’étais une vieille femme, je suis aujourd’hui un cachalot, mais c’est encore moi (d’autant que l’auteur prend soin de préserver aussi « l’identité narrative » : Ann ayant conservé sa mémoire de vieille femme, elle peut toujours se raconter). Mais la transmigration d’un corps à un autre bouleverse la donne ! Le texte en effet ni ne s’interroge sur l’identité d’Ann/cachalot, ni n'en illustre les problématiques. Certes, disons-le pour être complets (et pour que l’on ne nous qualifie point de dissimulateur), Ann/cachalot évolue vaguement vers un devenir-cachalot, symbolisé par son hypothétique accession finale au continent cétacé, mais précisément cette évolution suppose au préalable que la situation de départ soit celle du statu quo ; or, nous l’avons vu, celui-ci nous semble fort peu vraisemblable.
Non, ami lecteur, à aucun moment « Jeanne-A Debats » ne parvient à faire exister, en tant qu’autre (puisqu’il est toujours le même), son personnage né de la fusion d’Ann Kelvin avec le cachalot. Quelle que soit son enveloppe charnelle, et quelles que soient ses évolutions psychologiques, la vieille anglaise reste la vieille anglaise, à un point tel qu'elle se révèle encore capable de jouer les détectives océaniques !
À cette faillite, le critique sommé de se prononcer voit deux raisons. La première, on l’a vu, est d’ordre spéculatif : on ne saurait « capturer » une âme sans l’altérer, ou plutôt sans la détruire, pour en recomposer une copie forcément métamorphosée par ses nouvelles conditions, puisque à nos yeux, « l’âme » est absolument indissociable du corps-propre et de la notion d’adaptation ; Ann/cachalot est-elle/il encore Ann ? Ni l’auteur, ni Sénac, ni l’intéressée, ne s’en soucient. La seconde est d’ordre formel. Non seulement l’auteur échoue à faire exister son Über-cachalot, mais elle ne parvient pas plus à camper un narrateur masculin crédible : Marc Sénac, qui relate une partie du récit, écrit, pense et réagit non comme un homme, mais comme un homme vu par une femme… Si du moins telle distinction est encore opérante, puisque, selon notre interprétation du texte, le corps n’y joue d’autre rôle que celui de simple périphérique amovible (avec il est vrai certains problèmes de formatage). « Jeanne-A Debats » n’a donc pas, de notre point de vue, réussi à incarner ses personnages. À l’image même de la transmnèse qu’elle met en scène, elle s’est contentée de se transporter dans tel ou tel personna(ge) – homme, femme, baleine – sans que son intégrité soit menacée. Marc Sénac n’existe pas en tant qu’homme, Ann n’existe pas en tant que Sperm whale, ils apparaissent sans cesse comme des rôles joués par une « Jeanne-A Debats » égale à elle-même, soucieuse de la seule mêmeté (je me vois en baleine, donc je suis une baleine) sans le plus petit égard pour l’ipséité. Et le naufrage de la dernière partie de la nouvelle, qui verse dans le mauvais techno-thriller, se présente dès lors comme l’aboutissement logique de cette superficialité systématique, que nous expliquerons fort simplement : les raisons de la transmnèse d'Ann Kelvin dans un Moby Dick mort sont invraisemblables. Car enfin, j'aimerais que l'on m'explique pourquoi, plutôt que de déployer un arsenal technologique aussi fumeux que celui de la transmnèse, les éco-terroristes de La Vieille anglaise ne choisissent pas un moyen beaucoup moins coûteux, et beaucoup plus sûr, de répandre une épidémie chez les cétacés... Ce point pourtant essentiel n'est jamais résolu et, comme le reste, traité avec désinvolture. Abracadabrantesque, vous disais-je.
Le seul passage où se manifeste une tension intéressante entre l’identité d’Ann Kelvin et son corps d’emprunt, est celui-ci : « Toutes les fibres de son être la tiraient vers le bas. Mais son âme hurlait de frayeur ». Malheureusement, ce début de dissociation, qui aurait pu, s’il avait donné lieu à de solides développements, aboutir à une réflexion passionnante, ne sera suivi d’aucun autre, excepté tout de même au cours de l'épisode du kraken (Ann/cachalot terrifiée par ses propres hurlements : superbe idée). Ann apprend à apprivoiser son nouveau corps, comme un enfant, mais aussi comme si celui-ci avait été le sien depuis toujours, comme si, surtout, de l’occupation d’un cerveau de cachalot par une personnalité humaine ne devait pas naître de terribles conflits et une nouvelle personnalité totalement déstructurée…
Stylistiquement plat, jamais crédible et science-fictivement décevant, La vieille anglaise et le continent se lit rapidement mais ne mérite aucune des louanges que les milieux autorisés lui ont généreusement accordées, et je ne saurais trop conseiller à mes avisés lecteurs de se plonger ou se replonger dans les sublimes eaux du vrai Moby Dick, ce Léviathan littéraire dont chaque phrase contient l’écho, lointain mais perceptible, de l’univers tout entier…



 Les malheureux utilisateurs d'Internet Explorer n'ayant pas eu accès à ma dernière note consacrée à La Mémoire du Vautour de Fabrice Colin, je la propose
Les malheureux utilisateurs d'Internet Explorer n'ayant pas eu accès à ma dernière note consacrée à La Mémoire du Vautour de Fabrice Colin, je la propose