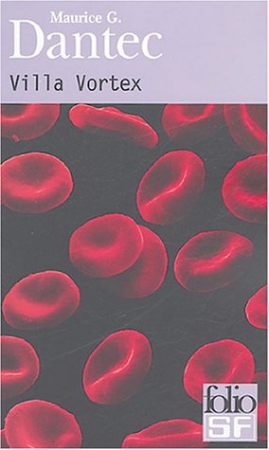
« Le monde est totalement dépourvu d’amour. Ne reste qu’un peu de lumière sur des villes perdues. »
Maurice G. Dantec, Villa Vortex
Kernal est flic à Créteil, un dur à cuire, un homme, un vrai. Mais cet alter ego de Toorop (La Sirène rouge, Babylon Babies) est confronté à un sérieux problème : un serial killer d’un genre un peu particulier sévit aux abords de centrales électriques en voie de démolition, semant derrière lui des cadavres atrocement mutilés dont certains organes ont été remplacés par des composants électroniques, comme pour les animer d’une pathétique vie artificielle. De la chute du mur de Berlin en 1989 jusqu’aux attentats d’Al Qaida du onze septembre 2001, Kernal cherche la trace d’un tueur qui semble avoir été oblitéré du monde réel. Entre temps, plusieurs rencontres décisives vont lui révéler des dimensions latentes de son être. Ces rencontres ont pour nom Nitzos, musicien reconverti dans le journalisme de guerre en Yougoslavie, auteur de quelques pages prophétiques, et Wolfmann, flic paranoïaque à la retraite, inventeur d’une théorie du crime absolu, dont l’arme principale est rien moins qu’une « bibliothèque de combat », corpus de romans et d’essais triés sur le volet censés faire surgir la vérité par la force de leur Verbe. Wolfmann est aussi l’homme qui initie Kernal aux bienfaits de la méthédrine, substance qui permet de rester éveiller durant de très longues périodes mais qui désinhibe les comportements violents. Dans une région parisienne crépusculaire, entre un Paris nécrosé et sa dangereuse ceinture urbaine, Kernal se transforme peu à peu en super-flic autodidacte et halluciné, hard boiled dick sous amphétamine qui fonce inéluctablement droit dans le mur. Contre toute attente cependant, Kernal survit à sa descente en Enfer – pour mieux y replonger. Tandis que l’affaire du tueur à la caméra le taraude toujours, tandis aussi que s’érige sous son nez la Très Grande Bibliothèque de François Mitterrand, lui et ses équipiers, informés par un ex-mercenaire d’extrême droite, sont confrontés à un réseau terroriste islamiste. Et lorsque les tours jumelles de Manhattan s’effondrent, terrassées par des avions de ligne de l’Apocalypse, Kernal comprend que le poisson est beaucoup trop gros pour lui. Trop tard : il finit par sauter. Dernière partie : Kernal est-il mort ? Il évolue désormais dans un inframonde futuriste et apocalyptique où il rencontre le diable lui-même, où Paris est un parc d’attraction culturel et où quelques résistants cybernétiques, reliés neurologiquement au Bibliogôn – sorte de base de données intelligente – luttent pour délivrer la civilisation occidentale de sa décadence avancée. Kernal-Nitzos, au cœur de cet Anti-Monde, prend évidemment fait et cause pour ces résistants. Parmi eux, on trouve Rommel, le grand stratège allemand et Massoud, le rebelle afghan. Leur cible principale, hautement symbolique : la Très Grande Bibliothèque de Babel. L’œuvre de destruction/création peut enfin commencer…
Rendre compte d’un roman d’une telle ampleur, d’une telle ambition, d’une telle ébullition encore, n’est certes pas une mince affaire, ce qui explique sans doute pourquoi la Critique s’est contentée d’une lecture superficielle ou commodément polémique, sinon, comme souvent, chez le Stalker, auteur du meilleur article consacré à Villa Vortex, et pour couronner le tout d’un entretien passionnant avec Dantec. Comme le précisait justement Juan Asensio, et comme il faut le marteler sans cesse, ces articles sans intérêt qui n’ajoutent rien au roman, vulgaires publicités ou grossières exécutions sommaires, sont (prématurément) éjaculés par des critiques professionnels, qui non seulement ne paient jamais les livres chroniqués – ce qui se traduit le plus souvent par une exaspérante indulgence pour l’énorme ventre mou de la littérature française, indulgence seulement émaillée de loin en loin par une attaque généralement sous forme de bons mots, rarement argumentée –, mais qui, de surcroît, sont payés pour lire… Soyons donc sans pitié et profitons qu’Internet échappe encore au contrôle des Gardiens de la pensée unique pour réduire ces imposteurs en morceaux, pour à notre tour les rouer de coups jusqu’au sang et défendre ce qui, dans la littérature, nous paraît essentiel – j’en vois certains qui tremblent de se ruer sur leur clavier et de m’accuser de « terrorisme intellectuel » : peu importe. Jetons à l’égout ces montagnes d’oeuvrettes, sympathiques ou non, d’écrivaillons sans envergure qui n’ont rien d’autre à écrire que leurs maux d’incréateurs, et jetons avec elles ceux qui, critiques – charognards – professionnels, fondent avidement sur les restes de gloire et de reconnaissance de ceux qu’ils haïssent en secret, faute d’être vraiment des leurs – les écrivains.
Surtout, parallèlement à l’incohérence de ses pamphlets – invectives logorrhéiques dont la véhémence relève plus, parfois, du syndrome de Tourette que du génie bloyen – se dessine une cohérence littéraire hors du commun. Ainsi que l’avait avancé Juan Asensio – ce dont je n’avais alors pour ma part qu’une conscience aux contours encore flous, une indéfinissable intuition –, le sujet de Villa Vortex n’est ainsi rien moins que le langage lui-même – le livre se présentant alors comme une tentative désespérée de rédimer le Verbe corrompu par la société moderne et technicienne – le Mal – et son rapport au monde.
L’ennui, et finissons-en une fois pour toutes avec les vaines polémiques qui parasitent tout discours critique sur l’œuvre de Dantec, est que l’auteur – dont la conversion au catholicisme, au cœur de Villa Vortex, n’est pas de moindre importance –, comme nombre de contempteurs de la modernité, juge le monde contemporain selon des présupposés dont la seule légitimité est désormais littéraire (ou spirituelle, ce qui, en un sens, revient au même). Autrement dit, vouloir sauver le langage (le monde) de ce vortex qui le réduit en cendres (vouloir l’arracher, en d’autres termes, des mains corruptrices des incultes et des vaniteux), est plus un moteur de fiction ou de transcendance personnelle qu’un authentique – et utopique – idéal philosophique et politique. Faut-il encore rappeler que confrontés aux contingences du Réel, les idéaux ainsi subvertis drossent la société vers les extrêmes ?
Une fois admise, tout de même, cette lente et implacable décomposition du langage, nous pouvons aisément retracer le chemin suivi par Dantec vers une défense de la civilisation qui a vu naître ce langage aimé (l’occident chrétien) puis naturellement vers une lutte, qu’on peut juger radicale, contre la menace islamiste et enfin contre l’idée universaliste d’une cohabitation des cultures – d’une acculturation générale. A l’opposé d’un Truong par exemple, qui à la suite de Lyotard et de Sloterdijk, prend acte d’une évolution inéluctable – au-delà, donc, du bien et du mal – des sociétés humaines vers l’effacement progressif des particularités et des différences culturelles, et donc vers l’éloignement tout aussi fatal, de ce l’on peut hâtivement désigner comme la « civilisation » et les « valeurs » chrétiennes, Dantec se rend cependant coupable d’un repli assurément réactionnaire. Quel incroyable revirement en effet puisque de son désir antérieur, mis en lumière par son roman Babylon Babies, de voir advenir l’Übermensch biotechnologique – autrement dit, une humanité qui assumerait enfin sa transhumanité sans mauvaise conscience –, Dantec en vient aujourd’hui à l’apostasier au nom de la divine Parole ! Dès lors, et jusqu’à sa prochaine révolution, notre auteur ne peut se dépêtrer d’un inextricable maillage de contradictions, condamné à concilier sa fascination pour les découvertes et connaissances scientifiques, pourtant consubstantielles à cette déhiscence de devenir-Machine du monde, et la posture qu’adoptait le Bernanos de La France contre les robots – lire les superbes textes du Stalker, encore lui, à propos de Cosmos Incorporated. Mais même inabouti, monstrueux, aussi frustre au regard de sa vertigineuse ambition (faisant fi des limites édictées par Borges pour qui le livre ne sera jamais qu’une infime parcelle de l’univers) que le pitoyable simulacre de vie mis en scène par le serial killer que pourchasse Kernal, n’empêche nullement Villa Vortex, aussi imparfait soit-il, de s’imposer comme un roman d’exception, l’ébauche en somme du chef d’œuvre qu’écrira peut-être un jour Dantec.


Commentaires
Merci pour cette critique très intelligente.
L' "inextricable maillage de contradictions" que vous relevez chez Dantec me semble due au fait que le romancier ne doit pas réfléchir en même temps qu'il écrit. Un roman ne doit pas être la tentative de démonstration d'une pensée, mais sa mise en forme presque involontaire - à la façon dont le rêve est celle de notre psyché. Sans doute pour atteindre au chef d'oeuvre que vous attendez faut-il savoir se retirer de son moi, son moi pensant et fort d'idées, et trouver l'humilité de se laisser traverser et guider par un verbe venu d'ailleurs.
Sans doute avez-vous raison Alina. Je ne doute cependant pas que Dantec parvienne un jour à cette forme de grâce que vous évoquez, et que Raymond Abellio a, me semble-t-il, fort bien mise en scène dans sa trilogie conclue par Visages immobiles. Il y a tout de même, dans cette pensée en construction, dans cette in(di)gestion de références -, quelque chose de fascinant, d'admirable même. Dantec possède une étrange faculté, que d'aucuns jugent un peu vite superficielle, de mise en relation des idées, des connaissances, des textes lus - incroyable trame que le travail de l'écrivain devra restituer par ce "verbe venu d'ailleurs".
Je viens par ailleurs - je passe du coq à l'âne -, au détour d'un rayon de bibliothèque, à la lettre "R", de me souvenir que j'avais en fait lu dans mon adolescence (ce devait être au début des années 90), votre roman "Le Boucher" dont l'érotisme promis par la quatrième de couverture, si ma mémoire ne me joue pas des tours, m'avait vivement intéressé... Ce fut là, je crois, l'un de mes premiers émois érotico-littéraires. Merci !
Cher Transhumain, est-ce moi qui fais l'âne, et Dantec le coq, dans votre "passage" ? Ah pourquoi pas, j'adore les ânes, je les appelle Lucius !
: )
Vous, un âne ?!? Le plus drôle est que, écrivant cette formule toute faite, un fragment de ma conscience a bien tenté de m'avertir d'une possible interprétation, mais ma paresse l'a emporté.
Et puis, je n'oublierai jamais certains ânes, mon préféré étant bien sûr Balthazar.