
Léonard de Vinci, La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne
(Santa Anna Metterza, 1508-1510, Musée du Louvre). Cherchez le vautour !
« Ma joie, mon chagrin, mon espoir, mon amour,
Tout tournait dans ce cercle.
Un cercle étroit. »
Edmund Waller, cité dans La Forteresse vide de Bruno Bettelheim.
« Le sujet s’étale sur le pourtour du cercle dont le moi a déserté le centre. »
Gilles Deleuze & Félix Guattari, L’Anti-Œdipe.
Voici enfin la dernière partie tant attendue ( ?) de cette divagation autour de La Mémoire du Vautour de Fabrice Colin.
La Mémoire du Vautour – 1 – Introduction
La Mémoire du Vautour – 2 – Résumé
La Mémoire du Vautour – 3 – La mort impensable
La Mémoire du Vautour – 4 – JE est un autre
La Mémoire du Vautour – 5 – L'expérience intérieure
La Mémoire du Vautour – 6 – Temps, récit et schizophrénie, première partie
La Mémoire du Vautour – 7 – Temps, récit et schizophrénie, deuxième partie
Il nous reste enfin, au terme de cette longue dérive sur les vagues incertaines de La Mémoire du Vautour, à comprendre comment, dans son univers schizoïde, s’articulent tous ces éléments.
*
* *
D’abord, rafraîchissons-nous la mémoire, voulez-vous ? Au premier chapitre, William Tyron, embauché par une mystérieuse organisation (D_Member), fait la connaissance de Sarah – qu’il est censé observer –, victime d’un crash en Indonésie. Un jour elle disparaît littéralement. Bill se replie dans sa salle de bains. Sarah Daniel Greaves devient la narratrice d’un deuxième chapitre à la chronologie difficile à établir (voir notre résumé). Elle a eu un enfant prénommé Narathan (le père lui a été présenté par un certain Jack Williamson (Williamson : littéralement « fils de William »…). En 1997, observée par un vautour, elle réchappe d’un crash terrible, et subit le lendemain ( ?) une « exérèse » (une sorte d’excision mémorielle) par les services secrets. Le troisième chapitre, « Reeltoy », est lui-même construit comme une chaîne. Le vautour qui observait Sarah est blessé par un congénère avant d’être achevé par un tigre. Le tigre prend la narration à son compte avant d’être blessé par un homme armé. Un autre homme, Setyo (un pirate halluciné), l’abat et prend le relais. Il est intercepté par d’autres pirates, qui le jettent aux requins. Nous suivons alors le requin dans son domaine, mais bientôt celui-ci est tué par des pirates. C’est l’un d’entre eux qui assume le rôle de cinquième maillon de la chaîne Reeltoy (« jouet-bobine ») en mangeant la cervelle du squale. Deux femmes sont prisonnières sur le bateau : la mère est violée puis abattue, mais Reeltoy aide la fille à s’enfuir. Le quatrième chapitre est consacré à Narathan, le fils de Sarah. Il est en compagnie de Reeltoy (le même ?). Au cours d’un voyage en Thaïlande, Narathan assiste sous l’influence de psychotropes à des événements étranges avant d’être tiré d’affaires par un autre Reeltoy ( ?). Le jour du fameux tsunami, Narathan sort son appareil numérique, prêt à immortaliser l’événement. Le narrateur du cinquième et dernier chapitre est un certain Io-Tancrède Violas, artiste et professeur schizophrène. Il est question ici : d’une installation consacrée au tsunami ; d’un mystérieux correspondant qu’il appelle LUI et qui lui transmet des informations biographiques relatives à Bill Tyron ; des mails que lui adresse Narathan ; d’une exposition comprenant cinq œuvres réalisées par ses élèves ; et de sa propre disparition. Io-Tancrède se rend dans une tour, téléphone à Tyron et lui dit : « C’est terminé ». Enfin, dans un épilogue à la troisième personne, Bill Tyron sort de sa salle de bains hors du monde pour s’enfoncer dans le grand blanc…
*
* *
Le personnage-qui-meurt, dans La Mémoire du Vautour, se replie sur lui-même, avons-nous dit. Apparemment destiné au solipsisme, il soumet le réel à son inconscient, et se meut dans une bulle imaginaire enclavée dans le monde « réel ». Oui, mais voilà : en créant son monde-propre, ce repli devient ouverture infinie – le trou noir ouvre sur un cosmos total. « Je » est un autre, souvenez-vous. Dès lors, tout devient possible, y compris cette tectonique des plaques temporelles qui fait se rencontrer Sarah et Tyron alors que le premier, au moins, est censé être mort. Ces liens étranges et discordants (et fort nombreux en vérité : ainsi par exemple, le requin évoque-t-il la mort de Socrate, faisant écho à la mort du singe Socrate dans le chapitre de Sarah, avant de réapparaître dans le chapitre « Io-tancrède » ; ainsi également, Narathan, qui à Patong rencontre un français, Max, qui assure qu’ils se connaissent. Ils se rendent dans une boîte de nuit appelée « le Tiger » et le lendemain, Reeltoy répète devant Narathan les trois mots prononcés par Sarah devant le vautour sur les lieux du crash, page 221…), ces liens irrationnels entre tous les personnages, donc, et le fait que le récit est enchâssé dans la mort de Tyron (le roman commence après sa mort, et s’achève par son accomplissement) nous suggèrent donc d’abord qu’en quelque sorte ils ne font qu’un : Tyron est Sarah, comme il est tous les autres personnages. Sausalito, Sarah, D_Member tout est en lui – tout, sauf peut-être la salle de bain, qui est précisément hors du monde (comprendre : hors du sien comme du nôtre). Et cependant, ils sont bien des personnages distincts, aux existences et aux expériences propres…
Comment nous dépêtrer de cet inextricable réseau de correspondances ? Faisons de nouveau appel à Alan Watts, l’une des figures tutélaires du roman. Comme Raymond Abellio, l’auteur de La structure absolue, Watts croit à l’interdépendance, à « l’idée d’un monde unitaire sans le moindre raccord, tissu d’interactions mutuelles, où une chose ne se comprend que rapportée à une autre et réciproquement. Il est impossible dans cette perspective de considérer l’homme isolément de la nature. » (nous avions déjà cité cet extrait d’Amour et connaissance). Par ailleurs, « [lorsque] l'esprit glisse à son insu dans une attitude réceptive, il lui arrive d'être gratifié d'une perception "magique" du monde. ». Nous retrouvons cette idée, chez Colin, que dans un monde donné tout, absolument, est lié. Le personnage colinien, nous le savons au moins depuis Kathleen, recherche l’illumination intérieure, le saisissement de cette pensée magique, cette connexion, qui n’est que flux continu de perceptions, avec le cosmos dont il fait inextricablement partie (cela n’est pas sans rappeler l’union plotinienne avec l’UN dans l’extase…). Il y a chez Colin une forme certaine de mysticisme, pas totalement diluée dans la métaphore : la croyance, ou la volonté de croire, à l’unité fondamentale du monde. Avant de mourir, le gorille (Socrate) parle par signes à Monika : « le cycle, l’histoire » (129), et le même soir, Sarah perd les eaux et accouche de Narathan. Or Socrate, le philosophe, croit en l’existence d’une « roue des générations » : si la mort fait suite à la vie, la vie fait suite à la mort, ce cycle rappelle à la vie ce qui était la mort. La nature a un devenir sans fin, selon la loi de l’alternance des naissances et des morts. On peut alors parler d’une « Âme du Monde ». Nous verrons plus loin qu’il s’agit là d’une idée centrale du roman.
Et nous sommes dès à présent en mesure de désigner les personnages narrateurs de La Mémoire du Vautour comme des hypostases, semblables, si l’on veut, à la Sainte Trinité chrétienne (et nous verrons plus tard qui est le « dieu » hypostasié).
*
* *
Cependant, le chiffre choisi par Fabrice Colin (qui jusqu’à preuve du contraire n’est pas un écrivain chrétien, même si Io-Tancrède en appelle souvent à Jésus) n’est pas le TROIS de la Trinité, mais le CINQ.
La Mémoire du Vautour comporte cinq chapitres (« Bill », « Sarah », « Reeltoy », « Narathan », « Io-Tancrède »). Le chapitre central, « Reeltoy », est lui-même composé de cinq parties, chacune étant assumée par un narrateur différent (le vautour, le tigre, Setyo, le requin, et le pirate que nous appellerons Reeltoy puisque c’est lui qui semble désigné par ce nom dans le chapitre suivant). Narathan évoque cinq niveaux d’implication dans le jeu : joueur, personnage, intelligence artificielle, observateur et concepteur, et envoie cinq textes à Io-Tancrède, qui lui-même propose cinq œuvres d’art à ses élèves, chacune représentant l’une des cinq conceptions de l’artiste qu’il a préalablement définies (l’avion furtif, le manipulateur, le locataire, l’intelligence, le raconteur). Pourquoi cette omniprésence du chiffre CINQ dans La Mémoire du Vautour ? Peut-être n’y a-t-il pas d’autre origine que l’épigraphe du roman par Bill Viola :
Death by beauty.
Death by sensitivity.
Death by awareness.
Death by experience.
Death by landscape.
Bill Viola
Note, 12 décembre 1986
Cinq manières de mourir. Cinq expériences de la mort. La figure du cercle, elle aussi surdéterminante[1], nous évoque bien sûr le vautour tournant autour de son sujet, la mort (nous avons vu qu’elle ne s’affrontait jamais de front), d’où ce titre initial qui pourrait être celui de tableau, Paysage avec vautour. L’origine de ce roman est peut-être à chercher seulement dans la conjonction de ces cinq lignes de Bill Viola[2] et de quelques chansons du groupe Radiohead. Mais nous ne nous en satisferons pas. Quelle qu’en soit la raison première, connue de lui seul, le choix de Fabrice Colin s’est porté sur le chiffre CINQ. Diantre ! Pourquoi ?!?
*
* *
Selon notre précieux Dictionnaire des symboles, le chiffre CINQ « est signe d’union, nombre nuptial disent les Pythagoriciens ; nombre aussi du centre, de l’harmonie et de l’équilibre. Il sera donc le chiffre des hiérogamies, le mariage du principe céleste (3) et du principe terrestre de la mère (2)[3]. Il est encore le symbole de l’homme (bras écartés, celui-ci paraît disposé en cinq parties en forme de croix : les deux bras, le buste, le centre – abri du cœur – la tête, les deux jambes). Symbole également de l’univers : deux axes, l’un vertical et l’autre horizontal, passant par un même centre ; symbole de l’ordre et de la perfection ; finalement, symbole de la volonté divine qui ne peut désirer que l’ordre et la perfection (CHAS, 243-244). […] Il représente aussi les cinq sens et les cinq formes sensibles de la matière : la totalité du monde sensible. […] L’étoile à cinq branches, la fleur à cinq pétales est placée, dans le symbolisme herméneutique, au centre de la croix des quatre éléments : c’est la quint-essence, ou l’éther. Le 5 par rapport au 6 est le microcosme par rapport au macrocosme, l’homme individuel par rapport à l’Homme universel. […] Dans la plupart des textes irlandais médiévaux cinquante, lit-on encore, ou son multiple triple cent-cinquante (tri coicait, littéralement : trois cinquantaines) est un nombre conventionnel indiquant ou symbolisant l’infini.[4]. […] Sainte Hildegarde de Bingen a développé toute une théorie du chiffre cinq comme symbole de l’homme. […] l’homme possède cinq sens, cinq extrémités (tête, mains, pieds). Plutarque utilise ce nombre pour désigner la succession des espèces. Une telle idée peut se trouver dans la genèse ou il est dit que les poissons et les volatiles furent crées le cinquième jour de la création… »[5]
Symbole d’union, de centre, d’harmonie, de perfection, de quintessence (et, pour finir, de succession des espèces) : l’abondance du CINQ nous paraît désormais justifiée. Est-ce là tout ?... Non, bien sûr. En chiffre romain, CINQ s’écrit V. V comme le roman de Thomas Pynchon (avec lequel, nous le verrons, La Mémoire du Vautour n’est pas sans rapport), V comme V pour Vendetta, V comme Vautour ou Vulture (du latin Vulturius), mais aussi comme le glyphe couramment utilisé pour figurer schématiquement un oiseau – et donc un vautour (V pour Vendetta comporte, bien sûr, un chapitre « Vultures » dans son troisième Livre)… Comme le disait Einstein, Dieu ne joue pas aux dés…
*
* *
V comme Vautour, donc. Remontons à présent le jouet-bobine (« Je termine la cervelle. Tout fond en moi. Tout forme une chaîne ininterrompue et sanglante, pleine d’une sagesse irréelle : du vautour au tigre, du tigre à l’homme, de l’homme au requin, du requin à moi. », 161), qui nous rappelle le jeu de la bobine (ou Fort-Da) chez Freud (jeu répétitif pré-symboliquement lié à la pulsion de mort) et revenons à ce personnage essentiel du roman.
*
* *
Le vautour n’est rien de moins, nous l’avons déjà suggéré, que l’incarnation plumesque du principe vital de La Mémoire du Vautour.
Ah ! Mais il n’est pas seul. Il est, en premier lieu, préfiguré par un chat, Moebius, celui de Sarah, retrouvé mort par Tyron au premier chapitre. Le chat : premier symbole de la mort, qui, cependant, peut vivre neuf vies (donc renaître…). Ensuite, le vautour sera suivi par le tigre et le requin. Tenez, le tigre, celui qui, non loin des lieux du crash, achève le charognard. Pour l’occidental, le tigre est d’abord un mangeur d’hommes, symbole de mort (encore). Mais dans le Bouddhisme (élevons un cierge à la gloire du Dictionnaire des symboles), sa force symbolise celle de la foi, « de l’effort spirituel traversant la jungle des péchés, elle-même figurée par une forêt de bambous. […] Il ne faut pas oublier que dans toute l’Asie du Sud-Est asiatique, le Tigre-Ancêtre mythique est regardé comme l’initiant. C’est lui qui conduit les néophytes dans la jungle pour les initier, en réalité pour les tuer et les ressusciter. »[6] Et les ressusciter ! Nous y sommes ! On trouve d’ailleurs une variation sur ce thème dans le beau film d’Apichatpong Weerasetakul, Tropical Malady – que je n’ai hélas jamais eu le temps ou, allez savoir, le courage d’évoquer ici – et dont une affiche est, plus tard, aperçue par Narathan en Thaïlande (205).[7] Setyo, qui tue le tigre qui a tué le vautour (on meurt beaucoup dans La Mémoire du Vautour mais, et c’est là l’important, ça n’est jamais une fin en soi), délire : « Je suis le personnage. Je comprends la chose noire. Qui enlace la vie. Opérant par cercles concentriques pour la séduction et nous incorporer à sa danse spéciale et savoir/comprendre/c’est voir ce qui se dessine et de quelle façon procèdent les départements concernés les tours hurlantes au sommet des cieux. Comprenons ceci ::: qu’elle va se confondre avec MOI. » (150-151). En mangeant le tigre, Setyo devient le tigre. Pas la mort elle-même, mais « une petite partie de la chaîne » (156). Comme le requin, qui le dévore. Le requin ? Ah, encore une autre image de la mort, dont le poète Lautréamont a fait un double de son Maldoror, en une scène de communion barbare[8]. Ducasse faisait d’ailleurs du requin le frère du tigre[9]. Votre dévoué serviteur, dont la culture étymologique laisse parfois à désirer, a récemment découvert dans le Déchronologue (ce bien beau roman de Stéphane Beauverger dont nous parlerons bientôt ici) que le mot « requin » serait dérivé du latin Requiem, qui comme chacun sait désigne la messe des morts (celle-là même que le malheureux tombé à l’eau peut chanter en guise de dernière prière avant la curée). À l’instar du tigre, le requin est porteur – plus encore depuis Les Dents de la Mer – d’images terrifiantes, de cruauté, de pulsions carnassières pures où noyade et dilacération des chairs s’accouplent dans les ténèbres des profondeurs. Comme son frère de sang Maldoror, le requin n’est qu’un avatar de la mort… Setyo et le pirate Reeltoy, qui mange la cervelle du requin, en sont deux autres. Mais rembobinons encore le jouet (qui a la fâcheuse manie de se dévider) et revenons à notre vulturienne icône.
*
* *
Le Gyps bengalensis que croise Sarah en Indonésie, le vautour Chaugun (un mirage ? Possible : selon le vrai-faux infirmier Frank, Sarah « a dû rêver » [101] « Il n’y a pas de vautours en Indonésie. […] Celui que vous me décrivez, je le connais par cœur, c’est le vautour chaugoun, le cou blanc, c’est ça ? Gyps bengalensis. […] et si je peux vous certifier un truc, c’est qu’il n’y a pas un seul de ces animaux à Sumatra, et certainement pas avec ces incendies. » (102). Pour Frank, le vautour est « un symbole occidental de mort » (102). Symbole de mort ? Oui, mais pas seulement. À la page suivante, Frank évoque les Tours du Silence à Bombay : « On comprend tout quand on les voit. Les vautours, les anges noirs, ennemis de la mort et de la décomposition. » (103). Ennemis de la mort. Pour notre aimé Dictionnaire des symboles, ce brave compagnon de décryptage, le VAUTOUR est certes symbole de mort, mais « se nourrissant de charognes et d’immondices, il peut également être considéré comme un agent régénérateur des forces vitales, qui sont contenues dans la décomposition organique et les déchets de toute sorte, autrement dit comme un purificateur, un magicien qui assure le cycle du renouveau, en transmutant la mort en vie nouvelle. »[10] De même chez les Bambara, où il est associé aux épreuves initiatiques, symbole de renaissance, « mais dans le domaine transcendantal de Dieu, dont la sagesse revêt, aux yeux des profanes, les apparences de la folie et de l’innocence. […] il a le pouvoir de transmuer la pourriture en or philosophal. »[11] Commencez-vous à comprendre ?... Sentez-vous le souffle de la révélation glisser sur votre nuque ? Allons ! Pour les égyptiens, le vautour « absorbe les cadavres et redonne la vie, symbolisant le cercle de la mort et de la vie dans une perpétuelle transmutation. »[12] Pensons aussi, s’il vous plaît, au vautour de Prométhée, dont le foie, dévoré chaque nuit, chaque jour se reconstituait !… C’est ça, la clé du roman. Le cycle ! La transmutation ! (au fait, Herakles tua le griffon). C’est au sommet des Tours du Silence de Mumbai, évoquées dans le livre, que les Parsis (Zoroastrisme), refusant de souiller la terre, déposent les dépouilles de leurs morts à l’intention des corbeaux et des vautours, qui font dès lors partie de la chaîne. « Nous sommes les fossoyeurs, les nettoyeurs, les anges grisâtres de la blancheur. » (136) Tuer le vautour, par exemple, indirectement, au Diclofenac (« C’est un anti-inflammatoire utilisé pour le bétail. Une saloperie hyper-toxique. Le bétail meurt, les vautours dévorent les carcasses, le Diclofenac passe dans leur sang, et ils crèvent à leur tour. » 102), c’est briser le cycle de vie, et non celui de mort (qui n’en est qu’un maillon).
Purificateur et fécondant (oh, et signalons aussi le V de la Cène[13], « ancien symbole de la déesse-planète Vénus »[14], emblème de l’utérus, de la féminité, de la maternité, de la fécondité ! Trouverai-je Dieu dans La Mémoire du Vautour ?... Il y en a un en vérité, mais j’ai bien peur qu’il ne s’agisse que d’un prête-nom…), le vautour fait disparaître les morts pour laisser la place aux vivants. Dépeçant, il incarne le lien[15].
*
* *
Le CINQ, symbole d’harmonie (et de succession des espèces). Le VAUTOUR, symbole de mort mais aussi et surtout du cycle de vie. Comme Kathleen, La Mémoire du Vautour est un roman de la transmission. L’on comprend alors que la chaîne des narrateurs n’introduit pas seulement la notion de succession, mais bien celle d’engendrement, ou de renaissance[16], selon une logique interne, propre au récit, mais que le chapitre « Reeltoy » restitue presque à la lettre. Le pirate qui a mangé le requin qui a mangé l’homme qui a tué le tigre qui a tué le vautour qui a mangé le bébé du crash, conserve des traces de ses prédécesseurs (« Deviens ce que tu manges », dira plus tard Io-Tancrède, 261).
*
* *
Sarah, juste avant son exérèse mémorielle : « J’essai de me concentrer sur l’idée que je ne vais pas être triste, qu’on ne peut pas perdre ce qu’on a oublié. Et je pense ceci : la mort dessine une carte dont nous sommes l’unique point mouvant, jusqu’à ce que nous nous immobilisions et trouvions notre place, mais nous laissons des traces, c’est sûr. L’amour, les mots, la vie : notre passage n’est pas vain. » (131-132)
*
* *
Comme le vautour nous tournons en cercles concentriques autour de la mort, jusqu’à nous y abîmer. Mais nous laissons des traces. Nous imprimons le réel. Non seulement l’univers est une trame formée d‘éléments enchaînés, mais encore, chacun de ces éléments est lié à l’ensemble, et inversement (Sarah est née en 1959, année de la théorie des dominos d’Eisenhower). Setyo : « La rougeur je suis un cri au milieu d’une flaque écarlate le pétrole qui s’en va de mes veines le pétrole sanglant et le trou béant là où se trouvait ma cuisse avant et ces lambeaux les filaments les connexions perdus je comprends. Que je suis une petite partie de la chaîne pas vraiment la mort elle-même. » (156) Et la mort fait partie du processus de perpétuation du vivant. (Io-Tancrède au téléphone à Narathan, qui vient de lui faire part de ses rêveries sur la finitude : « Et aujourd’hui, vous avez pris votre téléphone. Votre geste est un maillon d’une chaîne éminemment complexe de causes et de conséquences, mais il reste un maillon ; comme tel, il est indispensable. Vous m’avez appelé ; vous participez à l’œuvre. […] La mort. », 232-234) Et la mort elle-même est indispensable, en tant qu’elle prépare le terrain aux vivants (est-ce pour cette raison que des deux hollandaises prisonnières des pirates, Reeltoy choisit de sauver la fille, celle qui lui confie ses espoirs, pendant que sa mère est violée puis tuée ? ). La mort d’une vie, est justement pour Eugène Minkowski ce qui fait surgir la notion d’une vie. « La mort en tant que destruction engendre un devenir et non point un être »[17] « Ainsi la mort, en venant mettre fin à la vie, l’encadre tout entière, tout le long de son parcours »[18] Et Bill Tyron ne parvient à son immortalité schizophrénique qu’à sa mort. La mort est ce qui révèle la vie.
*
* *
« Je pense que nous vivons tous aux dépens les uns des autres. Pour qu’une fleur éclose, l’autre doit faner. » (255)
*
* *
Mourir en laissant une trace. Et vivre à travers ceux qui restent. Et bien entendu, faire un enfant, c’est, en principe, laisser une telle trace. Ainsi Reeltoy reconnaît-il Sarah en Narathan (Le cas de Sarah et Narathan est assez intéressant. Page 15, Sarah est définie par D_Member comme « célibataire sans enfant ». Simple oubli causé par l’exérèse ? Référence biblique cachée[19] ?... Toujours est-il qu’effectivement, comme la Sarah du Livre, Sarah Daniel – autre prénom biblique – Greaves aura un enfant, Narathan – dont le h exprime l’idée de Dieu –, au travers duquel elle continue d’exister).
*
* *
Mais la véritable grande idée du roman, celle qui est restée étrangement inaperçue, c’est que cette problématique est aussi celle de l’écriture, celle de la littérature. Les personnages eux aussi naissent, ou apparaissent, puis disparaissent, remplacés par d’autres, auxquels ils demeurent irrémédiablement liés. L’écrivain n’est-il pas créateur et destructeur de mondes ?... (Qu’on songe aux auteurs de space opera…) Chaque personnage est un monde, qui hérite du précédent quelque chose, qui lui fait écho par quelque mystérieuse alchimie, par association d’idée, ou parce qu’il en constitue une autre version. Voilà pourquoi tant d’éléments, apparemment dénués de toute logique, relient entre eux les personnages de La Mémoire du Vautour : ils sont tous créés par le même « dieu ». Bien entendu, telle affirmation sonne à vos oreilles comme une navrante lapalissade. Il faut alors que compreniez que lorsque nous écrivions plus haut que Bill, Sarah (à qui Patrick dit, page 165 : « Tu es une incarnation »), Reeltoy, Narathan et Io-Tancrède étaient des hypostases, nous l’entendions au sens littéral, et surtout pas comme une métaphore !
Cette idée ne relève pas que de l’interprétation, ou, comme certains l’imaginent sans doute déjà, de la surinterprétation. J’en veux pour preuve l’importance souterraine, dans La Mémoire du Vautour, de l’entité D_Member (écho au V de Thomas Pynchon, autre entité multiple et mystérieuse de la littérature dite « postmoderne »), qui n’est que l’un des multiples noms du dieu de ce livre, le double imaginal de l’auteur Fabrice Colin. Le seul lien authentique entre Tyron, Sarah, Io-Tancrède, Narathan et Reeltoy, c’est lui, D_Member. L’Énonciateur. Le Raconteur. Le Concepteur. Le Dieu hypostasié !
Et les personnages le pressentent. Pour Narathan, nous le savons, il y aurait trois niveaux d‘implication dans le jeu vidéo : « joueur, personnage, intelligence artificielle » auxquels il ajoute une quatrième, « celle de l’observateur, du type qui regarde de haut », puis une cinquième postures : « le concepteur qui maîtrise tous les codes, celui qui éteint la lumière si ça lui chante et fait disparaître le ghost in the shell. » (174) Les cinq catégories d’artistes de Io-Tancrède sont tout à fait semblables :
« Premier artiste : l’avion furtif. […] L’observateur. Toujours en mouvement. […] Plus d’ateliers, mais une bombe de peinture, mais un appareil numérique, mais des mains, une voix, des yeux. »
« Artiste deux : le manipulateur. Entrons à l’intérieur du système. […] Nous provoquons des accidents de pensée. Nous orchestrons des crashs : boursiers, sexuels, conceptuels, de voitures. Nous rejetons le mot « naturel ». Nous rions au nez de l’Eternel. L’action politique par excellence, et l’art ne peut être que politique en ce qu’il organise la vie dans la Cité […]. »
« Figure trois, […] le locataire ! L’habitant des formes d’art. […] Vous êtes personnifié. On vous reconnaît, on vous voit, on vous veut parfois. A vous d’élaborer les stratégies d’évitement. Cela va de pair avec l’utilisation des structures, la création, je le disais, de matrices nouvelles à partir des matières premières, ou de ce qui nous est donné comme tel.
« Artiste quatre. L’intelligence. Ce qui fait sens. […] nous ne voulons pas seulement laisser des traces, nous voulons être le véhicule, n’est-ce pas ? »
« Cinquième incarnation, […] le raconteur. Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes sortis du mythe de l’objet parfait et autonome à l’abri de l’histoire. Le discours n’est pas l’art. La forme n’est pas le contenu, une information ne saurait se passer de support ou se résumer à lui seul, bla-bla, et le mouvement n’est pas la vie. Le problème, […] c’est que l’histoire n’est plus donnée. C’est au spectateur, au visiteur, c’est au lecteur de la trouver. » (247-248).
Et ce raconteur, ce concepteur, celui du roman, qui est-ce sinon l’écrivain lui-même ? Fabrice Colin, l’auteur, intervient directement dans son propre texte, dans les premier et cinquième chapitres, sous le nom de D_Member, ou, dans le chapitre de Io-Tancrède, celui qui n’a pas de nom, « LUI ». C’est lui, le commanditaire de Bill Tyron. C’est LUI, le mystérieux Ian-le-Tigre rencontré par Sarah en Thaïlande, « des dreadlocks jusqu’aux fesses, et une main en moins » (115) (une main en main : dis-member). C’est LUI, le Dieu (« D » Member) de La Mémoire du Vautour, c’est LUI, l’entité aux « cinquante noms » (254), c’est LUI « Le Dieu™ dans la machine » (261, 281) évoqué par les mails envoyé par LUI à Io-Tancrède, qui ressemblent à des notes prises par l’auteur pour préparer le roman (« Rencontre BEE[20] (Google + catastrophes), 261 ; « Alan Watts ~ une bibliothèque non déterminée : Illumination. […] La. Voiture. Explose. Ggate : RIP. », 281-282) C’est LUI, encore, qui demande à Io-Tancrède de l’invoquer, de le faire apparaître « pour de bon » (238), LUI qui organise « tout ce bordel insensé sur la mort » (273), c’est LUI qui « contrôle les leviers et les amas globulaires. » (271), LUI qui voit le monde où évoluent les personnages (Io-Tancrède : « Je lève les yeux, lentement. Dieu, je – Les rues. Les rues sont vides. Les gens autour de moi. Ce n’est pas moi qui ne vois pas le monde. », 275) et qui, en « sémionaute », invente les « trajectoires parmi les signes » (244).
Le personnage, quel qu’il soit, n’est jamais que le « véhicule » (238), le « porte-parole » (ibid), la « pointe du stylet » (220) qui « trace à la ligne », « à toutes les étapes du processus » (ibid). L’auteur seul peut faire disparaître l’enfant des caméras de surveillance (241). « [Je] suis la conscience d’un autre, mais cet autre n’est pas Dieu. » (227) dit Io-Tancrède, le professeur hébéphrène. Pas Dieu, non, pas de notre point de vue, mais le créateur ! Et celui-ci vit en chacun des personnages (« Il y a cinq ans, j’ai commencé à LE voir. D’abord une sensation – l’impression d’être suivi. Puis une certitude. IL était là. Chez moi. En moi. », 285).
L’auteur, donc, intervient. Mais il ne peut tout assumer : son œuvre ne vit que par ses incarnations : « Je représente […] la force agissante d’une entreprise aux vocations démesurées. La mort est ce qui nous occupe. Certains défunts dégagent en rendant leur dernier souffle une énergie narrative. Cette énergie est le carburant de notre art. Nous l’utilisons pour créer des histoires. » (285) Io-Tancrède est donc chargé d’une mission : « mettre un terme à l’une de ces histoire. […] La personne dont vous devez vous occuper est déjà morte. Vous devrez juste le lui signifier. » […] Pour finir, je LUI ai demandé pourquoi IL ne pouvait pas se charger de cette tâche LUI-même. Impossible, a-t-IL rétorqué. Contrairement à vous, je vis dans un monde stable. » (285)
Quand Narathan veut rencontrer Io-Tancrède[21], ce dernier l’en dissuade : « De plus, il est probable que le monde dans lequel nous évoluons vous et moi, ce monde imparfait, lardé d’occurrences irréelles et de coïncidences forcées – il est probable que ce monde cesse demain d’exister. Ne gaspillez pas vos forces. » (288) Narathan veut lui parler de réincarnation, mais Io-Tancrède raccroche… Et c’est avec la carte de D_Member dans sa poche qu'il appelle Bill pour lui annoncer enfin : « C’est terminé. » (295). Les personnages de La Mémoire du Vautour sont des fictions dans la fiction : « Vous n’êtes pas là, dit-elle. Ceci n’est pas en train d’arriver. » (290)
*
* *
Le roman est une métaphore du roman (qui fixe les événements). Pour Colin, écrire ce n’est pas figer, c’est créer un monde, c’est mourir.
*
* *
La Mémoire du Vautour ne prétend pas décrire objectivement l’Instant mortel, mais seulement, en tournant autour de la mort et de son territoire, donner vie à des êtres mortels. Si la mort est indicible, apoétique, absolument inénarrable, les mourants ne le sont pas.
*
* *
Créer, écrire, pour ne pas mourir… Fabrice Colin écrit pour continuer d’exister ensuite, mais aussi pour continuer à vivre – et cependant la mort frappe quand elle veut. Peut-on alors voir en Narathan une référence au propre fils de l’auteur ?... Narathan… Étrange prénom en vérité… S’agirait-il d’une transformation du prénom du fils de l’auteur lui-même, Nathan ? Nathan, Narathan… Narathan/narration… Faut-il comprendre que ce livre serait comme un fils pour l’auteur, un enfant narré plutôt qu’incarné ?... Une trace pour exister quand, pour lui aussi, tout sera terminé ?
*
* *
Fabrice Colin cherche à donner un sens à la mort. Et la meilleure réponse qu’il a trouvée, c’est de la métamorphoser en fiction. Écrire. Mourir, c’est devenir une fiction, où l’on ne vit qu’à travers la narration de ceux qui restent. La mort, en tant qu’événement pur, unique et singulier (en tant qu’hapax), serait un processeur d’histoires (le terme est emprunté à Serge Lehman). Ainsi du tsunami (ou, dans sa BD World Trade Angels, les attentats du 11 septembre 2001), qui devient ici un moteur, un élément important du récit. Bill, Sarah, Narathan, Io-Tancrède, n’existent pas ? Peu importe, car « Sacha [Bronwasser] affirme ceci : au sein d’une société médiatisée, la frontière entre réalité et fiction est difficile à distinguer. […] Tout ce qui compte, c’est que l’histoire soit crédible. » (244)
Remarquons que ce que nous écrivons là est explicite dans le texte, ainsi qu’en témoignent les extraits suivants.
*
* *
« Les gens ne s’arrêtent jamais de marcher, de parler, de penser. Même lorsqu’ils dorment, ils réfléchissent. Leur existence est un film à trois cents images/seconde. Plus on regarde en arrière, plus les images se font rares. […] Toute cette production vouée à l’oubli. Pour qui, pour quoi ? » (235-236)
*
* *
« […] nous sommes des histoires racontées pour personne. […] continue, et ton histoire se mêlera à la mienne, et nous composerons la symphonie du monde. » (236-237)
*
* *
« Ce processus, c’est un homme qui l’a enclenché. La mort d’un homme. Sans cette mort, rien n’existerait. Et après-demain, tout ça prendra fin. » (282)
*
* *
« La mort est une fable. La mort ne met fin à rien parce qu’elle n’existerait pas sans la vie. Il n’y a ni passé, ni avenir et toutes les vies valent la peine d’être contées et nous ne sommes que ça, finalement – des possibilités. » (283)
*
* *
« Face à un événement d’une telle ampleur [le tsunami], seules deux possibilités artistiques me paraissent pertinentes : le témoignage (œuvre d’observateur neutre) ou la fusion (devenir la conscience du drame). […] j’ai opté pour la seconde. La mort, contrairement à ce que pensent ceux qui ne pensent pas, n’est pas la fin de l’histoire : elle est, au contraire, porteuse de narration. Et c’est par son truchement salvateur que l’imagination se libère. » (231)
*
* *
« Tu sais, ce n’est pas ma maladie qui me fit peur et qui fait peur aux psychiatres. Ce n’est même pas son existence à LUI. C’est me dire que je ne suis pas ici, en train de te parler. Me dire que le monde dans lequel nous vivons n’est pas le bon. Seulement une création, imparfaite, bourrée de fautes et de répétitions. [… La mort est une histoire. La mort crée une histoire, comme une dernière giclée. Nous faisons partie de cette histoire. Moi, je suis chargé de la boucler. […] Je suis la fin de l’histoire. Je ne suis pas plus réel qu’elle. Et nul ici ne peut prétendre l’être. » (262)
*
* *
Il nous faut aussi dire un mot de l’épilogue du roman, seul passage à être narré à la troisième personne. L’être-qui-meurt en première personne, avons-nous dit précédemment, se replie sur une atemporalité qui peut aussi bien être décrit comme un présent éternel. À l’exception de cet épilogue, le roman est tout entier produit par Tyron-qui-meurt, c’est une bulle d’espace-temps qui aurait pu se poursuivre sans fin. Pour achever son œuvre, pour, littéralement, en sortir, Colin devait impérativement quitter la singularité, se retirer de son personnage. Le déposséder. En changeant de perspective, en abandonnant le « Je » pour le « Il » (qui pour l’auteur, intime du personnage puisqu’il en est le géniteur, est un « Tu »), Colin permet au récit de retrouver une temporalité classique, de quitter l’incommunicable expérience directe de la mort pour en restituer plutôt le bouleversant hapax. Bill a eu un grave accident, donc Bill meurt et, logiquement, le roman s’arrête, dans un grand blanc qui est, bien sûr, celui de la page. Celui du livre.
« Elle lui montre le ciel. Il regarde le soleil crucifié et il se regarde lui, évanescent et quand il veut la rejoindre et qu’elle tourne les talons et court et disparaît, il réalise une chose élémentaire : qu’il n’a jamais vécu ici, ou seulement il y a longtemps, dans un autre monde, un monde de sensations et de contacts, un monde qu’il pouvait toucher et aimer – et qu’il est en train de quitter, en une vertigineuse désincorporation.
Il cligne des yeux dans la torpeur. Le blanc s’avance partout. Le blanc mange les images et dévore le mouvement. Ce n’est pas du brouillard. Ce n’est pas quelque chose que l’on voit. C’est quelque chose que l’on sait. Il n’y a plus rien après ça. » (299)
*
* *
« Tout est blanc, si blanc, et si vide, qu’il en ressent une joie intense, presque douloureuse – et autre chose aussi, une chose libératrice : il y a ce vide au-dessus, une connaissance qui n’a pas de nom et ne possède pas de fin – et il vole à présent, s’enfonce dans le grand blanc, il ne s’arrêtera plus, le vent traverse son corps, il hurle et personne ne l’entend […] mais pour lui, cela n’a plus aucune importance parce que, dans quelques secondes, pour la première fois, pour la première et unique fois de ce qui a été sa présence en ce monde, William Tyron va être libre. » (300) Ainsi s’achève le roman. Bill est enfin libre, affranchi de son créateur, mais qui vivra encore en lui, à travers lui, comme à travers ses œuvres futures.
*
* *
Nous ne prétendons pas avoir percé tous les secrets de La Mémoire du Vautour. Souvent avons-nous fait erreur, soyons-en sûr. Mais du moins en avons-nous révélé les forces vives, celles qui en font une œuvre certes imparfaite, mais fascinante. (Schizo)roman sur la mort, l’oubli et la filiation, La Mémoire nous parle aussi de la nécessité d’écrire, c’est-à-dire, donner vie aux morts passés et à venir.
[1] Il y a bien entendu les cercles déjà évoqués dans notre sixième chapitre : les cercles c
Alain Damasio, le repeupleur (So phare away)
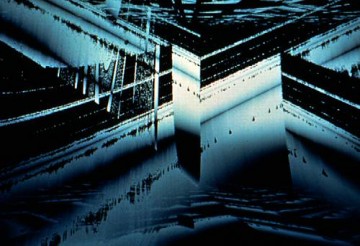
À Sébastien.
« Séjour où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur. Assez vaste pour permettre de chercher en vain. Assez restreint pour que toute fuite soit vaine. »
Samuel Beckett, Le dépeupleur.
« J’étais bien, abreuvé de noir et de calme, au pied des mortels, au fond du jour profond, s’il faisait jour. Mais la réalité, trop fatigué pour chercher le mot juste, ne tarda pas à se rétablir, la foule reflua, la lumière revint, et je n’avais pas besoin de lever la tête de l’asphalte pour savoir que je me retrouvais dans le même vide éblouissant que tout à l’heure. […] Je dis, la mer est à l’est, c’est vers l’ouest qu’il faut aller, à gauche du nord. Mais ce fut en vain que je levai sans espoir les yeux au ciel, pour y chercher les chariots. Car la lumière où je macérais aveuglait les étoiles, à supposer qu’elles fussent là, ce dont je doutais, me rappelant les nuages. »
Samuel Beckett, « Le calmant » in Nouvelles et textes pour rien.
Il est un passage de La Horde du contrevent, dans les toutes dernières pages, qui m’a ému aux larmes, viscéral à hurler :
Je m’en sortis parce que je compris, du cœur de mon effondrement, que toute la Horde n’était encore debout sur la lande que par ma faculté active à la faire vivre. La solitude n’existe pas. Nul n’a jamais été seul pour naître. La solitude est cette ombre que projette la fatigue du lien chez qui ne parvient plus à avancer peuplé de ceux qu’il a aimés, qu’importe ce qui lui a été rendu. Alors j’ai avancé peuplé, avec ma horde aux boyaux, les vifs à un pas et une certitude : l’écroulement de toutes les structures qui m’avaient porté jusqu’ici – la recherche de l’origine du vent, les neufs formes, l’Extrême-Amont, les valeurs et les codes de ma Horde – ne m’enlevait pas, ne pourrait jamais m’arracher, pas même par leur mort, ce qui ne dépendait, authentiquement, que de moi : l’amour enfantin qui me nouait à eux.
Ceux qui ont la chance de connaître – ou d’avoir connu – l’amitié authentique, indéfectible, celle qui vous lie irrémédiablement à l’autre, quoi qu’il arrive, par-delà même l’espace et le temps, sauront de quoi il est ici question. Comme Sov, nous avançons peuplés, avec nos hordes aux boyaux.
Plus que son éloge du dépassement de soi, plus que sa philosophie du mouvement, c’est cette mise en actes du lien, rendue possible par un inouï travail formel, qui fait de La Horde du contrevent l’un des plus beaux livres qui soient, et ce, même si les recherches phonétiques d’Alain Damasio, uniques dans le domaine romanesque contemporain, ne lui ont pas encore permis de s’attaquer avec la même pugnacité aux structures syntaxiques, et d’égaler ainsi les maîtres du monologue intérieur, tels Joyce, Faulkner et Beckett. Mais une synthèse de ces trois singularités est-elle seulement envisageable ? Joyce, et l’expression automatique d’un courant de conscience (stream of consciousness), stupéfiante tentative de surmonter la barrière des langues (Finnegans wake). Beckett, dont les alter ego se meuvent à distance égale du ciel et de la terre, se trouvant « comme qui dirait sous cloche, tout en pouvant se déplacer à l’infini dans tous les sens » (Nouvelles et textes pour rien), prisonniers des espaces intérieurs de l’auteur ; Beckett, donc, et le ressassement solitaire et métatextuel. Et Faulkner, qui fait mine de capter les flux de pensée de ses personnages, et de les restituer, brutes, soumettant la syntaxe à leur phénoménologie propre. L’idéal damasien se situerait donc, en théorie, au point nodal de ces trois grands modèles – tout en ne quittant jamais le champ de l’Imaginaire. Damasio singularise ses différents narrateurs par le style, comme Faulkner dans Tandis que j’agonise. Il fait fondre et se tordre le verbe, fait jaillir des étincelles avec Caracole, comme Joyce dans Finnegans wake. Enfin, comme chez Beckett (dans L’Innommable par exemple), métaphores et matière métafictive sont omniprésentes : dans La Horde, des bribes du récit flottent dans l’air, dans le sillage des tempêtes, sous forme de chrones – des concepts vivants – couverts de glyphes ; et Sov, le scribe de la (dernière) bande, est un passeur entre l’univers du roman et son propre engendrement.
Le texte-phare de la dernière livraison de la revue Galaxies (n°42), est une nouvelle d’une grande beauté, aussi abstraite que sensuelle, très poétique, et donc éminemment métaphorique, sur la déréliction du monde. « So phare away » d’Alain Damasio, rejoint en effet ces fictions, en si petit nombre, qui nous habitent, qui nous transforment durablement. La lecture, écrivait Sartre, « ne doit pas être une communion mystique non plus qu'une masturbation, mais un compagnonnage ». « So phare away », qui comme La Horde du contrevent nous accompagne, jamais à côté, mais au-dedans, est le récit tragique et visionnaire d’un dépeuplement.
Coupée d’un monde qui a peut-être disparu, ou qui a éclaté en îlots isolés les uns des autres – nous n’en saurons rien –, une ville à la minéralité tantôt ferme, tantôt fluide, traversée au sol par un trafic dense, incessant, d’automobiles en mouvement perpétuel, et surmontée d’une épaisse chape de smog crevée de milliers de phares émetteurs, s’apprête à subir le choc d’une gigantesque houle d’asphalte, cataclysme cyclique qui la remodèle à sa guise, engloutissant des édifices, en faisant surgir de nouveaux. Les gardiens de phares communiquent par signaux lumineux, non pour préserver les navires des récifs – nul ne vient plus par la mer –, mais pour diffuser des informations privées, publicitaires ou gouvernementales aux cinq millions d’habitants, ou simplement pour la beauté du geste, pour se sentir exister. Certains phartistes composent des tableaux de lumière, d’autres clignotent de manière incompréhensible en un pseudo morse connu d’eux seuls, d’autres encore se contentent d’apposer sur la ville leur signature photonique. Et les trois phares suréquipés des diffuseurs officiels phagocytent l’espace lumineux, achevant de transformer l’espace en une cacophonie optique :
Notre vide si moderne, la Nappe : ce tissu lumineux entre les phares, toujours changeant. Cet écheveau de faisceaux et de rayons qui se cumulent, rivalisent et s’annulent. Rien de tout ça n’aurait acquis la moindre épaisseur s’il n’y avait la circulation éternelle des voitures au sol, le smog qui en résulte et la bruine. La lumière s’y colle, y prend corps et texture. Et ça donne la Nappe , oui, saturée et surinvestie, notre espace de communication.
Comme l’écrit Bruno Gaultier, l’intuition fondamentale de la nouvelle « est que la surexposition à la lumière n’est pas révélation, mais négation ». Autrement dit, la lumière n’a de sens, ne fait sens, que si elle perce l’obscurité. La métaphore est splendide, ou plutôt : lumineuse… Sur la Toile, mais pas seulement, brillent en effet, comme les phares de Damasio, des feux solitaires dont nous percevons encore les insistants signaux, entre deux éblouissements. Mais l’entropie fait son œuvre. La prolifération métastatique des interconnexions, des hyperrelations, des flux d’information, auxquels contribuent d’ailleurs les phares qui nous sont chers, menace de submerger le monde sensible qui les a vu naître. Quand la lumière aura tout enveloppé, ce sera la fin. Alain Damasio condense cette idée dans une fulgurante dernière phrase : « Quand l’étreinte n’a plus d’air, on dit qu’elle est éteinte ».

Pour Jean-Michel Truong, l’Internet, à l’intersection de la Technique et du Capitalisme, constitue l’embryon du « Successeur », intelligence totalement inhumaine, machinique, que nous croyons maîtriser alors que c’est elle, indubitablement, qui nous manipule – jusqu’à notre élimination mathématique pure et simple. Si la Nappe est une image, superbe, de l’excès d’information, la houle d’asphalte, cette vie minérale qui déferle sur la ville, est alors celle de la déhiscence de la Technique , qui remodèle l’environnement à sa guise. Il y a, chez Damasio, plus qu’une méfiance : une réaction viscérale à l’emprise de la Technique et du Marché qui disjoignent les êtres. C’était patent dans La Zone du Dehors et dans La Horde du contrevent, ça l’est plus encore dans « So phare away ». À la toute fin de la nouvelle, Farrago est trompé par le bruit blanc de la Nappe , voyant le message de Sofia déformé par des relais fantaisistes – du moins est-ce ainsi que j’interprète les dernières lignes...
Comme souvent chez Damasio, un jeu de mot peut en cacher un autre (et peu importe l’intention supposée de l’auteur, qui n’a aucune importance).
Le soir, je regarde les appartements s’éclairer et s’éteindre, sur la centaine d’ouvertures de la façade, c’est parfois joli, souvent dérisoire. Les fenêtres pourraient presque former un code, un code collectif inconscient sur une clef binaire, qui raconterait une histoire différente toutes les nuits, ou un récit évolutif. Une cuisine qui s’allume, une chambre qui s’éteint, et le sens de la phrase pourrait basculer. “Faible” qui devient “Fable” par exemple parce qu’un i saute. Tout sauf i. Tout Sofia… Son manque me troue.
Tout sauf i, tout Sofia – mais pourquoi pas tout sauf I.A. ?... S’il n’a pas dans « So phare away » d’intelligence artificielle à proprement parler, la Nappe comme l’océan d’asphalte sont à l’évidence deux manifestations d’une Technique qui exclut l’homme de son horizon. La mort annoncée de Farrago en est, il me semble, le plus bel exemple. Les personnages damasiens pleurent l’humanité perdue.
« So phare away » oppose la verticalité des phares (l’en haut) à l’horizontalité de l’asphalte (ici-bas). Dans La Zone du Dehors, le signe « > » indiquait un changement de narrateur. Dans La Horde, les glyphes des personnages jouaient le même rôle et permettaient d’identifier leurs voix. Cette fois, chaque changement est introduit par le nom du narrateur (Phareniente, Farrago, Lamproie, Sofia, Faramine…), disposé verticalement, ou horizontalement, selon qu’il se trouve dans un phare ou à l’extérieur (au sol, dans l’eau). Ainsi dans l’extrait qui suit, à un passage dans lequel Faramine parle du haut de son phare, succède le monologue de Sofia, sortie en expédition :
F
A
R
A
M
I
N
E
n
—
« Sors sur ton balcon et déshabille-toi. Si tu restes nue, éclairée par mon projecteur, pendant cinq minutes entières, je ferais un effort pour ton amie ». Le Régulateur m’a répondu. Je suis furibarde. Il accepte de couper le flux du périphérique dix secondes si je m’exécute. Ce type est un salace, un pervers frustré qui se masturbe dans sa tour en matant les nymphettes à la jumelle, je le sais. Il demande ça à toutes les filles qu’il drague et je ne lui traduis jamais ces messages-là ! Jamais !!! Qu’il aille se faire foutre ! Même pour Sofia, je ne lui cèderai pas ! Fumier ! Salopard de voyeur ! Sodomise-toi profond avec ton phare !
— – - S O F I A - – —
Avant d’étouffer, je me suis relevée. Mes cheveux dégoulinent de suie. Flot de voitures toujours aussi rapide et cruel, puant et bruyant. J’essaie de sentir flux et reflux, de viser, je traverse en pensée. Maintenant !… Là ! Je pouvais… Là je suis morte… Là peut-être… ? Non. Sofia, tu peux encore rentrer, reprendre le Giotto à l’envers : survivre.
La version électronique de la nouvelle, sous fichier Word, figurait l’isolement des Liphares et autres Phartistes par des cadres qui entouraient le texte (cf. extrait ci-dessus). Ces cadres, bien sûr, qui renforçaient l’aspect géométrique de la ville, disparaissaient quand les personnages quittaient leur phare. Visuellement, l’effet était impressionnant – on ressentait physiquement la libération de Sofia ou de Farrago. La version imprimée dans Galaxies ne comporte plus les cadres. L’effet est donc moindre, mais reste sensible. Les murs, réels ou artificiels, ne tombent qu’avec la réunion des personnages, avec leur contact physique, leur communication proche, leurs dialogues de vive voix qu’aucune machine ne relaie plus. Tout sauf I.A.
Le monde, dans « So phare away », est assez semblable au cylindre du Dépeupleur, l’un des plus étranges textes de Samuel Beckett. Les deux cents être humain – s’il s’agit bien d’hommes – du cylindre, les habitants de la ville sans nom de la nouvelle de Damasio se meuvent pareillement, selon des règles précises, dans un périmètre limité (là le cylindre, ici la ville), parcourent absurdement les voies qui leur sont réservées ou cherchent une impossible transcendance dans la pure verticalité (au sommet d’échelles réparties sur la paroi du cylindre chez Beckett, dans les phares chez Damasio). Rien ne nous est dit de l’origine du dépeupleur, et il semblerait bien que la clé de l’œuvre réside dans la forme même du discours, froidement scientifique, qui nous décrit cet enfer minimaliste de l’intérieur. Comme Le dépeupleur, « So phare away » est un récit de fin du monde, un Holocauste métaphorique. Il nous relate rien moins que l’extinction de l’homme, enseveli sous sa Créature, symbolisée par l’asphalte et la nappe lumineuse. Mais autant l’œuvre beckettienne est refermée sur elle-même, autant la prose damasienne est ouverte. Dans Le dépeupleur, la règle est absolue et ne saurait être enfreinte, à moins que l’infraction elle-même soit prévue et codifiée, car pour Beckett il n’y a rien à faire. Damasio, en revanche, dont nous connaissons l’engagement politique, croit encore, et avec conviction, à la résistance individuelle et collective. Les voltés de La Zone s’insurgent, les hordiers du contrevent écrivent leur propre trace, les altermondialistes des « Hauts® Parleurs® » contournent les pièges d’un effarant code de la propriété intellectuelle, et les phartistes de « So phare away », voyant leur voix noyée dans la Nappe, bravent les dangers de l’asphalte pour retrouver le contact. Tous échappent, d’une manière ou d’une autre, aux lignes tracées d’avance.
Mais revenons un instant au rôle de la verticalité. Que ce soit dans La Zone (le Cube, la tour d’holovision), dans La Horde (les tours d’Alticcio, la tour d’Ær) ou dans « So phare away », la transcendance n’est jamais accomplie, on ne trouve le salut qu’au sol. L’ascension est en effet toujours suivie d’une chute, et vaut plus par elle-même que par ce qui nous attend au sommet. Ce n’est donc pas une opposition là-haut/ici(-bas) qui intéresse Damasio – sinon d’un point de vue social, avec les racleurs et les tourangeaux d’Alticcio –, mais le chemin qui mène de l’un à l’autre – qui les lie. Il n’y a pas d’Extrême-Amont, est-il répété dans La Horde… Il n’y a pas de jardin d’Éden, sinon son simulacre machinique : ici la lumière (qui n’éclaire plus mais aveugle) et la verticalité sont associées, mais ne mènent qu’aux phares géants de Surville, autant dire à une impasse. C’est la subversion, c’est le péché, qui font l’homme.
Jamais propos plus politique, donc. Sur la Toile, à l’image de la Gouvernance de « So phare away », États et grands groupes commerciaux s’accaparent les meilleurs référencements, et profitent de la saturation pour s’accaparer les nouveaux espaces – nul n’ignore ce qu’est devenue la bande FM, qui regroupait jadis les « radios libres »… Comme dans Bandes alternées de Philippe Vasset, la seule voie est alors celle du hors-piste, de la furtivité. Échapper, à tout prix, aux yeux et aux oreilles de la Machine. Renouer les liens. Se repeupler. « So phare away » annonce vraisemblablement le prochain roman d’Alain Damasio, dont nous connaissons déjà le titre : Les furtifs…
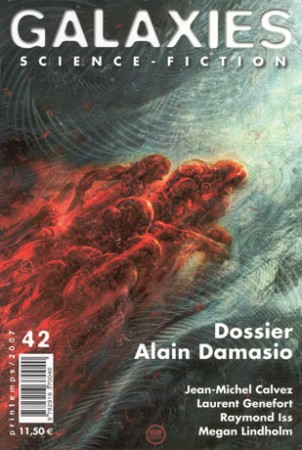
Electrons libres de James Flint (et retour sur Habitus)

« To subsist in lasting Monuments, to live in their productions, to exist in their names, and prædicament of Chymera's, was large satisfaction unto old expectations, and made one part of their Elyziums. But all this is nothing in the Metaphysics of true belief. To live indeed is to be again our selves, which being not only an hope but an evidence in noble beleevers; 'Tis all one to lye in St Innocents Church-yard, as in the Sands of Ægypt: Ready to be any thing, in the extasie of being ever, and as content with six foot as the Moles of Adrianus. »
Sir Thomas Browne, Hydriotaphia Or, A Brief Discourse of the Sepulchrall Urnes Lately Founds in Norfolk.
« Je t'invoque, toi qui es plus grand que tout, qui as tout créé, qui es né de toi-même, qui vois tout et qui n'es point vu. C'est toi qui as donné au Soleil sa gloire et toute sa puissance, à la Lune de croître et de diminuer et de suivre une course régulière, sans avoir rien enlevé aux ténèbres antérieures, mais en attribuant à tous une part égale. Car c'est avec ton apparition que le monde vint à l'être et que la lumière apparut. Toutes choses te sont soumises, toi dont aucun des dieux ne peut voir la vraie forme, toi qui, tandis que tu revêts toutes les formes, demeures l'invisible Aïon de l'Aïon. »
Hermès Trismégiste, Poimandrès
Virginia Woolf écrit que l’ouvrage Urn Burial de l’érudit Sir Thomas Browne, « est un temple dans lequel nous ne pouvons entrer qu’en laissant nos bottes boueuses sur le seuil (a temple which we can only enter by leaving our muddy boots on the threshold). Ici il n’est pas question de vous et moi, ou d’elle et lui, mais du destin et de la mort, de l’immensité du passé, de l’étrangeté qui nous enveloppe de toutes parts. Ici, comme dans aucun autre écrit anglais exceptée la Bible, plutôt que d’être abandonné à sa lecture solitaire le lecteur devient la partie d’un tout. Mais là encore, il y a une différence ; alors que la Bible prêche un évangile, qui saurait en revanche affirmer avec certitude que Sir Thomas Browne lui-même avait la foi ? » Auparavant, comme en prévision des labyrinthes borgésiens, Edgar Allan Poe citait Browne en épigraphe des Nouvelles histoires extraordinaires : « Quelle chanson chantaient les Sirènes ? Quel nom Achille avait-il pris, quand il se cachait parmi les femmes ? Questions embarrassantes, il est vrai, mais qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture ». Selon l’un des personnages du Livre de cendre (El Libro de ceniza) de l’auteur britannique James Flint, la rumeur voudrait que Sir Thomas Browne fut « le dernier homme vivant à avoir lu tous les livres jamais écrits » – la mort de Browne en 1682, si telle hypothèse était vérifiable, daterait alors précisément la venue au monde de la Machine. De l’abecedarium naturae de Bacon à la bibliothèque de Babel, perce ainsi peu à peu la certitude que l’univers est de dimensions sinon infinies, du moins indéfinies – l’étendue des possibles n’est pas humainement concevable. James Flint, s’il n’est pas doué du génie littéraire de Thomas Pynchon, de Don DeLillo ou du maître Argentin – qui refermait sa nouvelle Tlön Uqbar Orbis Tertius sur ces mots : « Alors l’Anglais, le Français et l’Espagnol lui-même disparaîtront de la planète. Le monde sera Tlön. Je ne m’en soucie guère, je continue à revoir, pendant les jours tranquilles de l’hôtel d’Adrogué, une indécise traduction quévédienne (que je ne pense pas donner à l’impression) de l’ “Urn Burial” de Browne »[1] –, a cependant l’ambition rare d’ouvrir quelques fenêtres sur un monde dont les sentiers, s’ils sont tracés d’avance, bifurquent suffisamment pour nous réserver le terrible honneur de choisir notre propre voie.
 J’avais été favorablement impressionné, il y a quelques années, par le premier roman de James Flint – admirablement traduit par Claro – : Habitus, œuvre aussi imparfaite qu’inventive et prophétique, nous conviait sur plus de 700 pages à un fascinant parcours à travers l’histoire de l’informatique au cours de la seconde moitié du 20e siècle – ou comment l’ère des réseaux aura raison de l’être humain… Après Douce Apocalypse,
J’avais été favorablement impressionné, il y a quelques années, par le premier roman de James Flint – admirablement traduit par Claro – : Habitus, œuvre aussi imparfaite qu’inventive et prophétique, nous conviait sur plus de 700 pages à un fascinant parcours à travers l’histoire de l’informatique au cours de la seconde moitié du 20e siècle – ou comment l’ère des réseaux aura raison de l’être humain… Après Douce Apocalypse,  recueil de nouvelles certes mineur mais sous-estimé par la critique (nous retiendrons tout particulièrement « Auto-assistance », texte ludique sous forme de test de personnalité ; « Lieux stratégiques », inquiétante variation autour du délire sécuritaire ; « Rêves d’un futur parfait », cauchemar psychosexuel nanotechnologique ; et « Esquisse pour un futur biotechnologique », implacable panorama historique des biotechnologies de 1980, date à laquelle la Cour suprême des Etats-Unis autorisa les brevets portant sur la vie génétiquement créée, jusqu’à 2060, année de la légalisation par le Congrès du clonage humain), les éditions Au Diable Vauvert publient aujourd’hui le dernier roman de James Flint, Electrons libres, traduit cette fois par Alfred Boudry. Ce Book of Ash s’avère plus drôle que Habitus, plus relâché aussi – à la construction composite de celui-là succède la nonchalance, la linéarité de celui-ci – ; le génie n’y transparaît plus qu’en creux, fuyant, insaisissable comme une ombre – celle de Jack Reever, le sculpteur pour déchets atomiques transmutés, sur les traces duquel nous sommes cordialement invités à marcher. Avant de nous pencher plus avant sur ces passionnants Electrons libres, plus profonds qu’ils n’en ont l’air, revenons sur Habitus. Voici ce que j’écrivis avec enthousiasme pour le numéro 28 de la revue Galaxies, en 2003 :
recueil de nouvelles certes mineur mais sous-estimé par la critique (nous retiendrons tout particulièrement « Auto-assistance », texte ludique sous forme de test de personnalité ; « Lieux stratégiques », inquiétante variation autour du délire sécuritaire ; « Rêves d’un futur parfait », cauchemar psychosexuel nanotechnologique ; et « Esquisse pour un futur biotechnologique », implacable panorama historique des biotechnologies de 1980, date à laquelle la Cour suprême des Etats-Unis autorisa les brevets portant sur la vie génétiquement créée, jusqu’à 2060, année de la légalisation par le Congrès du clonage humain), les éditions Au Diable Vauvert publient aujourd’hui le dernier roman de James Flint, Electrons libres, traduit cette fois par Alfred Boudry. Ce Book of Ash s’avère plus drôle que Habitus, plus relâché aussi – à la construction composite de celui-là succède la nonchalance, la linéarité de celui-ci – ; le génie n’y transparaît plus qu’en creux, fuyant, insaisissable comme une ombre – celle de Jack Reever, le sculpteur pour déchets atomiques transmutés, sur les traces duquel nous sommes cordialement invités à marcher. Avant de nous pencher plus avant sur ces passionnants Electrons libres, plus profonds qu’ils n’en ont l’air, revenons sur Habitus. Voici ce que j’écrivis avec enthousiasme pour le numéro 28 de la revue Galaxies, en 2003 :
« Premier roman de l'américain James Flint, Habitus célèbre avec bonheur les noces du proche et du lointain comme celles du trivial et du divin – ses personnages pathétiques sont confrontés aux vastes desseins qui président à leurs existences. Flint réussit une œuvre ambitieuse et personnelle qui ne croule jamais sous le poids de ses références : si Deleuze est cité en épigraphe[2], l'imaginaire de l'auteur paraît nourri avant tout de fantastique et de science-fiction. Habitus ressemble de ce fait à un improbable croisement entre Thomas Pynchon et Maurice G. Dantec, héritage de la grande tradition littéraire anglo-saxonne comme des cyberpunks. Impossible (pour des raisons matérielles) d'en résumer ici l'intrigue ; contentons-nous d'en dessiner les grandes lignes.
Nous suivons dans Habitus les destins croisés de Joel, génie des mathématiques devenu informaticien – né dans une famille de kabbalistes hassidiques –, Judd, sosie introverti de Denzel Washington, et Jennifer, jeune fille dévergondée en manque de liens affectifs. De l'union de ces trois fragiles personnalités naîtra une enfant mutante dotée de deux cœurs – et de pouvoirs effrayants. Et loin au-dessus, en orbite à 298 kilomètres de la Terre, Laïka la chienne de l'espace observe l'agitation des humains avec son regard distancié d'animal-dieu…
Pour donner vie ses personnages comme pour étayer ses descriptions, Flint utilise quasi systématiquement la métaphore – tantôt organique, tantôt minérale – dans un double mouvement de réification de l'homme et de vitalisation de l'inerte. Au confluent de ces deux courants contraires, le règne animal agit comme un révélateur des deux forces opposées qui se disputent l'univers : l'ordre et l'entropie. Mais ce qui n'apparaît un temps que comme un exercice de style gratuit prend tout son sens lorsque les métaphores deviennent littérales : Joël, obsédé par la création d'un Golem numérique à son image, devient lui-même pure information ; Judd finit par se minéraliser – littéralement – ; Jennifer se liquéfie, éparpillée en une myriade de particules. Et à bord de Spoutnik II, à force d'emmagasiner les flux d'informations en provenance de la Terre, Laïka finit par fusionner avec le satellite lui-même...
Roman post-humaniste, Habitus défend l'idée matérialiste d'un monde absolument déterministe mais aussi complètement imprévisible parce que l'homme est incapable de maîtriser l'infinitude des interactions à l'œuvre – considération éminemment borgésienne. D'où cette histoire critique, ludique et désenchantée des nouvelles technologies, conclusion imprévue d'un récit pourtant fasciné par la science. Le propos en lui-même n'est pas nouveau – le mythe de Prométhée a fait long feu –, mais James Flint a su le renouveler avec bonheur, lui donnant même une authentique dimension cosmique (métaphysique), sans jamais oublier ses personnages, profondément humains en dépit de leurs caractères exceptionnels. [...] »
Non sans humour et poésie, sur fond de physique quantique et de Kabbale, Habitus ne décrivait donc rien de moins que l’avènement imminent de la Machine-Monde – annoncé par les tentatives des personnages de dompter le hasard, et préfiguré par la Shoah. Cristallisation, structure structurante, structure structurée.
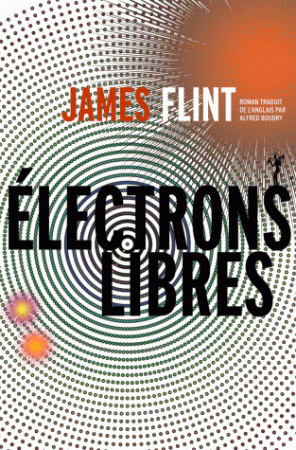 Dans Electrons libres, road-book aussi drôle qu'inquiétant – plus simple, plus touchant, moins métastatique qu'Habitus –, les métaphores sont plus discrètes, moins systématiques, mais d’une violence parfois surprenante. Ainsi les Etats-Unis, que traverse son personnage Cooper James équipé d’un appareil photographique – dont les clichés[3] sont insérés dans le texte, lui conférant plus d’étrangeté que de réalisme – et d’un exemplaire, offert par l’attentionnée Liz, d’une monographie de Sir Thomas Browne, « Hydriotaphia : De l’enfouissemen des Urnes ; ou Traicté des Urnes Sépulchrales récemmen mises à jour dans le Comté de Norfolk »[4], ainsi ces Etats-Unis sont-ils dépeints comme machine organique, immense et cancéreuse, à la beauté morbide. « Elle n’a rien d’une grande route large et vide qui s’étend pleine de promesses à la découverte de l’Ouest, non, c’est plutôt un tapis roulant pour bagnoles, un train à quatre voies dans lequel on s’insère pour s’oublier pendant les miles qu’on doit se taper, au milieu des feux arrière qui ondulent autour de vous avec une molle simplicité comme des composants électroniques en tri automatique dans une usine gigantesque, après quoi on n’a plus qu’à s’en extraire. » Si l’Homme empoisonne la planète, il s’assujettit volontairement à la Machine…
Dans Electrons libres, road-book aussi drôle qu'inquiétant – plus simple, plus touchant, moins métastatique qu'Habitus –, les métaphores sont plus discrètes, moins systématiques, mais d’une violence parfois surprenante. Ainsi les Etats-Unis, que traverse son personnage Cooper James équipé d’un appareil photographique – dont les clichés[3] sont insérés dans le texte, lui conférant plus d’étrangeté que de réalisme – et d’un exemplaire, offert par l’attentionnée Liz, d’une monographie de Sir Thomas Browne, « Hydriotaphia : De l’enfouissemen des Urnes ; ou Traicté des Urnes Sépulchrales récemmen mises à jour dans le Comté de Norfolk »[4], ainsi ces Etats-Unis sont-ils dépeints comme machine organique, immense et cancéreuse, à la beauté morbide. « Elle n’a rien d’une grande route large et vide qui s’étend pleine de promesses à la découverte de l’Ouest, non, c’est plutôt un tapis roulant pour bagnoles, un train à quatre voies dans lequel on s’insère pour s’oublier pendant les miles qu’on doit se taper, au milieu des feux arrière qui ondulent autour de vous avec une molle simplicité comme des composants électroniques en tri automatique dans une usine gigantesque, après quoi on n’a plus qu’à s’en extraire. » Si l’Homme empoisonne la planète, il s’assujettit volontairement à la Machine…
Le héros visible et introverti d’Electrons libres – Cooper James, jadis prénommé Ash, autrefois nommé Reever –, qui a passé son enfance dans une communauté hippie, a rejeté ce milieu contestataire : il est programmeur informatique pour l’armée américaine dans le Yorkshire, Angleterre. En plein cœur du complexe militaire qui l’emploie, alors que le personnel est évacué, Cooper se voir remettre par ses supérieurs une boîte métallique qu’on soupçonne de contenir de l’anthrax… mais qui s’avère ne renfermer que les cendres de son père !... Suspendu de ses fonctions, Cooper part en Amérique sur les traces de ce dernier, Jack Reever, qu’il n’a connu qu’enfant. Là-bas, de Graniteburg dans le Vermont à la Zone 51 en passant par les ateliers d’artistes de Seattle, de lieux-dits en communautés pittoresques jusqu’à l’étrange capitale du plutonium, Atomville[5], il découvre non pas un père entier, mais un homme aux mille visages, extrêmement difficile à cerner, sculpteur fantaisiste et féru d’alchimie qui s’était mis en tête de sculpter des matériaux radioactifs – jusqu’à des déchets nucléaires – pour créer son chef d’œuvre, L’Herme de l’ère moderne, et propager son sortilège symbolique... En même temps qu’une quête initiatique – l’impérieuse recherche d’une âme à travers les reflets irisés qu’elle a laissés sur d’autres âmes – se dessinent en effet de mystérieux liens entre énergie nucléaire, civilisation et alchimie… Le portrait du jamais vu Jack Reever satisfait pleinement aux exigences imposées par l’exercice. Non seulement Electrons libres ne manque pas de détails prophétiques, mais de surcroît Jack Reever, en dépit d’une personnalité apparemment complexe que son fils peine à reconstituer, laisse l’impression d’un caractère authentique. N’y voyez surtout aucun messianisme – Jack Reever échappe à toute tentative de dissection rationnelle –, mais seulement la sincère amitié que l’auteur porte à celui qui l’inspira, le sculpteur James L. Acord.
Nous l’avons dit, Cooper James est programmeur informatique pour l’armée américaine. Ce qu’il encode ? Il n’en a qu’une vague intuition : « Pour faire mon boulot, je n’ai pas besoin de connaître la fonction exacte du bidule. Même si j’ai mon idée sur la question » (p. 26). N’est-ce pas justement ce que dénonçait Günther Anders dans Nous, fils d’Eichmann ? Le défaut de représentation (« Quand nous avons passé un degré maximal de médiateté – et, dans le travail actuel, industriel, commercial et administratif, c’est la situation normale –, alors nous renonçons, non : alors nous ne savons même pas que nous renonçons, et qu’il serait de notre devoir de nous représenter ce que nous faisons. »[6]) nous plonge peu à peu dans un âge obscur : « Plus l’appareil dans lequel nous sommes intégrés se complique, plus ses effets grossissent, moins nous y voyons, plus s’enlise notre chance de pénétrer les déroulements dont nous sommes une partie ou de deviner ce qu’il en est réellement. Bref : bien qu’étant l’œuvre des humains, et maintenu en fonctionnement par nous tous, notre monde, se soustrayant aussi bien à notre représentation qu’à notre perception, devient de jour en jour plus obscur »[7], labyrinthe où nous nous perdons corps et âme. Il s’agit donc, pour Cooper James, de chercher en même temps que les traces de son père quelque lumière dans ces ténèbres grandissantes. Les sculptures de Jack Reever, où transparaît son obsession pour le nucléaire, les symboles alchimiques et autres allusions à Stonehenge disséminés çà et là, et l’Urn Burial de Browne, proposent à Cooper une nouvelle vision du monde qui ne renie plus l’héritage spirituel de la Vieille Europe, et qui ne repose plus sur les seuls produits culturels anglo-saxons, chrétiens, manichéens ou conspirationnistes (les références de Cooper ont pour titres Tron, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux[8], Harry Potter, X-Files…).
Depuis Habitus, James Flint tente tant bien que mal d’apporter sa modeste contribution – si telle chose est encore possible – au réenchantement d’un monde phagocyté par des puissances industrielles et techniques. Habitus empruntait la voie de la numérologie ; ici c’est l’hermétisme et l’alchimie – transmutation de l’Âme – qui sont convoqués. Jack Reever, selon Lemery, l’un de ses assistants était un magicien d’un nouveau type. Le symbole formé par le plan de Stonehenge, proche du circulus quadratus (voir image ci-contre) , était selon lui un puissant sortilège : représentant le palais (le pouvoir politique), le temple (la religion), le grenier à blé (le pouvoir véritable), les trois murs (divisés en cinq blocs sur le plan) entourés d’un cercle (le mur d’enceinte) puis d’un second (les maisons agglomérées autour du centre du pouvoir), le symbole « a changé une société clairsemée de nomades, d’agriculteurs de subsistance et de chasseurs-cueilleurs en ce que nous appelons aujourd’hui une civilisation » (p. 451). Or, Jack Reever postulait que les physiciens nucléaires, avec leur trinité proton, neutron, électron, capables de recréer sur la surface de la Terre l’énergie divine du Soleil, sont les alchimistes modernes, ceux dont les travaux furent selon lui à l’origine du développement des lotissements pavillonnaires, construits autour de la nouvelle citadelle inexpugnable, Atomville – la Nouvelle Atlantide. C’est pour conserver la trace de notre civilisation, pour en communiquer à quelque Droctulft des temps futurs non une vulgaire copie mais un symbole mystérieux que L’Herme de granit de Jack Reever, renfermant des cendres dont la légende dira qu'elles sont les siennes, s’élève finalement en plein désert toxique, au cœur des Zones contaminées.
, était selon lui un puissant sortilège : représentant le palais (le pouvoir politique), le temple (la religion), le grenier à blé (le pouvoir véritable), les trois murs (divisés en cinq blocs sur le plan) entourés d’un cercle (le mur d’enceinte) puis d’un second (les maisons agglomérées autour du centre du pouvoir), le symbole « a changé une société clairsemée de nomades, d’agriculteurs de subsistance et de chasseurs-cueilleurs en ce que nous appelons aujourd’hui une civilisation » (p. 451). Or, Jack Reever postulait que les physiciens nucléaires, avec leur trinité proton, neutron, électron, capables de recréer sur la surface de la Terre l’énergie divine du Soleil, sont les alchimistes modernes, ceux dont les travaux furent selon lui à l’origine du développement des lotissements pavillonnaires, construits autour de la nouvelle citadelle inexpugnable, Atomville – la Nouvelle Atlantide. C’est pour conserver la trace de notre civilisation, pour en communiquer à quelque Droctulft des temps futurs non une vulgaire copie mais un symbole mystérieux que L’Herme de granit de Jack Reever, renfermant des cendres dont la légende dira qu'elles sont les siennes, s’élève finalement en plein désert toxique, au cœur des Zones contaminées.

[1] « Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Yo no hago caso, yo sigo revisando en los quietos días del hotel de -Adrogué una indecisa traducción quevediana (que no pienso dar a la imprenta) del Urn Burial de Browne. »
[2] « L’habitude dans son essence est contradiction […] Il y a une contraction de la terre et de l’humidité qu’on appelle froment, et cette contraction est une contemplation, et l’autosatisfaction de cette contemplation. Le lys des champs, par sa seule existence, chante la gloire des cieux, des déesses et des dieux, c’est-à-dire des éléments qu’il contemple en contractant. Quel organisme n’est pas fait d’éléments et de cas de répétition, d’eau, d’azote, de carbone, de chlorures, de sulfates contemplés et contractés, entrelaçant ainsi toutes les habitudes par lesquelles il se compose ? […] Un animal se forme un œil en déterminant des excitations lumineuses éparses et diffuses à se reproduire sur une surface privilégiée de son corps. L’œil lie la lumière, il est lui-même une lumière liée. […] Or cette liaison est une véritable synthèse de reproduction, c’est-à-dire un Habitus. »
[3] Les photographies originales ont en réalité été prises par le sculpteur James L. Acord, dont l’œuvre et la personnalité ont largement inspiré la rédaction d’Electrons libres.
[4] Une traduction de cet ouvrage de Sir Thomas Browne (1605-1682) est disponible aux éditions Gallimard, Cabinet des lettrés, 2004, sous le titre Les Urnes funéraires.
[6] G. Anders, Nous, fils d’Eichmann (Rivages, Bibliothèque, 1999) pp. 50-51.
[7] Ibid., p. 51.
[8] James Flint ne manifeste toutefois aucun mépris pour ces œuvres destinées au grand public. Ainsi, pp. 448-449, le fameux vers de Tolkien (« Un anneau pour les gouverner tous ») acquiert une signification inattendue… De même, Cooper James nous démontre de manière assez convaincante (pp. 105-106) que le film Tron a « prophétisé le destin de l’industrie informatique des années 90 »…
J.G. BALLARD

huile sur toile, 147,5 x 89 cm
« Mais ce n’était pas seulement sur le monde extérieur que la douceur du temps répandait les prestiges de tant de charmes neufs et de vertus nouvelles et puissantes : le monde intérieur aussi en était visité et l’âme caressée, surtout à la suave approche des calmes heures du soir ; de même que la glace dessine de préférence ses floraisons et ses arborescences dans le silence des crépuscules, de même la mémoire découvre alors ses cristaux. »
Herman Melville, Moby Dick (texte français par Armel Guerne)
Sans que l’on sache s’il s’agit d’un hasard ou d’une invisible coordination, plusieurs éditeurs mettent en cette fin d’année l’auteur anglais J.G. Ballard à l’honneur, avec de nouvelles traductions (La Forêt de cristal chez Denoël, Le Massacre de Pangbourne, rebaptisé Sauvagerie chez Tristram), le premier tome de l’intégrale des Nouvelles (Tristram) et un recueil d’articles et d’interviews (J.G. Ballard, hautes altitudes, aux éditions è®e). C’est donc en toute logique que le site ActuSF lui consacre aujourd’hui un dossier rassemblant diverses critiques et chroniques signées par Éric Holstein (Millénaire mode d’emploi, Vermilion Sands, La Trilogie de béton), Jérôme Vincent (Le Monde englouti / Sécheresse), Ketty Steward (Le Monde englouti / Sécheresse également) et moi-même.
Tout d’abord, je vous invite dans « Inner Space : J.G. Ballard : Biographie » à un petit survol de la vie et de l’œuvre de celui que l’on surnomme parfois l’Oracle de Shepperton. Extrait :
 Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l’English Cathedral School jusqu’au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l’abri des affrontements. Après l’attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua – au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille –, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s’inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman L’Empire du soleil, adapté à l’écran par Steven Spielberg, et influencera son œuvre spéculative, comme en témoignent ses obsessions pour l’enfermement, les enclaves communautaires (en 1992, Ballard retournera à Longhua, qu’il trouvera inchangé :« Debout entre les couchettes, je compris que c’était là que j’avais été le plus heureux et m’étais senti le plus chez moi, alors même que j’étais un prisonnier soumis à la menace d’une mort prématurée », racontera-t-il dans un texte publié dans le Sunday Times en 1995) et le devenir-banlieue d’un monde civilisé qu’il perçoit comme un camp, lieu entropique aussi riche en menaces qu’en potentialités (l’une de ses premières nouvelles s’intitulera d‘ailleurs « La Villeconcentrationnaire »). « [Les] événements dont Ballard fut témoin, transmis à Jim de L’Empire du soleil, préfigurent les scènes de ses autres fictions fantastiques plus explicites. », écrit Luc Sante.« Les piscines asséchées, les banlieues désertées et les autoroutes vidées de Shanghai mutèrent en monde de dévastation hantant les nouvelles catastrophistes de Ballard ». (cf. J.G. Ballard, hautes altitudes, p. 121)
Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l’English Cathedral School jusqu’au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l’abri des affrontements. Après l’attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua – au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille –, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s’inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman L’Empire du soleil, adapté à l’écran par Steven Spielberg, et influencera son œuvre spéculative, comme en témoignent ses obsessions pour l’enfermement, les enclaves communautaires (en 1992, Ballard retournera à Longhua, qu’il trouvera inchangé :« Debout entre les couchettes, je compris que c’était là que j’avais été le plus heureux et m’étais senti le plus chez moi, alors même que j’étais un prisonnier soumis à la menace d’une mort prématurée », racontera-t-il dans un texte publié dans le Sunday Times en 1995) et le devenir-banlieue d’un monde civilisé qu’il perçoit comme un camp, lieu entropique aussi riche en menaces qu’en potentialités (l’une de ses premières nouvelles s’intitulera d‘ailleurs « La Villeconcentrationnaire »). « [Les] événements dont Ballard fut témoin, transmis à Jim de L’Empire du soleil, préfigurent les scènes de ses autres fictions fantastiques plus explicites. », écrit Luc Sante.« Les piscines asséchées, les banlieues désertées et les autoroutes vidées de Shanghai mutèrent en monde de dévastation hantant les nouvelles catastrophistes de Ballard ». (cf. J.G. Ballard, hautes altitudes, p. 121)
L’essai J.G. Ballard, hautes altitudes, s’intéresse surtout au Ballard visionnaire de la postmodernité. On doit à Bruce Bégout le texte le plus remarquable. Extrait :
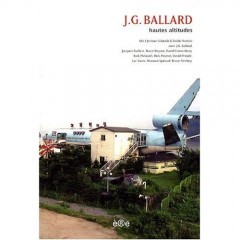 […] dans « Suburbia », lumineux article initialement publié dans le catalogue de l’exposition Airs de Parisdu Centre Georges Pompidou, le philosophe Bruce Bégout, fin observateur de le périurbanisation du monde (lire l’excellent Zéropolis aux éditions Allia), analyse d’abord l’émergence des « sous-villes », c’est-à-dire de ces banlieues décentrées, qui ne sont plus « une simple extension périphérique de la ville », mais « une nouvelle manière de penser et de constituer l’espace urbain », puis tente de la définir par un surprenant poème phénoménologique (extrait :« Nous sommes dans la suburbia là où les parkings désertés constituent des lieux de sociabilité nocturne. / Nous sommes dans la suburbia si un centre commercial représente un pôle d’attraction hebdomadaire dans votre quotidien. »), avant de conclure en beauté avec les visions ballardiennes de cette nouvelle forme d’occupation de l’espace : « L’angoisse de l’homme suburbain devant les espaces infiniment désolés de la banlieue infinie correspond […] traits pour traits au sentiment inquiétant de perte de la position centrale de l’homme dans un monde non géocentrique. La pensée d’errer dans une immensité sans bornes éveille alors une “horreur secrète”, pour reprendre la formule de Kepler. Or, la suburbia n’est plus effectivement un espace centralisé, fini et ordonné, mais l’univers illimité de places disséminées, le continu infini de lieux qui ne sont plus liés par une hiérarchie fixe et immuable. »
[…] dans « Suburbia », lumineux article initialement publié dans le catalogue de l’exposition Airs de Parisdu Centre Georges Pompidou, le philosophe Bruce Bégout, fin observateur de le périurbanisation du monde (lire l’excellent Zéropolis aux éditions Allia), analyse d’abord l’émergence des « sous-villes », c’est-à-dire de ces banlieues décentrées, qui ne sont plus « une simple extension périphérique de la ville », mais « une nouvelle manière de penser et de constituer l’espace urbain », puis tente de la définir par un surprenant poème phénoménologique (extrait :« Nous sommes dans la suburbia là où les parkings désertés constituent des lieux de sociabilité nocturne. / Nous sommes dans la suburbia si un centre commercial représente un pôle d’attraction hebdomadaire dans votre quotidien. »), avant de conclure en beauté avec les visions ballardiennes de cette nouvelle forme d’occupation de l’espace : « L’angoisse de l’homme suburbain devant les espaces infiniment désolés de la banlieue infinie correspond […] traits pour traits au sentiment inquiétant de perte de la position centrale de l’homme dans un monde non géocentrique. La pensée d’errer dans une immensité sans bornes éveille alors une “horreur secrète”, pour reprendre la formule de Kepler. Or, la suburbia n’est plus effectivement un espace centralisé, fini et ordonné, mais l’univers illimité de places disséminées, le continu infini de lieux qui ne sont plus liés par une hiérarchie fixe et immuable. »
Le très remarquable Sauvagerie s’intéresse justement aux prémices de ce glissement suburbain dans l’hyperréalité. Résumé :
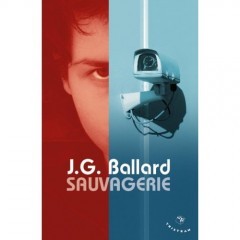 Pangbourne Village est un enclos résidentiel du Berkshire, non loin de Londres. Dix familles aisées – banquier, assureur, courtier en bourse, psychiatre, PDG, anciennes gloires du sport, pianiste de concert et autres riches propriétaires – vivaient dans cette édénique enceinte de seize hectares, surprotégée, clôturée, munie d’alarmes électriques, parcourue par des patrouilles régulières et aux avenues et allées privées surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des caméras vidéo. On y nageait dans un tel bonheur qu’une équipe de la BBC s’apprêtait à y tourner un édifiant documentaire. Alors, comment expliquer l’assassinat de trente-deux personnes (tous les résidents adultes, les gardiens et des membres du personnel domestique), et la soudaine disparition de douze enfants et adolescents ?... C’est ce que cherche à comprendre Richard Greville, consultant psychiatre adjoint mandé par le Home Office, auteur du journal médico-légal que nous lisons. Toutes les hypothèses sont examinées, des moins inconcevables (tueur fou, groupe de déséquilibrés…) aux plus improbables (expédition punitive d’un cartel de drogue, erreur de parachutage d’une unité de commandos soviétiques, chute accidentelle d’un gaz neurotoxique expérimental qui aurait provoqué un dérèglement mental chez les habitants d’une agglomération voisine, manipulation inconsciente par des puissances étrangères, élimination par des extraterrestres en quête de jeunes spécimens humains, parents assassinés par leurs propres enfants…) mais aucune n’est jugée réaliste par les autorités. Deux mois après les événements, la police ignore encore tout de l’identité des coupables, et n’a trouvé aucune trace des enfants kidnappés. Le docteur Greville, chargé du dossier, est d’abord incrédule lui aussi, mais à mesure qu’en compagnie du sergent Payne il s’imprègne de l’atmosphère doucement concentrationnaire de la résidence, il finit par reconstituer les faits, et par entrevoir une vérité extrêmement dérangeante…
Pangbourne Village est un enclos résidentiel du Berkshire, non loin de Londres. Dix familles aisées – banquier, assureur, courtier en bourse, psychiatre, PDG, anciennes gloires du sport, pianiste de concert et autres riches propriétaires – vivaient dans cette édénique enceinte de seize hectares, surprotégée, clôturée, munie d’alarmes électriques, parcourue par des patrouilles régulières et aux avenues et allées privées surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des caméras vidéo. On y nageait dans un tel bonheur qu’une équipe de la BBC s’apprêtait à y tourner un édifiant documentaire. Alors, comment expliquer l’assassinat de trente-deux personnes (tous les résidents adultes, les gardiens et des membres du personnel domestique), et la soudaine disparition de douze enfants et adolescents ?... C’est ce que cherche à comprendre Richard Greville, consultant psychiatre adjoint mandé par le Home Office, auteur du journal médico-légal que nous lisons. Toutes les hypothèses sont examinées, des moins inconcevables (tueur fou, groupe de déséquilibrés…) aux plus improbables (expédition punitive d’un cartel de drogue, erreur de parachutage d’une unité de commandos soviétiques, chute accidentelle d’un gaz neurotoxique expérimental qui aurait provoqué un dérèglement mental chez les habitants d’une agglomération voisine, manipulation inconsciente par des puissances étrangères, élimination par des extraterrestres en quête de jeunes spécimens humains, parents assassinés par leurs propres enfants…) mais aucune n’est jugée réaliste par les autorités. Deux mois après les événements, la police ignore encore tout de l’identité des coupables, et n’a trouvé aucune trace des enfants kidnappés. Le docteur Greville, chargé du dossier, est d’abord incrédule lui aussi, mais à mesure qu’en compagnie du sergent Payne il s’imprègne de l’atmosphère doucement concentrationnaire de la résidence, il finit par reconstituer les faits, et par entrevoir une vérité extrêmement dérangeante…
L’on se rend compte, à lire le premier volume des Nouvelles complètes chez Tristram, qui réunit les textes courts de Ballard de 1956 à 1962, que cette vision lucide mais fascinée du devenir-banlieue du monde, a pris très tôt naissance dans son esprit. Extrait de ma chronique :
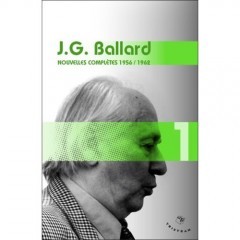 La plupart de ces nouvelles, sans doute marquées par l’internement de Ballard dans un camp de prisonnier japonais en Chine, nous parlent d’une manière ou d’une autre d’enfermement, d’aliénation, d’entropie, de surveillance et de contrôle, mais, comme dans les romans qu’il écrira par la suite, jamais l’auteur de Crash ! ne revendique ni ne dénonce : ce qui l’intéresse avant tout dans l’exercice dystopique – et même cataclysmique –, c’est d’identifier l’impact psychologique des mutations contemporaines (sociales, spatiales, biologiques, technologiques, artistiques ou architecturales) sur les individus. Il nous observe, comme l’étrange personnage du « Dernier monde de monsieur Goddard » (1960) penché au-dessus de son coffre-univers… Inquiet, peut-être ; excité, sûrement. Dès ses premiers textes des années cinquante, Ballard n’a cessé de donner à nos devenirs, aux métamorphoses de notreDasein, de nouvelles images, souvent poétiques, éminemment métaphoriques – et l’on doit ici considérer la métaphore non comme une simple figure de style, non comme l’illustration d’un concept, mais comme un phénomène de pensée poétique, l’expression multivalente, inépuisable, d’une pensée que la raison seule ne peut appréhender, mais qui éclaire une dimension ontologique de l’être. Métaphoriser, pour Aristote, c’est « mettre sous les yeux ».
La plupart de ces nouvelles, sans doute marquées par l’internement de Ballard dans un camp de prisonnier japonais en Chine, nous parlent d’une manière ou d’une autre d’enfermement, d’aliénation, d’entropie, de surveillance et de contrôle, mais, comme dans les romans qu’il écrira par la suite, jamais l’auteur de Crash ! ne revendique ni ne dénonce : ce qui l’intéresse avant tout dans l’exercice dystopique – et même cataclysmique –, c’est d’identifier l’impact psychologique des mutations contemporaines (sociales, spatiales, biologiques, technologiques, artistiques ou architecturales) sur les individus. Il nous observe, comme l’étrange personnage du « Dernier monde de monsieur Goddard » (1960) penché au-dessus de son coffre-univers… Inquiet, peut-être ; excité, sûrement. Dès ses premiers textes des années cinquante, Ballard n’a cessé de donner à nos devenirs, aux métamorphoses de notreDasein, de nouvelles images, souvent poétiques, éminemment métaphoriques – et l’on doit ici considérer la métaphore non comme une simple figure de style, non comme l’illustration d’un concept, mais comme un phénomène de pensée poétique, l’expression multivalente, inépuisable, d’une pensée que la raison seule ne peut appréhender, mais qui éclaire une dimension ontologique de l’être. Métaphoriser, pour Aristote, c’est « mettre sous les yeux ».
L’influence des peintres surréalistes, déjà évidente dans les nouvelles, trouve sans doute sa plus impressionnante expression dans Le Monde englouti et, surtout, dans ce magnifique et très étrange roman qu’est La Forêt de cristal. Extrait de ma critique :
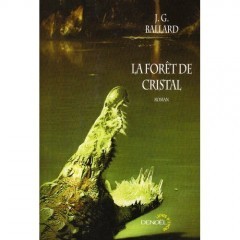 Si le roman, lumineuse inversion de Au cœur des Ténèbres, est traversé par maintes oppositions – chaque personnage semble avoir son double –, par maints contrastes propices à de splendides descriptions rappelant les plus belles toiles de Max Ernst, il est cependant rétif à toute interprétation morale. Port Matarre et le reste du monde sont comparés au purgatoire, c’est-à-dire à l’antichambre purificatrice de l’au-delà, mais comme souvent chez Ballard, nous sommes par-delà le bien et le mal : ombre et lumière ont ici un sens propre à Sanders. L’ombre : l’extérieur. Dans cette « zone grise de pénombre », si terne comparée à la forêt efflorescente – la lumière –, qui brille de mille feux au point que tous ceux qui la contemplent en sont bouleversés, hors du cristal donc, Suzanne n’est pas. Suzanne est la clé de voûte du récit.
Si le roman, lumineuse inversion de Au cœur des Ténèbres, est traversé par maintes oppositions – chaque personnage semble avoir son double –, par maints contrastes propices à de splendides descriptions rappelant les plus belles toiles de Max Ernst, il est cependant rétif à toute interprétation morale. Port Matarre et le reste du monde sont comparés au purgatoire, c’est-à-dire à l’antichambre purificatrice de l’au-delà, mais comme souvent chez Ballard, nous sommes par-delà le bien et le mal : ombre et lumière ont ici un sens propre à Sanders. L’ombre : l’extérieur. Dans cette « zone grise de pénombre », si terne comparée à la forêt efflorescente – la lumière –, qui brille de mille feux au point que tous ceux qui la contemplent en sont bouleversés, hors du cristal donc, Suzanne n’est pas. Suzanne est la clé de voûte du récit.
Ainsi la cristallisation – célébration finale de l’eucharistie selon le père Balthus – est-elle émanation de l’esprit de Sanders, réification dans le réel diégétique de ses désirs de repli fœtal, de paix et d’amour éternels (l’écriture de La Forêt de cristal coïncide avec la mort de la femme de Ballard en 1964, d’une pneumonie...). Désirs de communion, si l’on veut : la forêt (Jardin d’Éden chatoyant – l’auteur n’évoque-t-il pas des souvenirs archaïques ?) devient une Église où chacun est uni dans le corps mystique du Christ – ou de l’univers – ; où chacun rejoint le Royaume de Dieu après son passage dans le purgatoire du réel.
Et lorsque vous aurez lu cette critique de La Forêt de cristal ou, mieux, le roman lui-même, vous comprendrez pourquoi les quelques lignes de Moby Dick lues l’autre soir, et placées ici en épigraphe, ont puissamment résonné avec ma fibre ballardienne.
L’Enchâssement de Ian Watson - 3 - Les indiens Xemahoa
Dans la deuxième partie de notre texte consacré à L’Enchâssement de Ian Watson, nous avions surtout évoqué les expériences sur des enfants aphasiques menées au Centre Haddon. Mais parallèlement aux recherches du linguiste Chris Sole, son vieil ami français Pierre Darriand (qui n’est autre que le père de son enfant…), anthropologiste, vit parmi les Xemahoa, peuple amazonien menacé par un titanesque projet de barrage, mené par le Brésil et les Etats-Unis d’Amérique, qui doit à terme noyer la majeure partie de l’Amazonie sous les eaux. Avant d’aborder dans notre quatrième et dernière partie la trame la plus intéressante de ce récit de science-fiction (je veux bien entendu parler des extraterrestres Changeurs de Signes), attardons-nous quelques instants sur cette étrange tribu.
Dans une lettre adressée à Sole, Pierre évoque donc les Xemahoa, cette tribu exceptionnelle qui non seulement obéit à des lois différentes (par exemple l’inceste y est vivement encouragé, et leur système numéral est avant tout relatif), mais qui, surtout, possède deux langages : une langue quotidienne, traditionnelle, et une autre beaucoup plus complexe (le xemahoa B), un langage « enchâssé » compréhensible seulement pendant des transes provoquées par une drogue, le maka-i, ingéré lors d’un rituel initié par le bruxo (le chaman xemahoa). Comme Sole avec le langage artificiel développé par les enfants du Centre Haddon, Pierre Darriand compare le xemahoa B aux Nouvelles Impressions d’Afrique... Lisons un extrait de ses notes sur la langue xemahoa : « Si le xemahoa B – le langage drogué – est aussi profondément enchâssé que me le laissent penser mes enregistrements, alors l’expression, l’affirmation du “maintenant” est déjà grosse de l’achèvement à venir de cette affirmation. Cela vise à abolir l’étalement dans le temps d’un énoncé, étalement inévitable du fait même de la durée matérielle de l’énoncé, et durée au cours de laquelle l’objet de l’énoncé pourra avoir changé, ce qui, du coup, l’invalidera. » (pp. 81-82) Et plus loin : « Les prédicats “yi” et “yi-yi” y jouent un rôle important. Ainsi, le mot composé “kai-kai-yi” signifie “x” quanta de l’objet temporel mesuré (les phases de la grossesse, de l’histoire de l’Homme ou d’une cérémonie) en aval du cours du temps. Alors que, tout aussi utile et ingénieux, le terme “yi-kai-kai” signifie “x” quanta en amont du présent vers le passé, remontant le cours de ces enchâssements de mots qui, comme un fleuve, charrie la vie. » (p. 82)
Autrement dit, les Xemahoa « dansent le temps au son des mélopées du bruxo ». L’absence de référence précise au temps dans la langue xemahoa renvoie à l’étude des indiens Hopi par Whorf, pour qui cette particularité réfutait l’idée d’universalité linguistique – cela est toutefois sujet à caution : certains ont montré qu’en vérité, les Hopi avaient bel et bien des expressions pour exprimer les notions temporelles… Mais il semblerait que nos Xemahoa soient plus whorfiens que les Hopi ! Pour Whorf, c’est notre langue d’origine qui nous permet d’organiser le « flux kaléidoscopique d’impressions » sous lequel se présente le monde. Darriand poursuit : « Ce discours enchâssé n’est autre que la châsse où sont serrés l’âme, les mythes, de la tribu. Mais cela permet également aux Xemahoa de faire l’expérience immédiate de leur vie mythique au cours de ces célébrations à la fois chantées et dansées. Le dialecte vernaculaire quotidien, le xemahoa A, est passé au crible d’un re-codage extrêmement élaboré qui brise les séquences linéaires du parler normal et restitue le peuple xemahoa à cette unité spatio-temporelle de laquelle, nous autres, avons été coupés. Car nos langages se comportent comme des barrages entre la Réalité et notre Idée de la Réalité.
« Je suis enclin à penser que le xemahoa B est le langage le plus vrai que j’aie jamais rencontré. Il est évident qu’à d’autres égards – pour tout ce qui concerne la vie quotidienne – il met à mal, paralyse, infirme notre vision strictement euclidienne du monde. C’est un langage extravagant, semblable en cela à celui de Roussel, mais pire. L’esprit ne peut espérer seul, sans adjuvant, l’appréhender. Mais dans leurs hallucinations, ces Indiens ont découvert l’élixir vital de la compréhension. » (p. 117)
Ainsi, pour Darriand, nos langages non seulement ne restitueraient de la réalité qu’une vision toute relative, mais encore cette vision serait fausse, et le langage, totalitaire – en opposition à une vraie réalité, à laquelle notre langage ne nous donnerait pas accès... Voilà qui nous renvoie encore à Korzybski, qui rappelait que contrairement au langage mathématique – un langage conforme à ce qu’il décrit –, les langages employés par les bâtisseurs des structures sociales, économiques, politiques, ne sont pas strictement similaires à la structure de la réalité, des faits, des événements (d’où leurs échecs récurrents). Pour s’adapter à son environnement sans courir au désastre (des guerres mondiales par exemple), l’homme, toujours selon Korzybski, doit donc modifier sa conception du monde, rompre avec la logique aristotélicienne et inaugurer la Sémantique Générale, où la raison mathématique prévaut. Aussi « extravagant », aussi roussellien, aussi fou soit-il, le Xemahoa B repose sur le principe a priori très rationnel de l’enchâssement, et permettrait donc aux membres de la tribu, selon Darriand, d’atteindre à la compréhension du monde. Les Xemahoa auraient très exactement trouvé la solution aux recherches menées à titre expérimental au Centre Haddon. D’aucuns ont reproché à l’épisode des indiens Xemahoa de faire double emploi avec les passages consacrés au Centre, puisqu’il ne s’agit jamais, selon eux, que de nous présenter un langage enchâssé censé révéler sinon une autre réalité, du moins la réalité sous un autre jour... Si l'on s'en tient à ce que nous venons d'écrire, c'est juste. Mais le rapprochement des deux intrigues me paraît justifié, pour plusieurs raisons. Premièrement, l’étude des Xemahoa par Pierre Darriand propose un nouvel angle d’attaque, une autre façon d’appréhender une même réalité – préoccupation qu’on trouve précisément au cœur du roman. Ainsi, aux artifices du Centre répond l’harmonie des Xemahoa avec la nature ; au scientisme de Sole et de ses collègues répond le mysticisme des indiens. Cette opposition nous permet du reste de mettre en lumière une différence fondamentale : la mathématique pure permet certes à Chris Sole d’approcher certaine vérité, mais elle se heurte inévitablement au problème des « totalités illégitimes », pour utiliser la terminologie de Bertrand Russell : délimiter les « frontières de la pensée », c’est remplacer les schémas ainsi délimités par un nouveau schéma, qui dès lors devrait être lui-même inclus dans un ensemble plus vaste (dans les ultimes lignes du roman, Ian Watson parlera même d’un « camp de concentration »…) ; tandis que les Xemahoa s’accordent symbiotiquement par l’enchâssement à leur environnement naturel et à leurs mythes, bref, à leur monde dans sa totalité (nous allons y revenir dans un instant), sans accusation d’illégitimité. Et deuxièmement, l’entrelacement des deux intrigues permet à Watson de construire son roman de manière enchâssée – mais un enchâssement simple, fort compréhensible, somme toute très commun – : l’idée centrale s’en trouve évidemment renforcée.
À en croire Pierre Darriand, les Xemahoa auraient donc réussi, sous certaines conditions, ce que Chris Sole projetait avec les enfants de l’univers enchâssé du Centre : repousser les limites de la compréhension – et de l’esprit. Mais selon l’anthropologiste, les Xemahoa vont plus loin encore, et, sous l’influence de leur langage enchâssé, prétendent soumettre la réalité à leurs perceptions ! En prisant le maka-i en effet, le bruxo « […] ne vise rien moins qu’une perception totale de la Réalité qu’il restitue immédiatement dans le présent éternel de l’hallucination. Et, par cette reconstitution globale de la réalité, il pense pouvoir se donner les moyens de la contrôler, de l’infléchir. Le vieux rêve du sorcier !
[…] « Pour le bruxo comme pour les Xemahoa, la connaissance n’est pas une chose abstraite, mais plutôt codée en termes d’oiseaux et de bêtes, de roches et de plantes, en termes de forêt, avec les nuages et les étoiles qui la surplombent, dans les termes mêmes de la réalité donnée, concrète. C’est pourquoi la description globale de cette connaissance n’est pas une opération abstraite, mais une mainmise sur la réalité factuelle qui les entoure. Cette appréhension de la réalité revient à la contrôler, par là, à la manipuler. C’est, du moins, ce qu’il espère.
« Il doit bientôt entreprendre une gigantesque narration enchâssée de tous les mythes de la tribu ainsi codés en cet instant précis de leur histoire, de leur conscience. Jour après jour, au cours de la danse droguée, il accumule les éléments de la signification totale que doit prendre en charge sa narration, c’est-à-dire qu’il garde présent à l’esprit tout ce qui a été énoncé les jours précédents, qu’il le garde dans le présent éternel de son esprit inspiré par la drogue, malgré la tension terrible qu’en subissent son corps et son cerveau.
« Il doit bientôt parvenir à exprimer la conscience totale de l’Être. Bientôt, il percevra dans sa clarté le schéma qui sous-tend la pensée symbolique du mythe. » (pp. 118-119)
Et cet événement pur coïncidera avec l’accouchement d’une femme, mise à l’écart de la tribu et bourrée de maka-i au mépris des menaces de malformation. Les Xemahoa ne parlent-ils pas de « l’enfant enchâssé (c’est leur mot) dans le ventre de la femme enfermée dans la hutte » (p. 73) ? La dimension christique de cette prophétie (dont Pierre, comme le saint dont il porte le nom, serait le premier apôtre ?...) n’aura échappé à personne. Cette communion des Xemahoa avec leur monde, grâce au maka-i et au langage enchâssé, cette « conscience totale de l’Être », n’est-elle pas une forme animiste d’eucharistie, d’expérience sensorielle de l’union hypostatique catholique ? Mais ces troublantes ressemblances avec certains éléments de doctrine ne sont pas fortuites : à plusieurs reprises nous croisons le chemin de prêtres missionnaires, qui ont tenté (sans succès, selon eux) de porter la parole du Christ auprès d’indigènes qui paraissent, par leurs transes, avoir à leur tour enchâssé ces mythes chrétiens dans leur propre représentation du monde.
Lorsqu’il nous décrit les étranges particularités des Xemahoa, Pierre Darriand nage-t-il en plein délire, ou est-il dans le vrai ?... Difficile de répondre. Le dénouement de l’affaire du barrage amazonien (les Xemahoa ont essayé, par une narration enchâssée, de tordre le réel à leur guise, or le barrage est effectivement détruit, pour des raisons que nous évoquerons dans notre dernière partie…) brouille les pistes. Le bruxo a-t-il eu la vision du soudain reflux des eaux, au cours de sa narration enchâssée ? Ou ne s’agit-il que d’une coïncidence ?...
Vous le saurez (ou pas) en lisant la dernière partie de notre article : Les Changeurs de Signes…
2- Les expériences de Chris Sole
À suivre…


