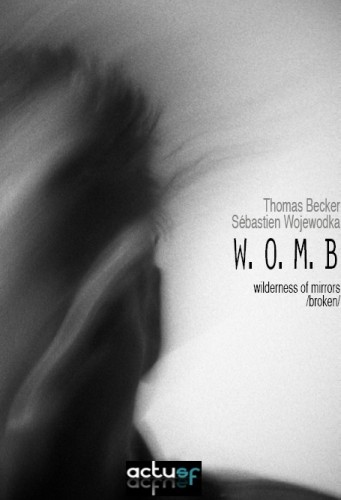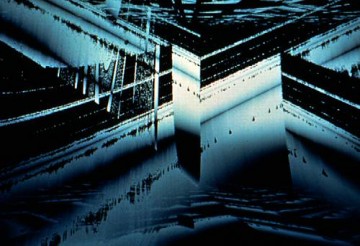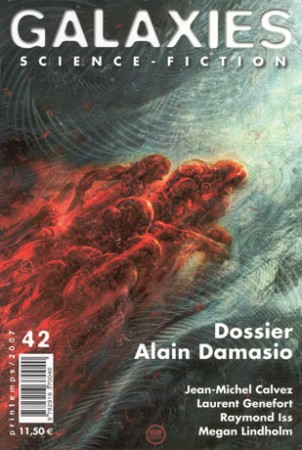À Sébastien.
« Séjour où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur. Assez vaste pour permettre de chercher en vain. Assez restreint pour que toute fuite soit vaine. »
Samuel Beckett, Le dépeupleur.
« J’étais bien, abreuvé de noir et de calme, au pied des mortels, au fond du jour profond, s’il faisait jour. Mais la réalité, trop fatigué pour chercher le mot juste, ne tarda pas à se rétablir, la foule reflua, la lumière revint, et je n’avais pas besoin de lever la tête de l’asphalte pour savoir que je me retrouvais dans le même vide éblouissant que tout à l’heure. […] Je dis, la mer est à l’est, c’est vers l’ouest qu’il faut aller, à gauche du nord. Mais ce fut en vain que je levai sans espoir les yeux au ciel, pour y chercher les chariots. Car la lumière où je macérais aveuglait les étoiles, à supposer qu’elles fussent là, ce dont je doutais, me rappelant les nuages. »
Samuel Beckett, « Le calmant » in Nouvelles et textes pour rien.
Il est un passage de La Horde du contrevent, dans les toutes dernières pages, qui m’a ému aux larmes, viscéral à hurler :
Je m’en sortis parce que je compris, du cœur de mon effondrement, que toute la Horde n’était encore debout sur la lande que par ma faculté active à la faire vivre. La solitude n’existe pas. Nul n’a jamais été seul pour naître. La solitude est cette ombre que projette la fatigue du lien chez qui ne parvient plus à avancer peuplé de ceux qu’il a aimés, qu’importe ce qui lui a été rendu. Alors j’ai avancé peuplé, avec ma horde aux boyaux, les vifs à un pas et une certitude : l’écroulement de toutes les structures qui m’avaient porté jusqu’ici – la recherche de l’origine du vent, les neufs formes, l’Extrême-Amont, les valeurs et les codes de ma Horde – ne m’enlevait pas, ne pourrait jamais m’arracher, pas même par leur mort, ce qui ne dépendait, authentiquement, que de moi : l’amour enfantin qui me nouait à eux.
Ceux qui ont la chance de connaître – ou d’avoir connu – l’amitié authentique, indéfectible, celle qui vous lie irrémédiablement à l’autre, quoi qu’il arrive, par-delà même l’espace et le temps, sauront de quoi il est ici question. Comme Sov, nous avançons peuplés, avec nos hordes aux boyaux.
Plus que son éloge du dépassement de soi, plus que sa philosophie du mouvement, c’est cette mise en actes du lien, rendue possible par un inouï travail formel, qui fait de La Horde du contrevent l’un des plus beaux livres qui soient, et ce, même si les recherches phonétiques d’Alain Damasio, uniques dans le domaine romanesque contemporain, ne lui ont pas encore permis de s’attaquer avec la même pugnacité aux structures syntaxiques, et d’égaler ainsi les maîtres du monologue intérieur, tels Joyce, Faulkner et Beckett. Mais une synthèse de ces trois singularités est-elle seulement envisageable ? Joyce, et l’expression automatique d’un courant de conscience (stream of consciousness), stupéfiante tentative de surmonter la barrière des langues (Finnegans wake). Beckett, dont les alter ego se meuvent à distance égale du ciel et de la terre, se trouvant « comme qui dirait sous cloche, tout en pouvant se déplacer à l’infini dans tous les sens » (Nouvelles et textes pour rien), prisonniers des espaces intérieurs de l’auteur ; Beckett, donc, et le ressassement solitaire et métatextuel. Et Faulkner, qui fait mine de capter les flux de pensée de ses personnages, et de les restituer, brutes, soumettant la syntaxe à leur phénoménologie propre. L’idéal damasien se situerait donc, en théorie, au point nodal de ces trois grands modèles – tout en ne quittant jamais le champ de l’Imaginaire. Damasio singularise ses différents narrateurs par le style, comme Faulkner dans Tandis que j’agonise. Il fait fondre et se tordre le verbe, fait jaillir des étincelles avec Caracole, comme Joyce dans Finnegans wake. Enfin, comme chez Beckett (dans L’Innommable par exemple), métaphores et matière métafictive sont omniprésentes : dans La Horde, des bribes du récit flottent dans l’air, dans le sillage des tempêtes, sous forme de chrones – des concepts vivants – couverts de glyphes ; et Sov, le scribe de la (dernière) bande, est un passeur entre l’univers du roman et son propre engendrement.
Le texte-phare de la dernière livraison de la revue Galaxies (n°42), est une nouvelle d’une grande beauté, aussi abstraite que sensuelle, très poétique, et donc éminemment métaphorique, sur la déréliction du monde. « So phare away » d’Alain Damasio, rejoint en effet ces fictions, en si petit nombre, qui nous habitent, qui nous transforment durablement. La lecture, écrivait Sartre, « ne doit pas être une communion mystique non plus qu'une masturbation, mais un compagnonnage ». « So phare away », qui comme La Horde du contrevent nous accompagne, jamais à côté, mais au-dedans, est le récit tragique et visionnaire d’un dépeuplement.
Coupée d’un monde qui a peut-être disparu, ou qui a éclaté en îlots isolés les uns des autres – nous n’en saurons rien –, une ville à la minéralité tantôt ferme, tantôt fluide, traversée au sol par un trafic dense, incessant, d’automobiles en mouvement perpétuel, et surmontée d’une épaisse chape de smog crevée de milliers de phares émetteurs, s’apprête à subir le choc d’une gigantesque houle d’asphalte, cataclysme cyclique qui la remodèle à sa guise, engloutissant des édifices, en faisant surgir de nouveaux. Les gardiens de phares communiquent par signaux lumineux, non pour préserver les navires des récifs – nul ne vient plus par la mer –, mais pour diffuser des informations privées, publicitaires ou gouvernementales aux cinq millions d’habitants, ou simplement pour la beauté du geste, pour se sentir exister. Certains phartistes composent des tableaux de lumière, d’autres clignotent de manière incompréhensible en un pseudo morse connu d’eux seuls, d’autres encore se contentent d’apposer sur la ville leur signature photonique. Et les trois phares suréquipés des diffuseurs officiels phagocytent l’espace lumineux, achevant de transformer l’espace en une cacophonie optique :
Notre vide si moderne, la Nappe : ce tissu lumineux entre les phares, toujours changeant. Cet écheveau de faisceaux et de rayons qui se cumulent, rivalisent et s’annulent. Rien de tout ça n’aurait acquis la moindre épaisseur s’il n’y avait la circulation éternelle des voitures au sol, le smog qui en résulte et la bruine. La lumière s’y colle, y prend corps et texture. Et ça donne la Nappe , oui, saturée et surinvestie, notre espace de communication.
Comme l’écrit Bruno Gaultier, l’intuition fondamentale de la nouvelle « est que la surexposition à la lumière n’est pas révélation, mais négation ». Autrement dit, la lumière n’a de sens, ne fait sens, que si elle perce l’obscurité. La métaphore est splendide, ou plutôt : lumineuse… Sur la Toile, mais pas seulement, brillent en effet, comme les phares de Damasio, des feux solitaires dont nous percevons encore les insistants signaux, entre deux éblouissements. Mais l’entropie fait son œuvre. La prolifération métastatique des interconnexions, des hyperrelations, des flux d’information, auxquels contribuent d’ailleurs les phares qui nous sont chers, menace de submerger le monde sensible qui les a vu naître. Quand la lumière aura tout enveloppé, ce sera la fin. Alain Damasio condense cette idée dans une fulgurante dernière phrase : « Quand l’étreinte n’a plus d’air, on dit qu’elle est éteinte ».

Pour Jean-Michel Truong, l’Internet, à l’intersection de la Technique et du Capitalisme, constitue l’embryon du « Successeur », intelligence totalement inhumaine, machinique, que nous croyons maîtriser alors que c’est elle, indubitablement, qui nous manipule – jusqu’à notre élimination mathématique pure et simple. Si la Nappe est une image, superbe, de l’excès d’information, la houle d’asphalte, cette vie minérale qui déferle sur la ville, est alors celle de la déhiscence de la Technique , qui remodèle l’environnement à sa guise. Il y a, chez Damasio, plus qu’une méfiance : une réaction viscérale à l’emprise de la Technique et du Marché qui disjoignent les êtres. C’était patent dans La Zone du Dehors et dans La Horde du contrevent, ça l’est plus encore dans « So phare away ». À la toute fin de la nouvelle, Farrago est trompé par le bruit blanc de la Nappe , voyant le message de Sofia déformé par des relais fantaisistes – du moins est-ce ainsi que j’interprète les dernières lignes...
Comme souvent chez Damasio, un jeu de mot peut en cacher un autre (et peu importe l’intention supposée de l’auteur, qui n’a aucune importance).
Le soir, je regarde les appartements s’éclairer et s’éteindre, sur la centaine d’ouvertures de la façade, c’est parfois joli, souvent dérisoire. Les fenêtres pourraient presque former un code, un code collectif inconscient sur une clef binaire, qui raconterait une histoire différente toutes les nuits, ou un récit évolutif. Une cuisine qui s’allume, une chambre qui s’éteint, et le sens de la phrase pourrait basculer. “Faible” qui devient “Fable” par exemple parce qu’un i saute. Tout sauf i. Tout Sofia… Son manque me troue.
Tout sauf i, tout Sofia – mais pourquoi pas tout sauf I.A. ?... S’il n’a pas dans « So phare away » d’intelligence artificielle à proprement parler, la Nappe comme l’océan d’asphalte sont à l’évidence deux manifestations d’une Technique qui exclut l’homme de son horizon. La mort annoncée de Farrago en est, il me semble, le plus bel exemple. Les personnages damasiens pleurent l’humanité perdue.
« So phare away » oppose la verticalité des phares (l’en haut) à l’horizontalité de l’asphalte (ici-bas). Dans La Zone du Dehors, le signe « > » indiquait un changement de narrateur. Dans La Horde, les glyphes des personnages jouaient le même rôle et permettaient d’identifier leurs voix. Cette fois, chaque changement est introduit par le nom du narrateur (Phareniente, Farrago, Lamproie, Sofia, Faramine…), disposé verticalement, ou horizontalement, selon qu’il se trouve dans un phare ou à l’extérieur (au sol, dans l’eau). Ainsi dans l’extrait qui suit, à un passage dans lequel Faramine parle du haut de son phare, succède le monologue de Sofia, sortie en expédition :
| F A R A M I N E n — | « Sors sur ton balcon et déshabille-toi. Si tu restes nue, éclairée par mon projecteur, pendant cinq minutes entières, je ferais un effort pour ton amie ». Le Régulateur m’a répondu. Je suis furibarde. Il accepte de couper le flux du périphérique dix secondes si je m’exécute. Ce type est un salace, un pervers frustré qui se masturbe dans sa tour en matant les nymphettes à la jumelle, je le sais. Il demande ça à toutes les filles qu’il drague et je ne lui traduis jamais ces messages-là ! Jamais !!! Qu’il aille se faire foutre ! Même pour Sofia, je ne lui cèderai pas ! Fumier ! Salopard de voyeur ! Sodomise-toi profond avec ton phare ! |
— – - S O F I A - – —
Avant d’étouffer, je me suis relevée. Mes cheveux dégoulinent de suie. Flot de voitures toujours aussi rapide et cruel, puant et bruyant. J’essaie de sentir flux et reflux, de viser, je traverse en pensée. Maintenant !… Là ! Je pouvais… Là je suis morte… Là peut-être… ? Non. Sofia, tu peux encore rentrer, reprendre le Giotto à l’envers : survivre.
La version électronique de la nouvelle, sous fichier Word, figurait l’isolement des Liphares et autres Phartistes par des cadres qui entouraient le texte (cf. extrait ci-dessus). Ces cadres, bien sûr, qui renforçaient l’aspect géométrique de la ville, disparaissaient quand les personnages quittaient leur phare. Visuellement, l’effet était impressionnant – on ressentait physiquement la libération de Sofia ou de Farrago. La version imprimée dans Galaxies ne comporte plus les cadres. L’effet est donc moindre, mais reste sensible. Les murs, réels ou artificiels, ne tombent qu’avec la réunion des personnages, avec leur contact physique, leur communication proche, leurs dialogues de vive voix qu’aucune machine ne relaie plus. Tout sauf I.A.
Le monde, dans « So phare away », est assez semblable au cylindre du Dépeupleur, l’un des plus étranges textes de Samuel Beckett. Les deux cents être humain – s’il s’agit bien d’hommes – du cylindre, les habitants de la ville sans nom de la nouvelle de Damasio se meuvent pareillement, selon des règles précises, dans un périmètre limité (là le cylindre, ici la ville), parcourent absurdement les voies qui leur sont réservées ou cherchent une impossible transcendance dans la pure verticalité (au sommet d’échelles réparties sur la paroi du cylindre chez Beckett, dans les phares chez Damasio). Rien ne nous est dit de l’origine du dépeupleur, et il semblerait bien que la clé de l’œuvre réside dans la forme même du discours, froidement scientifique, qui nous décrit cet enfer minimaliste de l’intérieur. Comme Le dépeupleur, « So phare away » est un récit de fin du monde, un Holocauste métaphorique. Il nous relate rien moins que l’extinction de l’homme, enseveli sous sa Créature, symbolisée par l’asphalte et la nappe lumineuse. Mais autant l’œuvre beckettienne est refermée sur elle-même, autant la prose damasienne est ouverte. Dans Le dépeupleur, la règle est absolue et ne saurait être enfreinte, à moins que l’infraction elle-même soit prévue et codifiée, car pour Beckett il n’y a rien à faire. Damasio, en revanche, dont nous connaissons l’engagement politique, croit encore, et avec conviction, à la résistance individuelle et collective. Les voltés de La Zone s’insurgent, les hordiers du contrevent écrivent leur propre trace, les altermondialistes des « Hauts® Parleurs® » contournent les pièges d’un effarant code de la propriété intellectuelle, et les phartistes de « So phare away », voyant leur voix noyée dans la Nappe, bravent les dangers de l’asphalte pour retrouver le contact. Tous échappent, d’une manière ou d’une autre, aux lignes tracées d’avance.
Mais revenons un instant au rôle de la verticalité. Que ce soit dans La Zone (le Cube, la tour d’holovision), dans La Horde (les tours d’Alticcio, la tour d’Ær) ou dans « So phare away », la transcendance n’est jamais accomplie, on ne trouve le salut qu’au sol. L’ascension est en effet toujours suivie d’une chute, et vaut plus par elle-même que par ce qui nous attend au sommet. Ce n’est donc pas une opposition là-haut/ici(-bas) qui intéresse Damasio – sinon d’un point de vue social, avec les racleurs et les tourangeaux d’Alticcio –, mais le chemin qui mène de l’un à l’autre – qui les lie. Il n’y a pas d’Extrême-Amont, est-il répété dans La Horde… Il n’y a pas de jardin d’Éden, sinon son simulacre machinique : ici la lumière (qui n’éclaire plus mais aveugle) et la verticalité sont associées, mais ne mènent qu’aux phares géants de Surville, autant dire à une impasse. C’est la subversion, c’est le péché, qui font l’homme.
Jamais propos plus politique, donc. Sur la Toile, à l’image de la Gouvernance de « So phare away », États et grands groupes commerciaux s’accaparent les meilleurs référencements, et profitent de la saturation pour s’accaparer les nouveaux espaces – nul n’ignore ce qu’est devenue la bande FM, qui regroupait jadis les « radios libres »… Comme dans Bandes alternées de Philippe Vasset, la seule voie est alors celle du hors-piste, de la furtivité. Échapper, à tout prix, aux yeux et aux oreilles de la Machine. Renouer les liens. Se repeupler. « So phare away » annonce vraisemblablement le prochain roman d’Alain Damasio, dont nous connaissons déjà le titre : Les furtifs…