J.G. BALLARD (30/11/2008)

huile sur toile, 147,5 x 89 cm
« Mais ce n’était pas seulement sur le monde extérieur que la douceur du temps répandait les prestiges de tant de charmes neufs et de vertus nouvelles et puissantes : le monde intérieur aussi en était visité et l’âme caressée, surtout à la suave approche des calmes heures du soir ; de même que la glace dessine de préférence ses floraisons et ses arborescences dans le silence des crépuscules, de même la mémoire découvre alors ses cristaux. »
Herman Melville, Moby Dick (texte français par Armel Guerne)
Sans que l’on sache s’il s’agit d’un hasard ou d’une invisible coordination, plusieurs éditeurs mettent en cette fin d’année l’auteur anglais J.G. Ballard à l’honneur, avec de nouvelles traductions (La Forêt de cristal chez Denoël, Le Massacre de Pangbourne, rebaptisé Sauvagerie chez Tristram), le premier tome de l’intégrale des Nouvelles (Tristram) et un recueil d’articles et d’interviews (J.G. Ballard, hautes altitudes, aux éditions è®e). C’est donc en toute logique que le site ActuSF lui consacre aujourd’hui un dossier rassemblant diverses critiques et chroniques signées par Éric Holstein (Millénaire mode d’emploi, Vermilion Sands, La Trilogie de béton), Jérôme Vincent (Le Monde englouti / Sécheresse), Ketty Steward (Le Monde englouti / Sécheresse également) et moi-même.
Tout d’abord, je vous invite dans « Inner Space : J.G. Ballard : Biographie » à un petit survol de la vie et de l’œuvre de celui que l’on surnomme parfois l’Oracle de Shepperton. Extrait :
 Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l’English Cathedral School jusqu’au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l’abri des affrontements. Après l’attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua – au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille –, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s’inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman L’Empire du soleil, adapté à l’écran par Steven Spielberg, et influencera son œuvre spéculative, comme en témoignent ses obsessions pour l’enfermement, les enclaves communautaires (en 1992, Ballard retournera à Longhua, qu’il trouvera inchangé :« Debout entre les couchettes, je compris que c’était là que j’avais été le plus heureux et m’étais senti le plus chez moi, alors même que j’étais un prisonnier soumis à la menace d’une mort prématurée », racontera-t-il dans un texte publié dans le Sunday Times en 1995) et le devenir-banlieue d’un monde civilisé qu’il perçoit comme un camp, lieu entropique aussi riche en menaces qu’en potentialités (l’une de ses premières nouvelles s’intitulera d‘ailleurs « La Villeconcentrationnaire »). « [Les] événements dont Ballard fut témoin, transmis à Jim de L’Empire du soleil, préfigurent les scènes de ses autres fictions fantastiques plus explicites. », écrit Luc Sante.« Les piscines asséchées, les banlieues désertées et les autoroutes vidées de Shanghai mutèrent en monde de dévastation hantant les nouvelles catastrophistes de Ballard ». (cf. J.G. Ballard, hautes altitudes, p. 121)
Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l’English Cathedral School jusqu’au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l’abri des affrontements. Après l’attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua – au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille –, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s’inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman L’Empire du soleil, adapté à l’écran par Steven Spielberg, et influencera son œuvre spéculative, comme en témoignent ses obsessions pour l’enfermement, les enclaves communautaires (en 1992, Ballard retournera à Longhua, qu’il trouvera inchangé :« Debout entre les couchettes, je compris que c’était là que j’avais été le plus heureux et m’étais senti le plus chez moi, alors même que j’étais un prisonnier soumis à la menace d’une mort prématurée », racontera-t-il dans un texte publié dans le Sunday Times en 1995) et le devenir-banlieue d’un monde civilisé qu’il perçoit comme un camp, lieu entropique aussi riche en menaces qu’en potentialités (l’une de ses premières nouvelles s’intitulera d‘ailleurs « La Villeconcentrationnaire »). « [Les] événements dont Ballard fut témoin, transmis à Jim de L’Empire du soleil, préfigurent les scènes de ses autres fictions fantastiques plus explicites. », écrit Luc Sante.« Les piscines asséchées, les banlieues désertées et les autoroutes vidées de Shanghai mutèrent en monde de dévastation hantant les nouvelles catastrophistes de Ballard ». (cf. J.G. Ballard, hautes altitudes, p. 121)
L’essai J.G. Ballard, hautes altitudes, s’intéresse surtout au Ballard visionnaire de la postmodernité. On doit à Bruce Bégout le texte le plus remarquable. Extrait :
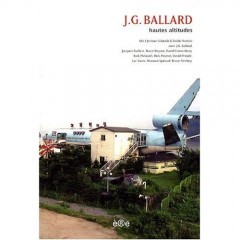 […] dans « Suburbia », lumineux article initialement publié dans le catalogue de l’exposition Airs de Parisdu Centre Georges Pompidou, le philosophe Bruce Bégout, fin observateur de le périurbanisation du monde (lire l’excellent Zéropolis aux éditions Allia), analyse d’abord l’émergence des « sous-villes », c’est-à-dire de ces banlieues décentrées, qui ne sont plus « une simple extension périphérique de la ville », mais « une nouvelle manière de penser et de constituer l’espace urbain », puis tente de la définir par un surprenant poème phénoménologique (extrait :« Nous sommes dans la suburbia là où les parkings désertés constituent des lieux de sociabilité nocturne. / Nous sommes dans la suburbia si un centre commercial représente un pôle d’attraction hebdomadaire dans votre quotidien. »), avant de conclure en beauté avec les visions ballardiennes de cette nouvelle forme d’occupation de l’espace : « L’angoisse de l’homme suburbain devant les espaces infiniment désolés de la banlieue infinie correspond […] traits pour traits au sentiment inquiétant de perte de la position centrale de l’homme dans un monde non géocentrique. La pensée d’errer dans une immensité sans bornes éveille alors une “horreur secrète”, pour reprendre la formule de Kepler. Or, la suburbia n’est plus effectivement un espace centralisé, fini et ordonné, mais l’univers illimité de places disséminées, le continu infini de lieux qui ne sont plus liés par une hiérarchie fixe et immuable. »
[…] dans « Suburbia », lumineux article initialement publié dans le catalogue de l’exposition Airs de Parisdu Centre Georges Pompidou, le philosophe Bruce Bégout, fin observateur de le périurbanisation du monde (lire l’excellent Zéropolis aux éditions Allia), analyse d’abord l’émergence des « sous-villes », c’est-à-dire de ces banlieues décentrées, qui ne sont plus « une simple extension périphérique de la ville », mais « une nouvelle manière de penser et de constituer l’espace urbain », puis tente de la définir par un surprenant poème phénoménologique (extrait :« Nous sommes dans la suburbia là où les parkings désertés constituent des lieux de sociabilité nocturne. / Nous sommes dans la suburbia si un centre commercial représente un pôle d’attraction hebdomadaire dans votre quotidien. »), avant de conclure en beauté avec les visions ballardiennes de cette nouvelle forme d’occupation de l’espace : « L’angoisse de l’homme suburbain devant les espaces infiniment désolés de la banlieue infinie correspond […] traits pour traits au sentiment inquiétant de perte de la position centrale de l’homme dans un monde non géocentrique. La pensée d’errer dans une immensité sans bornes éveille alors une “horreur secrète”, pour reprendre la formule de Kepler. Or, la suburbia n’est plus effectivement un espace centralisé, fini et ordonné, mais l’univers illimité de places disséminées, le continu infini de lieux qui ne sont plus liés par une hiérarchie fixe et immuable. »
Le très remarquable Sauvagerie s’intéresse justement aux prémices de ce glissement suburbain dans l’hyperréalité. Résumé :
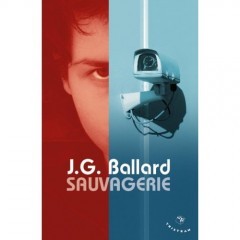 Pangbourne Village est un enclos résidentiel du Berkshire, non loin de Londres. Dix familles aisées – banquier, assureur, courtier en bourse, psychiatre, PDG, anciennes gloires du sport, pianiste de concert et autres riches propriétaires – vivaient dans cette édénique enceinte de seize hectares, surprotégée, clôturée, munie d’alarmes électriques, parcourue par des patrouilles régulières et aux avenues et allées privées surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des caméras vidéo. On y nageait dans un tel bonheur qu’une équipe de la BBC s’apprêtait à y tourner un édifiant documentaire. Alors, comment expliquer l’assassinat de trente-deux personnes (tous les résidents adultes, les gardiens et des membres du personnel domestique), et la soudaine disparition de douze enfants et adolescents ?... C’est ce que cherche à comprendre Richard Greville, consultant psychiatre adjoint mandé par le Home Office, auteur du journal médico-légal que nous lisons. Toutes les hypothèses sont examinées, des moins inconcevables (tueur fou, groupe de déséquilibrés…) aux plus improbables (expédition punitive d’un cartel de drogue, erreur de parachutage d’une unité de commandos soviétiques, chute accidentelle d’un gaz neurotoxique expérimental qui aurait provoqué un dérèglement mental chez les habitants d’une agglomération voisine, manipulation inconsciente par des puissances étrangères, élimination par des extraterrestres en quête de jeunes spécimens humains, parents assassinés par leurs propres enfants…) mais aucune n’est jugée réaliste par les autorités. Deux mois après les événements, la police ignore encore tout de l’identité des coupables, et n’a trouvé aucune trace des enfants kidnappés. Le docteur Greville, chargé du dossier, est d’abord incrédule lui aussi, mais à mesure qu’en compagnie du sergent Payne il s’imprègne de l’atmosphère doucement concentrationnaire de la résidence, il finit par reconstituer les faits, et par entrevoir une vérité extrêmement dérangeante…
Pangbourne Village est un enclos résidentiel du Berkshire, non loin de Londres. Dix familles aisées – banquier, assureur, courtier en bourse, psychiatre, PDG, anciennes gloires du sport, pianiste de concert et autres riches propriétaires – vivaient dans cette édénique enceinte de seize hectares, surprotégée, clôturée, munie d’alarmes électriques, parcourue par des patrouilles régulières et aux avenues et allées privées surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des caméras vidéo. On y nageait dans un tel bonheur qu’une équipe de la BBC s’apprêtait à y tourner un édifiant documentaire. Alors, comment expliquer l’assassinat de trente-deux personnes (tous les résidents adultes, les gardiens et des membres du personnel domestique), et la soudaine disparition de douze enfants et adolescents ?... C’est ce que cherche à comprendre Richard Greville, consultant psychiatre adjoint mandé par le Home Office, auteur du journal médico-légal que nous lisons. Toutes les hypothèses sont examinées, des moins inconcevables (tueur fou, groupe de déséquilibrés…) aux plus improbables (expédition punitive d’un cartel de drogue, erreur de parachutage d’une unité de commandos soviétiques, chute accidentelle d’un gaz neurotoxique expérimental qui aurait provoqué un dérèglement mental chez les habitants d’une agglomération voisine, manipulation inconsciente par des puissances étrangères, élimination par des extraterrestres en quête de jeunes spécimens humains, parents assassinés par leurs propres enfants…) mais aucune n’est jugée réaliste par les autorités. Deux mois après les événements, la police ignore encore tout de l’identité des coupables, et n’a trouvé aucune trace des enfants kidnappés. Le docteur Greville, chargé du dossier, est d’abord incrédule lui aussi, mais à mesure qu’en compagnie du sergent Payne il s’imprègne de l’atmosphère doucement concentrationnaire de la résidence, il finit par reconstituer les faits, et par entrevoir une vérité extrêmement dérangeante…
L’on se rend compte, à lire le premier volume des Nouvelles complètes chez Tristram, qui réunit les textes courts de Ballard de 1956 à 1962, que cette vision lucide mais fascinée du devenir-banlieue du monde, a pris très tôt naissance dans son esprit. Extrait de ma chronique :
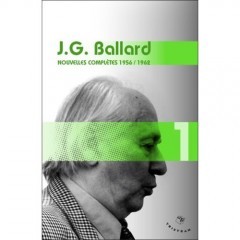 La plupart de ces nouvelles, sans doute marquées par l’internement de Ballard dans un camp de prisonnier japonais en Chine, nous parlent d’une manière ou d’une autre d’enfermement, d’aliénation, d’entropie, de surveillance et de contrôle, mais, comme dans les romans qu’il écrira par la suite, jamais l’auteur de Crash ! ne revendique ni ne dénonce : ce qui l’intéresse avant tout dans l’exercice dystopique – et même cataclysmique –, c’est d’identifier l’impact psychologique des mutations contemporaines (sociales, spatiales, biologiques, technologiques, artistiques ou architecturales) sur les individus. Il nous observe, comme l’étrange personnage du « Dernier monde de monsieur Goddard » (1960) penché au-dessus de son coffre-univers… Inquiet, peut-être ; excité, sûrement. Dès ses premiers textes des années cinquante, Ballard n’a cessé de donner à nos devenirs, aux métamorphoses de notreDasein, de nouvelles images, souvent poétiques, éminemment métaphoriques – et l’on doit ici considérer la métaphore non comme une simple figure de style, non comme l’illustration d’un concept, mais comme un phénomène de pensée poétique, l’expression multivalente, inépuisable, d’une pensée que la raison seule ne peut appréhender, mais qui éclaire une dimension ontologique de l’être. Métaphoriser, pour Aristote, c’est « mettre sous les yeux ».
La plupart de ces nouvelles, sans doute marquées par l’internement de Ballard dans un camp de prisonnier japonais en Chine, nous parlent d’une manière ou d’une autre d’enfermement, d’aliénation, d’entropie, de surveillance et de contrôle, mais, comme dans les romans qu’il écrira par la suite, jamais l’auteur de Crash ! ne revendique ni ne dénonce : ce qui l’intéresse avant tout dans l’exercice dystopique – et même cataclysmique –, c’est d’identifier l’impact psychologique des mutations contemporaines (sociales, spatiales, biologiques, technologiques, artistiques ou architecturales) sur les individus. Il nous observe, comme l’étrange personnage du « Dernier monde de monsieur Goddard » (1960) penché au-dessus de son coffre-univers… Inquiet, peut-être ; excité, sûrement. Dès ses premiers textes des années cinquante, Ballard n’a cessé de donner à nos devenirs, aux métamorphoses de notreDasein, de nouvelles images, souvent poétiques, éminemment métaphoriques – et l’on doit ici considérer la métaphore non comme une simple figure de style, non comme l’illustration d’un concept, mais comme un phénomène de pensée poétique, l’expression multivalente, inépuisable, d’une pensée que la raison seule ne peut appréhender, mais qui éclaire une dimension ontologique de l’être. Métaphoriser, pour Aristote, c’est « mettre sous les yeux ».
L’influence des peintres surréalistes, déjà évidente dans les nouvelles, trouve sans doute sa plus impressionnante expression dans Le Monde englouti et, surtout, dans ce magnifique et très étrange roman qu’est La Forêt de cristal. Extrait de ma critique :
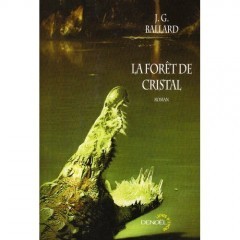 Si le roman, lumineuse inversion de Au cœur des Ténèbres, est traversé par maintes oppositions – chaque personnage semble avoir son double –, par maints contrastes propices à de splendides descriptions rappelant les plus belles toiles de Max Ernst, il est cependant rétif à toute interprétation morale. Port Matarre et le reste du monde sont comparés au purgatoire, c’est-à-dire à l’antichambre purificatrice de l’au-delà, mais comme souvent chez Ballard, nous sommes par-delà le bien et le mal : ombre et lumière ont ici un sens propre à Sanders. L’ombre : l’extérieur. Dans cette « zone grise de pénombre », si terne comparée à la forêt efflorescente – la lumière –, qui brille de mille feux au point que tous ceux qui la contemplent en sont bouleversés, hors du cristal donc, Suzanne n’est pas. Suzanne est la clé de voûte du récit.
Si le roman, lumineuse inversion de Au cœur des Ténèbres, est traversé par maintes oppositions – chaque personnage semble avoir son double –, par maints contrastes propices à de splendides descriptions rappelant les plus belles toiles de Max Ernst, il est cependant rétif à toute interprétation morale. Port Matarre et le reste du monde sont comparés au purgatoire, c’est-à-dire à l’antichambre purificatrice de l’au-delà, mais comme souvent chez Ballard, nous sommes par-delà le bien et le mal : ombre et lumière ont ici un sens propre à Sanders. L’ombre : l’extérieur. Dans cette « zone grise de pénombre », si terne comparée à la forêt efflorescente – la lumière –, qui brille de mille feux au point que tous ceux qui la contemplent en sont bouleversés, hors du cristal donc, Suzanne n’est pas. Suzanne est la clé de voûte du récit.
Ainsi la cristallisation – célébration finale de l’eucharistie selon le père Balthus – est-elle émanation de l’esprit de Sanders, réification dans le réel diégétique de ses désirs de repli fœtal, de paix et d’amour éternels (l’écriture de La Forêt de cristal coïncide avec la mort de la femme de Ballard en 1964, d’une pneumonie...). Désirs de communion, si l’on veut : la forêt (Jardin d’Éden chatoyant – l’auteur n’évoque-t-il pas des souvenirs archaïques ?) devient une Église où chacun est uni dans le corps mystique du Christ – ou de l’univers – ; où chacun rejoint le Royaume de Dieu après son passage dans le purgatoire du réel.
Et lorsque vous aurez lu cette critique de La Forêt de cristal ou, mieux, le roman lui-même, vous comprendrez pourquoi les quelques lignes de Moby Dick lues l’autre soir, et placées ici en épigraphe, ont puissamment résonné avec ma fibre ballardienne.
18:23 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ballard, critique littéraire, littérature, forêt de cristal, sauvagerie, nouvelles, actusf |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Vraiment intéressant ton papier, cela fait quelque temps déjà que j'entends citer Ballard à droite à gauche, à la longue ça me met la puce à l'oreille.
Écrit par : Guit'z | 04/12/2008
Excellents articles.
Je me suis vraiment régalé avec toute cette actualité ballardienne, et je salive déjà pour le deuxième tome de l'intégrale des nouvelles...
Écrit par : Nébal | 13/12/2008
Merci Nébal (tes articles sur les mêmes livres sont pas mal, eux aussi, mais ne va pas le répéter, surtout). Ouaip, vivement la suite des nouvelles.
Écrit par : Transhumain | 13/12/2008
A mon avis J.G. Ballard est le plus original des auteurs britanniques de science et d'anticipation sociale anglais.Il me semble que l'œuvre de Ballard est étrange et sophistiquée . Il explore la face sombre des citadins des grandes mégalopoles.Il decrit de personnages en apparence normaux, cadres supérieurs, gens policés. J'adore son oeuvre surtout son roman "La Forêt de cristal"
Écrit par : stop smoking blog | 03/03/2009