
Rechercher : L'homme qui mangait
-
Au cœur de Ténèbres - 13 - Frustration
« Le désir du spectateur est le ressort principal de Ténèbres. Au cours des projections, quand Daria sort de la voiture pour retourner à la maison où tout semblait être fini, j’ai constaté que le public devenait hystérique. Il crie, bat des mains, hurle qu’elle va être tuée. En fait il ne cherche pas à la prévenir. Il désire ardemment ce qui va suivre… » Dario Argento in Starfix n°5, juin 1983. Dario Argento, nous l’avons vu, a sciemment construit son film comme une « messe d’un rite antique », comme un spectacle cathartique. Le spectateur y projette ses désirs et le film devient alors l’accomplissement, ou plutôt la représentation de l’accomplissement, de ces désirs. Or en vérité, le phénomène psychique le plus apte – le plus naturel du moins – à réaliser cette tâche, a priori, n’est pas le cinéma mais le rêve. Avant d’étudier la place du désir dans Ténèbres, il convient donc de rappeler avec concision ce que Freud entendait par le « travail du rêve » dans sa Traumdeutung [49]. Rappelons que le rêve a toujours été une abondante source d’inspiration pour Argento, qui avoue en tirer certains thèmes ou motifs de ses films – avec Bertolucci, Fellini et d’autres, les années soixante-dix ont vu naître un intérêt certain pour l’onirisme. C’est avec Suspiria en 1977 et surtout Inferno en 1980 que Dario Argento expérimente au plus près le « film-rêve » : incohérence apparente du récit, leur hypnotisme lancinant, évident rôle d’exutoire… Jean-Pierre Putters a parlé de « caméra automatique » pour décrire le processus filmique à l’œuvre dans ces deux films, qui s’adressent directement à l’inconscient. A cet égard Ténèbres, qui jouit de l’expérience du réalisateur en la matière, est à mon sens son film le plus abouti. Sigmund Freud a tenté, dans L’Interprétation des rêves, de décomposer les différentes phases du processus du rêve. Il distingue d’abord entre le contenu manifeste du rêve et son contenu latent. Le contenu manifeste, pour simplifier, est l’histoire vécue en songe telle qu’on peut la raconter au réveil – il est souvent composé de scènes absurdes où l’on retrouve des éléments des jours précédents ou des souvenirs très anciens. Le contenu latent est le discours « réel » du rêve, celui qui se dissimule derrière les apparences. Freud soutient que tout rêve, même un cauchemar, est l’accomplissement d’un désir. Selon lui chaque élément manifeste masque un ou plusieurs éléments latents en rapport direct avec le désir inconscient du rêveur. Ces désirs inconscients, selon le psychanalyste viennois, ne sont jamais très « moraux » puisque, libérés des barrières et tabous de l’éveil, ils n’obéissent à aucune convention sociale. Ainsi pour atteindre le domaine conscient – nous percevons en effet consciemment le contenu manifeste du rêve –, ces désirs doivent contourner « l’instance de censure », appareil psychique gardien de la conscience. Pour cela, ils sont soumis au « déplacement » des intensités psychiques, c’est-à-dire une transformation de l’idée initiale qui la rend alors acceptable aux yeux de la censure, avant de subir une « condensation », opération qui permet au rêve de concentrer ses idées pour les rendre plus fortes (la condensation ne serait alors que la conséquence du déplacement). Selon Freud le rêve, accomplissant les désirs inconscients du rêveur, jouerait le rôle de soupape de sécurité empêchant à la fois le refoulement perpétuel (qui conduirait à la folie), et la réalisation matérielle de ces désirs le plus souvent amoraux. La similitude avec la sublimation artistique ne vous aura pas échappé : c’est dire combien l’art et le rêve sont inextricablement liés (voir les films de Bergman, Buñuel et consort). Argento reproduit pourtant scrupuleusement avec Ténèbres, au moyen du seul langage cinématographique, le schéma résumé ci-dessus du travail du rêve. Il est certes difficile d’exhumer le désir inconscient à l’origine de la forme du film, puisqu’il s’agit de celui d’un personnage fictif, mais on a vu que le complexe de castration pouvait être considéré comme fortement impliqué dans le comportement des tueurs : on peut alors penser que le désir latent du film « rêvé » par Neal découle directement de cette angoisse [50] – je ne confonds pas le film, évidemment, avec un rêve qu’il n’est pas : je cherche seulement à déterminer selon quelle logique, selon quelle structure, quel système, le cinéaste a construit son film. Si l’on s’en tient strictement au récit – c’est-à-dire aux actions et non à leur représentation esthétique –, le complexe de castration est surtout visible lors des scènes de meurtre : l’égorgement d’Elsa Manni, de Tilda et de son amante, l’étranglement de Gianni, le démembrement de Jane McKerrow, et l’auto-égorgement factice de Peter Neal, qui finit empalé par un cône métallique. L’assassin, par son acte, tente désespérément de recouvrer quelque chose (pénis ? puissance sexuelle ?). Les rapports non liés dans le sang véhiculent néanmoins le même désir, la quête d’un objet perdu. Elsa Manni fait des avances au surveillant pour échapper à son ire, mais celui-ci sera finalement frustré puisque la jeune fille meurt peu après – le clochard vicieux aux tendances agressives et scoptophiles verra également ses espoirs misérables anéantis. Le cadeau promis à Anne par l’écrivain a été détruit à New York – Anne ne l’aura pas – ; quant à leur supposée nuit d’amour, nous avons vu qu’elle n’était sans doute que pure virtualité. Tilda et sa compagne nouent des relations assez tendues en raison de désaccords sexuels : Tilda est lesbienne et son amie bisexuelle : aux yeux de cette dernière, il manque à Tilda un pénis, et inversement, Tilda se trouve impuissante face à ce vide qu’elle ne peut combler. En photographiant ses victimes, Berti veut conserver cet instant fugace de beauté, lorsque le sang est encore vif et les yeux brillants. Jane McKerrow elle-même est une figure du manque : Neal ignore si elle se trouve à New York ou bien à Rome, et leurs rapports restent très obscurs… Elle le trompe d’ailleurs avec Bullmer, l’agent de l’écrivain... Ténèbres n’est ainsi fait que de frustrations, de désirs inassouvis, interrompus ou aliénés. L’inspecteur Giermani, dont le désir premier est bien entendu de résoudre l’enquête, est lui-même frustré plus qu’à son tour : il découvre trop tard la réalité de la culpabilité de Peter Neal et se fait berner par le faux suicide ; même son assistante voit son espoir déçu lorsqu’elle apprend avec humour que l’homme qui vient de lui signer un autographe n’est pas… Yves Montand ! Comme tous les autres – à l’exception notable d’Anne –, l’inspecteur Altieri finira assassinée… [49] S. Freud, L’Interprétation des rêves (PUF, 1987). [50] Il est d’ailleurs écrit dans le Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis, à propos du complexe de castration, que « […] ses modalités sont repérées dans l’ensemble des structures psychopathologiques, en particulier dans les perversions (homosexualité, fétichisme). » (p.75.).
-
Et Expecto - 5 - Sui Generis
 Ma mère s’appelle Annie Weber, épouse Klossowski, et vit aujourd’hui recluse dans une modeste maison du Beaujolais, maison hantée par le souvenir de Roland qui y vécut avec elle vingt longues années de routine ménagère.
Ma mère s’appelle Annie Weber, épouse Klossowski, et vit aujourd’hui recluse dans une modeste maison du Beaujolais, maison hantée par le souvenir de Roland qui y vécut avec elle vingt longues années de routine ménagère.
Les photographies en noir et blanc de leur mariage préhistorique, exposées dans les escaliers en bois usé ; les dizaines de pipes de toutes formes, alignées sur les étagères du living et exposées aux murs, collectionnées par mon père au fil des ans ; cette odeur indéfinissable, si tenace, que des années d’aération quotidienne n’ont pas réussi à éradiquer et que j’associe irrémédiablement à la vieillesse, à la maladie et à la mort ; ces bibelots par centaines, champignons parasites recouvrant chaque centimètre carré de surface plane ; cet énorme et antédiluvien écran de télévision trônant tel un tyran débonnaire en face de la cheminée condamnée, branché en permanence sur des Krimis, séries policières allemandes diffusées en boucle par les chaînes hertziennes et numériques durant les après-midi en semaine ; cette cuisine éreintée dont les divers éléments scarifiés par le temps sont recouverts d’une couche de poussière tellement épaisse qu’elle a fini par former une pellicule graisseuse indélébile ; cette salle de bains encore, où des peignoirs défraîchis se laissent pendre sur des cintres négligemment accrochés à la porte tels les mues chitineuses des fantômes d’une vie passée, exsudant la mort et le chagrin comme ces sous-vêtements baignant dans l’eau froide du lavabo écaillé, vestiges informes d’une jeunesse depuis longtemps révolue : tous ces fragments de la vie d’Annie semblent appartenir à une autre époque.
La maison où vit aujourd’hui ma vieille mère a des accents d’Henry James à mes yeux. Si selon la médecine clinique ma mère a encore de longues années devant elle, je devine que plus rien ne la retient désormais dans ce monde-ci, pas même moi, Hugo, son enfant chéri, car Roland avait été son compagnon de toujours, son unique amour et son seul horizon, tandis que je ne représente qu’un don certes divin mais incidemment apparu en son sein.
L’existence, pour ma mère, se résumait à Roland, c’était ainsi, inexplicablement, et c’est encore ainsi, et ce sera toujours ainsi par-delà la mort et l’oubli.
Une fois son mari disparu, Annie s’est mise à évoluer dans un plan intermédiaire, comme une figure cinématographique prisonnière de la toile, à la fois réitération du Réel et fiction vaporeuse, rose pourpre à jamais flétrie. Sa flamme vitale est à présent de plus en plus ténue, vacillante, et même si son corps fatigué refuse encore de céder à la Seconde loi de la Thermodynamique, de payer ce prix que la Faucheuse lui réclamera sans coup férir, pour moi elle est déjà morte, de l’autre côté du miroir.
Annie, ma mère, maman, cette sexagénaire déjà vieille et amorphe oscillant sur son fauteuil à bascule dans sa maison vétuste du Beaujolais, ne ressemble en rien, et n’a jamais ressemblé de près ou de loin, à la muse désincarnée de l’affiche grand format que j’examine sur le quai du métro. Elle n’y ressemblera jamais. Elle va dépérir, puis mourir, puis pourrir, et ne subsister, peut-être, que sur un autre plan de réalité. Annie était avant tout une femme d’intérieur à la silhouette pas exactement disgracieuse, mais trop grasse et dénuée de charisme, bonne mère, bonne épouse et maîtresse de maison convenable, seulement un peu trop protectrice peut-être.
C’était.
Je pense à elle au passé. A trop être couvé, on finit par se casser les ailes dit-on parfois. Je n’ai jamais pardonné à ma mère le naufrage de mon adolescence – je ne pardonne jamais. Toujours à la traîne des modes, ignorant des us et coutumes de l’amour, de la séduction, du sexe et de la domination, je traînais mon corps de pantin étique et dégingandé comme une ombre inopportune et encombrante, mal à l’aise dans mes vêtements ringards, vite élimés, trop courts et bon marché. Mes parents me surnommaient « l’invertébré », inconscients des blessures qu’ils infligeaient. Mon corps décharné n’était pas sans analogie avec un exosquelette sculpté par le fantôme d’Alberto Giacometti. Mes côtes apparentes et mes yeux globuleux me faisaient ressembler à ces morts-vivants des camps de concentration que j’avais vus à la télévision, à l’aune desquels j’avais nourri mon imaginaire et auxquels je m’identifiais en secret, rejeté comme eux par mes congénères, voué comme eux à m’effacer anonymement, à partir en fumée, à venir polluer les poumons des survivants sous forme de particules éparses.
Sous forme de poussière.
Au collège, les garçons plus durs, plus forts, plus beaux, me houspillaient à chaque interclasse : coups de coude dans les côtes, coups de poing dans le dos et crocs-en-jambe étaient mon pain quotidien, sans compter les quolibets en tous genres ; à croire qu’un facétieux Antéchrist s’était amusé à multiplier les brimades à seule fin de railler la légendaire bonté du Fils de l’homme et de ses ridicules bons sentiments.
Je n’étais pas le bouc émissaire de la classe pourtant, ce rôle peu enviable étant en réalité dévolu à Nicolas J., pauvre gamin trop petit et l’air pas assez éveillé, les yeux déformés par les verres les plus épais qu’il soit possible de porter. Tout le monde l’appelait « Crâne d’œuf ». J’étais compatissant, je ne comptais pas parmi ses persécuteurs les plus acharnés, même si je m’autorisais parfois quelque flèche mesquine pour faire bonne figure auprès des mâles dominants et des filles, pour m’intégrer. Je n’en retirais aucune satisfaction, aucune honte, seulement du dégoût. La lâcheté n’était pas alors le moindre de mes attributs. Le fait de côtoyer un adolescent plus misérable que moi ne me permettait même pas de savourer l’exaltation propre à l’expérience du martyr.
Tel un Paul Muad’Dib rachitique mais doué de prescience et d’une incroyable volonté de puissance, je savais alors avec une absolue certitude que je saurais un jour dominer mes insouciants tortionnaires, maîtriser mes semblables co-sentients, devenir Dieu.Or des années plus tard, sur les bancs polis par des générations de postérieurs estudiantins à la faculté de lettres de Paris III, je découvris les travaux de Friedrich Nietzsche en même temps que mes premières expériences sexuelles. La naissance de la tragédie, Humain, trop humain, Ainsi parlait Zarathoustra, Le crépuscule des idoles et L’Antéchrist façonnaient mon esprit de glaise et de feu tandis que mon corps inexpérimenté s’ouvrait à des sensations inconnues, jouet inconscient des ordres chimiques impulsés par un ADN trop heureux de s’exercer enfin à son unique objectif : la perpétuation de l’espèce. -
Retour sous l'horizon, 2 : intermède théorique
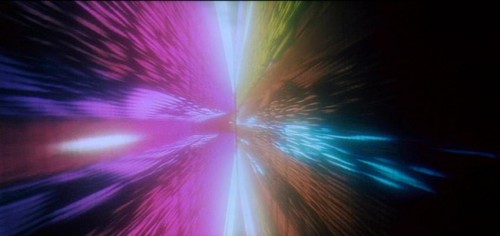
« Percevoir, c’est engager d’un seul coup tout un avenir d’expérience dans un présent qui ne le garantit jamais à la rigueur, c’est croire à un monde. » (Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception)
J'ai sérieusement mis en doute dans mon introduction l'hypothèse de Serge Lehman selon laquelle le déni de la SF par les élites serait étroitement lié à sa teneur métaphysique ; ainsi pour moi, la seule SF authentiquement métaphysique est celle qui établit, à l'image du fantastique borgésien, « que la réalité du monde est une hypothèse indécidable » [1] mais cette science-fiction-là – celle de Philip K. Dick par exemple –, qui s'enracine dans une faille de la logique, dans un paradoxe, n'est peut-être pas de la science-fiction à proprement parler puisqu'elle postule notre monde réel comme avatar ou fiction où prolifèrent les doubles, « virtualités éléatiques de l'être » [2]. Et si l'émotion littéraire naît du peuplement des intervalles, de l'installation d'une continuité « là où est donnée la seule succession d'éléments discrets » [3], le sense of wonder naît lui de la fonction W, du peuplement de la faille qui sépare irrémédiablement, dans la diégèse, un fait ou un concept métaphysique (une altérité radicale) de notre connaissance immédiate du monde. Gilbert Hottois, dans Philosophie et science-fiction, exprime une idée qui n'est pas sans rapport avec notre hypothèse : « À l’idée du sublime, la technoscience procurerait les moyens opératoires de sa réalisation. Et la transcendance devenue opératoire entre les mains de l’homme susciterait l’émotion d’un sublime renouvelé et radicalement ambivalent : de l’effroi absolu qui anéantit à l’enthousiasme infini qui rapproche des dieux » [4] ; ce transfert du sublime aux sciences et techniques commencerait avec Frankenstein de Mary Shelley, et connaitrait son sommet avec 2001 : A Space Odyssey de Stanley Kubrick. La science-fiction serait alors la fictionnalisation de ce surgissement du sublime... L'une des cause du déni – ou de l'incompréhension ? – pourrait être la forme de pensée spécifique que produisent les littératures de l'imaginaire, et en particulier la science-fiction...
Serge Lehman estime que le propre de la SF – mais aussi, doit-on ajouter, de la fantasy et du fantastique – est de prendre ses métaphores au pied de la lettre. Le concept réifié, c'est-à-dire métamorphosé en image, n'est plus un concept. L’image est considérée comme réelle, et le monde devient métaphore de l’image… « La métaphore n’est pas pour le vrai poète une figure de rhétorique, mais bien une image substitutive, qui plane réellement devant ses yeux, à la place d’une idée. » [5] « Et la science-fiction, c’est peut-être cette jouissance-là : la parole sans le savoir. Le monde sans autre connaissance que celle qu’il rêve. Celle de l’Autre. » [6] Ainsi la SF ne pense pas par concepts, mais par matrices d'idées, vivier foisonnant pour qui s'en donne la peine, mais follement intimidant pour celui qui n'en connaît pas la langue. La pensée de la science-fiction est une pensée non articulée, non conceptualisée, une pensée hallucinée, qui permet de faire l'expérience immédiate de l'intellection ; c'est un langage vrai, extravagant. La science-fiction métaphorise, c'est-à-dire qu'elle immanentise le sens (selon une formule employée un jour par Bruno Gaultier) dans la diégèse (inventer le monde plutôt que le parodier, appelait de ses vœux Aragon dans Blanche). Et comme le rappelle opportunément Shalmaneser dans Lehman Brothers, 2 : La température d'un dieu, « toute oeuvre de fiction repose sur une « feintise » : l’auteur fait comme s’il produisait un discours sérieux, un authentique acte de langage, et nous acceptons de nous prêter à ce jeu innocent, le temps de la lecture. » La conception de l'herméneutique selon Gadamer, puis Ricoeur (il ne s'agit jamais de retrouver une intention originelle, inaccessible, mais d'interpréter les métaphores à l'aune de sa propre expérience, c'est-à-dire de produire du sens ; la vérité d'un texte est toujours à son aval) paraît s'appliquer plus qu'à tout autre genre aux littératures de l'imaginaire : par l'effet-miroir de leurs mondes fictifs, elles nous confrontent à notre nature de métaphores réifiées, êtres, lieux, événements jamais univoques, absurdes sur un plan téléologique – l'univers n'a pas de sens –, mais riches d'univers entiers de sens. Et c'est par cette forme particulière de pensée, métaphorique, qui nous renvoie directement à notre être au monde, à notre expérience sensible du réel, que la science-fiction, avec ses mondes rationnels et techniques, part à l'abordage du sublime. En dernière analyse, la science-fiction n'est pas à proprement parler une littérature métaphysique (la réification enlève son méta à ce qui devient physique), mais une littérature où dans ses formes les plus abouties, lorsque, à la face des métaphores réifiées et des objets techniques, surgit le vortex – la grande idée métaphysique qui, elle, ne se laisse jamais totalement réifier (Dieu, le Trou Noir, l'Infini, etc.), l'Altérité absolue que les objets techniques sont impuissants à circonscrire, – se rejoue sans cesse notre rapport intime au sublime. Car in fine, l'immanence est l'essence de la transcendance [7].
Nous sommes tous Dave Bowman devant le monolithe noir, près de Jupiter et au-delà.
[1] S. Thorel, « Borges, Achille et la Tortue » in Borges, souvenirs d'avenir, Gallimard, 2006, p. 217.
[2] Ibid., p. 199.
[3] Ibid., p. 211
[4] G. Hottois, « Science fiction et philosophie : une introduction » in Philosophie et science-fiction, Vrin, 2000, p. 11.
[5] F. Nietzsche, La Naissance de la tragédie in « Œuvres complètes », T.1, p. 61.
[6] J. Lacan in L’effet science-fiction, R. Laffont, « Ailleurs & Demain », 1979, p. 281.
[7] Sainte Jeanne, saint Serge, vous avez bien fait d'attendre avant de m'occire ! Mais rendons-nous à la triste évidence : pour une véritable histoire métaphysique de la science-fiction, il nous faudra attendre que Bruno Gaultier, alias Systar, auquel je dois – ainsi qu'à la caféine et au houblon – quelques unes des idées exprimées ici, s'y colle une bonne fois pour toutes.
-
La cité nymphale de Stéphane Beauverger, Phago[cité] de Hint
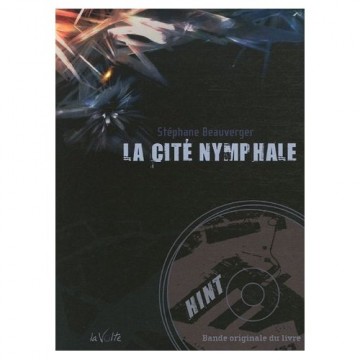
« Ceci est l’instant de notre épiphanie. Ici s’élève notre cité nymphale. »
Les éditions la Volte, auxquelles nous devons la publication d’un chef d’œuvre, La horde du contrevent d’Alain Damasio (que j’évoquais en juin 2005 chez le Stalker), ont depuis entrepris la publication des romans inclassables de Jeff Noon (Vurt et Pollen, bientôt suivis par d’autres inédits), et nous ont fait découvrir un jeune écrivain prometteur, auteur d’une excellente trilogie d’anticipation, Stéphane Beauverger. Il y a tout juste un an, je vous parlais avec enthousiasme de Chromozone et des Noctivores, les deux premiers tomes du triptyque, dont le dernier volet, La cité nymphale, est paru en novembre 2006. Le silence insistant de la presse et des webzines critiques me plonge dans des abîmes de perplexité. Certes, nous allons y revenir, La cité nymphale ne constitue pas le paroxysme attendu, le feu d’artifice final espéré, l’apocalypse désirée. Mais elle ne méritait certainement pas telle inattention. Doit-on incriminer les fêtes de Noël ?... La surcharge de travail des critiques ? Une méfiance illégitime envers un éditeur qui avait d’emblée placé la barre très haut ? Mystère. Toujours est-il que La cité nymphale existe et, en dépit des réserves que je vais vous livrer dans un instant, mérite d’être lue. Non seulement lue, mais encore, écoutée. Et même, pour une fois, regardée : les explosions de lumière sur fond noir de la couverture – conçue par la graphiste Corinne Billon – sont tout simplement superbes. Entre nous, ça nous change du tout-venant de l’illustration SF, mais les couvertures des deux volumes précédents, réalisées par la même graphiste, n’étaient pas moins réussies – la Volte sait y faire.
 Quant au CD qui accompagne le roman, il est l’œuvre d’un groupe que je croyais disparu, Hint, dont j’avais écouté un excellent album il y a déjà de longues années. Leur musique, tour à tour abrasive et éthérée, électrique et planante, ne craint pas d’emprunter à tous les genres pour construire un univers d’une cohérence et d’une intensité rares, plutôt inattendues dans le cadre de la « bande originale » d’un roman d’anticipation. À son écoute, c’est tout un pan de ma discothèque idéale qui défile. Ici, un écho de Painkiller, voire de Naked City, avec le clone du saxo mutant de John Zorn. Là, le fantôme ambient de la drum and bass étouffante du meilleur Scorn, Evanescence. De loin en loin, des constructions presque post-rock qui pourraient évoquer Mogwai ou Mono, si elles n’étaient empoisonnées par un spleen industriel aux riffs décharnés, descendants de Neurosis, Pitchshifter ou Godflesh. À l’horizon, bizarrement précédé d’un titre à la Ministry période Psalm 69, je discerne les bribes d’un chant tibétain ou mongol, ainsi que la silhouette de Michael Gira, dont les Swans sont pourtant bien morts, mais dont les glauques expérimentations nous hanteront à jamais (je vous parlerai un jour de son recueil de nouvelles, La bouche de Francis Bacon, sans doute l’œuvre littéraire la plus tourmentée, la plus violente qui soit). « Eyes in axis (diaphonic interferences mix) », treizième titre de ce CD qui en compte vingt-trois, tiré de l’album 100% white puzzle mais largement modifié, en constitue le point d’orgue, tour à tour calme, dépressions électriques sur un tempo trip-hop, puis corrosif, déchiré par un hurlement libérateur et des riffs assassins, avant de nous renvoyer au royaume du delirium tremens. Bref, Phago[cité], l’album de Hint enregistré pour La cité nymphale, est l’un des meilleurs CD de l’année. En ce qui me concerne, l’écoute du CD et la lecture du roman n’ont pas coïncidé, chronologiquement parlant. Pour m’immerger dans les aventures de Cendre, Gemini et consort, j’avais choisi le métal instrumental de Pelican, le doom-drone maladif et shoegaze de Jesu, le post-rock dramatique de Godspeed You Black Emperor! (Moya) et le doom expérimental du Black one de Sunn O))) (imaginez des démons black metal psalmodiant leurs malédictions d’outre-tombe sur des riffs d’une lenteur extrême soutenus par les nappes ambient d’un Otomo Yoshihide)…
Quant au CD qui accompagne le roman, il est l’œuvre d’un groupe que je croyais disparu, Hint, dont j’avais écouté un excellent album il y a déjà de longues années. Leur musique, tour à tour abrasive et éthérée, électrique et planante, ne craint pas d’emprunter à tous les genres pour construire un univers d’une cohérence et d’une intensité rares, plutôt inattendues dans le cadre de la « bande originale » d’un roman d’anticipation. À son écoute, c’est tout un pan de ma discothèque idéale qui défile. Ici, un écho de Painkiller, voire de Naked City, avec le clone du saxo mutant de John Zorn. Là, le fantôme ambient de la drum and bass étouffante du meilleur Scorn, Evanescence. De loin en loin, des constructions presque post-rock qui pourraient évoquer Mogwai ou Mono, si elles n’étaient empoisonnées par un spleen industriel aux riffs décharnés, descendants de Neurosis, Pitchshifter ou Godflesh. À l’horizon, bizarrement précédé d’un titre à la Ministry période Psalm 69, je discerne les bribes d’un chant tibétain ou mongol, ainsi que la silhouette de Michael Gira, dont les Swans sont pourtant bien morts, mais dont les glauques expérimentations nous hanteront à jamais (je vous parlerai un jour de son recueil de nouvelles, La bouche de Francis Bacon, sans doute l’œuvre littéraire la plus tourmentée, la plus violente qui soit). « Eyes in axis (diaphonic interferences mix) », treizième titre de ce CD qui en compte vingt-trois, tiré de l’album 100% white puzzle mais largement modifié, en constitue le point d’orgue, tour à tour calme, dépressions électriques sur un tempo trip-hop, puis corrosif, déchiré par un hurlement libérateur et des riffs assassins, avant de nous renvoyer au royaume du delirium tremens. Bref, Phago[cité], l’album de Hint enregistré pour La cité nymphale, est l’un des meilleurs CD de l’année. En ce qui me concerne, l’écoute du CD et la lecture du roman n’ont pas coïncidé, chronologiquement parlant. Pour m’immerger dans les aventures de Cendre, Gemini et consort, j’avais choisi le métal instrumental de Pelican, le doom-drone maladif et shoegaze de Jesu, le post-rock dramatique de Godspeed You Black Emperor! (Moya) et le doom expérimental du Black one de Sunn O))) (imaginez des démons black metal psalmodiant leurs malédictions d’outre-tombe sur des riffs d’une lenteur extrême soutenus par les nappes ambient d’un Otomo Yoshihide)…Revenons à la littérature à présent, et faisons le point. Chromozone plantait le décor de la trilogie. L’avenir proche de la France, cauchemardesque. Les « nouvelles » technologies anéanties par un mégavirus qui, par-dessus le marché, s’attaque aussi à l’homme, exacerbant ses pulsions de mort, transformant l’individu lambda en foutu berserker. Le pays divisé en territoires communautaires férocement gardés. Tuer pour survivre. Leitmotiv : « il n’y a plus de place en ce monde pour la bêtise ». Chromozone nous bombardait d’idées – dont la moindre n’était pas Khaleel, l’un des plus fantastiques personnages de la science-fiction moderne, mais citons aussi la faction Orage et le système de communication phéromonique –, multipliait les registres, nous baladait de camps de prisonniers en Bretagne en réunions au sommet du pouvoir économique, avec un sens du rythme et de l’action digne des premiers Dantec. Les Noctivores surprenait moins par sa forme, mais lesdits Noctivores, entité collective réunissant des milliers d’individus au prix de leur individualité, constituaient à eux seuls une putain d’idée. Leitmotiv : « il est peut-être temps d’en finir avec la violence ». Voici ce que j’écrivais à la fin de ma critique : « L’enjeu du triptyque est ainsi le choix impossible que l’humanité s’apprête à faire malgré elle, et auquel nous confrontent tous les grands romans d’anticipation : soit nous suivons la voie de la déshumanisation, la servitude volontaire, l’engloutissement dans la Machine-Monde qui caractérise l’Occident moderne, soit nous lui résistons, l’arme au poing, au risque du terrorisme et de la barbarie – mais avec l’espoir d’une illumination. Combattre le Mal par le Mal, ou épouser sa cause... Comme pour Dantec, le salut n’est ici sans doute possible que par un inflexible réenchantement du monde. » En finir avec la violence, au prix de notre humanité ?... Il semble que je me sois trompé, du moins en partie. Nous y reviendrons.
Ce réenchantement, pour Beauverger, ne passe pas par la religion – l’Église est souvent moquée, voire conspuée dans La cité nymphale (ah, que j’aurais aimé écrire, le premier, un blasphème comme : « L’enculée conception » !). Il ne passe pas non plus, ou si peu, par la littérature. Certes la Parispapauté est installée dans les bâtiments hideux de la Grande Bibliothèque de Tolbiac, et Cendre, personnage principal du roman, découvre ou redécouvre ce que nous transmettent les grands écrivains – il relit par exemple Moby Dick (version Giono ; je ne saurais trop vous encourager à découvrir la traduction d’Armel Guerne, infiniment plus puissante). Mais le verbe, pour Stéphane Beauverger – qui d’ailleurs préfère travailler le rythme du récit plutôt que la musique d’une phrase –, n’est pas une réponse en soi. Il n’est pas lumière. Il n’est pas feu. Il est moyen de communication, tisseur de liens. La réponse, c’est l’amour, la réponse, c’est l’éthique. Le salut par l’amour, et par l’éthique. S’il fallait ne retenir qu’un mot du roman, ce serait celui-là. Éthique.
Il n’y a que peu d’idées nouvelles dans La cité nymphale, qui se contente pour l’essentiel de dévider les bobines déjà employées dans les tomes précédents. Le parcours de Gemini sur un rivage désert, en compagnie d’un jeune Moken nommé Salamah, qui attend de pouvoir enfin rencontrer celle qui est à l’origine du cataclysme Chromozone, n’a que peu d’intérêt et, si l’on excepte la pirouette finale qui pourrait éventuellement laisser la porte ouverte à une suite, les révélations obtenues en fin de parcours ne font que confirmer ce que nous pressentions déjà : le virus peut être vaincu par une volonté de fer. Cette histoire de virus commençait d’ailleurs à me chiffonner. Le Chromozone était à la fois omniprésent, car à l’origine de cette France post-apocalyptique, et étrangement absent, n’influant finalement que modérément sur les comportements des personnages infectés. Le virus n’est qu’un leurre, un alibi, un révélateur. Bref, rien de neuf. Et les aventures de Lucie au pays de Keltiks, si elles démontrent une nouvelle fois le talent de Beauverger pour l’action menée tambour battant, n’apportent pas non plus d’éléments déterminants. On est en terrain connu. La source se tarit. L’ennui guette.
Il en est une d’idée, cependant, qui doit retenir l’attention du critique, comme celle du lecteur. Une idée forte, qui conditionne la construction du récit et les choix de l’écrivain. Cette idée, la voici : l’entité noctivore évolue, s’émancipe du joug de son créateur Peter Lerner, et développe une intelligence collective qui ne serait pas que logique, mathématique : elle serait aussi « éthiquement viable » : une « entité globale éthique, mue par des pulsions secrètes visant à la satisfaction de notre nous… De notre moi. »… Des entités collectives, la science-fiction nous en a déjà donné de nombreux exemples. Dans La lune seule le sait de Johan Heliot, ce que Bruno Gaultier avait décrit comme « la refonte des consciences individuelles des êtres décédés dans un amalgame Ishkiss millénaire et condamné à errer dans l’espace à la recherche de nouvelles aides pour survivre », était une évidente métaphore politique, et n’ouvrait sur aucune réflexion métaphysique. En revanche, les post-humains de La ruche d’Hellstrom de Frank Herbert, comme les légions de l’Anome de Grande Jonction, étaient comme sortis de l’humanité. Vivre ensemble, mais en ruinant le sens de cet « ensemble ». Lutter pour la survie de la ruche, au détriment de toute autre intelligence. Détruire la singularité divine, pour régner en maître sur une terre dévastée. Des intelligences « totalement inhumaines », pour reprendre les termes de Jean-Michel Truong. Si dans le deuxième tome de sa trilogie les Noctivores de Stéphane Beauverger paraissaient appartenir à cette dernière catégorie, alternative inhumaine et, comment dire, diabolique, à la folie humaine, ils s’apparentent plus, ici, au Gestalt des Plus qu’humain de Theodore Sturgeon. La cité nymphale du titre, c’est l’imminence annoncée d’un contrat social d’un nouveau type. L’apocalypse, certes, puisque l’homme ancien est amené à disparaître, mais une apocalypse dorée, tant les Noctivores, derrière leur apparence de zombies, se montrent habiles, intelligents, capables des plus grandes prouesses techniques. Et, surtout, ils ne cherchent plus à éliminer leurs dissemblables. Leur conscience, d’abord froidement logique, est désormais alimentée par un inconscient collectif qui, semble-t-il, leur garantit une certaine humanité (jusqu’au sens de l’humour).
Les meilleurs passages du livre, ceux où Beauverger s’affranchit le plus des conventions romanesques, sont une conséquence directe de cette évolution inattendue des Noctivores. Il s’agit de courts chapitres, intercalés dans la trame principale, où nous suivons les « sauts de conscience » d’un tueur noctivore. Pour figurer son mode de pensée radicalement différent du nôtre, Beauverger s’autorise des descriptions synesthésiques du plus bel effet : « Encore un pas. Encore deux. Scintillement jaune. Un puits flamboyait quelque part devant lui, au loin. Il avait tellement hâte d’y être. Un air oublié reprit dans sa tête cabossée. Scintillement jaune soutenu par un accord grave, mi majeur, en x, en y et en z. » Dans ces interludes, dont l’importance ne vous sera révélée qu’au dénouement, Beauverger fait montre d’une inventivité vraiment jubilatoire, qui ne se retrouve que sporadiquement dans le reste d’un récit secrètement tendu vers sa propre expérience de la synthèse éthique des Noctivores. En effet, si la violence est évidemment présente dans La cité nymphale, elle est le plus souvent désamorcée. Beauverger joue avec nos attentes, et c’est délibérément qu’il les déçoit. Ses personnages, son roman lui-même, doivent domestiquer leur propre violence, et s’ouvrir enfin aux autres et au monde. Et lorsque la violence se manifeste brutalement, par le canon du flingue de Lucie ou par les pensées dégénérées d’une laissée-pour-compte enragée, nous sommes gênés, mal à l’aise, confrontés à notre banale complaisance.
On peut alors regretter que la réussite de ce projet ambitieux, se fasse au prix de ce qui forçait l’enthousiasme dans Chromozone et Les Noctivores, cet art de la castagne, ce rythme insensé, cette capacité à maintenir une étincelle de lumière dans l’enfer des armes. Ce style tranchant, sans fioritures mais redoutablement efficace, sied moins au tissage de liens fraternels qu’à l’équarrissage d’autrui à la machette… Par ailleurs, cette volonté louable de reconstruire après avoir tout fait exploser, se traduit dans La cité nymphale par une simplification des données. Hormis les mystérieux agents de Derb Ghallef, dont nous ne saurons rien sinon qu’ils ne sont pas l’ennemi supposé, nous connaissons quasiment d’emblée toutes les forces en présence, ainsi que leurs dirigeants. Et si quelques événements viennent troubler les relations diplomatiques, au point d’en arriver à une situation de crise qui permet à Beauverger d’en réunir enfin tous les protagonistes, aucune évolution majeure ne permet au récit de décoller – jusqu’au surgissement inoubliable du tueur, prélude tragicomique aux révélations sur la nouvelle éthique des Noctivores. Situation figée, donc, et dont les éléments ne sont jamais qu’effleurés. Comme les personnages du reste, dont l’essence se dilue tandis que leurs doutes laissent place à une nouvelle détermination. Aucun, en vérité, ne parvient à émouvoir, aucun ne nous invite au vertige. Même le Roméo, traître professionnel rencontré dans le volume précédent, n’est plus intéressant dès lors qu’il devient trop humain. Chacun joue son rôle à la perfection, comme à l’Actor’s Studio, mais où est la chair ? Où est le sang ? Où est l’âme ? Dépecée et synthétisée par les Noctivores ? Idée séduisante, mais infondée.
Pour autant, Stéphane Beauverger ne choisit pas la beauté plus qu’humaine des Noctivores (la référence du titre au monde des insectes – la cité nymphale – ne saurait être fortuite). Avec la communauté secrète réunie autour de Laurie Deane, c’est une nouvelle fraternité qui est en train de naître. D’un côté, la ruche éthique des Noctivores. De l’autre, les hommes libres. Beauverger ne juge pas les Noctivores, qu’il paraît contempler avec tristesse, comme s’il pressentait que l’avenir de l’univers par lui créé, leur appartient. Mais il choisit évidemment de clore son texte en compagnie de Cendre et Lucie, nouvel Adam, nouvelle Ève, sur un navire – possibilité d’une île. Le dernier mot du roman, c’est « vie ». Où est l’âme, demandais-je à l’instant. Elle surgit in extremis, l’âme, dans une « larme de joie triste ».
-
Grande Jonction de Maurice G. Dantec - Shoot them up
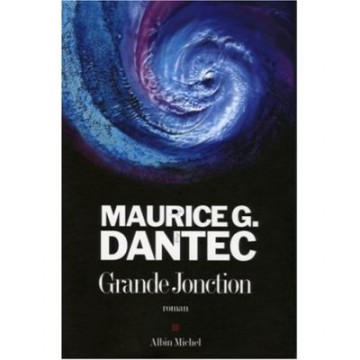
“Bored of the things
that you are.
And now at the things
that you were.
How does it feel to destroy
everything by your guilt?”Justin K. Broadrick, Your Path to Divinity, in album Jesu.
Les critiques de l’œuvre de Maurice G. Dantec ont ceci de paradoxal, qu’elles la considèrent généralement comme l’une des plus marquantes de l’époque, tout en formulant de sérieuses réserves (Juan Asensio, qui s’agace à juste titre de « très pesants tics de langage », d’un style « lourdement cinématographique » ou encore d’une « fastidieuse monodie accumulative », sans parler de « fautes de goût » adolescentes, ou Jean-Louis Kuffer, qui reproche à Dantec, non moins légitimement – mais avec un stupide préjugé sur la bande dessinée –, sa paranoïa « ravageuse », ses lourdes « béquilles idéologiques », ses « personnages terriblement stéréotypés » et, surtout, un hiatus énorme « entre la substance théologique dense mais plaquée et cette dramaturgie de bande dessinée »). L’an dernier, ne qualifiais-je pas moi-même Cosmos Incorporated d’échec littéraire, l’accusant, un peu violemment, de s’aspirer dans son propre trou noir ? Aujourd’hui Grande Jonction, qui sur le fond ne fait qu’approfondir les thèmes essentiels du roman précédent, pourrait représenter un nouveau danger pour son auteur. Je pense, comme mon ami Juan, aux critiques, professionnels ou amateurs, qui hier conchiaient un écrivain fasciste et/ou illisible, et qui, sans crier gare, et sans le moindre amour-propre, retournent aujourd’hui leur veste et, avec la même superficialité que leurs précédentes attaques, vantent les mérites romanesques d’un écrivain retrouvé, ce qui reste encore le plus sûr moyen, et le plus vil, de s’en débarrasser. Ne pas céder aux sirènes du grand cirque. D’un autre côté, la richesse de certaines analyses, comme celle, remarquable, de Bruno Gaultier, tendent à surestimer une œuvre certes importante, voire indispensable, mais aussi souvent poussive, naïve, maladroite – une œuvre monstrueuse, en perpétuelle mutation, que son mouvement frénétique empêche d’atteindre la grâce. En un sens, la série de textes de Bruno, parce qu’elle énonce clairement et intelligemment les ressorts narratologiques et métaphysiques du roman, lui est supérieure (mais en un sens seulement, car elle ne saurait exister sans l’œuvre première)… Le danger, pour Dantec, serait donc d’une part de croire à une nouvelle plénitude médiatique alors qu’il n’est, aux yeux et entre les mains des journalistes, qu’un pantin réac’ et rock n’roll, et d’autre part, en dépit d’une authentique humilité (que j’ai pu constater lors de notre rencontre), de croire à la lettre les bienveillants exégètes qui, grisés par leur analyse, élèvent son œuvre au niveau des plus grands. Je m’étonne par exemple que personne, ou presque, n’ait encore souligné combien l’envol final des derniers hommes libres de Grande Jonction, parcelle canadienne arrachée à son socle terrien, est à la fois sublime et ridicule, s’étirant d’un égal élan vers la Bible , et vers La soupe aux choux… Que retenir, donc, de cet épais roman de science-fiction théologique dont la forme même s’attache, au mépris de toute prudence, à figurer la lutte inégale entre la Bête et la beauté ? Le blog du Transhumain reprend son rythme.
Après avoir fait imploser Cosmos Incorporated en cours de route, après avoir lutté contre la fausse parole pour que renaisse le verbe dont nous serions selon lui constitués, Maurice G. Dantec se trouvait, pour nous, dans une position littéraire inconfortable. Allait-il s’emparer de ce verbe qui l’obsède tant et cesser enfin de tourner autour, ou allait-il inlassablement reproduire le même échec ? Grande Jonction, suite directe de Cosmos Incorporated, se meut en effet délibérément entre ces deux territoires incompossibles – qu’en vain cependant, Dantec tente de lier –, autrement dit, à leur impossible jonction, au cœur de la Centrale de Narration cosmogonique évoquée par Gabriel Link de Noval à l’heure de sa transformation, à l’aube de la création de son Arche céleste. Tragique récit d’une lutte pour un territoire menacé, Grande Jonction narre à la manière d’un western – et parce qu’en ces terres réside encore quelque beauté échappant à la grisaille de la Machine-Monde –, en en déclinant tous les codes (attaque d’un camion/diligence par les néo-islamistes/indiens ; défense d’un Fort Alamo ; shérif inflexible et tutti quanti), les hauts faits d’une guerre qui oppose à la fin du 21e siècle quelques irréductibles – une poignée de femmes, d’hommes et d’androïdes qui littéralement refusent de se laisser réduire, qui défendent leur âme d’essence divine à sa déclinaison chiffrée – à l’emprise infernale de la chose, l’Anome, survivance omnipotente de la Métastructure , qui s’apprête à engloutir le monde. À Grande Jonction en effet, aux alentours du cosmodrome, au lieu même où tout commença – et où tout finira, provisoirement –, un nouveau mal se répand. Ne sont plus touchés les seuls détenteurs de systèmes bio-embarqués – ceux-là continuent de décéder les uns après les autres, tués par les dispositifs artificiels qui les avaient aidés à survivre. Désormais la chose, « l’Après-Machine », ne s’attaque plus seulement au mécanique, ni même au biologique, mais directement à ce qui selon Dantec définit l’homme en tant que tel : le symbolique, le langage, le pouvoir de nommer les choses (qu’on se souvienne de Primo Levi, qui dans Si c’est un homme écrivait la nécessité vitale de ne pas considérer les individus comme des matricules, ou comme des unités interchangeables). Les malades contaminés par le métavirus se mettent à débiter du langage binaire, suite ininterrompue de 1 et de 0, de plus en plus vite, jusqu’à se muer en modems organiques, avant d’exploser en débris numériques, la version codée de leur être exposée aux yeux de tous, sur les murs. L’écriture elle-même disparaît littéralement des livres et de tout autre support : les pages redeviennent vierges, les unes après les autres, effaçant les mondes qu’elles contenaient. En d’autres termes, la chose « machinise » ce qui reste de l’humanité, essaie d’en éliminer l’essence. Et transforme le monde en Camp de concentration global. Le salut de l’humanité, moins menacée numériquement que symboliquement (puisque le travail de l’Anome est de réduire l’humanité, de la diviser, non de la détruire totalement, ce qu’illustre magnifiquement l’épique bataille finale), ne tient qu’à un fil, ou plutôt à six cordes, celles de la guitare électrique de Gabriel Link de Nova, ange christique de douze ans dont la musique rock, par laquelle communient les mortels (Link, le lien), guérit définitivement les malheureuses victimes du métavirus. Gabriel, prophète dont les mains avaient déjà le pouvoir de préserver les machines électroniques, puis électriques, s’impose comme la réponse surnaturelle à la chose qui le ronge. Autour de lui se réunit en effet une communauté de valeureux croisés, un « Reste » par qui l’humanité continue malgré tout d’exister : Chrysler Campbell, l’ordinateur humain, tueur loyal à la froide intelligence, et son acolyte Youri McCoy, fasciné par les derniers chrétiens et amoureux de la belle Judith Sévigny ; Balthazar, le cyberchien de Cosmos Incorporated qui rôde dans les couloirs déserts de l’hôtel Laïka ; le shérif Wilbur Langlois, la Loi incarnée, bouclier d’airain du Territoire ; Milan Djordjevic, père adoptif de Gabriel, et l’androïde Sydia Nova, sa mère adoptive ; et ces envoyés du Vatican, qui convoient une bibliothèque d’ouvrages théologiques à l’intention des derniers hommes libres. En face, la chose semble s’être incarnée en la personne d’un androïde qui offre à ses fidèles l’immortalité en échange de leur singularité (leur âme) – donnant naissance à une néo-humanité (une « Anomanité ») de « clones » indifférenciés dont la conscience est purement collective (comme, récemment, dans Les Noctivores de Stéphane Beauverger, dont la suite, La cité nymphale, paraît prochainement, nous y reviendrons en temps voulu).
Dans sa critique de Cosmos Incorporated (Galaxies n°39), Sam Lermite (dont je vais publier dans quelques jours un excellent texte consacré à Minuscules flocons de neige depuis dix minutes de David Calvo) parlait à juste titre d’un « roman sur la science de la fiction ». Et de fait, nous assistons encore, avec Grande Jonction, récit de l’anomie du langage, à la représentation esthétique du combat opposant l’Anome et le Logos, comme le suggère cette belle pensée de Josef Ratzinger, citée par l’auteur en exergue de la deuxième partie (et qui fait écho au Nous, fils d’Eichmann de Gunther Anders longuement commenté dans Cosmos Inc.) : « Aujourd'hui, si la loi universelle de la machine est acceptée, il ne faut pas oublier que les camps pourraient préfigurer la destinée d’un monde qui adopte leur structure. Les machines qui ont été mises au point imposent la même loi. Selon cette logique, l’homme doit être interprété comme un ordinateur et cela n’est possible que s’il est traduit en nombres. La Bête est un nombre et transforme en nombres. Toutefois, Dieu a un nom et nous appelle par notre nom. Il est la personne et recherche la personne. » L’enjeu du roman est limpide : comment figurer l’indicible, comment écrire la dévolution du langage – et donc de l’humanité – sans y succomber à son tour ? Le chef d’œuvre de George Orwell, 1984, sans doute l’un des romans les plus importants de l’histoire, y répondait magistralement, et le plus simplement du monde : le langage n’est pas un simple système de codage d’informations, il n’est pas strictement utilitaire : il est vecteur de singularité, de beauté, par sa richesse, par sa liberté de dire l’amour, mais aussi parce qu’il transmet un héritage – un témoignage. L’omniprésence dans Grande Jonction de la musique rock, qui contamine le roman jusqu’à son style (nous allons y venir), nous rappelle précisément que la singularité, la spécificité individuelle, naît moins du néant, que d’une patiente et laborieuse étude d’un socle culturel commun (d’où l’importance cruciale des 13000 volumes convoyés par les soldats du Vatican). La littérature, comme le rock, ne font pas, en théorie, qu’exploiter un « temps de cerveau disponible », pour reprendre les termes employés par Patrick Le Lay à TF1 : comme le principe divin selon Jean Duns Scott, abondamment cité dans le roman, ils transmettent, ils unifient tout en singularisant.
Du rock, Dantec essaie donc de conserver un rythme, un tempo particulier, tout en répétitions, en scansions, d’où les variations personnelles, que nous qualifions un peu facilement de « fulgurances » (en omettant de rappeler que pour que ces dernières surviennent, il faut en maîtriser la genèse, savoir enfouir la beauté pour la mieux faire surgir), sont censées émerger. Sans parler des titres de chapitres, qui reprennent tous le titre d'une chanson, ou le nom d'un groupe, à commencer par Radiohead. Le roman dans son ensemble est ainsi conçu comme une chanson rock (Bruno Gaultier en dissèque fort bien les mécanismes), Welcome to the Territory, orchestrée par Gabriel Link de Nova. Et c’est précisément là que le bât blesse. En effet, la langue syncopée de Grande Jonction, qui dans ses meilleurs passages peut évoquer le style quasi slamé de Chuck Palahniuk (Fight Club), souffre le reste du temps d’un pénible déficit de singularité, d’un excès de machinisme, évidemment problématique dans le cas qui nous intéresse. Loin d’hypnotiser le lecteur, loin de l’immerger dans un éblouissant trip littéraire, les refrains en anglais de Welcome to the Territory alourdissent inutilement une prose déjà trop mécanique. Si Dantec martèle ainsi ses idées, si les mêmes phrases reviennent sans cesse, comme des mantras, c’est que l’auteur, aveuglé par la puissante lumière qu’il trouve dans la prière, essaie à son tour de nous faire entrer en transe. En vain. Comme si U2 jouait du Rammstein (ou du Laibach…).
À plusieurs reprises, de longues descriptions de la flore étique de Grande Jonction s’insèrent dans la narration, tout droit sorties d’un quelconque dictionnaire botanique. La critique s’en est d’ailleurs moquée, sans pourtant chercher à en saisir le sens. Or, si ces maladroits passages auraient pu sans dommage être réduits et mieux répartis, disséminés dans le texte comme autant de graines de combat, ils n’en témoignent pas moins de la lutte, à l’œuvre au cœur de la diégèse comme dans l’écriture elle-même, pour la survie du langage. Nommer les choses, nous l’avons dit, même s’il ne s’agit que de mauvaises herbes, permet en effet à l’auteur de ne pas céder à la destruction du langage. Mais la beauté du verbe se fait trop rare, et sans vraie cohérence : ça ne fonctionne pas, ça tourne à vide. D’autant, effet sans doute involontaire, qu’à ces listes d’espèces végétales (dont la poésie s’estompe rapidement) fait écho la précision mécanique avec laquelle l’auteur, comme à son habitude, inventorie les nombreuses armes et méthodes de combat employées.
En outre, hormis Gabriel Link de Nova et, dans une moindre mesure, Youri McCoy, les personnages sont bien trop stéréotypés pour vraiment prendre vie. Dantec ne parvient jamais, par exemple, à nous communiquer la beauté de Judith, même lorsqu’elle est perçue par les yeux de ses prétendants. Judith ne reste, pour nous, qu’un fantasme adolescent de beauté féminine. Une créature dont l’âme se limite aux formes plantureuses. Une poupée aux yeux morts. Quant aux héros, réduits à leurs fonctions minimales, ils évoquent davantage de rigides avatars de shoot them up (cette analogie me frappe soudain : la tentative dantécienne de nommer les choses, plantes ou automatiques, de leur redonner une existence annihilée par l’Anome, renvoie aux listes d’items auxquels le gamer d’un jeu de survie comme Resident Evil est confronté…) que des êtres autonomes, doués d’une vie propre. Erreur fatale dans un roman dont l’enjeu est bien la sauvegarde d’une étincelle de lumière divine. Pensez que même Feric Jaggar, le leader nazi de Rêve de fer de Norman Spinrad, qui extermine les impurs dans la joie et l’exaltation, même cette caricature de héros de fantasy ou de space opera était bien plus émouvante, plus vivante que les personnages de Grande Jonction… Dans la première partie, Youri McCoy (personnage privilégié, de loin le plus intéressant, car sans doute le plus proche de Dantec, dont nous suivons le cheminement spirituel jusqu’à sa conversion) et son mentor Chrysler Campbell recensent toutes les victimes de la chose. Ils enregistrent et analysent les données, chacun à sa manière, mathématique pour Chrysler, plus affective, métaphysique pour Youri, Ils sont les « médecins du Camp », comme Youri le répète à longueur de temps, c’est-à-dire qu’ils font eux-mêmes partie de la dévolution (nous faisant comprendre au passage combien cette analyse purement numérique de la situation est absurde), mais y compris, et c’est sur ce point que je voudrais insister, de la dévolution narrative. Certes, comme le rappelle Bruno Gaultier, le personnage de Judith vaut surtout pour l’amour qu’il inspire à Gabriel et à Youri, mais cet amour lui-même reste lettre morte, ne jaillit jamais d’un verbe dantécien tout simplement impuissant. Il faut se demander si cette antienne de Youri McCoy, « Nous sommes les médecins du Camp », n’est pas le code d’accès au système du roman. Certes, nous savons que Maurice G. Dantec a écrit Grande Jonction très vite, trop vite, en quelques mois, avec une facilité qui ne laisse pas d’inquiéter. Mais ce leitmotiv de McCoy ne saurait être fortuit : l’auteur aurait-il donc tenté ce pari insensé, d’enfermer sciemment ses personnages, et leur univers, dans la grisaille machinique de l’Anome, pour mieux les sauver ensuite ?... À l’échelle du roman, cela n’a aucun sens, mais à celle d’un cycle ? Délire d’interprétation ? Sans doute. Et cependant.
L’espoir n’est pas mort. Grande Jonction est un roman métaphysique passionnant, sans conteste, surtout pour l’indéniable élan intellectuel qu’il suscite chez certains lecteurs – quoique, ne nous leurrons point : je ne sache pas que nos girouettes de la presse aient vraiment compris ce que Dantec essaie de leur dire –, mais qui échoue encore une fois formellement à se hisser à la hauteur de ses admirables ambitions. Je le répète : j’aime la démarche courageuse de Maurice G. Dantec ; je préfère mille fois son échec (qui, tout de même, n’est jamais complet) aux réussites étriquées d’écrivains sans envergure, dont le nombril, sujet ou moteur de fiction, constitue l’indépassable horizon. Mais l’espoir subsiste encore, disais-je. Avec son Arche de lumière (qui, selon que l’on est bienveillant envers l’auteur, ce qui est mon cas, ou que l’on est son adversaire, provoquera une émotion toute métaphysique ou bien suscitera le souvenir de l’effarant final de certain navet, cité en introduction de cet article, où flatulences et onomatopées tenaient lieu de dialogues…), Gabriel Link de Nova conduit les derniers hommes libres dans l’espace, hors de Grande Jonction (hors du lieu diégétique, mais aussi, hors du roman) vers ce Ring qui, en orbite, échappe à l’emprise de l’Anome. Ainsi est-ce non sans impatience, et non sans inquiétude – car le successeur de Grande Jonction n’a plus droit à l’erreur –, que nous attendrons le troisième et, en théorie, dernier volet de cette trilogie annoncée, où nous devrions retrouver, peut-être enfin transcendée, cette nouvelle communauté de l’Anneau.

