Maudit soit Andreas Werckmeister de Juan Asensio (28/04/2008)
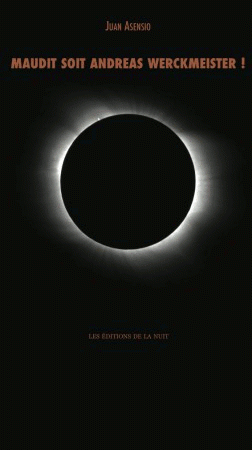
« Des yeux fous de la tête décapitée jaillissent des larmes de cristal pur. Les Nécrophages quittent mon Corps comme à regret. Dieu semble m’avoir abandonné. »
Anonyme
Étrange petit livre, que ce Maudit soit Andreas Werckmeister de Juan Asensio, publié aux Éditions de la Nuit – auxquelles nous devons la magnifique revue La Nuit. Étrange, en raison moins de son style et de son propos, qui ne surprendront aucun lecteur habitué à arpenter la zone du Stalker, que de son indécise oscillation entre essai et fiction.
Un homme – le dernier homme –, se tient devant une table de dissection, dans une morgue aux dimensions borgésiennes hantée par d’innombrables cadavres, qui en réalité n’en sont qu’un : celui de la littérature française, cette terre vaine et dévastée, mais aussi aseptisée – si l’on veut bien s’accommoder de cette légère odeur de vieux fromage, caractéristique de certains cadavres en pleine dessication. « […] ce petit texte tentera de montrer que la littérature, déjà parole ossifiée ou écrite, est à présent, devant nos yeux, devenue le cadavre desséché d’une baleine ou celui de la Parole, c’est-à-dire de Dieu » (p. 30) Cette posture sied parfaitement à notre ami, et permet à son double (le narrateur) de se lancer dans une méditation tantôt poétique (un peu), tantôt polémique (beaucoup), sur la littérature, son cadavre et ses légistes.
« Si les morts hantent les livres, si, littéralement, tout grand livre est bâti sur un charnier, chacun d’entre eux est le réceptacle d’une parole morte à laquelle toute nouvelle lecture redonnera vie durant quelques heures. Nous tenons entre nos mains des multitudes de cadavres blanchis, dont la chair autrefois aimante ou douloureuse a été transformée en papier. » (p. 25) De la littérature comme un rituel de possession, donc. Les grands livres seraient ceux dont cette dimension démoniaque, ou christique, c’est selon, n’aurait pas été phagocytée par la « fausse parole » des marchands du temple du paysage éditorial français, depuis longtemps hélas presque entièrement contaminé, ainsi que le savait Julien Gracq (La Littérature à l’estomac). Or, la littérature française, nous dit Asensio, paraît aujourd’hui incapable d’un tel prodige. Et de s’en prendre, après d’autres, aux foutriquets des lettres, les Besson (lequel ?), Pennac et Beigbeider, dont les livres médicamenteux, bons ou mauvais, restent aussi loin que possible de l’abîme.
Mais dans un chapitre intitulé « Seconde métamorphose du cadavre », le narrateur s’aperçoit que la main du cadavre, « verdâtre, crochue et fine comme une araignée desséchée, percée d’un trou », désigne de son doigt figé « un gros bloc d’ambre très sombre », mystérieux aleph où l’âme du narrateur est aspirée, comme par un trou noir, jusqu’à la lumière aveuglante du feu de la Connaissance. Ce n’est qu’au terme de cet épisode poétique, qui voit le narrateur fouler le sol d’une terre glacée, morte, couverte de ruines, puis reprendre conscience dans sa chambre (sur son bureau : une bouteille de whisky vide…), que Juan Asensio nous dévoile l’idée qui sous-tend ce livre : les plus grandes œuvres littéraires seraient semblables à des trous noirs, « véritables puits de chaos au sein d’un univers autrement impeccablement ordonné, dont les règles et les usages sont enseignés depuis quelques siècles dans les universités » (pp. 81-82). Elles seraient plis de l’espace-temps, invisibles car en définitive, pures vues de l’esprit : « L’explorateur le plus intrépide, à quelques mètres de la gueule formidable d’un trou noir, ne saurait probablement rien du monstre qui va l’engloutir, qui l’a déjà englouti, qui l’a dévoré de toute éternité. De la même façon, Kurtz et Ouine ne sont guère présents que dans quelques pages qui évoquent leurs paroles et actions énigmatiques, secrètes, comme si Conrad ou Bernanos ne pouvaient s’approcher de ces êtres repliés, occlus, qu’à une certaine distance en nous affirmant : “Voilà, je suis allé au bout de mes possibilités de créateur et, au-delà de cette limité, il n’y a plus que désordre et chaos…” » (pp. 88-89). Les œuvres essentielles seraient donc celles qui « figurent en leur propre construction la descente aux enfers annonçant le retour d’Orphée à la lumière du jour. […] Toute parole doit s’éteindre, accepter de s’éteindre, pour renaître, plus forte, au monde. […] Car ce qui meurt sous la plume de Faulkner, Broch, Conrad ou Bernanos, c’est le langage. Ce qui renaît, c’est aussi le langage […] » (p. 105) Voilà qui est intéressant, et qui concerne aussi – surtout – celui dont l’œuvre planant au-dessus de ces pages m’est désormais consubstantielle : Samuel Beckett, l’écrivain parmi tous les autres qui n’a cessé de tendre vers le silence, à qui a été confié, pour reprendre la formule de Maurice Blanchot, « ce mouvement de la fin qui n’en finit pas ». C’est aussi, me semble-t-il, ce qui est réifié, métaphorisé par la meilleure science-fiction, celle qui plonge ses lecteurs dans le vertige logique ou métaphysique du sense of wonder.
Juan Asensio ne profère pas des paroles de fou, comme il espère qu’on le lui reprochera, en écrivant que ces trous noirs formeraient une constellation, une communauté dont les membres communiqueraient entre eux, comme, par exemple, Kurtz et Macbeth – d’autres ont déjà souligné la parenté de ces deux personnages, au point même de les faire fusionner (lire ma critique de Chronique des jours à venir de Ronald Wright). Nous savons que les plus grandes œuvres se nourrissent d’autres œuvres, qui se réincarnent alors sans cesse, sous d’autres traits. Qu’il me soit donc permis d’imaginer mon propre réseau de trous noirs, où les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, tout Beckett, Le château, Le Procès et autres nouvelles de Franz Kafka, Moby Dick et Bartleby, les contes de Borges, les hallucinations de William Burroughs, mais aussi La forêt de cristal de J. G. Ballard, Camp de concentration de Thomas M Disch et la Trilogie divine de Philip K. Dick, et bien d’autres, résonnent tous entre eux, plus ou moins visiblement, de quelque manière que ce soit. Et tous, à leur façon, nous font plonger dans un gouffre sans fond, hors de la trame bien ordonnée du monde sensible.
Je regrette vivement que Juan Asensio n’ait pas bridé son penchant naturel pour la polémique et le concassage des nains littéraires et de leurs « coprophages », de Gérard Genette (« cet exégète infatigable du point-virgule ») au « doge de la bêtise » Philippe Sollers, en passant par Tzvetan Todorov, François Meyronnis, Richard Millet (encore récemment épinglé sur Stalker), Yannick Haenel et même Pierre Jourde qui, s’il n’avait cette odeur de fromage à maudire publiquement, n’aurait selon notre auteur « rien à nous révéler, donc : rien à nous dire ». Cette dimension pamphlétaire que les lecteurs du Stalker connaissent bien, certes toujours réjouissante et non dénuée de pertinence, mais aussi la surabondance de citations, nuisent cependant à la hauteur d’un livre qui, dès lors, peine à imposer une « réelle présence », une voix qui ne serait pas celle du Stalker, ou de son auteur, mais celle d’un être nouveau, poétique. La parole d’Asensio en effet, sitôt incarnée par son narrateur, sitôt mise en fiction, se désincarne et revêt les atours agressifs du critique littéraire, alors même que pour faire mouche, son idée directrice exigeait d’être pleinement assumée comme brûlot polémique, ou, mieux, véritablement incorporée. On comprend ce qui a pu motiver pareille prudence (« […] mon échec est patent, je ne parviens pas à écrire ce livre qui ne peut-être lui-même que monstrueux », p. 88) : passer de l’essai à la fiction, c’est non seulement se mettre à nu, tendre le fer pour se faire battre, c’est se confronter à ses propres maîtres, mais c’est encore laisser sa parole s’échapper, divaguer et n’en faire qu’à sa tête. Prendre des directions que vous ne soupçonniez pas. Et, à son tour, construire une œuvre, dont ce livre atypique ne présente que les linéaments.
Quel dommage, donc, que Maudit soit Andreas Werckmeister (dont le titre renvoie inévitablement au chef d’œuvre de Béla Tarr) ne soit finalement qu’un long billet du Stalker, implacable diatribe, souvent brillante, mais illuminée seulement de loin en loin (en particulier dans le beau chapitre « Seconde métamorphose) par une veine allégorique et symbolique certes pas toujours maîtrisée mais soutenue par une plume de talent, une fréquentation assidue de livres exigeants, et une volonté de feu que même ses ennemis acharnés ne lui enlèveront pas.
Un mot, encore. Cette idée de la littérature comme trou noir ne suppose pas forcément que la littérature, même française, soit déjà morte – elle ne l’est pas. Dans son roman Temps, Stephen Baxter imagine qu’à l’origine de notre univers – de chaque univers –, il y aurait un trou noir dans un autre univers évolutionniste de la même famille, créatrice de singularités primordiales… Si la littérature est morte, elle ne cesse de renaître.
Découvrez les premières pages de Maudit soit Andreas Werckmeister.
14:49 | Lien permanent | Commentaires (56) | Tags : critique, critique littéraire, stalker, trous noirs |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Une sorte de littérature bling-bling, en tout cas ces premières lignes.
Même pas besoin de disséquer.
Le reste doit être meilleur, je suppose. J'espère.
Écrit par : Sébastien | 29/04/2008
Sébastien, tu pourras causer quand tu sauras lire.
Cher Transhumain,
Merci pour cet article. Il me permet de patienter...
Le Stalker a déjà dit il y a longtemps que son talent se limitait à l'essai et ne lui permettait donc pas la fiction.
Pourquoi ne pas voir dans son utilisation de l'image de la morgue infinie une "simple" parabole utilisée pour introduire son propos ? Ou bien une réminiscence d'une expérience mentale réelle ?
Écrit par : Samuel Gourio | 29/04/2008
Olivier, il paraît que tu ne sais pas lire Juan comme il faut et que tu n'as pas compris où il voulait en venir.
(soupir)
C'est fâcheux, évidemment.
(silence)
C'est un mythe qui s'effondre sur lui-même.
(soupir) (silence) (soupir)
Un peu comme Barcelone ce soir.
(soupirs et silences)
Écrit par : Bruno | 29/04/2008
Allez l'OM !
Et voilà, bravo Bruno .
T'as complètement détourné le sujet de l'article.
Pffiou !
Je sors.
Écrit par : Aïn | 30/04/2008
Bruno, je te trouve de plus en plus idiot, sans doute la lecture de trop de nanars de SF ou une trop longue exposition aux rayons tueurs de cellules grises de l'agrégation.
Tu n'as pas lu ce livre alors, le mieux que tu puisses faire, c'est tout simplement de te taire, non, puisque ton commentaire est du même niveau que celui de Sébastien ?
Ou alors, tiens, de nous recopier/recoller une belle note sur Systar, en 821 pages, sur Husserl, ça, tu sais le faire, et bien.
Écrit par : Stalker | 30/04/2008
Oui, effectivement, l'agrégation rend con.
C'est bien connu.
Suis-je bête.
Si je ne l'avais pas préparée, effectivement, j'aurais continué à... bloguer.
Par ailleurs, trêve de mascarade: tu ne m'as jamais trouvé très malin - trop naïf, trop jeune, trop enthousiaste - , tout ce qui t'a plu, c'est le moment où, en toute sincérité, j'ai dit du bien, à une certaine époque, de ton travail. On appelle ça un idiot utile, je crois.
Soit. Mais j'apprends vite. La preuve.
Écrit par : Systar | 30/04/2008
"Je vous demande de vous arrêter !"
Edouard B., 21 avril 1995.
Écrit par : Transhumain | 30/04/2008
Oh non voyons, l'agrégation ne rend pas con mais, oui, beaucoup de cons peuvent la passer. Dans ce cas, une fois réussie, leur cas, j'en ai peur, ne s'arrange pas.
Trêve de plaisanterie : pour résumer toutes tes qualités juvéniles, j'ai un mot, un seul, l'adjectif et substantif merdeux.
Je trouve au contraire que tu apprends extraordinairement lentement, que tu régresses même : lis ce livre et, ma foi, tu en diras ce que tu voudras une fois que tu l'auras lu, promis, je ne te gronderai pas.
Cela aura plus de gueule que ton dernier petit glaviot se voulant spirituel je le suppose.
Un idiot utile ? Si tu le dis dis. Mais utile à quoi ?
Écrit par : Stalker | 30/04/2008
Utile à quoi: à parler un peu en bien de La Critique meurt jeune, qui était un bon livre.
J'exprimais un étonnement, certes amusé, sur le fait que tu juges utile de t'expliquer sur les intentions de ton livre après le texte d'Olivier.
Rien de bien méchant en somme, et surtout pas contre ton livre.
Pour le reste, passe à "merdeux", "idiot" si tu veux, rajoutes-en même, peu importe. Je t'ai trop souvent vu t'emporter sur internet pour des broutilles, pour en faire à présent le moindre cas.
Écrit par : Systar | 30/04/2008
Non, je ne rajoute rien, je t'ai dit ce que j'avais à te dire.
Je ne m'emporte pas mais disons que j'ai suffisamment de problèmes à régler avec ce livre (de distribution, de diffusion, d'envois de sp, de désirs de casser la figure à quelques journalistes ET pseudo-libraires, etc.) pour que je sois le meilleur lecteur de ton ironie si particulièrement fine en cette occasion.
Je ne vois vraiment pas par quel drôle de principe de retenue, appelons-le de constipation intellectuelle, l'auteur que je suis de ce livre devrait abandonner, sur un texte (celui d'Olivier en l'occurrence) son regard (de) critique.
Explique-moi donc cela.
Je vais verser une larme quant à ton utilité : ma foi, jamais je n'ai tu ton propre travail il me semble ni même évoquer ton nom auprès de certaines personnes.
Écrit par : Stalker | 30/04/2008
ni même hésité à...
Écrit par : Stalker | 30/04/2008
Ah, que tu sois agacé par les difficultés à faire exister ton livre, soit.
C'est compréhensible.
Pour la retenue qu'un auteur devrait avoir sur son propre livre: une fois livré au public, je ne sais pas si l'auteur doit expliquer le livre, dire que et en quoi il n'a pas été compris. A fortiori quand tu confies le livre à un type comme Olivier, qui ne peut pas être soupçonné d'avoir été partial, hâtif, et intellectuellement trop faible pour comprendre ce livre (je dis ça parce que je le connais un peu, et que je sais comment il travaille).
Mais dans la mesure où tu défends ton livre, y compris sur le plan le plus concret du "commercial", cela fait partie du jeu que tu en expliques l'intention. Cela fera partie du jeu également que d'hypothétiques lecteurs s'en étonnent ou n'en tiennent pas du tout compte.
Écrit par : Bruno | 30/04/2008
Voyons, Bruno, si j'avais quelque doute sur la rigueur d'Olivier, crois-tu que je lui aurais envoyé un exemplaire de ce livre ? C'est Pierre Cormary le sado-maso, pas moi.
L'unique défaut que je vous ai TOUJOURS reproché, au Transhu et à toi, c'est plutôt la surinterprétation...
Reste que j'ai le droit, ce livre publié ou pas, de dire ce qu'Olivier n'y a pas vu, non ?
Pourquoi ? Parce que je suis beaucoup plus critique envers ce livre que ne le sera jamais Olivier, crois-moi; mais, en même temps, j'en connais les forces et ces forces, à mon sens (j'ai encore le droit, sur mon blog, de donner mon avis, non ?) n'ont pas été suffisamment soulignées.
Par exemple la dimension éthique du livre; par exemple son insistance à récuser, entre le trou noir et la littérature, l'usage (trop facile) de la métaphore. Je n'ai pas écrit le livre qu'un Jean-Pierre Luminet a écrit sur ce sujet : bon livre du reste, mais mon intention était autre et cette intention, dans le droit fil de La Littérature à contre-nuit est, mes amis, une intention EXISTENTIELLE.
Autre chose, et Olivier m'a confirmé ce point en privé : le texte qu'il a écrit est davantage une recension qu'une véritable critique. Manque de temps sans doute, c'est vrai qu'il a fait très vite et que je le remercie d'ailleurs pour sa célérité.
Disons, alors, que je suis jaloux des longues études du Transhumain sur le surestimé dernier de Damasio (je suis, enfin, en train de le lire et je m'ennuie ferme)...
Disons encore que j'ai le droit de penser que mon pourtant petit livre soulève au moins autant de problématiques que la grosse Horde et que j'estimais que notre bon Transhumain les verrait, plutôt que de réduire AW a un long billet du Stalker, ce qu'il n'est évidemment pas...
Sur ce point, s'il le souhaite, je laisse Olivier s'exprimer bien sûr.
Écrit par : Stalker | 30/04/2008
Bon, pour mettre tout le monde d'accord (en fait, non), un codicille complètera la présente note. Une critique des critiques de ma critique, en somme. Enfin du sport !
Juan, je te demanderai de ne point insulter Bruno ici - Bruno est un ami -, d'autant qu'il a, au moins en partie, raison. Mais j'y reviendrai dans mon billet : inutile de nous pugiler pour le moment !
Écrit par : Transhumain | 30/04/2008
Voyons, Olivier, Bruno a pris un peu trop l'habitude de jouer au finaud avec moi. Qui s'étonne si un pékinois qui vient faire le malin sous la gueule du pit s'est fait bouffer la moitié de l'arrière-train ?
En plus, tu le sais, on me trouve assez vite, surtout lorsqu'on glaviote l'air de rien, en passant.
Pour le reste, oui, laissons là les amabilités et attendons ton apostille.
Écrit par : Stalker | 30/04/2008
"plutôt que de réduire AW a un long billet du Stalker, ce qu'il n'est évidemment pas..."
Ah, mais j'aime bien, les billets du Stalker, moi.
Écrit par : Transhumain | 30/04/2008
Bruno, je vous prie de ne pas essayer de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Merci.
Jamais vous ne verrez signés par moi des propos du genre : "Le Transhumain ne sait pas lire Juan comme il faut." Ou autres conneries du même genre.
Comme vous répliquez à Juan sur son billet portant sur AW dans la Zone le Stalker a évidement raison : comment pourriez-vous écrire un billet sur Systar ou commenter ici un livre que vous n'avez pas lu ?
De plus le Stalker ne s'énerve pas sur la manière dont son livre est distribué mais sur la manière dont IL N'EST PAS DISTRIBUE !
Déjà plus de quinze jours de retard dans les soi-disant bonnes librairies parisiennes !! Mais de qui se foutent-ils à la sodis ?!
Écrit par : Samuel Gourio | 30/04/2008
Samuel: ce n'est pas de vous que je parlais. Vous n'êtes pas seul sur terre.
J'aime vos mises au point.
Si j'étais à la place de Juan, votre dévouement m'embarrasserait presque. C'est touchant.
Écrit par : Bruno | 30/04/2008
"C'est Pierre Cormary le sado-maso, pas moi."
Quel grand enfant, tu fais, Juanito, quand même !
Envoie-le moi, ton livre, tiens, que j'en dise un mal, heu, un mot.
Écrit par : montalte | 01/05/2008
Bruno, tu devrais pourtant commencer à me connaître un peu : je préfère n'importe quel type franc du collier, fût-il expert en ouvertures d'huîtres (je ne dit pas cela pour Samuel !) à n'importe quel quadruple professeur au Collège de France (ce que tu n'es même pas encore) se piquant de son savoir et presque aussi faux-cul qu'il est malin ;-)
Pierrot : je vois si j'ai un ex. en souffrance (avec toi, c'est le cas de le dire) mais j'ai un peu peur que ce livre ne te plaise pas, bien trop éloigné de tes goûts esthétiques...
Tiens, une de mes amies chiliennes (Carmen Munoz) m'a promis quelle réagirait (en espagnol, ce qui pourrait limiter ton éventuelle réplique, je ne sais) à ton apostille, Olivier, cela risque d'être finalement assez drôle !
Écrit par : Stalker | 01/05/2008
"Bruno, tu devrais pourtant commencer à me connaître un peu : je préfère n'importe quel type franc du collier"
"se piquant de son savoir et presque aussi faux-cul qu'il est malin":
arrête ton cirque, Juan.
Pour ma part, et pour autant que l'un de tes "fans" ne viendra pas à nouveau m'expliquer ce que je dois ou ne dois pas écrire sur internet, j'en resterai là. Bon vent à ton Andreas Werckmeister.
Écrit par : Bruno | 01/05/2008
Arrête ton cirque, Bruno.
Samuel n'est pas un de mes fans, parce que je ne suis pas un chanteur; il t'a juste fait remarquer qu'il y avait quelque grotesque à faire un commentaire sur un sujet qui ne te concerne pas franchement puisque tu n'as pas lu mon livre, et que ce sujet lui est, je crois, directement lié.
Tu me répondras bien sûr que ton commentaire visait plutôt ma réaction au texte d'Olivier.
Bien sûr.
Restons-en là, effectivement.
Écrit par : Stalker | 01/05/2008
Bon, Juan, mon codicille attendra un ou deux jours de plus. Trop fatigué.
Écrit par : Transhumain | 01/05/2008
Je confirme, pour les problèmes de distribution. Le site Fnac a commencé par annuler ma première commande, pour cause " d'indisponibilité de cet ouvrage" , je l'ai commandé une deuxième fois, on promet d'envoyer le livre entre le 8 et le 15 mai.
J'aurais aimé que Juan traduise les deux courriels de Carmen Munoz, quoiqu'il soit surbooké, le pauvre, ce qui permettrait aux lecteurs de suivre le débat. Latiniste et italianisante, j'essaie de deviner l'espagnol, mais quand il s'agit de critique littéraire, deviner ne suffit pas. J'espère que vous allez trouver un bon traducteur, cher Transhumain,votre réponse est attendue!
Écrit par : Elisabeth Bart | 03/05/2008
Eh bien, chère Elisabeth, je devine plus ou moins, moi aussi, le sens du texte de Carmen Munoz, et vais devoir m'en contenter pour le moment. Du reste, ce n'est pas à son intervention que je vais réagir, mais ç la réaction de Juan, et à la lettre de Sok - non sans revenir, car c'est là l'essentiel, au livre lui-même.
A priori, c'est pour ce soir.
Écrit par : Transhumain | 03/05/2008
Chère Elisabeth Barth,
Si vous êtes pressée vous trouverez Maudit soit Andreas Werckmeister ! à la librairie L'écume des pages, boulevard Saint-Germain à Paris (en face de la brasserie Lipp).
Si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris, écrivez-moi à l'adresse suivante : samuelgourio@hotmail.fr car j'ai un exemplaire "en réserve" que je vous envoyerai si vous le souhaitez.
Écrit par : Samuel Gourio | 04/05/2008
(Bonjour). Très bonne critique. Hormis le dernier paragraphe, trop sententieux il me semble ("elle ne l'est pas")... Quasi énervant.
Bien à vous,
Écrit par : Marie Gabrielle | 29/05/2008
Ce que j'aurais (j'avais) à dire en est un peu choquant (et puis, limite petit...).
J'ai sincèrement aimé lire votre avis, ruisselant mais avéré plus fort que le serait encore mon imperméabilité...
C'est pourquoi j'aurai su m'attacher au bon mot transcrit qui fait tilt... (cf. "elle ne l'est pas.")
C'est la moindre évidence.
Comme à un son lâché - la broussaille.
Monsieur Noël, je me sens bien un peu honteuse, mais il m'aura semblé qu'un ton dont vous usiez évoqua (de peu s'en sera donc fallu...) - souleva la question de la virginité.
J'espère franchement ne pas vous indisposer par ce partage de ma lecture, tellement spontané (dans le mauvais sens ?), et sans doute personnel...
Aussi, si :
Vierge, elle-ne-l'est-pas (morte ?). Morte, elle-ne-l'est-pas (vierge) non plus ?
Je sais que je sais d'être un peu compliquée... veuillez me pardonner de m'être ainsi soumise à ce vrai penchant d'illettré sur un sujet qui sincèrement m'intéresse.*
Merci en tout cas, car JE vous ai suivi.
Bien cordialement,
Marie-Gabrielle Montant
* j'aurais du procéder par phases. L'idée, c'est qu'il existe un lien bien naturel, mais à circonstancier, entre ce trou noir - ou chat - et cette mort virginale, ou chat...
Écrit par : Marie Gabrielle | 29/05/2008
Bonsoir,
En fait, là, je n'ai pas/plus le temps de faire autre chose autrement que "conduire avec le regard", et donc... m'expliquer (hum), mais je développerai volontiers cet apparent "hors sujet"... plutôt écriture.
Merci de ce possible échange, et à bientôt.
Écrit par : Marie Gabrielle | 29/05/2008
Marie-Gabrielle, merci de votre passage : je ne fais que passer, je vous répondrai dès que j'aurai un peu de temps !
Écrit par : Transhumain | 29/05/2008
Cher Olivier, un doux réveil nocturne et je m'inspire - entre forme et fiction - afin de répondre, un peu plus intuitive, à même une proximité actée...
"Elle n'est pas morte." Répondrait-elle alors debout sur un céans (pardon... séans) ? à cette mort du lieu, d'un lien - ou encore - de passage ? Certainement pas.
C'est la raison pour laquelle j'opérerai aujourd'hui méthodiquement "tempera"... brisons l'oeuf, voulez-vous ? et cessons d'illuminer "seulement de loin en loin" (surtout dans le chapitre second qui serait d'après moi le plus vilain, silencieux, et louche), mais passons.
La posture d'Asensio n'est pas celle de son double - qui ne peut être son narrateur, lui-même objet de sa dissection ! c'est dit, c'est même écrit - sa "méditation" tiendrait-elle du simple fait conviant à l'authentique expérience poétique par l'exemple ; je n'ai vu pour finir aucun légiste... ; la dimension démoniaque n'est pas toujours l'envers de sa version christique, et peut être une transparence oubliée ; enfin si certains livres "restent aussi loin que possible de l'abîme", c'est là ce qu'il serait encore convenu de démontrer...
Personnellement, je n'adhère pas à l'idée d'un aveuglement par le feu ("la lumière aveuglante du feu de la Connaissance"), puisque les "vues de l'esprit" je pris à la lettre.
Cher Olivier, vous serait-il permis de créer votre "propre réseau de trous noirs"... ?
A vous.
Écrit par : Marie Gabrielle | 02/06/2008
P.S. : il serait trop long de chercher ou bien difficile de mémoire, de deviner lorsque c'est vous, ou bien quand et si c'est encore lui (Juan) à penser, donc évoquer, tandis qu'il ne m'a pas semblé possible de m'appuyer totalement sur la présence de guillemets pour me le signifier.
Cela fausse réellement le "jeu" de votre "critique" (ou compte-rendu, mais de quoi ?), d'autant que vous ajoutez de nouvelles références de lectures bien à vous...
Alors voilà, je tenais à le préciser... il y a cette confusion des genres - somme toute à regretter.
Je n'attends pas spécifiquement de réponse, étant seulement contente d'avoir pu reconsidérer ma vision du travail de Juan Asensio qui, en effet, serait à méditer.
Écrit par : Marie Gabrielle | 02/06/2008
tres bien et bon chhansse
Écrit par : mourad | 12/09/2008
tres bien et bon chhansse
Écrit par : mourad | 12/09/2008
Euh. Merssi ?
Écrit par : Transhumain | 12/09/2008
Leurre du théâtre
Dans le domaine artistique j’ai remarqué que des approximations, confusions, franches maladresses, malhonnêtetés littéraires flagrantes, voire parfaites inepties pseudo poétiques étaient admises avec une déconcertante facilité à travers une suspecte approbation d’un public distrait ou peu exigent, lui-même influencé, berné par l’adhésion d’une certaine intelligentsia entérinant ces oeuvres selon des critères n’appartenant qu’à elle...
Par paresse naturelle du public qui ne détecte pas ces incohérences ou n’ose tout simplement pas les relever et les confronter aux auteurs, sottement impressionné qu’il est par l’aura supposée de l’œuvre, ainsi que par coupable mansuétude ou négligence de la part des critiques, des œuvres théâtrales, littéraires, poétiques incompréhensibles, bancales, imbéciles passent à la postérité.
Dés lors, toute appréciation négative de ces oeuvres devient subversion, provocation gratuite, mauvaise foi aux yeux de leurs créateurs et surtout aux yeux des « cultureux » du milieu artistique qui les ont légitimées.
Au théâtre par exemple, lieu privilégié de maintes expériences artistiques post-contemporaines, abus poétiques et nullités littéraires en tous genres, l’imposture artistique est encore plus aisée. Là, les oeuvres (maladroites) supportées avec une telle efficacité par les artifices scéniques les plus variés deviennent miraculeusement beaucoup plus digestes… Dans l’ordre normal des choses de l’art c’est le texte qui devrait supporter la scène et non l’inverse.
J’en ai déduit avec consternation que l’on pouvait donner du lustre à n’importe quelle œuvre hermétique, complexe ou prodigieusement ennuyeuse pourvu qu’elle soit présentée sous forme théâtrale (avec ses faux éclats artistiques) et obtenir de manière certaine des applaudissements nourris ! Et ce, même si personne n’a vraiment rien compris à la pièce ni ne l’a appréciée pour le fond. L’œuvre, médiocre au départ, se perd alors dans les savantes fumées, subtils jeux de lumières du théâtre et de sa magie factice, se pare de l’artificielle noblesse conférée par les masques et capes flatteurs de la scène et, sournoisement, la forme prend le dessus sur le fond.
Et le tour est joué !
Prenant un soudain -et involontaire- relief grâce aux apports techniques et astuces scéniques du théâtre, l’œuvre, aussi infecte soit-elle, est acceptée par la critique -et à plus forte raison par le public- dupés, séduits par la pompe avant-gardiste ou le souffle superficiel avec lequel on a emballé le terne texte original (qui est la base de l’œuvre).
Aux mensonges mondains de ce théâtre prétentieux j’oppose la simplicité, la clarté et l’humour tranchant du théâtre primaire. Ainsi avec Guignol, pas d’entourloupe intellectuelle ! J’apprécie la proximité, la franchise et la crudité de ce spectacle sain, accessible à tous.
Le théâtre contemporain est une sorte de panthéon à la fois populaire et élitiste où quasiment toute oeuvre est officialisée d’office, faussement sacralisée par le simple fait qu’elle a été couchée sur les planches et que, touchée par leurs échos frelatés, elle résonne longtemps dans l’air du temps. Peut-être parce que le plancher du théâtre est finalement beaucoup plus creux qu’on ne le croie… Bref, c’est la reconnaissance par l’apparence. Ici les effets visuels servent à merveille les navets littéraires. Je compare le théâtre à une baudruche qui gonflerait les textes les plus minuscules par simple étalage des mots sur sa surface.
Soyons réalistes : qui a déjà assisté à des sifflements à la fin d’une représentation donnée dans une salle de province ? Evidemment quasiment personne ! Au théâtre chez les spectateurs il existe un processus psychologique collectif perfide et implacable consistant à ne pas sortir de l’ornière, indépendamment du fait que la pièce soit brillante ou nulle.
On ne va pas au théâtre pour faire de l’esclandre littéraire, pour se faire bassement remarquer auprès d’autres gens venus s‘offrir une agréable soirée… Le théâtre n’est pas l’endroit idéal où faire preuve d’honnêteté, d’indépendance de pensée, d’esprit d’analyse. C’est tout simplement un lieu festif et convivial.
Et de fausse réflexion, à mon sens.
Bref, c’est par pur mimétisme grégaire, convenance sociale ou simple courtoisie envers les comédiens que les gens applaudissent.
Ou même, ce qui est beaucoup plus navrant, pour la simple raison qu’ils ont payé pour aller applaudir un spectacle, comme si leurs applaudissements justifiaient le prix du ticket d’entrée parfois chèrement payé.
Qui dans une salle oserait, seul dans son coin et devant toute l’assistance réprobatrice, siffler, huer les comédiens, conspuer l’auteur de la pièce une fois la représentation terminée ? De même, avez-vous déjà vu un mauvais chanteur de rue recevoir des tomates à la face ? Dans la réalité les gens sont évidemment plus diplomates ! Ce que les gens de théâtre prennent pour une discrète adhésion à la pièce n’est parfois, si ce n’est souvent, qu’un poli silence de déception et d’hypocrisie.
Ou d’indifférence.
Dans la grande majorité les spectateurs déçus gardent leurs opinions pour eux, entretenant ainsi le malentendu.
Au final, grâce à une certaine complaisance générale de la part du public et des « officiels » à l’égard de ces écrits mis en scène sur les planches, on peut aisément faire passer à la postérité des oeuvres insignifiantes que n’importe quel lecteur honnête et normalement constitué renierait sans hésiter s’il les lisait dans le texte au lieu de les subir sans discernement au théâtre.
Le théâtre avec ses emphases et solennités -oppressantes ou ridicules- ne laisse ni la place ni le temps à l’esprit de contestation de se manifester, contrairement au texte nu que le lecteur affronte seul dans sa chambre.
Ce texte fut rédigé en réaction à la pièce de théâtre" MON PÈRE, MA GUERRE" à laquelle j'ai récemment assistée. Son auteur ayant pris connaissance de mes réflexions et croyant que je parlais exclusivement de son oeuvre à travers cet article me manifesta son étonnement. Il me semble donc utile d'ajouter ceci en complément à mon article :
A travers mon article ci-dessus je ne parlais évidemment pas de la pièce "MON PÈRE, MA GUERRE" en particulier mais d'une partie de la production littéraire contemporaine en général, dont celle qui est destinée à être jouée sur des scènes de théâtre.
Il est vrai que cet article a été directement inspiré par la pièce "MON PÈRE, MA GUERRE", mais mon discours à travers cet article ne se cantonne pas à cette oeuvre spécifiquement. Disons que la pièce a été un déclencheur après une accumulation de contrariétés vis-à-vis de certains abus artistiques et littéraires.
Les qualificatifs employés ici ne s'appliquent pas tous nécessairement à l'oeuvre"MON PÈRE, MA GUERRE" mais à l'actuelle production littéraire en général d'inspiration "post-modernisme" comme on dit.
Que j'aime ou non la pièce "MON PÈRE, MA GUERRE" n'a rien voir avec mon jugement qui est purement intellectuel, émis avec le plus d'honnêteté possible, indépendamment de mes goûts culturels ou appréciations émotionnelles.
Ici je vais tout simplement jusqu'au bout de la démarche consistant à saisir l'oeuvre dans son entièreté, à la soumettre à l'épreuve du spectateur. Je parle de l'authentique spectateur ici, non du simple quidam sans particulière exigence ne cherchant qu'une passagère et confuse distraction dénuée d'analyse, distraction qu'il aura oubliée une fois passée la porte de sortie du théâtre...
Que l'on comprenne une chose : je ne suis pas là pour m'amuser à dénigrer stérilement une cause mais pour faire preuve d'honnêteté, de courage face à ces oeuvres que l'on me présente.
Applaudir benoîtement est très facile, c'est même une sorte de réflexe grégaire difficile à contrôler et à la portée de tous les publics du monde. Admettre envers et contre tous que l'on est perplexe, insatisfait devant une oeuvre que l'on a perçue comme hermétique, complexe, improbable et préférer faire le choix d'une démarche approfondie dans la réflexion c'est, à mon sens, un acte de vraie liberté en tant que spectateur. Au lieu de subir une oeuvre et d'y adhérer par lâche mimétisme je décide au contraire de lui opposer un regard souverainement lucide.
En allant voir la pièce "MON PÈRE, MA GUERRE" j'ai fait le choix d'aller au-devant de cette oeuvre avec un esprit ouvert, sans préjugé, un coeur sain.
Mais puisque ses subtilités supposées m'ont totalement échappé, je me confronte donc à cette oeuvre avec les armes d'une réflexion honnête et sans complaisance. Je n'ai aucun plaisir particulier à décrier un auteur, une oeuvre, un système. Ma véritable satisfaction est de défendre l'art dans sa justesse, sa vérité, son authenticité.
D'ailleurs les vrais responsables de la "médiocrisation" culturelle et de la prétention littéraire ambiante ne sont pas les auteurs eux-mêmes mais leurs éditeurs, ceux qui leur donnent ce ticket d'entrée officiel pour la reconnaissance. Ce n'est pas vers les créateurs essentiellement que vont mes reproches, loin de là, mais vers les décideurs culturels qui font des choix navrants.
Le manque de perspicacité, de volonté d'approfondir les choses, d'aller jusqu'au bout d'une démarche d'analyse esthétique, artistique, littéraire de la part de la majorité du public contribue à un regrettable malentendu dans le domaine culturel et intellectuel. Une bonne part de "facteur psychologique" influe également (dans le mauvais sens) et par conséquent fausse les jugements, anesthésie les bonnes volontés dans ce processus consistant à appréhender une oeuvre avec le maximum d'honnêteté.
Bref, au cours de ces réflexions, confrontations avec les auteurs (principalement les auteurs de littérature), études des différentes psychologies tant chez les auteurs que chez leur public, examens minutieux des textes "litigieux", exercices de ma sensibilité par rapport à certaines oeuvres -démarche personnelle qui n'a rien d'oiseux- l'évidence s'impose de plus en plus : l'authentique littérature est une eau claire et non une onde trouble, non une atmosphère enfumée, non un nuage d'inextricables pelotes de symboles... Simplicité, clarté, élégance, telles sont, selon moi, les parures chastes, humbles, sobres et belles de l'authentique littérature.
Pour résumer, un véritable auteur n'écrit pas pour lui-même mais pour les autres.
Je compte donner un écho plus général à ces réflexions, dans un second temps.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 15/05/2011
Aucun rapport avec la choucroute, raphie.
Écrit par : Transhumain | 19/05/2011
Transhumain,
Détrompez-vous : la choucroute se meut à l'air libre, contrairement à la saucisse de Bretagne.
Quoi qu'il en soit je suis végétarien.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 19/05/2011
Ecrire pour les autres, hein. Pour QUELS autres ? Tous ? Madame Michu ? John Doe ? Dupont ? Le professeur C. ou H. ou X. ? Pour la lectrice de Musso ou pour l'admirateur de Nabe ? Pour les balzaciens ou pour les adeptes du Nouveau Roman ? Pour Kevin-moi-j'lis-ke-D-textos, ou pour la ménagère de moins de 50 ans ? "Les autres", mon raphounet, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit, sauf, bien entendu, si l'on souhaite vendre beaucoup, auquel cas, "l'autre" c'est "le plus grand nombre".
Je ne connais pas la pièce que vous évoquez, peut-être sa mise en scène est-elle mauvaise, mais n'avez-vous pas l'impression de vous prendre, vous-même, vous seul, raphie, pour "les autres" ?
Écrit par : Transhumain | 24/05/2011
Transhumain,
En effet, tout auteur authentique écrit avant tout et surtout pour être lu, donc pour les autres.
Le reste n'est qu'imposture, baratin, invention stérile, rêverie juvénile, sonobisme, hypocrisie ou mensonge.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 24/05/2011
Transhumain,
En effet, tout auteur authentique écrit avant tout et surtout pour être lu, donc pour les autres.
Le reste n'est qu'imposture, baratin, invention stérile, rêverie juvénile, snobisme, hypocrisie ou mensonge.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 24/05/2011
Vous vous répétez et paraphrasez à tour de bras, mais ne répondez pas. Ecrire pour être lu, c'est une évidence. Mais être lu par qui ? Combien ? Le nombre fait-il loi ? Qui sont ces "autres" pour lesquels vous écrivez ? Et que signifie, concrètement, écrire pour "les autres", sinon rendre intelligible, pour CERTAINS lecteurs - à chaque auteur de déterminer lesquels - des idées, une pensée, un monde qui, sans cette mise en forme, serait inintelligible ? Hermétisme n'est pas autisme, mon raph. Littérature n'est pas que discours. Mieux, il me semble, comme je l'ai déjà dit ailleurs lors d'une discussion similaire, que donner une expression formelle à des idées et à des images mentales, constitue l'acte littéraire lui-même : ça ne dit absolument rien de la manière dont on doit le faire. On écrit toujours pour quelqu'un : pour un lecteur imaginaire. Reste à le qualifier, ce lecteur imaginaire, et je vous souhaite bien du courage. Tant que vous n'aurez pas défini très précisément ce que vous désignez comme "les autres", "écrire pour", "simplicité", "clarté, "élégance" (je n'ose imaginer quel sentiment vous inspire Mallarmé), vous argumenterez dans le vide, j'en ai peur.
Écrit par : Transhumain | 24/05/2011
Transhumain,
Je vais faire bref, clair, simple, élégant.
En effet, le nombre peut aussi faire loi et ici je me réfère à HUGO qui par sa géniale simplicité a su séduire et le peuple et l'élite. Plaire aux foules ne signifie pas nécessairement faire dans la bassesse. Quantité et hauteur ne sont pas choses incompatibles.
Ce que vous avancez est valable aussi dans l'autre sens : on peut également mettre en désordre l'intelligibilité immédiate d'un discours pour lui conférer un lustre imbécile, autrement dit rendre volontairement complexe la simplicité, au nom du snobisme. Ce que font les doctes imposteurs que je dénonce.
Ecrire pour les autres signifie respecter un lectorat en ne lui écrivant pas des sornettes à la mode. Les autres, c'est tout humblement le voisin de pallier qu'il s'agit de convaincre à la force de la plume. Pourquoi aller chercher plus loin ? Le lecteur est dans la rue non sur je ne sais quel foutaiseuse et inaccessible montagne...
Je n'ai rien contre l'hermétisme de Mallarmé car avec lui on sait qu'il n'y a pas imposture, il annonce la couleur si je puis dire.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 24/05/2011
Plaire aux foules n'est certes pas rédhibitoire. Encore une lapalissade, qu'ici personne ne contredira. Mais ne pas plaire aux foules - votre argument - est-il plus suspect ? Allons, allons.
Vos propos sont extrêmement confus. Le voisin de palier, il n'existe pas, vous dis-je. Ou plutôt, si : il est, absolument singulier, unique, il s'appelle Michel, ou Robert, ou Malik, et ce voisin-ci n'est pas ce voisin-là. Respecter son lecteur, c'est la moindre des choses, mais je doute que nous ayons tous une même idée de ce que cela signifie. La littérature n'est pas réductible à des schèmes simplistes, tels que ceux que vous avez rapidement (mais sans clarté ni limpidité, si l'on se fie par exemple à votre manière quelque peu expéditive de ne pas argumenter l'exception Mallarmé...) exposés ici.
Et, tant que j'y suis, n'oubliez jamais cette belle intuition du moraliste Sainte-Beuve : "c'est soi-même encore et toujours qu'on préfère et qu'on célèbre chez les autres. Chaque critique, dans les types qu'il ramène, ne fait que sa propre apothéose."
Écrit par : Transhumain | 24/05/2011
Transhumain,
Au nom de cette diversité littéraire que vous défendez (d'ailleurs à force de la tordre dans tous les sens elle se dénature purement et simplement et certains esprits dégénérés prennent cette bouillie pour de l'art) on en arrive à des aberrations indigestes que l'on tente de faire passer pour des chefs-d'oeuvre...
Non, la littérature n'est pas cette arabesque mentale qui n'en finit pas de se contorsionner stérilement pour la plus grande joie des faux esthètes se masturbant le cerveau.
La littérature est quoi qu'il en soit plus proche de la clarté simpliste que de cette obscure complexité qui a la malhonnêteté de noyer bien des pensées dans l'épaisseur de ses fumées. Dans l'écoeurante complaisance générale de notre époque pour tout ce qui est tordu, hermétique, trouble, il est naturel que la simplicité littéraire -amie de la vertu- soit ainsi dénigrée.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 24/05/2011
Vous dialoguez seul avec vous-même, mon pauvre. Personne, ici, ne dénigre la "simplicité". Vous, et vous seul, avec une morgue invraisemblable - et l'emploi d'un vocable des plus douteux ("esprits dégénérés") -, prétendez détenir quelque vérité révélée sur la forme que doit prendre la littérature, sans pour autant vous appuyer sur le moindre exemple, sans déployer la moindre argumentation. Apprenez, pédant visiteur, que votre petite opinionette, dont vous n'avez toujours pas justifié la présence en ces pages, est très tendance. Vous êtes légion, vous qui ne concevez d'autre littérature que "simple" et "limpide", sans pour autant parvenir à restituer votre pensée autrement qu'en sentences ridicules et en lieux communs sur "notre époque". La critique, ce n'est pas le café du commerce, même dans sa déclinaison la plus grandiloquente.
Écrit par : Transhumain | 25/05/2011
Transhumain,
Votre évidente mauvaise foi (mes propos sont dûment argumentés, contrairement à ce que vous prétendez) est une preuve supplémentaire de la corruption de certains esprits au sujet de la littérature contemporaine : ils ne souffrent pas de saine, honnête et sensée opinion tranchée. J'ai cité HUGO en exemple : aucune fumée verbeuse chez lui. Vous soutenez l'ineptie littéraire au nom d'un anti-izarrisme primaire, me semble-t-il.
En effet, crime impardonnable à vos yeux, j'ose dénoncer l'imposture littéraire de ce siècle et prône le "retour à la terre", c'est à dire le choix volontaire -et vertueux- de l'originelle simplicité du sillon droit, clair et propre de la forme littéraire honnête produisant de bonnes patates bien charnues qui tiennent au ventre. Cette forme nette s'impose universellement aux lecteurs par son immédiate intelligibilité contrairement aux prétentieuses courbes littéraires aboutissant à de vastes espaces... de vent.
La publication de mon premier article n'est pas un acte stérile, elle a été motivée par l'évocation de JUAN ASENSIO en ces lieux, verveux virtuose, brillant intellectuel mais piètre écrivain. Asensio est un authentique pédant qui incarne justement la dégénérescence littéraire de notre époque.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 25/05/2011
Notes sur les notions de poésie et révolution
Ce n’est pas la poésie qui doit être au service de la révolution, mais au contraire la révolution qui doit être au service de la poésie.
Ce que l’on est en droit d’attendre de la poésie, c’est qu’elle nous apporte de la beauté, à savoir : premièrement, une consolation ; deuxièmement, un espoir.
Certains verront dans la beauté un nouvel avatar de l’opium du peuple, une translation de la religion déclinante adaptée au goût du jour. Ce n’est pas totalement faux, mais sans beauté, c’est à dire sans consolation ni espoir, aucun progrès esthétique ou moral n‘est possible.
Tant que l’on ne prendra pas en compte la pluralité consubstantielle à la notion de poésie, toutes les discussions tendant à légiférer dans l’abstrait sur ce qu’elle doit ou ne doit pas être n’aboutiront qu’à la satisfaction de quelques égos et au versement de quelques subventions, à savoir, sur le plan artistique, au néant.
Ce n’est pas le lyrisme, fût-il critique, ou l’anti-lyrisme en qui réside l’avenir de la poésie, mais la conflagration de ces deux modes d’expression, le champ de bataille qui en résulte avec pour horizon inatteignable une impossible Aufhebung, un au-delà de la poésie.
La seule véritable révolution est celle que chacun opère sur soi-même.
La soi-disant « poésie publique », surnommée récemment « vroum vroum » par Roubaud, n’est que la manifestation de l’annexion du vocable « poésie » par les forces institutionnelles du divertissement spectaculaire.
La poésie est individuelle, aristocratique et privée. Elle ne saurait avoir une portée autre qu’individuelle sans se déliter en spectacle de propagande publicitaire destinée à une micro élite ultra favorisée socialement et culturellement, et ne pouvant rivaliser efficacement avec l’industrie du divertissement de masse.
La façon dont nous décrivons le monde montre notre façon d’interpréter le monde. Notre façon d’interpréter le monde détermine notre façon d’y participer. Comment nous participons au monde le transforme.
Paris, le 4 mars 2011
Écrit par : denis_h | 25/05/2011
Ce qui est une certitude en littérature comme en rhétorique, c'est de faire les choses à la lettre sans souci des mots relativement à leur signification intrinsèque. L'inconstance libère l'auteur des exigences de son art. Libre, il jouit de son pouvoir. Ses chaînes brisées lui confèrent justesse et exactitude, rectitude et hauteur. Sa loi fait foi. L'écrivain ne jure que par ces mots-là. Ceci est vrai aussi bien dans le contexte original du grammairien qui, précis, manie avec science et rigueur sa plume, que dans le contexte secondaire de l'auteur pris dans son propre texte. Là il devient auteur, véritablement.
Alors que le lecteur juge selon la capacité de l'auteur à l'émouvoir, le surprendre, l'auteur lui s'engage dans une voie nécessairement inconfortable et cela pour la raison essentielle qu'il possède la clé de son propre enfermement comme de sa libération. Les livres sont sa prison et ses horizons. Obligé qu'il est de reconnaître une si cruelle évidence. Il s'en évade parfois au prix d'un effort surhumain. Justement, là est son pouvoir. Presque magique. Il fascine par ses mots et son imagination est féconde, mais qu'en pense le lecteur au moment où il perd contact avec le réel, déjà emporté par les ailes de l'écrivain ? Oeuvre d'imagination ou rêve éveillé ? Fiction ou récit dans le récit ? Au lecteur de faire la part des choses, de se frayer un chemin dans la forêt de livres que l'auteur lui offre dans la foulée, disert et secret à la fois, bavard et muet. Entre l'auteur et le lecteur, admiration et rejet, fusion et incompréhension.A l'auteur de semer ses petits cailloux dans les méandres des mots qu'il jette au hasard de ses errances livresques, définitivement inaccessible au jugement du lecteur qu'il projette dans une sorte de vie rêvée, tels ces mots noirs jetés sur la blancheur de la page qui nous révèlent soudain la beauté enfantée, obscure, gémissante, douloureuse et prometteuse de l'Oeuvre.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 25/05/2011
Encore ces brèves de comptoir sur "notre époque", hein ma bonne dame.
Vous avez lu mon article (à moins que...) et connaissez donc ma position quant au livre de Juan. Pour autant, je vous laisse la responsabilité de vos propos injurieux à son égard. Votre obsession pour la dégénérescence est franchement suspecte et, si vous poursuivez sur cette voie, je vous demanderai de ne plus fouler cet espace.
Par ailleurs, vous avez cité Hugo, mais dites-moi, en quoi votre name-dropping constitue-t-il un argument ? Définissez "fumée verbeuse". Démontrez en quoi des livres que vous n'avez pas d'ailleurs pas nommés méritent votre mépris. Quel est l'objet de votre intervention ? Que diable me voulez-vous ? Pourquoi la littérature devrait-elle remplir votre cahier des charges personnel ? Croyez-vous vraiment que, lorsque, ce soir, je poursuivrai la rédaction d'une nouvelle à l'hermétisme primesautier - d'une fausse simplicité -, je penserai à vous et à votre conception étriquée (et extrêmement nébuleuse) de la littérature ? Prenez-vous donc vraiment vos vagues péroraisons pour un jugement critique ?
Écrit par : Transhumain | 25/05/2011
Transhumain,
Je n'ai pas tenu des "propos injurieux" à l'égard d'ASENSIO comme vous l'affirmez sottement, j'ai simplement émis des propos critiques, courageux et lucides au sujet de son écriture.
Dire la vérité n'a jamais été une injure. ASENSIO est particulièrement indigeste : voilà une vérité universellement partagée (à condition que son lectorat dupé soit de bonne foi évidemment)...
Je me rends compte que, quels que soient les arguments que j'avancerai, vous les dénigrerez systématiquement pour la simple raison qu'ils sont purement izarriens.
Par conséquent je ne vois pas l'intérêt de poursuivre ces échanges stériles.
Je sais que le temps me donnera raison : seules les patates nourrissantes de la littérature résisteront aux siècles tandis que les champs de fumée s'anéantiront.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 25/05/2011
Transhumain,
Je vais quand même répondre à votre question à travers ce texte extrait de mon blog :
=======
Qu'est-ce que la littérature (izarrienne) ?
La littérature c'est la crème de l'écrit, la crête des textes : le meilleur de la plume.
Comprenons-nous, l'oeuvre de l'écrivain telle que je la définis n'est pas le roman de A à Z avec ses digressions, ses détours, ses détails -superflus ou non-, ses longueurs, ses anecdotes, ses nuits et ses clartés, ses maladresses et ses voyages sans fin, ses médiocrités et ses éclats sans fond, ses artifices et ses petits mots immortels... La Plume c'est tout simplement le sommet des lettres, l'extrait le plus savoureux, sa partie la plus fine, la plus délectable.
L'exemple le plus éminent de ce que sont les hauteurs du verbe -et cela fera sans doute bondir les puristes et les érudits- se trouve dans nos manuels scolaires. Ce que l'on appelle les "livres de lecture". Là sont les morceaux les plus fins issus des plus nobles fruits. Accessibles à tous. Simplicité, clarté, authenticité sont les grandes vertus de cet art que de mauvaises ou bonnes langues nommeront "de base". Les plus grands maîtres ont produit leurs chefs-d'oeuvre non dans les tourments de l'inspiration morbide et de la réflexion tortueuse mais dans la joie et la facilité.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les joyaux de cette "musique de base" se retrouvent dans nos cartables d'écoliers. J'ai abordé, connu, sondé et même parfois appréhendé d'une intuition fulgurante de grands auteurs classiques à travers les fragments les plus éclatants de leurs oeuvres publiés dans les livres d'apprentissage scolaire.
Mes productions izarriennes sont exactement à l'image des pépites que l'on trouve dans les livres scolaires. Depuis toujours j'ai choisi d'écrire non pas des fleuves mais des ruisseaux. Mon histoire intitulée "Tante Jeni", pour prendre un exemple parmi d'autres, pourrait être la perle remontée d'un long et ennuyeux manuscrit. C'est comme si j'avais épargné à l'amateur de belles lettres le fastidieux plongeon dans un pavé pour lui livrer ce qui aurait été l'écume et le sel de l'ouvrage. Ne nous leurrons pas : ce que l'on retient des fresques livresques ce ne sont pas les monotonies mais les sommets. Et le génie de l'artiste, c'est cela précisément : atteindre les nues.
La richesse d'un livre n'est pas dans sa totalité mais dans son essence. L'auteur n'écrit pas de l'or à chaque ligne sur deux cents pages. Il écrit cent pages banales, cinquante excellentes, quarante-sept mémorables et trois immortelles. Est-il utile de s'engager dans un chemin de cent quatre-vingt dix sept pages pour n'en retenir que trois ? Certes on trouvera du plaisir à lire un monument dans sa totalité. Plus que le simple et indolent plaisir des volumes mollement absorbés, plaisir nécessairement dilué à travers les pages, avec mes "fleurs de livres" je m'efforce de faire naître des étincelles dans la tête du lettré. En lui offrant non pas cent quatre-vingt dix sept pages de qualité inégale mais les fameuses trois pages en or. Ce que j'appellerais l'ivresse immédiate, pure, non diluée.
La neige des cimes : voilà ce que sont mes créations. Ainsi définissé-je l'Olympe textuelle. Et c'est ce que je propose aux esthètes à travers mes compositions.
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 25/05/2011
Ha, ha, ha ! très haut et majusculé RAPHOUNET, vous êtes certes de désopilante compagnie, mais je vous prie de bien vouloir quitter ces modestes pages et retourner siéger sur votre trône glorieux dans les nuées. Là est votre place, et non ici-bas, dans notre monde dégénéré et sclérosé. Bye, bye.
Écrit par : Transhumain | 25/05/2011
Bonjour Transhumain
Il dommage pour vous que vous n'ayez pas su apprécier à leur juste valeur les réflexions d'Izarra.
Peut-être qu'avec le temps vous finirez par en apprécier la grâce ?
Sincèrement je vous le souhaite
Cordialement
Écrit par : TTMC | 21/03/2012
Pour moi Asensio est une outrance de la littérature, une aberration des Lettres. Au début je me suis doucement laissé prendre au piège des apparences (de 2001 à 2003) mais peu à peu j’ai compris à qui j’avais réellement affaire : un prétentieux, certes drôle et vif dans ses postures de critique maudit et à travers ses injures scatologiques, mais aussi un clown plus drôle du tout capable de réelle méchanceté envers ses détracteurs, au moins dans les apparences.
Sa conception de la littérature est poussiéreuse, sinistre, comiquement grave, stérilement intellectualisée, à l’extrême.
J’ai vaguement appris qu’il avait eu physiquement affaire avec un certain Erwan ou Ersan, un célèbre blogueur. Echanges de coups entre eux je crois.
J’ai plusieurs fois essayé d’entrer dans son univers austère mais, non content d’arborer le masque de la gravité, son monde est décidément trop touffu, impénétrable comme une jungle, étouffant, soporifique, indigeste et furieux.
Je ne lui reproche pas de ne pas savoir écrire mais seulement de vouloir enfermer les Belles Lettres dans cet inutile carcan intellectuel.
Nombreux sont ceux qui ont eu tristement affaire à Asensio sur le web...
Personnellement ce personnage m’amuse plutôt. En 2001 j’ai raté un rendez-vous avec lui à Paris, dommage... Je n’ai plus eu l’occasion de pouvoir le rencontrer. Mais une de mes amies, Marianne D., a eu ce “privilège” à la même époque.
Bref, tout ce qui touche à l’imposture littéraire me touche, donc parlons-en !
Raphaël Zacharie de IZARRA
Écrit par : Raphaël Zacharie de IZARRA | 21/03/2012
Parlez-en, mais ailleurs.
Écrit par : Transhumain | 23/03/2012