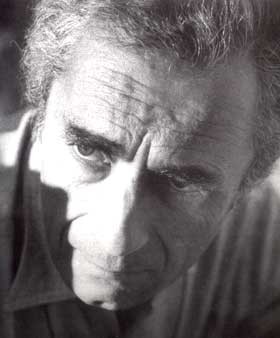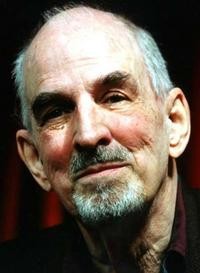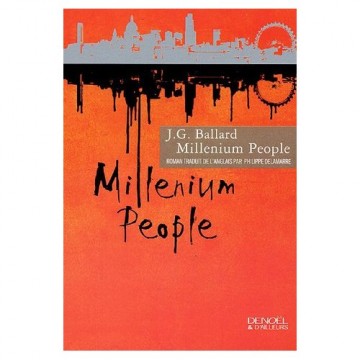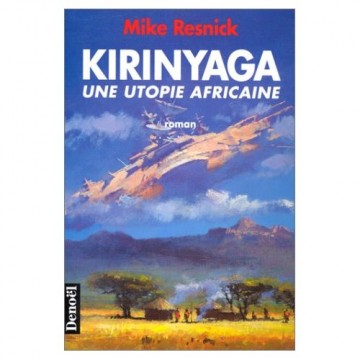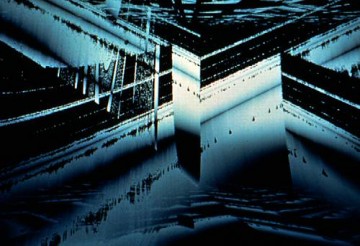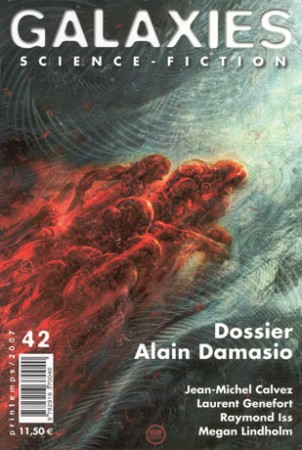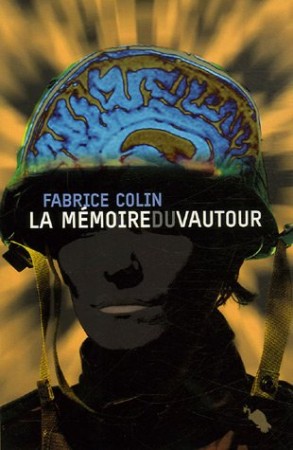
« Je crois que nous perdons l'immortalité parce que notre résistance à la mort n'a pas évolué ; nous insistons sur l'idée première, rudimentaire, qui est de retenir vivant le corps tout entier. Il suffirait de chercher à conserver seulement ce qui intéresse la conscience. »
Bioy Casares, L’invention de Morel
Le nouveau roman de Fabrice Colin paru en avril dernier est un véritable casse-tête pour la critique. La raison en est très simple : La Mémoire du vautour invite ses lecteurs à l’envisager, et à envisager le monde, non pas de manière froidement rationnelle, mais de manière holistique, intuitive, expérimentale. La référence à David Lynch en quatrième de couverture est, pour une fois, plutôt pertinente : comme Inland Empire, le dernier film du cinéaste américain, La Mémoire du vautour ne se laisse appréhender – et apprécier – qui si l’on veut bien abandonner, le temps de quelques heures, le mode de pensée analytique de l’homme occidental, pour arpenter, à la manière du rêveur, des territoires étranges à la temporalité altérée. La Mémoire du vautour n’a jamais besoin d’être compris, il doit avant tout être vécu – il veut s’immiscer dans les zones les plus reculées de notre cerveau, et s’y répandre, comme un virus. Il ne s’agit pourtant pas d’une littérature « ambient » comme celle qu’appelle David Calvo de ses vœux – une littérature plastique, littéralement stupéfiante, que nous devons sentir pour connaître l’extase –, mais bien plutôt d’une forme d’inconscience-fiction, littérature qui, comme le rêve, nous submerge de métaphores et d’images symboliques dont la puissance est avant tout souterraine – cette prose n’est donc pas sans rapport avec la forme particulière du récit poétique. L’émotion nous étreint sans que nous sachions d’abord pourquoi – il serait sans doute exagéré d’en imputer les responsabilité à la seule beauté de certains passages ou à la surdétermination thanatique. Pendant que nous essayons de le plier à notre réalité, ce paysage avec vautour[1] se diffuse dans notre inconscient.
Néanmoins, le critique – qui par son propre désir d’écriture réactive le désir à l’origine de l’œuvre – ne saurait se contenter d’une approche intuitive : quel que soit le projet original, l’œuvre achevée possède une structure, des idées, un réseau de symboles, toujours interprétables. C’est donc au critique qu’il incombe de comprendre pourquoi naît – en lui – cette émotion, c’est à lui de « tirer au clair les potentialités mal élucidées »[2] recélées dans la situation de désorientation provoquée par la stratégie de défamiliarisation[3] du roman. En effet La Mémoire du vautour, comme Inland Empire, n’obéit pas vraiment aux codes narratifs en vigueur, et la plupart des commentateurs ont été déroutés[4], comme on dit d’un programme informatique, par le double jeu d’une œuvre qui ne fait appel au répertoire du familier que pour mieux nous surprendre, pour mieux frustrer notre « attente d’une configuration immédiatement lisible »[5]. Nous perdre, pour que nous nous cherchions. Ces deux œuvres, Inland Empire et La Mémoire du vautour, résistent aux grilles d’analyse trop rigides mais n’en sont pas moins savamment construites, et nous projettent dans des univers singuliers où ce qui importe est moins une certaine idée de cohérence rationnelle, qu’une authentique cohésion souterraine, celle-là même que nous allons tenter ici de mettre en lumière.
Il convient cependant de préciser, en guise de précaution, que cette étude de La Mémoire du vautour ne prétend certainement pas expliquer le roman une fois pour toutes, mais seulement en donner une interprétation, sachant que d’autres sont sans doute possibles[6]. Un texte, surtout de fiction, n’est jamais fermé sur lui-même. Lire, écrivait Paul Ricœur, « c’est, en toute hypothèse, enchaîner un discours nouveau au discours du texte. »[7]. Le critique s’approprie le texte, mêle intimement l’interprétation du texte et l’interprétation de soi. Par ailleurs, et nous nous contentons de paraphraser Ricœur, cette interprétation réflexive n’est jamais qu’une actualisation d’un texte dont le monde est toujours celui du lecteur. Il n’a jamais été question, pour nous, de retrouver une intention originelle, celle de l’auteur, qui, par nature, nous est dissimulée. L’interprétation réussie est alors celle qui nous met « dans le sens » du texte, dans sa direction.
Le sujet de La Mémoire du vautour, à l’évidence, à la fois omniprésent et insaisissable, c’est la mort. Il nous semble toutefois pouvoir dégager deux grands axes de réflexion, que nous nous proposons de développer. Premièrement, la mort en première personne, comme expérience intérieure, impensée car impensable, mais irrémédiablement, et irrévocablement presque vécue : que se passe-t-il, en soi, quand on meurt ? Et deuxièmement, la mort en troisième personne, comme événement universel : que signifie la mort de l’individu en tant qu’elle est un principe du vivant ? La mort a-t-elle un sens ? À ces questions implicites, à ces problèmes ontologiquement insolubles (on ne revient pas de cette ultime expérience, et le sens de la mort – événement dont la quoddité est pourtant absolue – nous demeure à jamais inaccessible), Fabrice Colin ne répond, bien sûr, jamais directement, mais seulement par métaphores. En poète. Mais il y répond : la mort est un processeur d’histoires…
À suivre.
La Mémoire du vautour – 2 – Résumé
La Mémoire du vautour – 3 – La mort impensable
La Mémoire du vautour – 4 – JE est un autre
La Mémoire du vautour – 5 – L'expérience intérieure
À lire aussi :
Entretien avec Fabrice Colin (juin 2006)
[2] P. Ricœur, Temps et récit 3, Paris, éd. du Seuil, « Points Essais » (1985), 1991, pp. 304-309, cité dans P. Ricœur, Anthologie, textes choisis et présentés par M. Fœssel et F. Lamouche, Paris, éd. du Seuil, « Points Essais », 2007, pp. 100-101.
[3] Ibid.
[4] La seule critique qui ait tenté, à défaut de réussir vraiment, de donner une interprétation de La Mémoire du vautour, est celle de Nathalie Ruas sur le site ActuSF (en bas de page, à la suite du compte-rendu d’Éric Holstein). En dépit de trop nombreuses coquilles, son texte ressemble plus ou moins à ce qu’on est en droit d’attendre d’une critique destinée au grand public – à ce détail près que Nathalie Ruas se contente trop souvent de signaler des occurrences, sans forcément chercher à en déterminer le sens (par exemple, elle signale bien le découpage du roman en cinq parties, corrélé avec les cinq maillons de la chaîne Reeltoy, mais sans donner la moindre explication à ce chiffre. Pourquoi pas six ? Ou sept ? Ou vingt-sept ? Nous donnerons plus loin notre propre interprétation).
Mieux écrite, la critique du même livre, sur la même page, par Éric Holstein, s’avère pourtant moins pertinente, voyant de « l’affectation » où nous ne trouvons, quant à nous, que structures et éléments signifiants. Éric Holstein a bien vu que le roman « se propose de s’interroger sur la mémoire et – surtout – la finitude », mais il considère que « Fabrice Colin s’approche de l’abîme primal, mais refuse de regarder au fond », sans comprendre que précisément, comme nous le verrons plus loin, La Mémoire du vautour se situe, dans l’espace comme dans le temps, dans le territoire circulaire de la mort.
Avec Mr C., du Cafard Cosmique, les choses se compliquent sérieusement (si je puis dire). Certes, pour lui, le roman comporte bien des « clés », « mais des clés qui n’ouvrent que des portes qui donnent sur des couloirs sombres, dont les portes sont, à leur tour, fermées à clé. », ce qui n’est qu’une manière de dire qu’il n’a rien compris au roman. La suite le confirme : « Alors je dois être con, parce que j’ai pas tout trouvé. Ou alors, je suis encore plus con, parce que je crois qu’il y a un truc à trouver, et il y en a pas. C’est un truc d’émotion. Mais l’émotion, ben, ça me l’a fait qu’à moitié. Pasque j’étais un peu à l’ouest au milieu de tout ça, à essayer de comprendre. Alors que, peut-être, faut pas. […] “La mémoire du vautour” de Fabrice COLIN, c’est pas désagréable, mais c’est pas vraiment réussi. Mais c’est pas vraiment raté. Je sais, ça fait dégonflé de botter en touche comme ça, on dirait un centriste. C’est juste que c’est exactement ce que je pense. Je n’ai rien à ajouter. Si, tiens : je vais lire un truc simple maintenant. » En fait, si l’on enlève la vaine paraphrase, l’emballage « cool » pour teenagers et l’aveu d’impuissance, il ne reste rien, absolument rien.
La lecture de La Mémoire du vautour par Patrick Imbert dans Bifrost n° 47 (juillet 2007) s’avère du même tonneau.
[5] P. Ricœur, Anthologie, op. cit., p. 98.
[6] Nous esquisserons d’ailleurs, plus loin, une tout autre interprétation, plus simple, peut-être plus proche de l’intention de l’auteur, mais, à bien des égards, moins séduisante…