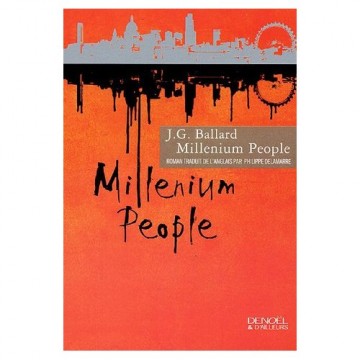
En attendant mon texte sur La Mémoire du vautour de Fabrice Colin, où je me perds corps et âme, et pour que ce blog ne se fige pas pour l’éternité sur la pourtant belle nouvelle d’Alain Damasio, voici, alors que son dernier livre, Que notre règne arrive, est en librairie depuis quelques mois, ma critique de Millenium People de J. G. Ballard parue dans Galaxies n°36, revue, corrigée, et mise en relation avec Kirinyaga, une utopie africaine, le cycle de nouvelles de Mike Resnick.
Depuis ses premiers romans, Ballard a fait subir les pires outrages à notre société de consommation, prenant un plaisir sadique à la détruire par des catastrophes naturelles (Le Vent de nulle part, Le Monde englouti…) ou à lui inventer de « nouvelles psychopathologies » : accidents automobiles comme stimulants sexuels dans Crash !, ou violence organisée et désinhibée dans La Face cachée du soleil et Super-Cannes… Dans ces deux derniers textes déjà, des classes privilégiées se rebellaient contre leur habitus déshumanisé. Millenium People semble radicaliser – politiser ? – sa démarche : faire éclater les schémas sociétaux contemporains sous les coups de boutoir d’une discrète révolution. L’échappatoire à la zombification générale, pour Ballard, serait-elle donc l’insurrection ? Rien n’est moins sûr, vous allez le voir…
Le pessimisme terminal de Millenium People, adouci par un humour désabusé, rend le roman rétif aux enthousiasmes spontanés en dépit d’une thématique qui a pourtant déjà donné naissance à plusieurs chefs d’œuvre ; tandis que dans Crash ! ou IGH, Ballard jouait l’entomologiste sur un échantillon soumis à des conditions extrêmes, nous ménageant ainsi quelque espoir, il prétend cette fois étendre son observation clinique à la « Middle Class » dans toute sa normalité, même s’il concentre l’action sur un quartier résidentiel, la Marina de Chelsea, où, sous l’impulsion d’un psychiatre exalté, les riverains organisent la révolution (ils refusent de payer leurs factures, incendient des voitures…) et forment une cellule terroriste qu’infiltre le psychologue David Markham, sur la piste des assassins de son ex-femme tuée dans un attentat.
À première vue, le roman paraît souffrir d’une forme minimaliste – un style transparent, fantomatique, ayant supplanté la froide poésie urbaine de Crash ! –, au point qu’on s’ennuierait presque. Et pourtant, Millenium People (dont la pertinence, à défaut du génie, ne se révèle qu’après-coup et revient railler nos « molles complaisances » quotidiennes…) ne saurait être jugé sur sa seule incapacité à « divertir » : si Ballard se fait aujourd’hui volontiers cynique – semblant ricaner que lui est vivant et nous, morts –, il n’en reste pas moins prophétique : « Pour la première fois dans l’histoire humaine, un ennui féroce régnait sur le monde, scandé par des actes de violence dénués de sens » Ennui, violence gratuite : les clés d’un monde-parc à thème nihiliste « où tout est transformé en spectacle. » Markham lui-même est plus agi qu’agissant, acteur-spectateur d’un son et lumière à l’intention du « nouveau prolétariat ».
Par certains aspects, Millenium People peut être rapproché d’Identification des schémas de William Gibson. Ces deux auteurs, ça ne surprendra personne, sont en train d’inventer sous nos yeux la science-fiction post-11 septembre, la SF de l’ère de la mondialisation (ou du simulacre, dirait Baudrillard), où le spécifique, l’individu sont gommés par la standardisation généralisée, victimes du désenchantement du monde qui contamine d’ailleurs jusqu’au style lui-même – Millenium People souffre de dialogues démonstratifs et, nous l’avons dit, d’un certain effacement formel, comme si Ballard avait voulu, par l’écriture, simuler cet aplatissement du réel.
Dès lors, la violence seule, comme dans Crash !, semble à même de redonner corps au monde, voire de l’érotiser. Les attentats du World Trade Center constituent logiquement, pour Ballard, une « courageuse tentative de libérer l’Amérique du XXe siècle ». Courageuse, mais inutile ; de même une bombe meurtrière ravive un temps l’ardeur sensuelle de Markham. Le terrorisme n’est pas tant ici la marque d’un choc des civilisations que celle d’une guerre du sens, ce qui nous vaut d’ailleurs les plus belles pages du roman, où Ballard retrouve son art de la métaphore et sa scansion prophétique : « Une bombe terroriste […] produisait une violente déchirure dans le temps et l’espace, brisant la logique qui maintenait le monde en place. » Le monde moderne selon Ballard ressemble à une banlieue sans fin, à un centre commercial peuplé de morts-vivants, cadavre du 20ème siècle que seule une secousse de l’ampleur du 11 septembre 2001 pourrait ranimer. C’est pourquoi les résidents de la Marina , s’en prennent d’abord à des symboles – la Cinémathèque , la Tate Gallery (du « Walt Disney pour classes moyennes » !) – avant de leur préférer des cibles totalement gratuites. Ils cherchent à nous faire réintégrer le réel à coups de bombes incendiaires, sans se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes partie intégrante du spectacle ! Comme le narrateur de Glamorama de Bret Easton Ellis (roman halluciné dans lequel des people s’improvisent poseurs de bombes…), Markham ne cesse de s’interroger sur son identité sociale, incapable de trouver un sens à ses actes. Et comme chez Ellis encore, ces derniers paraissent mis en scène, joués dans un décor factice : Londres prend ici des allures de cliché hollywoodien, signe que la bataille est déjà perdue.
De manière générale, l’homme occidental ballardien est un être privé de désir. La société de consommation prévoit tout, anticipe tout, absorbe tout. Le monde nous refuse en tant qu’individu de chair, de sang et de pulsions, si bien que le monde entier devient son ennemi. Mais depuis Crash ! et sa réappropriation érotique du monde, la Machine s’est étendue. Les actes des personnages de La Face cachée du soleil, de Super-Cannes et de Millenium People sont désespérés. Ils me font penser aux Kikuyus suicidaires de la nouvelle « Le lotus et la lance » de Mike Resnick, qui s’insère dans le magnifique cycle de Kirinyaga (Denoël, 1998). Dans cette « utopie africaine » qui regroupe une dizaine de textes, un peuple kenyan, les Kikuyus, s’est créé un monde pour lui seul sur un planétoïde terraformée, où les Anciens perpétuent les traditions ancestrales, à l’abri des ingérences, sous l’œil sévère de leur sorcier narrateur, Koriba, le mundumugu. Ce dernier est un jour confronté aux suicides rapprochés de trois jeunes hommes célibataires. Au mundumugu, qui ne comprend pas le désespoir de certains membres de son peuple, l’un d’entre eux répond ceci :
« Vois-tu cette chèvre, Koriba ? Sa vie est plus riche que la mienne.
– Ne dis pas de bêtise.
– Je suis sérieux. Elle donne du lait au village tous les jours, elle fait un petit par an, et quand elle mourra, ce sera certainement en sacrifice à Ngai. Sa vie a un but.
– La nôtre aussi. »
Il secoua la tête. « Ce n’est pas vrai, Koriba.
– Tu t’ennuies ?
– Si le voyage à travers la vie peut se comparer à un voyage sur une large rivière, je suis comme à la dérive et sans terre en vue.
Puis, plus loin :
– […] Tout homme a un rêve. Que faudrait-il pour que tu sois heureux ?
– Franchement ?
– Franchement.
– Que les Masaïs viennent sur Kirinyaga, ou les Wakambas, ou les Luos. […] Donne-moi une raison de porter ma lance, de marcher sans entrave devant ma femme quand son dos plie sous son fardeau. […] N’attendons pas d’être assez vieux pour qu’on nous donne de nouvelles terres à cultiver ; disputons-nous avec les autres tribus.
– Ce que tu demandes, c’est la guerre.
– Non, c’est une raison d’être.
Il s’avère donc que les malheureux ne pouvaient pas supporter la vie toute tracée, faite d’oisiveté et de bavardages, qui les attendait. À quoi bon porter la lance, si aucun guerrier Masaï ne menace les siens ? Quel est le sens des traditions dans un monde clos, coupé du reste de l’univers, alors qu’elles se sont précisément construites en rapport direct avec lui ? Le mundumugu finit par trouver une parade, ô combien illusoire, au désespoir de ce jeune homme : il le bannit du territoire des Kikuyus. Il lui offre un ennemi (une raison d’être) : son peuple.
Les classes moyennes occidentales – par classe moyenne, entendez plutôt les classes relativement aisées – sont semblables aux Kikuyus. La majorité se contente du prêt-à-vivre qu’on lui impose, et s’en trouve heureux, mais les éléments discordants se multiplient. On ne compte plus les actes nihilistes commis par des hommes auxquels le sens de leur vie (de leurs actes, de leurs habitudes, des conventions sociales) échappe totalement. Malaise dans la civilisation… Et cependant Ballard, maître de l’anticipation sociale, a toujours une longueur d’avance sur nous. Ces déviants, que Resnick identifie en superbes paraboles, l’auteur de Fièvre guerrière les met en scène depuis plus de trente ans. Ballard se situe au-delà du lotus et de lance. Pour les figurants de Millenium People, la révolution, certes motivée par le même désespoir qui pousse certains habitants de Kirinyaga à se jeter en pâture aux hyènes, n’est qu’une nouvelle lubie, à peine plus excitante que les autres. Tout est rapidement digéré. L’avenir ballardien est sombre. Tellement sombre, en vérité, que l’écrivain a décidé d’en rire. Même Crash !, devenu fétiche socioculturel, est parodié (par l’entremise de la femme de Markham, qui simule un handicap) et les soubresauts sexuels du héros, plus absent que jamais, ne sont rien de plus qu’un réflexe post-mortem.
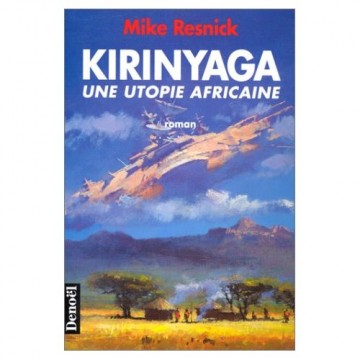
Millenium People de J.G. Ballard
Traduit par Philippe Delamare
Denoël, Denoël & D’Ailleurs, 2005, 22 €, puis Gallimard, Folio, 2006, 7,70 €.
Kirinyaga de Mike Resnick
Traduit par Olivier Deparis
Denoël, Présences, 1999, 21,34 €, puis Gallimard, Folio SF, 7,20 €.


Commentaires
Cette phrase sublime de Ballard, tirée de "Super-Cannes" : "La violence est la poésie du XXIème siècle".
...
Le personnage de Markham me rappelle le héros de La mort blanche de Frank Herbert: un veuf qui cherche du sens quand dans sa vie il ne peut plus y en avoir (dans La mort blanche, il invente une espèce d'anthrax qui ne tue que les femmes, pour venger la mort de la sienne).
Belle note, Olivier!
Roman assez mal écrit (ou alors traduit, je ne sais) sur lequel j'ai failli m'endormir cher Olivier.
Rien n'est vraiment crédible, y compris le lent basculement d'anonymes dans le sectarisme apocalyptique.
Je n'ai jamais été un grand fan de Ballard : pas assez littéraire et écrit comme une fusée Saturn V qui décolle, sans faire de détails en somme.
Samuel Delany ressemble, à côté, à du Gracq.
Tu connais les romans de David Peace ? Par certains côtés, nombre de ressemblances avec ceux de Ballard.
Le tout en mieux (et pourtant tout aussi mal écrit/traduit).
Ah ah, Juan, tu exagères. Millenium People est certes tout aussi amorphe que son personnage, mais relis Crash!, IGH, Vermillion Sands, Fièvre guerrière, Le rêveur illimité ou même Super-Cannes : l'écriture recherche d'abord l'efficacité, mais n'en est pas moins riche. Delany ? Hum, j'ai relu récemment Babel 17, c'est tout de même pas du Gracq. Je préfère Ballard, et de loin. Pas encore lu David Peace. J'attendais que toute sa série soit en poche.Tu dis qu'on ne croit jamais à la révolte terroriste des personnages. Et tu as raison ! C'est pour ça que je parle, dans ma critique, de décor en carton-pâte, de simulacre. On ne peut pas y croire, parce que précisément eux non plus n'y croient pas. Dans Millenium People le monde est peuplé de fantômes, dont même les pulsions n'ont de la vie que l'apparence. Millenium People est le roman d'un monde mort. J'ignore si c'est le fruit d'un travail ou celui d'un talent déclinant, mais le style mécanique, plat, sans relief du livre, s'avère particulièrement pertinent... On ne peut pas dire que ce soit enthousiasmant, mais c'est assez terrifiant. Non ?
Terrifiant ?
Bah non.
Je n'ai même pas eu cette impression : n'importe quel bouquin de Dick, même la besogne alimentaire la plus mal fichue, me fout davantage une sorte de trouille métaphysique (tu vois ce que je veux dire) ou plutôt un vertige, un sentiment diffus d'angoisse.
Ballard s'ennuie et nous ennuie (au passage)...
J'avais relu Sécheresse qui n'est certes pas son plus grand : même sensation d'avancée à pas lents sur des dunes mouvantes donc, accuser deux fois la traduction...
Il faudrait sans doute que je relise les autres que tu pointes mais le souvenir que j'en ai n'est pas phénoménal.
Delany n'est évidemment pas Gracq (tu sais que je lui préfère TRES largement Guy Dupré, d'un simple point de vue stylistique) mais au moins, avec Babel 17, voilà un bon space opera intelligemment mené tout de même : efficace, rythmé, poétique, intelligent.
Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi personne sur Terre n'a pensé à faire de ce livre un film...
Autre sujet.
Tu comptes lire, comme Bruno, le prochain Dantec ?
Je crois que je vais m'abstenir pour ma part.
PS : Peace : toute la série est en poche, sauf le dernier.
Cela te plaira.
Juan, on n'y croit pas un seul instant: bien sûr que tu vas le lire. Tu vas t'agacer tout seul sur le rayon de la librairie, tu vas le prendre et le reposer cinq fois d'affilée, et puis finalement, tu vas le lire d'une traite et... en dire beaucoup de mal... Non?
Non mon cher, je crois que je ne vais tout simplement pas le lire, en tout cas pas avant d'avoir lu ce que vous en aurez pensé car VOUS, je sais bien que vous allez le lire, hein ? Cela me suffira (pour une fois) amplement je crois.
Et puis, j'attends avec une telle impatience la mise en ligne vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment super-méga-officielle et tout et tout du Club syriaco-babylonien des lecteurs de Dantec que, toutes les heures sur Internet afin d'être bien certain de ne pas louper l'événement, je n'ai tout simplement plus le temps de lire...
Ha !
Bah oui, je le lirai... Et en rendrai peut-être compte ici, nous verrons !
Ne manque surtout pas, cher Juan qui guette la naissance de l'assoc' des Babybel, le beau logo qui figure déjà sur la page d'accueil temporaire: www.babylonbabies.org
N'est-ce pas ce genre de choses qu'on appelle d'habitude une "faute de goût"?
qui guetteS, pardon.
Comme moi je vais encore surestimer le livre, il ne te restera guère qu'Olivier pour te forger une opinion... ;-)
S'il ne s'agissait que d'une faute de goût... Le chef des babybels n'est-il pas le garçon qui s'émouvait plus que de raison, sur Ring, des corps riefenstahliens, et de la farouche résistance des spartiates face aux ignobles perses, dans le film 300 ?...
Mais non, Olivier, tu vois le mal partout. C'était son droit le plus légitime d'aimer ce film qui ne fonctionne qu'au premier degré, et pas au second du tout.
Et puis, au fond, un aigle, c'est pas bien méchant. Que je sache, ce bel animal n'a jamais été utilisé dans l'imagerie politique au cours de l'Histoire. Tout juste en littérature, comme dans Tolkien, ou des choses aussi innocentes que Sindbad. Non, vraiment, pas de quoi en faire un fromage.
Oui tu as raison je vois le Mal partout. D'ailleurs c'est l'aigle romain, pas l'aigle nazi. Qui, comme chacun sait, n'ont strictement aucun rapport...
Hum... votre aigle Babybel ressemble plus à l'aigle allemand des armoiries qu'à celui de Rome, Transhumain. Revoyez votre héraldique!
De Ballard, je n'ai lu que Crash! - après avoir vu le film (qui, pour moi, est un culte) - et en version originale.
D'abord, je me demande si la traduction française (que vous semblez avoir lue) ne déconsidère pas un peu de la saveur du vernaculaire anglais-américain. Ensuite, Crash! ne m'a pas impressionnée; le récit, le thème, oui, l'atmosphère mi-réalité, mi virtualité, oui, mais le style, la prose? Non. Je n'y vois pas de la "grande" littérature américaine. Est-il possible que le thème ou le genre de l'ouvrage confère au texte une qualité qu'il ne peut soutenir seul comme le feraient les textes de Thoreau ou de Roth?
Dans le catalogue Airs de Paris, il y a un bel article de B. Bégout sur la suburbia et Ballard, sur l'univers bizarre de la banlieue infinie, et infiniment finie.
Frédéric F.