
JG Ballard at home in Shepperton, in 1988.
Photograph: David Levenson/Getty Photograph: David Levenson/Getty
J.G. Ballard, l'auteur de Crash (pièce maîtresse de sa fameuse « trilogie de béton ») et de L'Empire du Soleil, grand romancier et nouvelliste, est mort dimanche des suites d'un cancer.
Je lui avais consacré plusieurs articles, dont celui-ci, pour un dossier d'ActuSF.
Inner Space : J.G. Ballard (1930-2009) : Biographie
La fiction est une branche de la neurologie
« Ce décès du sentiment et de l'émotion [la mort de l'affect] a ouvert la voie à tous nos plaisirs les plus réels et les plus tendres - dans l'excitation de la douleur et de la mutilation ; dans la sexualité, culture de pus stérile et arène idéale pour toutes les véroniques de nos perversions ; dans notre licence morale de pratiquer comme un jeu notre propre psychopathologie ; et dans nos capacités d'abstraction toujours plus étendues - ce que nos enfants doivent craindre, ce ne sont pas les voitures lancées sur les autoroutes e demain mais le plaisir que nous trouvons nous-mêmes à calculer les plus élégants paramètres de leur mort. »
(J.G. Ballard, « L'innocent comme paranoïaque », 1969, in Millénaire mode d'emploi, éd. Tristram, 2006, p. 115).
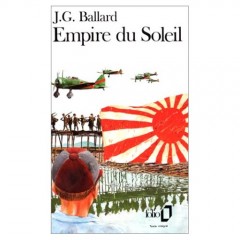 Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l'English Cathedral School jusqu'au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l'abri des affrontements. Après l'attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua - au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille -, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s'inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman L'Empire du soleil, adapté à l'écran par Steven Spielberg, et influencera son œuvre spéculative, comme en témoignent ses obsessions pour l'enfermement, les enclaves communautaires (en 1992, Ballard retournera à Longhua, qu'il trouvera inchangé : « Debout entre les couchettes, je compris que c'était là que j'avais été le plus heureux et m'étais senti le plus chez moi, alors même que j'étais un prisonnier soumis à la menace d'une mort prématurée », racontera-t-il dans un texte publié dans le Sunday Times en 1995) et le devenir-banlieue d'un monde civilisé qu'il perçoit comme un camp, lieu entropique aussi riche en menaces qu'en potentialités (l'une de ses premières nouvelles s'intitulera d'ailleurs « La Ville concentrationnaire »). « [Les] événements dont Ballard fut témoin, transmis à Jim de L'Empire du soleil, préfigurent les scènes de ses autres fictions fantastiques plus explicites. », écrit Luc Sante. « Les piscines asséchées, les banlieues désertées et les autoroutes vidées de Shanghai mutèrent en monde de dévastation hantant les nouvelles catastrophistes de Ballard ». (cf. J.G. Ballard, hautes altitudes, p. 121).
Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l'English Cathedral School jusqu'au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l'abri des affrontements. Après l'attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua - au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille -, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s'inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman L'Empire du soleil, adapté à l'écran par Steven Spielberg, et influencera son œuvre spéculative, comme en témoignent ses obsessions pour l'enfermement, les enclaves communautaires (en 1992, Ballard retournera à Longhua, qu'il trouvera inchangé : « Debout entre les couchettes, je compris que c'était là que j'avais été le plus heureux et m'étais senti le plus chez moi, alors même que j'étais un prisonnier soumis à la menace d'une mort prématurée », racontera-t-il dans un texte publié dans le Sunday Times en 1995) et le devenir-banlieue d'un monde civilisé qu'il perçoit comme un camp, lieu entropique aussi riche en menaces qu'en potentialités (l'une de ses premières nouvelles s'intitulera d'ailleurs « La Ville concentrationnaire »). « [Les] événements dont Ballard fut témoin, transmis à Jim de L'Empire du soleil, préfigurent les scènes de ses autres fictions fantastiques plus explicites. », écrit Luc Sante. « Les piscines asséchées, les banlieues désertées et les autoroutes vidées de Shanghai mutèrent en monde de dévastation hantant les nouvelles catastrophistes de Ballard ». (cf. J.G. Ballard, hautes altitudes, p. 121).
En 1946 il s'installe en Angleterre non loin de Plymouth avec sa mère et sa sœur - qui rejoindront son père en Chine quelques années plus tard -, et entre à la Leys School avant d'étudier la médecine au King's College à Cambridge, en 1949 : il veut devenir psychiatre. Il commence alors à écrire des textes d'avant-garde, déjà fortement influencés par les peintres surréalistes et la psychanalyse, et remporte en 1951 un concours de nouvelles policières organisé par un journal estudiantin, avec « The Violent Noon », l'histoire d'un officier britannique victime d'un attentat terroriste sur fond de conflit asiatique, où perce une manière très personnelle de mêler violence et détails surréalistes. Il n'en fallait pas plus pour inciter Ballard à abandonner la médecine - disséquer des cadavres pendant deux ans, dira-t-il un jour, lui aura permis, après sa troublante expérience du camp de Longhua, de ne pas oublier la valeur d'une vie - pour consacrer plus de temps à l'écriture : il part étudier la littérature anglaise à Londres, avant d'être rapidement « remercié »...
Ballard écrit, vend des encyclopédies et travaille pour une agence de pub. Puis s'engage à la Royal Air Force l'année suivante, en 1953. Il est envoyé dans un centre de formation au Canada. C'est là-bas, dans les magazines américains, qu'il découvre la science-fiction. Il s'y met aussitôt et rédige « Passeport pour l'éternité », hommage et pastiche des récits lus alors. Il quitte la RAF en 1954 et revient en Angleterre, où il rencontre Helen Mary Matthews, qu'il épouse en 1955 avant de s'installer dans un district de l'ouest londonien. Leur premier enfant voit le jour en 1956 (les autres naissent deux ans et trois ans plus tard), l'année où est publiée dans New Worlds sa première nouvelle de SF, « Prima Belladonna », qui inaugure le cycle de Vermilion Sands. Entre 1957 et 1960, Ballard collabore à une revue scientifique (Chemistry and Industry), qui lui fournit un vocabulaire technique dont il pressent le potentiel érotique et poétique, et compose une fiction expérimentale pour panneaux d'affichage, « Projet pour un Nouveau Roman », que la revue New Worlds publiera finalement vingt ans plus tard, en 1978.
Ses nouvelles - qui selon certains ne relèvent pas vraiment de la science fiction, ce qui n'a aucune importance - ne passent pas inaperçues. Quant à son goût pour l'avant-garde, il se manifestera plus tard à la fois dans ses fictions, de « La plage ultime » (1964) à La Foire aux atrocités (1969) - nous y reviendrons -, et dans ses créations expérimentales, pour le magazine Ambit et d'autres revues, dans les années soixante, où il publie de vraies-fausses annonces publicitaires, collages aux titres, aux photographies et aux légendes chocs : « A neural interval » et sa photo tirée d'un magazine bondage (légende : « In her face the diagram of bones forms a geometry of murder. After Freud's exploration within the psyche, it is now the outer world of reality which must be quantified and eroticised » (« Dans son visage le diagramme des os forme une géométrie du meurtre. Après l'exploration par Freud de la psyche, c'est au tour du monde extérieur de la réalité d'être quantifié et érotisé ») ; « Venus smiles » et sa femme nue dont la toison pubienne occupe le centre de la page ; ou « Does the angle between two walls have a happing ending ? » (« Les angles entre deux murs ont-ils une fin heureuse ? »), qui montre une femme en train de se masturber en contre-plongée (image tirée d'un film de Steve Dwoskin), avec cette légende : « Fiction is a branch of neurology : the scenarios of nerve and blood vessel are the written mythologies of memory and desire. Sex : Inner Space : J. G. Ballard » (« La fiction est une branche de la neurologie : les scénarios du vaisseau sanguin et nerveux sont les textes mythologiques de la mémoire et du désir. Sexe : Espace Intérieur : J. G. Ballard »)...
Ballard emménage à Shepperton - où il réside encore aujourd'hui - dans le Middlesex, en 1960 : un lieu qui aura une grande influence sur sa perception du monde. Désirant vivre de sa plume, il écrit et publie son premier roman, Le Vent de nulle part (1962), qu'il considère aujourd'hui comme une œuvre purement alimentaire ne valant pas d'être rééditée, ni même d'être citée dans ses bibliographies. S'il ne possède pas les qualités des romans suivants, Le Vent de nulle part n'est cependant pas un mauvais livre : en décrivant ainsi l'arasement du monde civilisé par des vents monstrueux, Ballard montrait que notre mode de vie basée sur les progrès techniques tient vraiment à peu de choses : une simple augmentation de la vitesse du vent suffirait à la faire s'écrouler irrémédiablement... Le livre paru, il quitte Chem and Industry : désormais, J.G. Ballard est écrivain à part entière. Son deuxième roman, Le Monde englouti (1962), à l'écriture beaucoup plus personnelle, paraît la même année. Sous la houlette de E.J. Carnell, et en compagnie de Michael Moorcock, de Brian Aldiss et de quelques autres, Ballard devient l'un des chefs de file du mouvement New Wave, ouvrant la science-fiction à des thèmes et à des formes insoupçonnés. Pas de conquête spatiale. Pas d'extraterrestres. Mais des paysages dévastés, apocalyptiques, surréalistes, qu'il qualifiera d'espace intérieur, c'est-à-dire « ce point nodal de l'esprit [...] où la réalité extérieure et l'univers mental se rencontrent et se fondent en une vibration unique » (préface à l'édition française de Crash !). Autrement dit, il s'agit moins d'imaginer le futur que d'inventer le réel d'un monde de plus en plus fictif...
 Fortement influencés par les peintres surréalistes (Ernst, Dali, Tanguy, Delvaux...), Le Monde englouti, Sécheresse (1964) et La Forêt de cristal (1966), qui forment avec Le Vent de nulle part un « quatuor apocalyptique », présentent des visions saisissantes, extrêmement picturales, de différentes fins du monde (tempêtes, chaleur et montée des eaux, sécheresse, pétrification), mais il s'agit moins pour Ballard, comme je l'écrivais récemment dans Galaxies NS n°1 à propos du Monde englouti et de Sécheresse, « d'imaginer des catastrophes vraisemblables que d'offrir, avec les moyens de la science-fiction, des tableaux où monde réel et univers psychiques ont fusionné - combler, en quelque sorte, les vacances des espaces intérieurs modernes. Les apocalypses ballardiennes sont donc les récits d'itinéraires mentaux, passage par les personnages d'un monde, concret, à un autre, imaginal. Et dans celui-ci, il devient quasiment impossible de discerner le vrai du faux - si du moins ces valeur y ont encore cours.... Chaque détail, chaque élément de décor, participent à la réification (ou à la « mondification ») de ces espaces intérieurs : Sécheresse, et plus encore Le Monde englouti et La forêt de cristal (qui décrit la cristallisation d'une forêt africaine dont le foyer s'étend inéluctablement), sont des récits hautement schizophréniques dans lesquels l'univers extérieur est réorganisé sous l'emprise d'une présence dont il serait vain de chercher une origine extérieure ou divine. Les personnages ballardiens de cette période renouvellent sans cesse la même expérience psychotique, remodèlent leur monde pour faire face à leurs angoisses. »
Fortement influencés par les peintres surréalistes (Ernst, Dali, Tanguy, Delvaux...), Le Monde englouti, Sécheresse (1964) et La Forêt de cristal (1966), qui forment avec Le Vent de nulle part un « quatuor apocalyptique », présentent des visions saisissantes, extrêmement picturales, de différentes fins du monde (tempêtes, chaleur et montée des eaux, sécheresse, pétrification), mais il s'agit moins pour Ballard, comme je l'écrivais récemment dans Galaxies NS n°1 à propos du Monde englouti et de Sécheresse, « d'imaginer des catastrophes vraisemblables que d'offrir, avec les moyens de la science-fiction, des tableaux où monde réel et univers psychiques ont fusionné - combler, en quelque sorte, les vacances des espaces intérieurs modernes. Les apocalypses ballardiennes sont donc les récits d'itinéraires mentaux, passage par les personnages d'un monde, concret, à un autre, imaginal. Et dans celui-ci, il devient quasiment impossible de discerner le vrai du faux - si du moins ces valeur y ont encore cours.... Chaque détail, chaque élément de décor, participent à la réification (ou à la « mondification ») de ces espaces intérieurs : Sécheresse, et plus encore Le Monde englouti et La forêt de cristal (qui décrit la cristallisation d'une forêt africaine dont le foyer s'étend inéluctablement), sont des récits hautement schizophréniques dans lesquels l'univers extérieur est réorganisé sous l'emprise d'une présence dont il serait vain de chercher une origine extérieure ou divine. Les personnages ballardiens de cette période renouvellent sans cesse la même expérience psychotique, remodèlent leur monde pour faire face à leurs angoisses. »
1964. Sa femme meurt d'une pneumonie à l'étranger, le laissant seul avec trois enfants. C'est à cette époque qu'il commence à intégrer dans son œuvre cette « mort de l'affect » constitutive selon lui du XXe siècle, évoquée en introduction. La mort de son épouse lui aurait-elle, par quelque tortueux déplacement, ouvert les yeux sur celle du sentiment et de l'émotion ?... Cette même année Ballard publie les premières versions de ce qui deviendra La Forêt de cristal, et se lance à corps perdu dans des fictions expérimentales qui nourriront son écriture et aboutiront à l'une de ses œuvres maîtresses, le roman-recueil postmoderne The Atrocity Exhibition (La Foire aux atrocités, qui inspira une chanson à Joy Division), fragments en gros plans de nos mythologies modernes et d'une nouvelle « psychopathologie des relations sexuelles », comme l'écrira William S. Burroughs dans une préface en 1990, « si étrangère et si abstraite que les gens ne seront plus que de simples extensions de la géométrie des situations ». Un certain nombre de célébrités emblématiques (Marilyn Monroe, J. F. Kennedy, Ronald Reagan, Liz Taylor, Ralph Nader, etc.) étaient impliquées dans les fantasmes sexuels des personnages (quelques exemples de titres de fragments : « Projet pour l'assassinat de Jacqueline Kennedy » ; « Pourquoi je veux baiser Ronald Reagan » ; « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy considéré comme une course automobile de côte » ; « La mastectomie réductrice de Mae West »...), ce qui valut à l'auteur quelques ennuis... Ce remodelage de la sexualité et des psychopathologies par la technologie et les médias, fournira également le cadre du roman culte, Crash ! (1973, superbement adapté au cinéma en 1995 par David Cronenberg), qui développe et systématise sous une forme moins radicale certains éléments de La Foire aux atrocités : dans un Londres de chrome et d'échangeurs d'autoroutes, une poignée d'accidentés de la route s'inventent une nouvelle sexualité, cherchant le plaisir ultime dans de violentes collisions reproduisant les crashes de James Dean, d'Albert Camus ou de Jane Mansfield. Le héros de Crash !, nommé James Ballard, vit comme l'auteur à Shepperton ; c'est d'ailleurs près de l'aéroport d'Heathrow, l'un de ses lieux de prédilection, que son personnage rencontre Vaughan, le prophète du groupe d'accidentés. Roman pornographique, métaphore de l'investissement sexuel de l'automobile - fluides mécaniques et corporels se mélangent, voire se confondent ; ainsi Xavier Mauméjean évoquait-il dans une critique une « synchronie entre l'être et la fonction » (« Helen, qui réécrit la mort de son mari dans chaque orgasme automobile, se nomme Remington comme une célèbre machine à écrire, et la femme pompiste pratique des fellations ») -, Crash ! est aussi un grand roman de SF hyperréaliste, vision fascinante et cauchemardesque de notre monde de simulacres en voie de suburbanisation globale.
Selon Ballard c'est dans le dernier tiers des années soixante que Shepperton - où se déroule également Le rêveur illimité (1979) - a commencé à se transformer en « agréable réplique de Los Angeles, avec tous les charmes ambigus, mais capiteux, de l'aliénation et de l'anonymat » (« Shepperton passé et présent » in Millénaire mode d'emploi, pp. 219-220), et à s'annexer à l'aéroport. Peu à peu dans l'œuvre de Ballard, dans ses nouvelles d'abord [1], puis dans ses romans à partir de Crash !, se forme l'image d'une banlieue sans fin, sans centre, telle que Bruce Bégout la décrit dans « Suburbia » (voir notre compte-rendu de lecture de J.G. Ballard, hautes altitudes), grande simulation urbaine - fiction criarde - où nous évoluons (lire aussi le texte de Jean Baudrillard consacré à Crash ! dans Simulacres et Simulation). Dès lors Ballard s'évertuera à nous montrer l'envers du décor qui nous sert d'habitat : Armageddon automobile dans Crash !, îlots sauvages dans les interstices des mégalopoles dans L'île de béton (1974), régression sociale et psychologique dans la verticalité des monades urbaines d'I.G.H. (1975), constituent la « Trilogie de béton », dans laquelle on peut identifier la seconde période de l'auteur (même si ses cycles sont extrêmement poreux), qui tente, comme Dali avant lui, de cartographier l'inconscient de son époque.
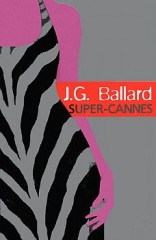 Les romans suivants s'éloignent des mythes de béton et d'acier, comme pour mieux en signifier la chute. Salut l'Amérique ! (1981) dépeint une Amérique post-apocalyptique retournée à la jungle, et Le Jour de la création (1987), splendide version ballardienne d'Au cœur des ténèbres, replonge dans la moiteur hallucinée du Monde englouti. Par ailleurs, il livre deux romans à caractère autobiographique : L'Empire du soleil (1984), best seller mondial déjà évoqué, et La bonté des femmes (1991), sensuelle évocation (romanesque) des femmes qui, du camp de Shanghai au tournage du film de Spielberg, ont traversé sa vie. Mais deux textes, au cœur même de cette période moins « spéculative », augurent de la période suivante. Le Massacre de Pangbourne d'abord, en 1988 (aujourd'hui réédité sous le titre Sauvagerie), court roman sur la « libération » - par la folie meurtrière - d'enfants privilégiés étouffés par la bienveillance de leurs parents, puis La Course au paradis en 1994, annoncent un dernier virage dans l'œuvre ballardienne : l'observation de la middle class oppressée par l'ennui, la consommation, les loisirs et le contrôle d'une société excessivement raisonnable et désormais orpheline de mythes authentiques (« CYBERNÉTIQUE - Les systèmes totalitaires du futur seront dociles et soumis, tels des domestiques super-efficaces, et n'en seront que plus menaçants » écrivait-il dans son « Projet de glossaire du XXe siècle ») Si cette problématique transparaissait déjà dans ses romans antérieurs (dès Crash !, voire même, mais en creux, La Forêt de cristal), et dans certaines nouvelles, comme « Le plus grand parc d'attraction du monde » (1989), elle devient centrale dans La Face cachée du soleil (1996), Super-Cannes (2000), Millenium People (2003) et Que notre règne arrive (2006), quatre romans qui, comme American Psycho de Bret Easton Ellis et Fight club de Chuck Palahniuk, analysent les conséquences du refoulement, dans des milieux aisés, des pulsions de violence : dans ce monde dénué de surprise, où l'idée même de « mythe » relève du simulacre, où l'espace intérieur n'est qu'un simulacre identique à l'extérieur, la folie devient l'unique liberté.
Les romans suivants s'éloignent des mythes de béton et d'acier, comme pour mieux en signifier la chute. Salut l'Amérique ! (1981) dépeint une Amérique post-apocalyptique retournée à la jungle, et Le Jour de la création (1987), splendide version ballardienne d'Au cœur des ténèbres, replonge dans la moiteur hallucinée du Monde englouti. Par ailleurs, il livre deux romans à caractère autobiographique : L'Empire du soleil (1984), best seller mondial déjà évoqué, et La bonté des femmes (1991), sensuelle évocation (romanesque) des femmes qui, du camp de Shanghai au tournage du film de Spielberg, ont traversé sa vie. Mais deux textes, au cœur même de cette période moins « spéculative », augurent de la période suivante. Le Massacre de Pangbourne d'abord, en 1988 (aujourd'hui réédité sous le titre Sauvagerie), court roman sur la « libération » - par la folie meurtrière - d'enfants privilégiés étouffés par la bienveillance de leurs parents, puis La Course au paradis en 1994, annoncent un dernier virage dans l'œuvre ballardienne : l'observation de la middle class oppressée par l'ennui, la consommation, les loisirs et le contrôle d'une société excessivement raisonnable et désormais orpheline de mythes authentiques (« CYBERNÉTIQUE - Les systèmes totalitaires du futur seront dociles et soumis, tels des domestiques super-efficaces, et n'en seront que plus menaçants » écrivait-il dans son « Projet de glossaire du XXe siècle ») Si cette problématique transparaissait déjà dans ses romans antérieurs (dès Crash !, voire même, mais en creux, La Forêt de cristal), et dans certaines nouvelles, comme « Le plus grand parc d'attraction du monde » (1989), elle devient centrale dans La Face cachée du soleil (1996), Super-Cannes (2000), Millenium People (2003) et Que notre règne arrive (2006), quatre romans qui, comme American Psycho de Bret Easton Ellis et Fight club de Chuck Palahniuk, analysent les conséquences du refoulement, dans des milieux aisés, des pulsions de violence : dans ce monde dénué de surprise, où l'idée même de « mythe » relève du simulacre, où l'espace intérieur n'est qu'un simulacre identique à l'extérieur, la folie devient l'unique liberté.
Aujourd'hui Ballard, parfois surnommé « l'Oracle de Shepperton », et devenu officiellement un adjectif (« Ballardian » a fait son entrée au Collins, le Robert anglais), est admiré non seulement d'une partie du lectorat de science-fiction, mais aussi des arpenteurs de la contre-culture, comme d'un public sensible aux métamorphoses du monde contemporain. Et si sa froide dissection des sociétés des loisirs et de l'ennui ne suscite pas toujours l'enthousiasme de lecteurs déstabilisés par un style aussi fantomatique que ses personnages, J.G. Ballard n'en reste pas moins l'un des plus fins écrivains de la postmodernité et l'un des plus fameux auteurs de science-fiction.
Discret sur sa vie privée, Ballard livre début 2008 son autobiographie, Miracles of life (à paraître avant la fin de l'année aux éditions Denoël), et au cours d'une interview révèle son cancer de la prostate, diagnostiqué en 2006, qu'il devrait évoquer dans un nouveau livre, Conversations With My Physician : The Meaning, if Any, of Life, et qui l'emporte finalement le dimanche 19 avril 2009.
[1] : L'émergence de son œuvre romanesque et son succès critique et - parfois - public, ne doivent pas faire oublier le talent de Ballard pour la forme courte. Les quelques cent vingt nouvelles publiées, la plupart dans les années 1960 et 1970, étaient jusqu'ici disséminées dans divers recueils - Vermilion Sands, La Région du désastre, Fièvre guerrière... -, mais une édition des Nouvelles complètes est actuellement en cours aux éditions Tristram (cf. notre critique du premier volume).
Rappel :
« Inner Space : J. G. Ballard : Biographie » ;
Le Monde englouti suivi de Sécheresse ;
Sauvagerie (également connu sous le titre Le Massacre de Pangbourne) ;
Nouvelles complètes 1956 / 1962 ;
J. G. Ballard, hautes altitudes d'Émilie Notéris et Jérôme Schmidt ;



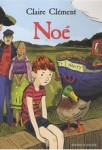 Noé
Noé
 Nous disparaissons
Nous disparaissons Dans la colonie pénitentiaire
Dans la colonie pénitentiaire Incarnations
Incarnations Les malheureux utilisateurs d'Internet Explorer n'ayant pas eu accès à ma dernière note consacrée à La Mémoire du Vautour de Fabrice Colin, je la propose
Les malheureux utilisateurs d'Internet Explorer n'ayant pas eu accès à ma dernière note consacrée à La Mémoire du Vautour de Fabrice Colin, je la propose 