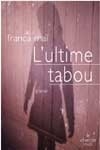
« Las, il restait une contingence purement humaine que je ne pouvais transcender, quel que fût le réconfort spirituel que l’on m’offrait, quelles que fussent les éternités lithophaniques qui m’attendaient, à savoir que rien ne pourrait faire oublier à ma Lolita le stupre infâme où je l’avais plongée. »
V. Nabokov, Lolita.
« Les tourments sont inutiles. Mais je ne peux m’empêcher de penser que je suis fautive. Je devais être là. Et je n’arrive pas à garder la saveur de son baiser. Notre dernier câlin. »
F. Maï, L’ultime tabou
Comme le suggère l’infatigable Marc Alpozzo dans « La parole étouffée » (est ainsi intitulée sa critique de L’ultime tabou prématurément publiée sur son blog ainsi que sur Bellaciao et, bien sûr, sur e-torpedo[1]), la littérature contemporaine – trop lâche, trop inodore, aussi creuse qu’un tronc pourri – « rechigne » à aborder la pédophilie sous un angle moins ambigu, plus frontal, que les suaves obsessions de Humbert Humbert pour la prépubère Dolly dans le roman de Nabokov – « comme si l’acte, écrit Alpozzo, ultime sacrilège, rendait la parole impossible, la douleur et la peine indicible » ou comme si, ajouterais-je, comme si la parole avait été confisquée, structuralement et totalement, à la fois ligaturée par les milices communautaires du politiquement correct, et phagocytée, voire mise à mort par l’armée, chaque jour plus puissante, des faussaires professionnels.
Le dernier audacieux à avoir brisé le tabou, Nicolas Jones-Gorlin, a cruellement subi les frais de la censure médiacratique avec son fameux Rose Bonbon qui adoptait le point de vue d’un pédophile – premier roman de l'ère post-Dutrou. La lecture de quelques passages choisis au hasard, en librairie, m’avaient rapidement convaincu de renoncer à l’acquisition d’un Rose Bonbon que je devinais pathétiquement nul : son humour noir et un style sous-nabokovien dégénéré, tout en calembours de mauvais goût, non seulement me semblaient maladroits, mais surtout paraissaient parfaitement incapables de transcender un sujet trop grave, trop complexe, trop douloureux aussi, pour le traiter avec une telle désinvolture – d’autant plus qu’aucun roman, si je ne me trompe, n’avait encore accordé la parole sinon aux victimes elles-mêmes, du moins à leurs proches : c’était un peu comme si la première fiction sur l’horreur des Camps, après-guerre, avait eu comme personnage et narrateur un nazi certes odieux mais attachant ; comme si ses actes pouvaient être psychologiquement justifiés… Autant dire que si j’aurais défendu sans condition son auteur contre toutes les tentatives de censure étatique ou médiatique, la littérature en sortait néanmoins avilie.
Le cas du roman fantastique de Louis Skorecki, paru également en 2002, est sensiblement différent. Il entrerait dans la légende (prix Sade 2003) évoque en 2323 séquences les viols et les meurtres de femmes de plus en plus jeunes, par un narrateur monstrueux, noir comme l’obscurité, serial killer de cauchemar, ogre sexuel tout droit sorti d’un conte de fée infernal, abîmé dans l’envers de l’amour fou. Ici, la naïveté d’un style scandé jusqu’à la nausée est grandement légitimé par l’espèce de candeur immorale du monstre. Même s’il n’arrive pas à la cheville du Georges Bataille d’Histoire de l’œil, même si son croquemitaine moderne n’est pas aussi significatif, loin s’en faut, que les tueurs emblématiques de Bret Easton Ellis (American Psycho) et Eric Bénier-Bürckel (Un prof bien sous tout rapport), Il entrerait dans la légende ne méritait en tout état de cause ni le harcèlement judiciaire, ni la conjuration critique dont il fut victime à l’instar de Rose Bonbon.
Les violeurs d’enfants, de Lolita à Il entrerait dans la légende, avaient donc leurs héros. Mais les victimes ?...
L’ultime tabou, le nouveau roman de Franca Maï (dédicacé à l’innocence dépossédée), vient donc combler cette intolérable lacune, en s’attaquant de front à cette abominable menace qui pèse, ne cesse-t-on de nous rappeler à longueur de faits divers, sur nos enfants. L’auteur, dont je ne connaissais pas l’œuvre, tente en effet courageusement de dire l’indicible – la souffrance d’une mère dont la fille a été violée, torturée puis assassinée par un psychopathe – avec une conviction morale inébranlable, sans ambiguïté, sans fioriture. Composé de chapitres très courts (une page ou deux, parfois un simple paragraphe), L’ultime tabou commence aussi brutalement que possible, après que les faits ont eu lieu : la gendarmerie apprend à Madame Alvy que sa fille a enfin été retrouvée – morte. Suit l’identification à la morgue, insupportable : « J’ai découvert alors la chair carbonisée par endroits, le visage méconnaissable défiguré par les coups, les cheveux ébène détachés enlaidis de plaques séchées de sang, la robe retroussée et une petite chaussure blanche résistant encore aux assauts fatidiques. Des vers luisants grouillaient dans les orbites, attaquant avec férocité des lambeaux de peau. Non, ce n’était pas ma fille !... ce corps en décomposition ne pouvait être elle. Je ne voulais pas de cette monstruosité » (p. 11). L’image de la petite Betty rongée par la vermine, la bouche emplie de terre, va hanter la mère. Après cette description très crue du cadavre de l’enfant, aussi brève qu’insoutenable, Franca Maï se refusera à toute complaisance supplémentaire. Par sa violence, par sa force d’évocation, ce passage traumatique est également gravé dans l’esprit du lecteur – à mesure que l’intrigue (ténue et, nous le verrons, trop « ficelée » comme on dirait d’un jambon), à mesure, donc, que l’intrigue progresse, le lecteur est lui aussi poursuivi par cette vision d’une horreur et d’une tristesse infinies – ce corps, ce visage absents qui seuls soutiennent un roman par ailleurs abandonné par le souffle.
Le voisin de madame Alvy, monsieur Bernard, est alors arrêté, suscitant bientôt la haine d’habitants rendus hystériques par la monstruosité du crime – Franca Maï rend bien compte, avec une étonnante économie de moyens, de l’animosité barbare dont la foule est capable dans certains circonstances... Cette arrestation ne lui est cependant d’aucun secours :
« Qui pourrait réveiller ma fille ?
« Lui enlever la terre de la bouche
« Coller ses dents cassées ?
« Recoudre son hymen ?
« Rapiécer les lambeaux de chair brûlée ?
« Qui pourrait me la rendre comme avant ? » (pp. 29-30)
L’inculpé est relâché. Il est innocent. Monsieur Bernard s’invite alors chez madame Alvy et entreprend de lui conter son histoire – quelques bribes par jour –, celle qui lui valut jadis d’être condamné. Il est un « pédophile abstinent », malade mais suffisamment conscient pour ne pas passer à l’acte. Ce qu’il a vécu, et qu’il vit encore intérieurement, comme une authentique et pure histoire d’amour – Franca Maï prend acte de l’existence de telles amours, fussent-elles immorales –, est toutefois dénoncé par madame Alvy comme une lâcheté coupable. Même s’il n’a jamais pénétré celle qu’il appelle Reine, monsieur Bernard a abusé de sa candeur, de ses émois de préadolescente en mal de séduction – « Mais vous êtes une ordure. La pire des ordures. Vous avez brisé une vie. » (p. 83). Ces dialogues entre le pédophile abstinent et la mère désespérée, s’ils révèlent une grande sensibilité et une finesse de jugement assez inattendue, sont hélas parfois aussi digestes que la transcription d’un café philo (voir les pages 60-61)… Dès que l'auteur s'éloigne de l'univers mental de son personnage, le récit s'embourbe dans les discours d'où la littérature, à son tour, est absente..
Madame Alvy, de son côté, reçoit des vidéos enregistrées par le tueur. Le roman voit alors alterner le récit de monsieur Bernard et le visionnage des cassettes par madame Alvy. La première montre Betty s’amuser à une petite fête – sa dernière fête, précisément celle qui coïncida avec sa disparition – ; la seconde la montre danser puis s’éclipser pour se diriger vers les toilettes... N’en dévoilons pas plus. Peu à peu la vérité se fait jour, abjecte, impensable. Un tel procédé emprunté au thriller aurait été profondément choquant – et ne manquera pas, j’en fais le pari, de faire bondir les garants du nouvel ordre moral – si Franca Maï, concédons-le, n’avait toujours observé une pudeur exemplaire. Certes, à chaque nouveau visionnage, l’auteur crée un suspense qui nous fait entrevoir les portes de l’abjection littéraire, mais cette technique douteuse est systématiquement désamorcée – jusqu’à la vengeance finale, étouffée avant même d’avoir pu se concevoir nettement –, comme pour mieux identifier, dénoncer et enfin exorciser nos pulsions malsaines de voyeurs drapés dans nos certitudes morales. Ainsi lorsque madame Alvy visionne l’enregistrement du supplice de sa fille, elle nous écrit la seule phrase acceptable : « Je ne raconterai rien » (p. 73).
Entreprise des plus vaines en vérité – et des plus blessantes. Sans doute aurait-il mieux valu en effet ne jamais résoudre l’énigme, désintégrer l’affaire des cassettes et laisser la pauvre femme se débattre avec ses fantômes ; en nous révélant non seulement l’identité du coupable, mais de surcroît le fin mot de l’histoire – comme chez Agatha Christie, comme s'il s'agissait du simple vol d'une potiche –, l’auteur s’interdit en effet de laisser transparaître une réflexion universelle – ne nous est administrée qu'une leçon aussi inefficace qu'extrêmement désagréable : sauf la poignée de cinglés qui se procureront le livre pour d'inavouables raisons, les lecteurs normalement constitués n'auraient pu supporter la description de l'abjection. Et si le style de Franca Maï, d’une manière très anglo-saxonne, réussit dans un premier temps à transmettre quelque écho de l’indicible douleur évoquée plus haut, il s’enlise ensuite dans l’exercice romanesque et ne survit pas à la métamorphose de cet elliptique roman noir en explicite, manipulateur et trivial roman policier. Une épure rigoureuse n’aurait conservé de L’ultime tabou que quelques pages de détresse, l’exploration de l’espace intérieur complètement dévasté d’une mère dépossédée de son enfant – cette absence intolérable, on le devine, était l’ossature invisible du roman. Je déplore pour ma part qu’à la Littérature Franca Maï ait préféré la pédagogie retorse et velléitaire.
Franca Maï, L’ultime tabou (Paris : le cherche midi, 2005), 132 pages, 13 €.
[1] Franca Maï est en effet la principale rédactrice d’e-torpedo.


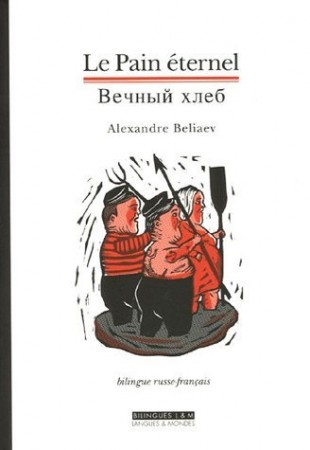


 Sous forme de dossier d’instruction (transcriptions d'écoute, articles de journaux, lettres, etc.), Reproduction interdite déroule son implacable démonstration avec une rigueur, une froideur d’entomologiste qui renvoie au lecteur ses lâches compromissions. Le juge Norbert Rettinger, avec l'aide de la belle commissaire de police Nora Simonot, exhume une affaire d'ampleur internationale, mettant gravement en cause divers gouvernements et multinationales, et ébranlant la puissante industrie du clone. Nous sommes en France, en 2037. Les clones humains, génétiquement amputés d’une petite partie du cerveau et donc profondément débiles, sont depuis longtemps utilisés à des fins médicales (transplantations d'organes, transfusions sanguines, expériences diverses...), industrielles (recyclage des déchets...) et militaires (chair à canon), depuis que les dernières résistances d'ordre éthique ont été balayées grâce, entre autres, à l'acceptation par l'Eglise de la non-humanité du clone, désormais considéré comme un robot organique, sans plus de droit qu’un autocuiseur. Tout le monde s'en accommode, vous, moi, vos enfants, sauf quelques agitateurs subversifs volontiers qualifiés de terroristes fanatiques. Mais à la suite de divers rebondissements, les millions de clones « élevés » dans le camp CP24 doivent être supprimés, de la même façon qu’un cheptel d’animaux est aujourd’hui abattu dès que plane un soupçon de contamination par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Entre temps, Rettinger aura appris à considérer les clones, qui pour lui n’étaient que de la chair à son service, comme ses égaux en droit.
Sous forme de dossier d’instruction (transcriptions d'écoute, articles de journaux, lettres, etc.), Reproduction interdite déroule son implacable démonstration avec une rigueur, une froideur d’entomologiste qui renvoie au lecteur ses lâches compromissions. Le juge Norbert Rettinger, avec l'aide de la belle commissaire de police Nora Simonot, exhume une affaire d'ampleur internationale, mettant gravement en cause divers gouvernements et multinationales, et ébranlant la puissante industrie du clone. Nous sommes en France, en 2037. Les clones humains, génétiquement amputés d’une petite partie du cerveau et donc profondément débiles, sont depuis longtemps utilisés à des fins médicales (transplantations d'organes, transfusions sanguines, expériences diverses...), industrielles (recyclage des déchets...) et militaires (chair à canon), depuis que les dernières résistances d'ordre éthique ont été balayées grâce, entre autres, à l'acceptation par l'Eglise de la non-humanité du clone, désormais considéré comme un robot organique, sans plus de droit qu’un autocuiseur. Tout le monde s'en accommode, vous, moi, vos enfants, sauf quelques agitateurs subversifs volontiers qualifiés de terroristes fanatiques. Mais à la suite de divers rebondissements, les millions de clones « élevés » dans le camp CP24 doivent être supprimés, de la même façon qu’un cheptel d’animaux est aujourd’hui abattu dès que plane un soupçon de contamination par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Entre temps, Rettinger aura appris à considérer les clones, qui pour lui n’étaient que de la chair à son service, comme ses égaux en droit. Si la SF contemporaine n’est pas aussi riche que celle des années soixante, soixante-dix — son véritable « âge d’or » avec les chefs d’œuvre de Dick, Brunner, Spinrad, Disch, Silverberg, Jeury, Curval, Ballard, Herbert, Vonnegut, etc. ―,
Si la SF contemporaine n’est pas aussi riche que celle des années soixante, soixante-dix — son véritable « âge d’or » avec les chefs d’œuvre de Dick, Brunner, Spinrad, Disch, Silverberg, Jeury, Curval, Ballard, Herbert, Vonnegut, etc. ―, 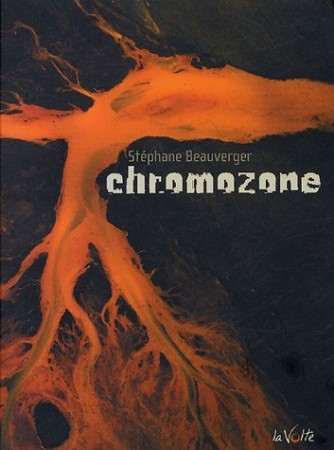 Chromozone est un récit choral, à l’anglo-saxonne, qui nous fait suivre en alternance et à la troisième personne les aventures de Gemini — jeune prisonnier d’un camp de réfugiés dominé par les violents Keltics —, de Teitomo — flic pur et dur qui travaille pour le plus offrant dans les « zones de couleur » communautaires de Marseille —, d’Ogre — machine à tuer pour qui « il n’y a plus de place en ce monde pour la bêtise », véritable leitmotiv du roman —, de Justine — femme (à poigne) de l’inventeur d’un éventuel antivirus révolutionnaire —, et de Khaleel — homme génétiquement modifié qui traite les informations phéromoniques et fournit ses synthèses sous forme de sueur, avant de se découvrir un effrayant don de prescience… Dans ce futur proche en effet, les technologies informatiques ont été anéanties par un mégavirus militaire, le « Chromozone », qui a contraint les consortiums et multinationales à développer un nouveau mode de communication et de stockage de l’information : les phéromones… La catastrophe a eu une autre grave conséquence : les nations ont éclaté en communautés, en territoires ethniques ou tribaux — Beauverger n’est cependant jamais caricatural —, abandonnant l’ordre public et la justice à des milices privées — c’est la loi de la jungle urbaine ; dans Chromozone, seuls les plus forts et les plus malins survivent, souvent au détriment des autres.
Chromozone est un récit choral, à l’anglo-saxonne, qui nous fait suivre en alternance et à la troisième personne les aventures de Gemini — jeune prisonnier d’un camp de réfugiés dominé par les violents Keltics —, de Teitomo — flic pur et dur qui travaille pour le plus offrant dans les « zones de couleur » communautaires de Marseille —, d’Ogre — machine à tuer pour qui « il n’y a plus de place en ce monde pour la bêtise », véritable leitmotiv du roman —, de Justine — femme (à poigne) de l’inventeur d’un éventuel antivirus révolutionnaire —, et de Khaleel — homme génétiquement modifié qui traite les informations phéromoniques et fournit ses synthèses sous forme de sueur, avant de se découvrir un effrayant don de prescience… Dans ce futur proche en effet, les technologies informatiques ont été anéanties par un mégavirus militaire, le « Chromozone », qui a contraint les consortiums et multinationales à développer un nouveau mode de communication et de stockage de l’information : les phéromones… La catastrophe a eu une autre grave conséquence : les nations ont éclaté en communautés, en territoires ethniques ou tribaux — Beauverger n’est cependant jamais caricatural —, abandonnant l’ordre public et la justice à des milices privées — c’est la loi de la jungle urbaine ; dans Chromozone, seuls les plus forts et les plus malins survivent, souvent au détriment des autres.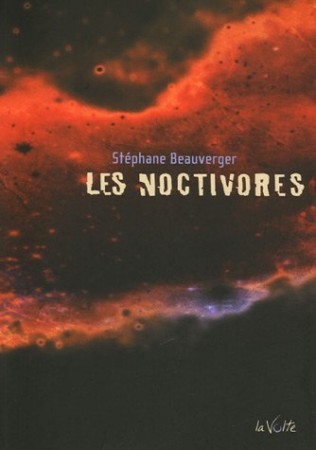 La narration des Noctivores, suite directe du précédent, est plus linéaire. Huit ans après les massacres de Marseille, une version mutante du virus Chromozone qui exacerbe la violence de ses hôtes divise le territoire entre « zombies » contaminés et éléments « sains ». Deux génies se disputent alors le pouvoir : Khaleel, le prophète doué de prescience reclus dans son bunker, a développé un contre-virus technologique aux effets insidieux tandis que Peter Lerner, inexpugnable démiurge à l’origine de la pandémie, phagocyte littéralement l’humanité avec ses hordes de Noctivores. Cendre, jeune Sauveur des Soubiriens Révélés doué d’un terrifiant pouvoir ― par la prière, il foudroie les porteurs du virus ― et jeté au cœur du maelström, devient l’enjeu de ces deux grands manipulateurs. Mais quand les renégats d’Ouessant et les bombardiers Chamans s’en mêlent, le chaos menace de détruire cet ordre précaire. Comme l’assènent sans arrêt les sbires post-humains de Peter Lerner, « il est peut-être temps d’en finir avec la violence »…
La narration des Noctivores, suite directe du précédent, est plus linéaire. Huit ans après les massacres de Marseille, une version mutante du virus Chromozone qui exacerbe la violence de ses hôtes divise le territoire entre « zombies » contaminés et éléments « sains ». Deux génies se disputent alors le pouvoir : Khaleel, le prophète doué de prescience reclus dans son bunker, a développé un contre-virus technologique aux effets insidieux tandis que Peter Lerner, inexpugnable démiurge à l’origine de la pandémie, phagocyte littéralement l’humanité avec ses hordes de Noctivores. Cendre, jeune Sauveur des Soubiriens Révélés doué d’un terrifiant pouvoir ― par la prière, il foudroie les porteurs du virus ― et jeté au cœur du maelström, devient l’enjeu de ces deux grands manipulateurs. Mais quand les renégats d’Ouessant et les bombardiers Chamans s’en mêlent, le chaos menace de détruire cet ordre précaire. Comme l’assènent sans arrêt les sbires post-humains de Peter Lerner, « il est peut-être temps d’en finir avec la violence »…