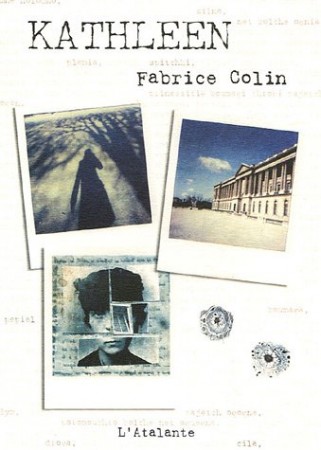
« Mon esprit est à peu près mort. La source de ma vie est tellement amoindrie que c’est à peine si elle n’a pas tari. Presque toute cette amélioration de ma santé n’est que faux-semblant – que comédie. […] Qu’est-ce donc que ma vie ? C’est l’existence d’un parasite. »
K. Mansfield, Journal.
La meilleure façon d’entrer dans l’univers dramatique de Kathleen de Fabrice Colin – l’un des plus impressionnants romans parus cette année – n’était sans doute pas la froide analyse, encore qu’une telle chose soit possible et, je n’en doute pas, passionnante. Fin de partie vous propose plutôt, une fois n’est pas coutume, une lecture fragmentaire où s’entrechoquent des extraits du roman et mes commentaires. Beaucoup d'éléments seront ici révélés, mais cela ne devrait pas, il me semble, atténuer la magie du texte. Et dans quelques jours, vous découvrirez un long entretien qui devrait en inciter plus d’un à s’intéresser à l’œuvre de cet écrivain de premier ordre.
*
Nous pouvons diviser Kathleen en trois grands niveaux de récit (plus un quatrième, enchevêtré avec le troisième) :
A) À Paris, en 2005, Charles Walker se rend au chevet de son père, Louis Pardieu, dont la mort est imminente. À mesure que les souvenirs et les questions affluent, le mystère qui entoure Louis paraît s’épaissir irrémédiablement. A-il réellement rencontré et aimé Katherine Mansfield ? Quel rôle a-t-il joué auprès de Georges Gurdjieff, le mage caucasien d’Avon et de Saint-Germain ? Charles, tourmenté, reproche à son père d’avoir menti sans cesse, de ne lui avoir jamais révélé la vérité.
B) La vérité, serait-ce ce que nous apprend le « récit de vie » de Louis, biographie de sa jeunesse qui semble d’abord émaner d’un énonciateur omniscient, mais qui s’avère in fine avoir été rédigé par Louis lui-même ?...
C) Dans d’autres pages, sur une colonne plus étroite, un autre narrateur (sans doute Louis, à nouveau) nous conte son étrange périple dans un monde en guerre contre des machines et, incises dans les marges gauche et droite de ce récit fantastique, de poétiques incantations – pensées de Louis malade – évoquent Katherine Mansfield (l’Amie) comme s’il s’agissait d’une déesse adorée.
Enfin, reproductions de polaroïds et dessins épurés complètent le tableau…
D’apparence complexe, Kathleen est pourtant construit assez simplement, puisque se succèdent très exactement sept séries ABC, ce qui donne : ABC/ABC/ABC/ABC/ABC/ABC/ABC.
*
« Il ne croyait ni aux fantômes ni aux hallucinations. Il croyait au souvenir. Il croyait aux images et à la force du désir. »
*
La Kathleen du titre, c’est Katherine Mansfield, née Kathleen Beauchamp, nouvelliste morte à 35 ans, dont l’œuvre vient d’être rééditée chez Stock[1]. Son souvenir obsède Louis Pardieu, qui fit plus que la croiser au Prieuré d’Avon, au point que sur son lit de mort, ses dernières pensées, à supposer qu’il s’agisse bien d’elles dans les marges du récit fantastique, lui sont consacrées (vous serez là vous aussi, Kathleen – vous serez là.). Notons que c’est essentiellement dans ce texte onirique, voire surréaliste, que l’écrivain est désigné sous son véritable prénom.
*
Louis passe son enfance au Prieuré des Basses-Loges d’Avon, dans la forêt de Fontainebleau. Son père, Mathurin, en est le gardien, pour le compte de Margaret Labori, épouse de Fernand Labori, le célèbre avocat de Louis Dreyfus. Mathurin est un homme jaloux, sans doute parce que sa mère, Justine, est une femme très belle. Ta mère est une putain, répétaient les autres enfants. Ta mère est une putain !
*
« La suite ? Tu parles de la suite, Poopdeck Pappy ? Mais, putain, on la connaît par cœur, la suite, la suite c’est : un homme debout au bord du lac avec les montagnes fumantes en arrière-plan, la suite c’est : une saloperie de barque vide qui revient vers nous en oscillant, la suite c’est toi – toi et tes larmes silencieuses, toi qui te retournes vers ton fils, le menton tremblant d’angoisse, toi et tes lèvres qui remuent et ton regard qui brille, presque heureux – et ces mots, ces mots qui ont tant de mal à sortir : Katerina a disparu. »
*
Après Or not to be en 2002 et Sayonara baby en 2004, Kathleen est le troisième roman de Fabrice Colin publié par L’Atalante. Dans Or not to be, le schizophrène Vitus Amleth de Saint-Ange était hanté par des souvenirs qui semblaient être ceux de William Shakespeare lui-même ; et le personnage de Sayonara baby paraissait composé d’un patchwork instable d’identités aussi floues qu’innombrables. A priori, c’est un mal plus banal – mais non moins dramatique – qui frappe le héros de Kathleen, Louis Pardieu, puisque celui-ci, mourant et hanté par Katherine Mansfield, présente tous les symptômes de la maladie d’Alzheimer.
*
À mesure que les pièces du puzzle s’assemblent, Louis Pardieu (re)prend vie, riche de plusieurs existences, de drames et de passions. L’oubli et la mort, qui l’attendent irrémédiablement, auront été vaincus par les textes qu’il aura laissés. Qui est-on vraiment ? Sommes-nous les mêmes, à des époques et en des lieux différents ? Comme le vieillard de Big Fish, le film de Tim Burton, Louis préfère l’illusion, la légende, c’est-à-dire l’imaginaire, à la stricte restitution des événements, au risque de désorienter son propre fils. Impossible de ne pas y voir la profession de foi de Fabrice Colin qui, s’il n’est pas homme à acquiescer aux fadaises des marchands d’opium, s’est toujours efforcé de soumettre les événements de ses romans à un travail de contournement semblable à celui qu’imposent au rêveur les instances de l’inconscient. Ainsi de Kathleen, qui refuse de réduire son personnage à une série de faits consignés dans les registres – comme les nombreuses morts qui l’entourent, autant de plaies (ou de stigmates) qui altèrent profondément sa vision du monde. Ainsi également du Syndrome Godzilla, où les conflits intérieurs du jeune narrateur dépressif, s’intriquent avec le désespoir d’un personnage, Godzilla, dont on ne sait s’il est vraiment réel, ou s’il n’est qu’un fantasme.
*
Dans La possibilité d’une île, l’excellent dernier roman de Michel Houellebecq, la vie de l’humoriste Daniel est commentée par ses tristes clones qui, malgré une réduction génétique leur épargnant toute émotion, se rendent évidemment compte que l’angoisse de la vieillesse de leur ancêtre, n’était que le corollaire d’une irrépressible envie de vivre et d’échapper à sa condition d’homme ordinaire.
Dans Kathleen, c’est Louis Pardieu lui-même, en pleine possession de ses moyens (sa biographie), délirant (son récit de science-fiction), ou au seuil de la mort (le monologue intérieur des marges) qui prend son histoire en main. Chez les deux auteurs, que par ailleurs tout sépare, la mort est l’élément central, le cœur du récit, l’obstacle à contourner, rarement désigné mais omniprésent.
*
Au travers de ce dialogue impossible entre un père, à l’esprit dévasté, et un fils rancunier, nous assistons aussi à la confrontation d’un passé littéraire, magique, terrible et romantique (Gurdjieff, Mansfield, les excès mélodramatiques de la biographie de Louis) et d’un présent désenchanté où Google et le téléphone portable interdisent toute construction lente de la personnalité ou d’une relation, et phagocytent l’imaginaire. Comme la plupart des fictions de Fabrice Colin, y compris ses récits de fantasy tels les trois tomes du cycle de Winterheim, Kathleen est un roman du désenchantement du monde.
*
« Les mots sont de petits bouts de papier, deux ou trois en général, déchirés par la main du ciel, éparpillés sur l’herbe – assurément destinés à ma sagacité. De simples phrases : Ici, il faut que je note un rêve. Ou bien La lune et la rosée avaient posé une paillette sur chaque chose. Et encore Une fontaine de fées tout en mousse verte. Une fois ma récolte terminée, je remonte dans mon bureau et classe les coupures par ordre de découverte. Les premiers jours, j’ai éprouvé toutes les peines du monde à établir une chronologie satisfaisante. Puis, après un peu d’entraînement, j’ai compris qu’il n’était pas si difficile que cela de déterminer une séquence : il suffit d’écouter la musique des phrases. Aujourd’hui, c’est devenu une seconde nature.
Mis bout à bout, les mots composeront un texte complet. Certes, il est encore trop tôt pour deviner ce qu’en seront le sens et la thématique. Le moment venu, cependant, je ne doute pas que les explications surgiront d’elles-mêmes. »
*
Une nuit de janvier 1914, Louis alors âgé de sept ans, surprend des éclats de voix. Son père hurle à sa mère : Putain ! L’été de la même année, alors que la guerre est déclarée – Mathurin, trop âgé et de santé fragile, y échappe –, Justine bouleversée confesse à Louis qu’elle a un amant, certain Victor. Je veux que demain tu te casses une jambe. […] Il y a des arbres dans la cour de l’école. Monte sur un arbre et laisse-toi tomber. Oh ! mon Dieu, je suis folle. Louis ? N’écoute pas ce que je te dis. Je veux juste… J’ai juste besoin d’une heure avec lui. Tu vois ? Mais Louis l’a bien écoutée – si bien que le désir, celui qui consumait sa mère aimée, fera plus tard l’objet de toutes ses attentions.
*
Louis n’entend pas le maître hurler, il n’entend pas les autres gamins, il n’entend que sa mère, monte sur un arbre et laisse-toi tomber, c’est comme un mauvais, mauvais rêve, et, lentement, bascule.
*
« […] notre seul problème, et depuis toujours, c’est le temps. »
*
Le 21 février 1916, à Verdun, Victor, qui n’avait pas vingt ans, tombe sous le gaz asphyxiant et les balles des allemands. Lorsque la terrible nouvelle lui parvient, Justine ingère la missive, comme pour manger la mort de son amant. Le 8 juillet, le petit Louis découvre le cadavre de sa mère, nue, pendue à un arbre du parc.
Les arbres desquels on tombe, auxquels on se pend, les arbres qu’on étreint, qu’on caresse, sont dans Kathleen d’évidents symboles de virilité, de solidité, de stabilité – d’immobilité, opposée au feu pâle, éphémère, d’une vie humaine. Ils sont les symboles vivants de cet imaginaire immémorial qui resurgissait dans Or not to be avec les traits du Grand Pan.
*
En 1922, Georges Gurdjieff et ses disciples s’installent au Prieuré d’Avon. Mathurin n’est plus que l’ombre d’un homme, imbibé d’alcool et enfermé dans un mutisme persistant. Alors âgé de quinze ans, Louis découvre un monde étranger, et étrange, de jeûnes, de ballets russes et de travaux agricoles. Si Gurdjieff peine à voir en lui plus qu’un imbécile heureux, Louis se lie cependant d’amitié avec un dénommé Orage, éditeur fameux d’Erzra Pound, T. S. Eliot et G. K. Chesterton. Justine avait communiqué à Louis son amour de la langue et des livres, ce que ne manquent pas de remarquer les disciples : il est engagé comme traducteur et rédacteur de communiqués de presse.
*
Roman, cancer de la pensée, maladie grave, subjectivité, que du mensonge, mensonge : jamais écrire roman, complète merdité. Ce sont les mots de Gurdjieff. Fabrice Colin, qui ne cède jamais aux excès faciles de la condamnation ou de l’admiration béate, prend évidemment ses distances avec le mage : son roman, qui nous dit sa foi inébranlable en la littérature, tente précisément d’immortaliser ses personnages, de les rendre plus vivants que nous ne le sommes nous-mêmes. Fabrice Colin ne cesse de se confronter à son horizon ultime, la Mort. Et d’une certaine manière, il est l’un des rares écrivains, aujourd’hui, à croire encore au pouvoir romanesque, au roman comme mise à nu des mouvements invisibles du monde. Plonger dans l’univers intérieur de Louis, n’est d’ailleurs pas moins dépaysant qu’explorer les espaces inconnus de Rama ou de Solaris… De même que nous n’en savions pas plus sur l’origine et le sens du gigantesque artefact extraterrestre à la fin de rendez-vous avez Rama, ou sur ceux de la planète-océan du livre de Stanslaw Lem, de même aucune vérité ne nous est livrée au sujet de Louis Pardieu, qui emporte ses secrets dans sa tombe. Comme chez Clarke, comme chez Lem, c’est dans la relation des explorateurs – ici : son fils Charles, et le lecteur – avec l’entité explorée, que réside le sens de l’aventure.
*
Dans La fosse de Babel, Raymond Abellio écrivait : « […] qu’est-ce en effet que le drame de l’esthétique sinon celui de la communication, c’est-à-dire par excellence le drame religieux, par quoi au dernier instant tout se relie, c’est-à-dire encore l’épreuve dernière par quoi les solitudes s’affirment et s’effondrent et où le témoignage se fait martyre, et l’art sera en effet le dernier martyre ou bien ne sera rien. Les mots d’engagement et de dégagement perdent ici leur sens, et leur opposition devient même vulgaire et profanatrice. C’est que le vrai roman, c’est-à-dire celui de la structure absolue, enferme par force toute l’histoire en l’arrêtant ». Kathleen n’est rien de moins qu’une (modeste) quête métaphysique de cet ordre, même si, bien entendu, le vrai roman abellien ne saurait exister.
*
Le 17 octobre 1922, Orage annonce à Louis la venue d’une amie à lui. Elle s’appelle Katherine. Remember her name.
*
Le Journal de Katherine Mansfield s’arrête au 18 octobre 1922 : « Dans le jardin d’automne, les feuilles tombent. Petits pas qui se posent, comme un chuchotement léger. Ils s’envolent, tourbillonnent, virevoltent, frémissent. »[2] Suit une liste de mots (Cendres, J’ai froid, Allumer un feu, etc.), dont Katherine cherchait l’équivalent en russe. Les événements décrits dans Kathleen, ultérieurs aux dernières pages du Journal, reposent donc à la fois sur les témoignages d’autres personnes présentes, et sur l’imagination de l’écrivain.
L’arrivée de Katherine Mansfield au prieuré bouleverse la vie de Louis, qui la désire éperdument. L’auteur se lie d’amitié avec le jeune homme, qu’elle aide à perfectionner son anglais. Mais il y a déjà un homme dans sa vie : John Middleton Murry, surnommé Bogey. Jusqu’à ce jour de décembre, où, dans l’étable, l’anglaise croit pouvoir bénéficier, au moins un instant, de la vitalité du jeune homme…
Quelques semaines plus tard, après que Louis a seulement réussi à plonger son visage entre ses cuisses, Katherine Mansfield meurt, terrassée par la tuberculose. Après l’enterrement au cimetière communal d’Avon, Louis « essaya de tournoyer sur lui-même comme il l’avait vu faire, de plus en plus vite », comme un derviche. Il n’aura de cesse d’abolir la distance, pourtant irrémédiable, qui le sépare d’elle, et commence alors à s’intéresser aux théories de Gurdjieff, pour qui il existe une possibilité de vie après la mort – une certaine forme d’immortalité –, le « quatrième corps », que seule une parfaite maîtrise du centre sexuel permettrait d’acquérir… Et d’abord, découvrir son vrai « je ». Pour cela, Louis entreprend de tuer le père...
Cinq ans plus tard, il apprend que le corps de Katherine Mansfield, dont la tombe avait été ouverte plus tôt dans l’année, n’avait nullement subi les détériorations habituelles. « Littéralement, elle reposait. ». L’immortalité exige moins de prolonger la vie dans le temps, que d’arrêter le temps lui-même…
*
Les photographies de la page 242 rappellent celles compulsées par Liv Ullmann dans Saraband. Eros et Thanatos : l’image fétichise, et fixe à jamais l’instant.
*
Selon Gurdjieff, nous habitons des prisons, « nous vivons dans un système de cloisonnements et de correspondances secrètes, un authentique labyrinthe. Je ne parle pas le même langage que mon voisin, je ne vis pas dans le même monde que lui mais, naturellement, je suis persuadé du contraire. Parce que c’est moins douloureux. ».
*
« La vie n’est pas une expérience de la fraternité ! La vie est une exploration sans fin de la paternité ! » s’exclamait von Saas, dans La fosse de Babel de Raymond Abellio. Parce qu’ils ne sont pas frères, parce qu’ils ne sont pas une seule et même personne mais deux individus distincts, aux espaces intérieurs radicalement différents, Charles et Louis ne peuvent vraiment communiquer. Tout au plus, comme nous, lecteurs, Charles peut essayer de reconstruire le film de la vie de Louis.
*
À Paris, Louis découvre les plaisirs de la chair, et travaille à la révision perpétuelle du « chef d’œuvre » de Gurdjieff, Récits de belzébuth à son petit-fils. « […] il ne vivait rien. Quelque chose vivait en lui. ». « L’enseignement du Prieuré lui revenait en mémoire. Selon le système de Gurdjieff, l’homme était constitué de quatre corps : un corps charnel (le fiacre), un corps naturel (le cheval), un corps spirituel (le cocher) et un corps divin – le maître. Seule le corps divin, pour reprendre la terminologie du christianisme ésotérique, était susceptible de faire. Louis ne l’avait connu qu’en une seule occasion : lorsqu’il avait plaqué Kathleen contre la porte de sa chambre. Le reste était littérature, le reste était travail de sape, recherche et destruction. »
Si vous comprendre corps, vous comprendre mécanismes de l’univers, un jour. Mouvements des danseurs, même chose mouvement des planètes, lui dit Gurdjieff, inversant la proposition d’un Julien Offroy de la Mettrie, pour qui les lois de la physique suffiraient à comprendre les mécanismes du corps. Les hommes être machines (…) et, pour hommes machines, seulement actions machinales sont possibles. « [Louis] faisait partie intégrante d’une mécanique inhumaine, c’était ainsi. Mais l’homme neuf, l’homme véritable était plus qu’un grain de sable dans l’implacable ordonnancement des roues crantées : il était le regard, le rayon pénétrant. »
*
Parabole des moutons hypnotisés, la puissance de l’imagination substituée au réel : « nous sommes prêts à croire n’importe quoi plutôt que d’affronter la pesanteur ».
*
Louis se marie à une jeune femme, Thérèse, mais est subjugué par Kitty, qu’il n’ose aborder, qu’il désire en secret, et en qui il ne voit que Kathleen, au point que lorsque celle-ci quitte l’hôtel où Louis est employé, il s’enfonce la lame d’un couteau de boucher dans le ventre.
*
« Autour de lui, le monde continuait de se rétracter »
*
Thérèse accouche d’un enfant mort-né, et, tandis que Louis s’éprend d’un nouveau fantôme de Kathleen, prénommée Cathey, la malheureuse ne survit pas longtemps à cette épreuve. Gurdjieff ne peut rien pour elle, mais il prononce ces mots étranges : Toi comme Christ, mais Christ sans dieu. Laisser le monde éroder ton âme comme vents sur la montagne. Le diamant est tout au fond.…
*
Ce texte à la troisième personne s’avère finalement écrit par Louis lui-même, comme nous l’apprend un passage raturé, que nous pouvons néanmoins déchiffrer : « En vérité, c’est un effondrement, des ruines, j’ai l’impression que tout s’écroule en ce moment, que des pans entiers de ma mémoire disparaissent, engloutis par une vague invisible […] ». Déduction confirmée ensuite par une note du médecin de Louis à la maison de repos d’Avon.
*
Trois fois, Martha, dans des passages raturés, annonce à Louis qu’elle est enceinte… Louis réinvente sa vie, tait certaines choses, en magnifie d’autres. Il n’est pas personnage : il est écrivain.
*
Un rêve dans un rêve (« a dream within a dream »), un homme à tête de livre, un fiacre à cocher électrique, un tank qui attaque le Prieuré, des bombes en pierre, des soldats de pierre, les faubourgs attaqués par des sphères métalliques, « Je rêve de livres en feu, d’existences poudrées, de tourbillons dans la tempête. Ce matin, je suis allé acheter un pistolet. Il y a une vérité à saisir, toute proche : la flamme d’une lampe à pétrole, la flamme, en avez-vous conscience ? La flamme rend l’insecte fou. », « L’unique issue, c’est cet homme qu’il faut tuer. Qui est-il ? Cela me sera révélé en temps voulu. De quel type d’homme s’agit-il ? D’un type falsifié, factice, insignifiant. D’un type en construction. D’un type désastreusement obstiné. Et c’est cette obstination, précise G. avec gravité, qui est la cause de tout. », « Mon frère jumeau est un livre en feu. Mon passé est un champ de ruines. Le nom de mon avenir : no man’s land ».
Le récit fantastique inséré dans le roman n’est que l’image, déformée à l’extrême, du paysage intérieur de Louis. Cet homme qu’il faut tuer, c’est son père, Mathurin. Pour Gurdjieff, les gens, et en particulier ses disciples, étaient des moutons, de stupides robots privés d’équilibre.
*
La superposition des différents niveaux de récit de Kathleen rappelle la prodigieuse mise en abîme de Feu pâle de Nabokov, lequel est constitué d’un long poème, de son commentaire sous forme de notes, et d’un index – sans oublier une introduction, elle-même fictive. Kathleen s’inscrit en effet dans l’esthétique postmoderne la plus achevée, héritée de Thomas Pynchon – dont l’Ulysses de Joyce fut la véritable matrice –, où le puzzle narratif, jamais gratuit, nous permet en instaurant une distance « brechtienne », d’appréhender ses protagonistes dans toute leur complexité. Fabrice Colin n’a que faire d’un quelconque mimétisme : s’il nous renvoie évidemment au Réel, ce n’est qu’après lui avoir fait subir maintes altérations, maintes distorsions. Qu’ils soient schizophrènes ou sujets aux délires paranoïdes (Or not to be, Syonara baby), dépressifs (Le syndrome Godzilla) ou atteints de la maladie d’Alzheimer (Kathleen), ses personnages sont tous dans une situation analogue à celle de Joseph K., le malheureux employé du Procès, ou à celle de Grégoire Samsa, le héros de La Métamorphose : comme chez Kafka, leurs maux arborent des formes étranges, fantastiques.
*
Sa construction sophistiquée, postmoderne, n’empêche aucunement Kathleen d’être romanesque. Elle permet même, a contrario, d’éviter la sensiblerie qui guette immanquablement tout roman sur la maladie d’Alzheimer ou sur un mal semblable. Louis Pardieu et son fils Charles, sont à la fois illusions de personne, instruments textuels et prétextes fantasmatiques, pour reprendre les type énoncés par Vincent Jouve. Louis, en premier lieu, que nous découvrons au travers de ses propres textes et fantasmes et au travers du regard de son fils, s’avère tout simplement bouleversant.
*
Le roman se ferme sur le récit fantastique de Louis, en complète perdition mais, au contact de la Jeune Femme, submergé d’amour.
*
Submergé d'amour.


 Je vous proposais il y a quelque temps, en exclusivité, la belle
Je vous proposais il y a quelque temps, en exclusivité, la belle  Ce goût pour l’imaginaire et l’artifice, dont il s’arme pour lutter contre la défaite de la pensée et des sens, figure en première ligne dans ses romans rongés par l’obsession du mouvement. Son plaisir de créer, qui coïncide avec son acharnement à arracher ses propres racines, à se renouveler constamment, ne parvient pas à obombrer tout à fait une certaine mélancolie, mais même au plus sombre de son humeur perce une malice, un immarcescible enthousiasme que les ans n’ont jamais vraiment entamé. Sans se départir d’une langue élégante, incandescente, fluide et outrageusement sensuelle, ses fictions apatrides (ou « rastaquouères », comme il les qualifie lui-même dans Rasta Solitude) se plaisent à déployer des jeux de masques et de miroirs dont les règles ne nous sont qu’en partie dévoilées et dont le sens n’est pas à chercher dans de vaines et laborieuses expérimentations formalistes, mais dans le feu glacé d’un verbe viril, fiévreux et charnel.
Ce goût pour l’imaginaire et l’artifice, dont il s’arme pour lutter contre la défaite de la pensée et des sens, figure en première ligne dans ses romans rongés par l’obsession du mouvement. Son plaisir de créer, qui coïncide avec son acharnement à arracher ses propres racines, à se renouveler constamment, ne parvient pas à obombrer tout à fait une certaine mélancolie, mais même au plus sombre de son humeur perce une malice, un immarcescible enthousiasme que les ans n’ont jamais vraiment entamé. Sans se départir d’une langue élégante, incandescente, fluide et outrageusement sensuelle, ses fictions apatrides (ou « rastaquouères », comme il les qualifie lui-même dans Rasta Solitude) se plaisent à déployer des jeux de masques et de miroirs dont les règles ne nous sont qu’en partie dévoilées et dont le sens n’est pas à chercher dans de vaines et laborieuses expérimentations formalistes, mais dans le feu glacé d’un verbe viril, fiévreux et charnel.
 Olivier Noël – l’hôte de ces lieux – l’a souligné, Le Soleil de Sokourov est gris. Son image terne a froncé mes sourcils, arraché des larmes de mes yeux plus plissés encore que ceux de l’empereur. Que se passait-il devant moi ? Pas grand-chose en apparence. L’opacité dure toujours trop longtemps, elle nous ennuie. Elle stagne. Celle du film recèle pourtant de profondes mutations, à commencer par celle de l’empereur Hirohito, le dieu qui devient homme. Il mute, plongé dans le brouillard, ou dans l’encre grisâtre qu’il mélange longuement avant d’écrire à son fils. Comme s’il étouffait sous le voile cendré de l’image vidéo, il ouvre silencieusement la bouche, semblable au poisson inaccoutumé à son nouvel environnement.
Olivier Noël – l’hôte de ces lieux – l’a souligné, Le Soleil de Sokourov est gris. Son image terne a froncé mes sourcils, arraché des larmes de mes yeux plus plissés encore que ceux de l’empereur. Que se passait-il devant moi ? Pas grand-chose en apparence. L’opacité dure toujours trop longtemps, elle nous ennuie. Elle stagne. Celle du film recèle pourtant de profondes mutations, à commencer par celle de l’empereur Hirohito, le dieu qui devient homme. Il mute, plongé dans le brouillard, ou dans l’encre grisâtre qu’il mélange longuement avant d’écrire à son fils. Comme s’il étouffait sous le voile cendré de l’image vidéo, il ouvre silencieusement la bouche, semblable au poisson inaccoutumé à son nouvel environnement.
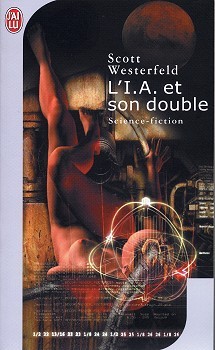
 Chéri est une intelligence artificielle qui a franchi le seuil de Turing et gagné son indépendance – ainsi qu’un corps humanoïde – en développant une relation très intime avec une jeune fille dans un vaisseau spatial. Sa vie d’Artificiel libre est alors entièrement consacrée au sexe – il collectionne les accessoires et extensions érotiques – et à l’esthétique – ayant accédé à la conscience par un apprentissage de la sensualité, c’est en toute logique que Chéri se spécialise dans l’authentification d’œuvres d’art. C’est au cours d’une mission – il doit expertiser une sculpture récente du célèbre Vaddum pourtant mort depuis des lustres – qu’il fait la connaissance de Mira, femme sans passé chargée de retrouver et d’éliminer un mystérieux Fabricant qui s’est rendu coupable de l’impossible, la duplication d’un Artificiel, crime hautement répréhensible s’il en est. Chéri et Mira, mus par une violente attirance sexuelle et unis par une destinée commune, vont se croiser en un corps à corps d’une intensité hors du commun.
Chéri est une intelligence artificielle qui a franchi le seuil de Turing et gagné son indépendance – ainsi qu’un corps humanoïde – en développant une relation très intime avec une jeune fille dans un vaisseau spatial. Sa vie d’Artificiel libre est alors entièrement consacrée au sexe – il collectionne les accessoires et extensions érotiques – et à l’esthétique – ayant accédé à la conscience par un apprentissage de la sensualité, c’est en toute logique que Chéri se spécialise dans l’authentification d’œuvres d’art. C’est au cours d’une mission – il doit expertiser une sculpture récente du célèbre Vaddum pourtant mort depuis des lustres – qu’il fait la connaissance de Mira, femme sans passé chargée de retrouver et d’éliminer un mystérieux Fabricant qui s’est rendu coupable de l’impossible, la duplication d’un Artificiel, crime hautement répréhensible s’il en est. Chéri et Mira, mus par une violente attirance sexuelle et unis par une destinée commune, vont se croiser en un corps à corps d’une intensité hors du commun.