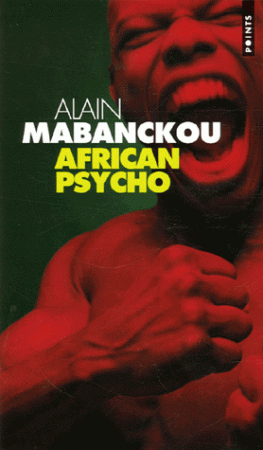« Le lien insensible qui lie tes images les plus éloignées et les plus différentes, c’est ta vision. »
Robert Bresson, Notes sur le cinématographe.
Comme vous le savez peut-être, Joseph Vebret, le rédacteur en chef de La Presse littéraire, vient de lancer une nouvelle revue. Exclusivement consacrée au septième art, comme son nom l’indique, La revue du cinéma reprend le format, le rythme de parution (bimensuel) et une partie de l’équipe de l’ancien Journal de la culture… Confrontant comme sa grande sœur littéraire les « anciens » et les « modernes », ce premier numéro n’est pas totalement dénué d’intérêt, on y trouve même quelques textes de qualité, mais, comment dire, l’ensemble manque de cohérence – et d’ambition. Comme La Presse littéraire du reste, il semblerait surtout – sans doute est-ce là le fond du problème – que La Revue du cinéma soit orpheline d’un minimum de travail éditorial. Les textes sont à peine relus ; et les rédacteurs sont sélectionnés au petit bonheur la chance, non pour l’excellence ou la légitimité de leurs travaux, mais parce qu’ils ont un blog, ou simplement parce que le patron n’est pas trop regardant sur le contenu.
L’éditorial de La Revue du cinéma, chant d’amour un peu niais et hypersubjectiviste où Joseph Vébret avoue n’être « ni cinéphile ni cinéphage et encore moins un spécialiste pointu et chevronné du 7e art », et confesse « se vautrer […] devant une superproduction américaine, du genre de celles où le président des Etats-Unis, lui-même et en personne, sauve la planète, aux commandes d’un supersonique ou tout simplement à bord d’Air Force One… », laissait d’emblée craindre le pire. En effet, assumer ses goûts personnels comme il le préconise, ne nous dispense certes pas de poser sur l’objet de notre attention, un regard extrêmement critique… Dans une autre nouvelle revue – nettement plus professionnelle – Philosophie Magazine, dont l’ambition, nous dit son rédacteur en chef Alexandre Lacroix, est, « […] de concilier philosophie et journalisme » (ce qu’elle parvient à faire assez brillamment : si sa maquette évoque celle du magazine Lire, son contenu s’avère d’un bon niveau), nous pouvons lire ces mots incisifs de Frédéric Schiffter (auteur déjà rencontré dans les pages de L’imbécile) : « Grossir le petit pour rapetisser le grand, élever le bas pour abaisser le haut, faire exister le néant pour anéantir le réel, la grandiloquence, on le voit, se montre la meilleure des techniques de manipulation du langage pour conforter l’opinion largement partagée selon laquelle cultiver le sens de la hiérarchie dans le domaine des arts trahit une manie de réactionnaire ». Ainsi, apprécier un film pour des raisons souvent étrangères au jugement esthétique, ne saurait acquérir valeur d’argument. Qu’il me soit donc permis d’adresser une bonne paire de claques à certaine Adeline Bronner, dont chacune des critiques – et elles sont fort nombreuses – prouve l’incompétence. Hormis Truman Capote, qu’elle juge « fastidieux » (sa critique l’est tout autant, sinon plus), les productions les plus insignifiantes, les plus molles, les plus assommantes, trouvent grâce à ses yeux. Eh ! oh ! Adeline, ma donzelle ! au moins, tu aurais pu lire De sang froid avant de rédiger ta notule sur le film de Bennett Miller !…
Honte ? Jamais ! proclame Joseph Vebret. Précisément, j’ai presque honte de voir mon nom associé à tel naufrage. J’accepte volontiers de participer à la naissance d’une revue, avec les ratés et les cafouillages de convenance (quoi de plus normal ?), j'accepte aussi la variété des points de vue, des approches, et même des compétences, mais tant d’amateurisme, discrédite complètement une entreprise pourtant modeste. Si La Presse littéraire ne brille pas toujours par sa perfection, au moins bénéficie-t-elle de plumes de talent et de rédacteurs honnêtes, voire talentueux – ainsi lui pardonnons-nous les quelques papiers indigents qui ne manquent jamais de s’inviter. Hélas, les précieux ridicules sont trop nombreux (et prolixes) dans La Revue du cinéma, pour que l’équilibre vital soit atteint. Si l’on écarte un beau texte de Sarah Vajda sur Jean-Luc Godard (« L’absurde s’éloigne un instant : quand chacun de nous est, le sait, le subit, sujet d’Auschwitz et d’Hiroshima, quand le Capital a joué aux dés notre royaume et l’a perdu, nous demeure l’art […]. L’humanité est une patrouille perdue qui retrouve son chemin et sa voie sous le fléau de la beauté. Sidérés, caressés, branlés, nous jouissons, nous vivons, esprits et corps comblés. »), un article assez juste de Ludovic Maubreuil à propos de Steven Spielberg (« Spielberg est un cinéaste qui confond sans cesse pensée et idéologie, mise en scène et accumulations d’images, raison pour laquelle les rapports qu’il crée sont toujours, comme les instants de réflexion de ses personnages, maniérés »), une intelligente évocation de Possession, le chef d’oeuvre de Zulawski, par Marc Alpozzo (« Entre des hommes qui communiquent de manière décousue, chaotique, théâtrale, seul l’amour pour l’autre, et non pas le seul emboîtement des corps, sera l’objet de transcendance »), une excellente contribution (déjà publiée dans la NRF) d’Anthony Dufraisse sur « Cendrars à Hollywood », l’interview de Jean-François Stévenin Par Rodolphe Viémont et, j’espère, mon propre article consacré à Un couple parfait de Nobuhiro Suwa – plus, certainement, quelques pages que je n’ai pas relevées –, il ne reste alors de la revue que prose insignifiante et péroraisons désinvoltes.
 Armand Chasle d’abord, inconnu au bataillon – et même de Google –, déblatère à tort et à travers, visiblement très content de lui, sur Munich et Le Nouveau monde. Il lâche à intervalles réguliers des sentences définitives seulement motivées par sa certitude d’avoir raison, non sans brandir au passage, sans aucune pertinence, quelques grands noms du cinéma. Ainsi le rôle de Matthieu Amalric dans Munich est-il « sans exagérer, le meilleur de sa carrière ». Pourquoi ? Mystère. Les personnages de Munich sont d’ailleurs comparés, tour à tour, à ceux de Allemagne année zéro, de Eyes Wide Shut et à ceux, forcément « mutants », de David Cronenberg, comme si citer Kubrick, Cronenberg et Rossellini suffisait à sauver Spielberg de la débâcle artistique. Et ce ne sont certes pas les explications données, trop brèves et désinvoltes, qui nous convaincront… Nous apprenons aussi que « le public français » (dont monsieur Chasle ne fait sans doute pas partie), est caractérisé par son « mauvais goût » ! Dommage, Armand : le public français est à peu près le seul au monde à se ruer vers les blockbusters d’Alain Guiraudie, de Béla Tarr ou de Guy Maddin… Chasle, d’autre part, n’a rien compris aux reproches – justifiés ou non – adressés par Emmanuel Burdeau, dans les Cahiers du cinéma, au dernier film de Terrence Malick. Burdeau, lui au moins, argumente. Bien moins pédant et assurément plus compétent, Burdeau exprime une certaine idée du cinéma, qui s’appuie sur une étude, parfois superficielle, parfois discutable, mais souvent judicieuse, de l’œuvre cinématographique comme expression formelle. Chasle me fait penser à Pierre Cormary : il ne manque pas de style, on prend même plaisir à le lire, mais à l’économie d’une patiente dissection, d’une mise à l’épreuve de ses hypothèses, il préfère l’affirmation péremptoire de ses perceptions subjectives.
Armand Chasle d’abord, inconnu au bataillon – et même de Google –, déblatère à tort et à travers, visiblement très content de lui, sur Munich et Le Nouveau monde. Il lâche à intervalles réguliers des sentences définitives seulement motivées par sa certitude d’avoir raison, non sans brandir au passage, sans aucune pertinence, quelques grands noms du cinéma. Ainsi le rôle de Matthieu Amalric dans Munich est-il « sans exagérer, le meilleur de sa carrière ». Pourquoi ? Mystère. Les personnages de Munich sont d’ailleurs comparés, tour à tour, à ceux de Allemagne année zéro, de Eyes Wide Shut et à ceux, forcément « mutants », de David Cronenberg, comme si citer Kubrick, Cronenberg et Rossellini suffisait à sauver Spielberg de la débâcle artistique. Et ce ne sont certes pas les explications données, trop brèves et désinvoltes, qui nous convaincront… Nous apprenons aussi que « le public français » (dont monsieur Chasle ne fait sans doute pas partie), est caractérisé par son « mauvais goût » ! Dommage, Armand : le public français est à peu près le seul au monde à se ruer vers les blockbusters d’Alain Guiraudie, de Béla Tarr ou de Guy Maddin… Chasle, d’autre part, n’a rien compris aux reproches – justifiés ou non – adressés par Emmanuel Burdeau, dans les Cahiers du cinéma, au dernier film de Terrence Malick. Burdeau, lui au moins, argumente. Bien moins pédant et assurément plus compétent, Burdeau exprime une certaine idée du cinéma, qui s’appuie sur une étude, parfois superficielle, parfois discutable, mais souvent judicieuse, de l’œuvre cinématographique comme expression formelle. Chasle me fait penser à Pierre Cormary : il ne manque pas de style, on prend même plaisir à le lire, mais à l’économie d’une patiente dissection, d’une mise à l’épreuve de ses hypothèses, il préfère l’affirmation péremptoire de ses perceptions subjectives.
Le Nouveau monde, soit dit en passant, fait l’objet d’un second article. Mais celui-ci est si mauvais, si mal écrit, que je préfère n’en point parler. Pauvre Terrence Malick ! Souhaitons seulement que son auteur, Enguerrand Guépy, soit expulsé manu militari des pages de la revue, sans quoi mes exhortations resteront peine perdue.
L’autre bonnet d’âne de ce premier numéro fort inégal, a pour nom Yann Boromus, l'animateur du blog Matière focale. Ce projectionniste lillois est l’auteur de textes aux titres impressionnants : « Munich, ta mère en short devant le stadium ! », « La trop pépère PME de Chabrol » et « Truman Capote, un film d’intention beau comme un tractopelle ». Tout un programme... Si Armand Chasle était en course pour le titre de critique néokantien de l’année[1] (catégorie fanzine), Yann Boromus, que l’on verrait bien cloué à un arbre comme son cousin Boromir, le bat finalement à plate couture. D’abord, cher Faramus, Scorsese, ne s’écrit pas « Scorcese ». Ensuite, il est inutile de répéter huit ou neuf fois le mot biopic dans un article, dont quatre dans la même page, pour exprimer son sentiment. Autre chose : d’où tiens-tu que les mauvaises copies ( ? ) seraient un « problème majeur franco-français » ?... Les articles de Boromus ne sont que d’interminables accumulations de jugements à l’emporte-pièce et d’assertions gratuites. Bon sang, mais bougres d’idiots ! lisez donc de vraies revues, dans lesquelles de véritables spécialistes éclairent les films de leurs lumières !
On comprend que le vœu de Joseph Vebret, de donner naissance à une « revue de référence », a toutes les chances de demeurer inexaucé, et on mesure, mortifié, quel incommensurable distance sépare La Revue du cinéma, de ses prestigieuses aînées tant décriées, Positif ou Les Cahiers du cinéma (et ne parlons même pas de Trafic ou Vertigo, qui ne visent certes pas le même public). Il manque à La Revue du cinéma un projet, une ligne éditoriale précise ou, du moins, affirmée. Dans son éditorial par exemple, Joseph Vebret aurait mieux fait de dégager quelque ossature de son improbable patchwork rédactionnel… Munich, Le Nouveau monde, Possession, Un couple parfait, Notre musique, sont étudiés sous un angle moral assez prononcé : il y avait là, ce me semble, matière à réflexion. Par ailleurs, le choix des films chroniqués dans le « cahier critique », est très discutable, de même que la présence en ces pages d’articles aussi inutiles, et maladroits, que celui qu’Eli Flory, par ailleurs pitoyable correctrice, consacre à Soudain, l’été dernier (encore une fois abusivement qualifié de chef d’œuvre). La Revue du cinéma ressemble à un assemblage hétéroclite de blogs ou d’éditoriaux inégaux et sans rapport les uns avec les autres, sans lien insensible, sans vision. La Revue du cinéma, n’a pas d’âme. Allez, voici tout de même un extrait, avant sa mise en ligne intégrale dans quelques mois, de mon article consacré au beau film de Nobuhiro Suwa, Un couple parfait. « A l’optimisme béat du cinéma classique aussi bien qu’à la complaisance narcissique du cinéma post-moderne, Nobuhiro Suwa oppose une vision beaucoup plus juste et responsable : le bonheur durable d’une vie conjugale ne réside pas tant dans la vive lumière de l’instant – que l’on peut assimiler à une performance sociale –, que dans la pénombre quotidienne, celle, précisément – en vidéo Haute Définition –, où sont littéralement plongés les personnages, celle encore de l’inintelligibilité de certains dialogues. Le bonheur du couple, comme celui du spectateur de cinéma, ne se mérite qu’au prix de quelque effort – tendre l’oreille, scruter avec attention. Les rares mouvements d’appareil, aussi discrets et fonctionnels soient-ils, ne surgissent pas au hasard des obstacles : aux panoramiques du musée Rodin – qui en nous faisant partager l’émotion de Marie devant quelques sculptures très charnelles, offraient une bénéfique respiration au film comme à la jeune femme –, répondront à la fin du film les panoramiques qui tenteront de suivre, et de réunir, les deux membres du couple. Dans la nouvelle chambre louée par Marie, après une journée occupée séparément à arpenter les allées du musée Rodin et à dormir (Marie) ou à ne rien faire (Nicolas), la caméra s’extirpe lentement de sa coupable fixité et daigne enfin timidement porter son attention sur les êtres, comme si quelque grâce, même infime, était libérée. »
Allez, voici tout de même un extrait, avant sa mise en ligne intégrale dans quelques mois, de mon article consacré au beau film de Nobuhiro Suwa, Un couple parfait. « A l’optimisme béat du cinéma classique aussi bien qu’à la complaisance narcissique du cinéma post-moderne, Nobuhiro Suwa oppose une vision beaucoup plus juste et responsable : le bonheur durable d’une vie conjugale ne réside pas tant dans la vive lumière de l’instant – que l’on peut assimiler à une performance sociale –, que dans la pénombre quotidienne, celle, précisément – en vidéo Haute Définition –, où sont littéralement plongés les personnages, celle encore de l’inintelligibilité de certains dialogues. Le bonheur du couple, comme celui du spectateur de cinéma, ne se mérite qu’au prix de quelque effort – tendre l’oreille, scruter avec attention. Les rares mouvements d’appareil, aussi discrets et fonctionnels soient-ils, ne surgissent pas au hasard des obstacles : aux panoramiques du musée Rodin – qui en nous faisant partager l’émotion de Marie devant quelques sculptures très charnelles, offraient une bénéfique respiration au film comme à la jeune femme –, répondront à la fin du film les panoramiques qui tenteront de suivre, et de réunir, les deux membres du couple. Dans la nouvelle chambre louée par Marie, après une journée occupée séparément à arpenter les allées du musée Rodin et à dormir (Marie) ou à ne rien faire (Nicolas), la caméra s’extirpe lentement de sa coupable fixité et daigne enfin timidement porter son attention sur les êtres, comme si quelque grâce, même infime, était libérée. »
[1] Le critique néokantien, fort répandu dans la presse et plus encore dans la blogosphère, assène des vérités sans dévoiler ses critères d’évaluation.


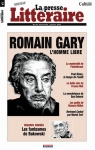 Voici la deuxième livraison de ma « chronique des nouveaux mondes », publiée dans La Presse Littéraire n°2, en janvier 2006. Elle reprend en partie une ancienne critique, jadis disponible sur Mauvais Genres en Bibliothèque, de La Lune n’est pas pour nous de Johan Heliot.
Voici la deuxième livraison de ma « chronique des nouveaux mondes », publiée dans La Presse Littéraire n°2, en janvier 2006. Elle reprend en partie une ancienne critique, jadis disponible sur Mauvais Genres en Bibliothèque, de La Lune n’est pas pour nous de Johan Heliot. Parmi ses nombreuses publications récentes – signalons les parutions en 2005 de Faerie Thriller chez Mnémos, de Führer Prime Time aux éditions du Rocher, et de Alter Jeremy chez Mango Jeunesse –, accordons quelque attention à La Lune n’est pas pour nous. Cette suite de La Lune seule le sait, dont le titre est un hommage à la trilogie noire de Léo Malet, nous plonge dans une Europe prématurément dominée par un IIIe Reich aussi grotesque que terrifiant. La France, en particulier, est dirigée par une clique d’extrême droite (Maurras, Brasillach et consort) prête à tous les compromis avec l’ennemi tandis que, protégés par la technologie pacifiste des Ishkiss, les résistants sélénites coulent des jours paisibles sur le satellite terraformé. Le Führer ne l’entend évidemment pas de cette oreille : il lance l’opération Toit du monde, vaste campagne de recherche scientifique censé mener à la destruction pure et simple des positions lunaires…
Parmi ses nombreuses publications récentes – signalons les parutions en 2005 de Faerie Thriller chez Mnémos, de Führer Prime Time aux éditions du Rocher, et de Alter Jeremy chez Mango Jeunesse –, accordons quelque attention à La Lune n’est pas pour nous. Cette suite de La Lune seule le sait, dont le titre est un hommage à la trilogie noire de Léo Malet, nous plonge dans une Europe prématurément dominée par un IIIe Reich aussi grotesque que terrifiant. La France, en particulier, est dirigée par une clique d’extrême droite (Maurras, Brasillach et consort) prête à tous les compromis avec l’ennemi tandis que, protégés par la technologie pacifiste des Ishkiss, les résistants sélénites coulent des jours paisibles sur le satellite terraformé. Le Führer ne l’entend évidemment pas de cette oreille : il lance l’opération Toit du monde, vaste campagne de recherche scientifique censé mener à la destruction pure et simple des positions lunaires…
 En outre Le Soleil, même s’il décrit lui aussi le « crépuscule d’un dieu », ne saurait être comparé de trop près au Ludwig de Visconti : la folie – le monde intérieur – de Louis II de Bavière, était sans cesse confronté – si mes souvenirs (assez anciens) du film sont bons – aux événements extérieurs dont nous percevions au moins la rumeur. Chez Sokourov, ce contexte est non seulement réduit à la ruine totale du Japon, comme si rien d'autre n'existait – ainsi que nous le montre l'extraordinaire séquence de bombardement onirique, où bombes et B-52 prennent la forme d’inquiétants poissons volants –, mais encore enveloppé d’un brouillard persistant. Plus que Ludwig, Le Soleil exige du spectateur, pour être seulement compris, quelque connaissance au moins superficielle de la réalité historique et du personnage. Même le spectateur le plus inculte ressentait le tragique de la situation de Louis II. À la vision du Soleil en revanche, le même spectateur se forgerait de Hirohito une image certes confusément ambiguë, mais essentiellement positive… Un minimum de culture générale, altère donc profondément la vision du film. Ainsi n'ai-je pu m'empêcher de penser, voyant cet attachant Hirohito s'extasier devant un crabe aux pattes atrophiées extrait du formol, ou se passionner pour la biologie, aux expériences atroces commises par la tristement célèbre unité 731 en Mandchourie
En outre Le Soleil, même s’il décrit lui aussi le « crépuscule d’un dieu », ne saurait être comparé de trop près au Ludwig de Visconti : la folie – le monde intérieur – de Louis II de Bavière, était sans cesse confronté – si mes souvenirs (assez anciens) du film sont bons – aux événements extérieurs dont nous percevions au moins la rumeur. Chez Sokourov, ce contexte est non seulement réduit à la ruine totale du Japon, comme si rien d'autre n'existait – ainsi que nous le montre l'extraordinaire séquence de bombardement onirique, où bombes et B-52 prennent la forme d’inquiétants poissons volants –, mais encore enveloppé d’un brouillard persistant. Plus que Ludwig, Le Soleil exige du spectateur, pour être seulement compris, quelque connaissance au moins superficielle de la réalité historique et du personnage. Même le spectateur le plus inculte ressentait le tragique de la situation de Louis II. À la vision du Soleil en revanche, le même spectateur se forgerait de Hirohito une image certes confusément ambiguë, mais essentiellement positive… Un minimum de culture générale, altère donc profondément la vision du film. Ainsi n'ai-je pu m'empêcher de penser, voyant cet attachant Hirohito s'extasier devant un crabe aux pattes atrophiées extrait du formol, ou se passionner pour la biologie, aux expériences atroces commises par la tristement célèbre unité 731 en Mandchourie Le dictateur nippon, sous l’œil réactionnaire de Sokourov, est décrit comme un idiot dostoïevskien, poète – il compose des haïkus – sinon pacifiste, du moins opposé à l’orgueil national qu’il rend d’ailleurs coupable de la débâcle, et infantile. Devant ses serviteurs et généraux médusés, Hirohito, à un discours intransigeant, préfère la métaphore de la capitulation : « Parfois le poisson-chat se cache dans les profondeurs, parfois le papillon ferme ses ailes… ». Face à l’inéluctable, l’Empereur pressent la nécessité de se défaire de sa « divinité » : il renonce volontairement à être le descendant du Soleil – il s’éclipse. Loin de l’exercice hagiographique, et cependant guère plus critique, Le Soleil s’attache à l’extinction d’un Dieu qui, littéralement, n’appartient pas à notre monde (de même que L’Arche russe, fameux film tourné lui aussi en vidéo, et en un seul plan magistral, interrogeait l’identité russe, Le Soleil s’intéresse à l’âme nippone). D’où, en dernière analyse, la pertinence de la vidéo, qui transporte le personnage, admirateur de Chaplin et de stars hollywoodiennes, dans un espace filmique totalement étranger et anachronique – hanter le présent numérique, tel est le projet de Sokourov. Comparés à Hirohito/Issei Ogata les autres personnages, à commencer par MacArthur et ses GI’s, semblent tous caricaturaux : l’Empereur ne se meut pas dans la même réalité. Ainsi ce dernier ouvre-t-il sans cesse la bouche en silence, agité d’un tic nerveux, comme un poisson, ou comme si son univers intérieur excédait cette réalité désastreuse qu’il refuse de contempler. Ainsi encore Hirohito, jusqu’alors prisonnier des obligations d’étiquette, semble-t-il appréhender le monde que nous connaissons, avec une innocence, une joie toute enfantine. Il faut le voir, chez MacArthur, ouvrir une porte pour la première fois, cette tâche étant d’ordinaire réservée à ses fidèles serviteurs, ou profiter de l’absence de son hôte américain pour moucher les bougies de l’Ambassade !
Le dictateur nippon, sous l’œil réactionnaire de Sokourov, est décrit comme un idiot dostoïevskien, poète – il compose des haïkus – sinon pacifiste, du moins opposé à l’orgueil national qu’il rend d’ailleurs coupable de la débâcle, et infantile. Devant ses serviteurs et généraux médusés, Hirohito, à un discours intransigeant, préfère la métaphore de la capitulation : « Parfois le poisson-chat se cache dans les profondeurs, parfois le papillon ferme ses ailes… ». Face à l’inéluctable, l’Empereur pressent la nécessité de se défaire de sa « divinité » : il renonce volontairement à être le descendant du Soleil – il s’éclipse. Loin de l’exercice hagiographique, et cependant guère plus critique, Le Soleil s’attache à l’extinction d’un Dieu qui, littéralement, n’appartient pas à notre monde (de même que L’Arche russe, fameux film tourné lui aussi en vidéo, et en un seul plan magistral, interrogeait l’identité russe, Le Soleil s’intéresse à l’âme nippone). D’où, en dernière analyse, la pertinence de la vidéo, qui transporte le personnage, admirateur de Chaplin et de stars hollywoodiennes, dans un espace filmique totalement étranger et anachronique – hanter le présent numérique, tel est le projet de Sokourov. Comparés à Hirohito/Issei Ogata les autres personnages, à commencer par MacArthur et ses GI’s, semblent tous caricaturaux : l’Empereur ne se meut pas dans la même réalité. Ainsi ce dernier ouvre-t-il sans cesse la bouche en silence, agité d’un tic nerveux, comme un poisson, ou comme si son univers intérieur excédait cette réalité désastreuse qu’il refuse de contempler. Ainsi encore Hirohito, jusqu’alors prisonnier des obligations d’étiquette, semble-t-il appréhender le monde que nous connaissons, avec une innocence, une joie toute enfantine. Il faut le voir, chez MacArthur, ouvrir une porte pour la première fois, cette tâche étant d’ordinaire réservée à ses fidèles serviteurs, ou profiter de l’absence de son hôte américain pour moucher les bougies de l’Ambassade !