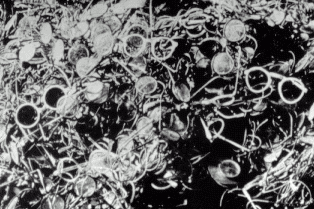« Image. Reflet et réflecteur, accumulateur et conducteur. »
Robert Bresson, Notes sur le cinématographe.
« Or – et c’est là où mène à son extrême limite la formule de MacLuhan – il n’y a pas seulement implosion du message dans le médium, il y a, dans le même mouvement, implosion du médium lui-même dans le réel, implosion du médium et du réel, dans une sorte de nébuleuse hyperréelle, où même la définition et l’action distincte du médium ne sont plus repérables. »
Jean Baudrillard, Simulacres et simulations.
Michael Haneke est un cinéaste hautement retors. Souvent accusés – à tort – d’être sursignifiants, ses films, du Septième continent au Temps du loup, se prêtent toujours à de multiples niveaux d’analyse dont le spectateur n’est jamais exclu. Sa dernière réalisation, Caché, en est magistral exemple. Ne nous fions surtout pas à notre première impression, bonne ou mauvaise : au sortir de la séance, animé de sentiments mitigés, je n’avais su déceler l’essence du film, ce qui en fait l’intérêt majeur, ce qui le hisse peut-être au rang sinon de chef d’œuvre, du moins d’œuvre de premier ordre. Comme nombre de commentateurs et critiques, abusé par la maestria d’Haneke, trompé par ses intentions supposées et, peut-être, coupable de paresse intellectuelle, je m’étais hélas contenté d’une traduction monosémique de cette histoire de culpabilité ; manipulé, je n’avais su voir que Caché, dont le titre même et la séquence d’ouverture auraient dû m’alerter, se payait ouvertement ma tête. Pourtant, je n’étais pas satisfait de cette lecture superficielle. La maîtrise formelle de Michael Haneke était tellement manifeste que je ne pouvais croire en effet, contre ma propre réaction, que Caché – auquel je concédais de nombreuses qualités – était un film trop (dé)monstratif. Il m’a fallu l’éclairage téléphonique de mon brillant ami Sébastien Wojewodka pour me convaincre. Je vous livre ici, après un bref résumé de l'intrigue, quelques réflexions à l’état brut.
Georges, journaliste littéraire pour la télévision, reçoit des vidéo anonymes, filmées depuis la rue, plans fixes et étrangement neutres de la façade de son pavillon, ainsi que d’inquiétants dessins figurant qui un poulet égorgé, qui un enfant crachant du sang. Canular ou sourde menace ? A mesure que le contenu des cassettes se fait plus intime, cette irruption oppressante et quasi fantastique, qui évoque le point de départ de Lost Highway de David Lynch, fissure inévitablement la vie apparemment banale, rangée et sans histoire du couple et de leur fils. Georges/Auteuil se lance alors à la recherche de l’auteur des mystérieuses cassettes. Peu à peu, une histoire d’enfance remonte à la surface de sa conscience, événement refoulé d’octobre 1961 dont il n’avait jamais parlé à sa femme : âgé de six ans, il avait empêché ses parents d’adopter Majid, fils d’ouvriers algériens disparus (victimes du préfet Papon ?) usant d’un pitoyable stratagème. Or, Georges/Auteuil parvient à localiser la porte d’un appartement d’HLM de banlieue, sur une nouvelle cassette : le locataire n’est autre que Majid. Entre eux, un drame va se nouer.

A première vue, donc, il s’agit de la vulgaire vengeance d’un Arabe rongé par le ressentiment au nadir d’une vie médiocre quand son homologue français, lui affichait sa tranquille réussite sociale et médiatique, le tout sur fond de refoulé historique (octobre 1961), de psychanalyse et de conflit israélo-palestinien. Et pourtant, comme me l’a pertinemment suggéré Sébastien, ceci n’est qu’une interprétation primaire et subjective d’images qui, en fait, n'en montrent rien. L’agencement des séquences, et en premier lieu la symétrie de la première et de la dernière d’entre elles, tend en effet à frapper d’indétermination ontologique la diégèse dans sa totalité. Le générique, au début du film, s’inscrit sur un plan fixe de la façade. Au bout d’un certain temps, nous voyons Georges/Auteuil traverser l’écran et entrer chez lui, quand soudain, les voix off de Daniel Auteuil et de Juliette Binoche se font entendre. Le son est feutré, manifestement dissocié de l’image. Il nous faut attendre un « retour rapide » de l’image pour enfin comprendre qu’il s’agissait d’une vidéo, visionnée et commentée par le couple. L’image, dans Caché, n’est jamais qu’un mensonge, comme cette émission littéraire dont le montage, forcément démiurgique, nous est dévoilé (Georges/Auteuil, manipulateur – alors même que nous le pensons manipulé – coupe les propos de ses invités – nous identifions au passage Jean Teulé, Mazarine Pingeot et Philippe Besson[1] –, les agençant à sa guise). Et le dernier plan, où nous voyons – où nous croyons voir – les deux fils deviser sur le parvis de l’établissement scolaire, nous renvoie à nos propres doutes.
Par ailleurs, il nous faut insister sur la constante et entière neutralité des images vidéos, qui ne présentent jamais le moindre élément objectif permettant éventuellement de justifier la terreur paranoïaque d’un Georges/Auteuil dont les mensonges et la culpabilité tendraient même à relativiser les faits... Il n’est pas interdit à vrai dire, à considérer l’étrange relation du drame par Georges/Auteuil à sa femme – relation d’ailleurs suivie de la prise de somnifères – d’imaginer que le suicide lui-même, ainsi que toute cette histoire, ne sont que pures inventions, rêve ou fantasme, de sa part (même si demeure, diégétiquement parlant, la preuve vidéo de cet acte désespéré)… Mais l’important, ici, est que les images vidéo ne sont signifiantes qu’en tant qu’elles sont investies par Georges/Auteuil de ses propres désirs, angoisses, souvenirs ou fantasmes refoulés, de sa mauvaise conscience : de la même façon le spectateur ne cesse d’interpréter, de mettre les images en relation, de construire sa propre fiction. D’une certaine manière, les images vidéo, dont l'auteur reste inconnu (tout le monde est suspect, y compris son fils Pierrot, y compris son ami Pierre) sont les moins signifiantes du film… De ce point de vue, le trauma franco-algérien originel, dont nous ne voyons qu’une représentation onirique, donc douteuse, pourrait bien n’être qu’un leurre, appât fantasmatique destiné à mieux nous tromper : ce que le film nous montre ne serait pas tant la révélation d’un secret enfoui que le dévoilement d’un inconscient, c’est-à-dire, en d’autres termes, l’investissement des images du film par le spectateur lui-même – c'est-à-dire, ce qu'il ne montre pas. Ainsi seraient justifiés ces dialogues étranges, presque incohérents, où Georges/Auteuil ne répond pas tant à ses interlocutrices qu’à ses démons intérieurs : quand sa mère (Annie Girardot) lui demande (je cite de mémoire) « tu y penses parfois ? », celui-ci répond : « A qui ? » et non, comme l’on pouvait s’y attendre, « A quoi ? », et lorsque sa femme lui demande, lors de la relation du drame : « Qu’est-ce que tu as fait ? », Georges/Auteuil répond étrangement : « Quand ? ». Surgissement de l'inconscient dans le Réel. De même, ce que je n’avais pris, bêtement, que comme un pesant arrière-fond politique (les images du conflit israélo-palestinien que ne cessent de diffuser les médias) contribue sans nul doute à susciter, ou du moins à consolider la paranoïa du héros. Mieux : le climat de doute ontologique instauré par le réalisateur nous rend suspectes ces images télévisuelles, dont nous savons qu’elles sont montées, commentées, agencées de façon à susciter une réaction précise.

Il n’est donc rien dans Caché qui ne soit mensonge, illusion. Il n’est aucune image, jusqu’au violent suicide de Majid/Bénichou – à la vue du rasoir, le spectateur s’attend à voir l’Arabe agresser Georges/Auteuil –, qui ne puisse être mal interprétée. L’intervention comique de Denis Podalydès, au cours d’un dîner, est quant à elle seulement justifiée par son muet avertissement (tout ce qu’il vient de raconter, cette abracadabrantesque histoire de réincarnation canine, était pure invention destinée à surprendre ses auditeurs – et les spectateurs du film). Songez aussi à la disparition du fils : quel spectateur, cette fois encore, n’a pas suspecté l’enlèvement alors que l’adolescent se prélassait sans doute dans les bras de quelque jeune fille délurée ? Dans ces conditions, pourquoi Majid se suicide-t-il devant sa caméra ? 
 Comment justifier cette scène, et cet acte terrible – dont la conséquence picturale,également motif de l'affiche officielle, rappelle à la fois la pochette de l'album mythique du groupe d'Alan Vega, Suicide et la fresque sanglante projetée par un bras tranché, sur un mur vierge, dans Ténèbres de Dario Argento ? Même si nous écartons, preuve vidéo à l'appui, la pure et simple négation des faits, nous sommes en mesure d’apporter un début d’explication. En premier lieu, Majid paraît pauvre, désabusé, dépressif. En second lieu, si lors de leur confrontation Majid semblait inquiétant, sarcastique, vraisemblablement coupable, la scène revue par l’image vidéo ne nous montre qu’un Georges/Auteuil menaçant, presque hystérique, face à un Majid amical et effondré… Sans doute n’en fallait-il pas plus pour décider cet homme brisé à franchir la dernière porte… Car en fin de compte, avouons que nous ne savons fichtre pas qui, de Majid ou de son fils, de Georges lui-même ou de Pierrot, de Pierre ou de la femme de Georges – sur qui pèse un soupçon d'adultère – a enregistré ces cassettes VHS. Peut-être même pourrions-nous, si le film était clos, identifier plusieurs « coupables », comme dans les gialli de Mario Bava et Daro Argento (Ténèbres, encore)...
Comment justifier cette scène, et cet acte terrible – dont la conséquence picturale,également motif de l'affiche officielle, rappelle à la fois la pochette de l'album mythique du groupe d'Alan Vega, Suicide et la fresque sanglante projetée par un bras tranché, sur un mur vierge, dans Ténèbres de Dario Argento ? Même si nous écartons, preuve vidéo à l'appui, la pure et simple négation des faits, nous sommes en mesure d’apporter un début d’explication. En premier lieu, Majid paraît pauvre, désabusé, dépressif. En second lieu, si lors de leur confrontation Majid semblait inquiétant, sarcastique, vraisemblablement coupable, la scène revue par l’image vidéo ne nous montre qu’un Georges/Auteuil menaçant, presque hystérique, face à un Majid amical et effondré… Sans doute n’en fallait-il pas plus pour décider cet homme brisé à franchir la dernière porte… Car en fin de compte, avouons que nous ne savons fichtre pas qui, de Majid ou de son fils, de Georges lui-même ou de Pierrot, de Pierre ou de la femme de Georges – sur qui pèse un soupçon d'adultère – a enregistré ces cassettes VHS. Peut-être même pourrions-nous, si le film était clos, identifier plusieurs « coupables », comme dans les gialli de Mario Bava et Daro Argento (Ténèbres, encore)...
Si Michael Haneke nous manipule, cet indispensable cinéaste-légiste de l’ère iconique post-panoptique nous propose dans le même temps de disséquer les moyens dont il dispose. Plus que le passé trouble d’une France coupable – qui n’est cependant pas évoqué à la légère –, le sujet du film n’est autre que le spectateur lui-même, pris en flagrante hallucination schizomatographique, forcé de s’avouer in petto combien ses efforts pour paraître, ou pour dissimuler, combien sa foi presque inébranlable en nos conventions sociales, sa soumission aux codes esthétiques, pourraient se révéler dangereux… A ce titre, le bien nommé Caché, plus labyrinthique qu’il n’y paraît – et qu’il me tarde de revoir afin d’en mieux étudier la dialectique souterraine –, pourrait bien être, avec Le Septième continent, Benny’s Video et La Pianiste, l’une de ses meilleures réalisations.
[1] A propos de Philippe Besson, je crois n’avoir jamais rien lu d’aussi creux, d’aussi vain, d’aussi platement policé, d’aussi VIDE que son Arrière-saison chez Julliard. D’un tableau de Hopper, Besson fait un roman sur un étrange principe esthétique : entre deux phrases de dialogues, il nous assène des pages et des pages d’inutiles explications de texte…