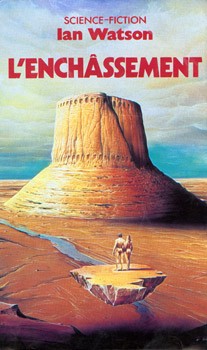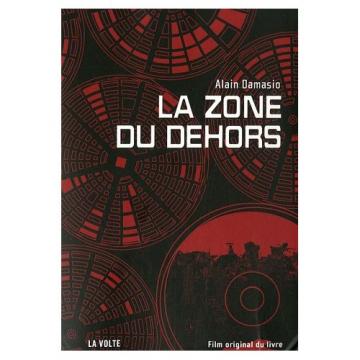
« Believe me when I tell you we know who you are - information, (in formation), violation !
Just do as I say don't question don't make wave - information, (in formation), violation ! »
Pitchshifter, Gatherer of data
Au printemps 2007 paraissait non sans mal, et au compte-goutte, l’ultime numéro de la défunte revue Galaxies (bonne nouvelle : le premier numéro de la nouvelle revue – qui conserve le même nom – doit sortir en mai 2008 sous la direction de Pierre Gévart). Or ce numéro 42, que seuls quelques abonnés ont pu parcourir, proposait un dossier central consacré à l’auteur de La Horde du contrevent, Alain Damasio, dont je ne cesse, depuis plusieurs années (par exemple ici, chez le Stalker), de louer un talent et une ambition hors du commun. Outre la nouvelle déjà commentée en ces pages, « So phare away » (lire aussi le texte de Bruno Gaultier sur Systar), ce dossier comprenait aussi une interview de l’auteur par votre serviteur, ainsi qu’un article dont je vous propose à partir d’aujourd’hui une version in extenso, remaniée et scindée en deux textes (l’un pour la très foucaldo-deleuzienne Zone du Dehors, l’autre pour la fort deleuzo-nietzschéenne Horde du contrevent), eux-mêmes divisés en deux parties afin d’en faciliter la lecture. Quatre billets, donc, pour arpenter comme jamais l’univers singulier du hordier, Alain Damasio.
« Ici régnait l’espace, le désert minéral sans bordure, une immensité qui ne prenait humaine dimension que par la trace, précaire, des pas – et le mouvement. Arpenter. Vagabonder, bondir, vagabondir pour exister ! »
Alain Damasio, La Zone du Dehors
« un dehors plus lointain que tout monde extérieur [...] dès lors infiniment plus proche »
Gilles Deleuze, Foucault
« Voilà le grand paradoxe : la recherche du fondement de l'imaginaire conduit au réel, mais la recherche des fondements du réel conduit à l'imaginaire. » remarquait Edgar Morin dans Le Vif du sujet (Seuil, 1969, p. 347). Ce « grand paradoxe » pourrait être celui d’Alain Damasio, dont La Horde du contrevent, son deuxième roman et – déjà – son chef-d’œuvre, est une véritable parabole– de quoi, nous le verrons –, subtil tressage de concepts philosophiques, spirituels, métamorphosés en grand récit d’aventures, en fictions qui, pourtant, renvoient souterrainement à notre expérience du quotidien. Mais Alain Damasio n’y verrait sans doute aucun paradoxe, lui qui dans une interview en ligne affirmait que « l’Imaginaire amène au fond une chair qui finit toujours par produire ses propres os. » De quoi cette chair est-elle faite ? Quelle « qualité d’os » peut-elle bien produire ?... Comment y faire fluer un sang neuf, sans cesse renouvelé ? C’est ce que nous allons nous efforcer ici de comprendre, de La Zone du Dehors, son premier roman, à La Horde du contrevent. Face aux livres d’Alain Damasio, à leur souffle inouï qui n’a rien à envier à ceux du Seigneur des Anneaux ou d’Hypérion, l’exégète est tenté de s’effacer, de laisser parler la voix de cet auteur unique, sans équivalent dans la littérature française contemporaine. A contrario, chaque page de La Zone du Dehors, et à plus forte raison de La Horde du contrevent, pourrait faire l’objet de passionnantes analyses thématiques ou structuralistes. Plus modestement, sans nous interdire – autant vous prévenir – de déroger à la règle qui voudrait que ne soit pas déflorée l’intrigue d’une œuvre, nous allons nous contenter d’indiquer des pistes de lecture, de livrer quelques interprétations – parfois très personnelles –, de mettre en lumière sa singularité, bref, de montrer en quoi l’œuvre d’Alain Damasio, grand créateur d’univers, est l’une des plus excitantes que la littérature française nous ait données depuis bien longtemps.
Avant de nous plonger au beau milieu des voltés et autres hordiers, une petite précision s’impose. Si La Zone du Dehors est un authentique roman d’anticipation, La Horde du contrevent en revanche ne relève pas de la science-fiction stricto sensu... S’agit-il, pour autant, de fantasy ? Pas exactement, puisque nous nous trouvons plutôt dans une réinterprétation de notre monde, une transposition poétique, métaphorique, avec les armes de l’imaginaire, de questions philosophiques essentielles de notre temps, à savoir : qu’est-ce que vivre ? Comment, aujourd’hui, rester vivant ?...
*
En juin 1999 paraissait aux éditions CyLibris, en deux tomes (Les Clameurs et La Volte), un remarquable roman de politique-fiction, La Zone du Dehors. Rééditée en 2007 dans une version révisée par l’auteur aux éditions la Volte (dont le nom est tiré du livre), cette œuvre explosive, très largement inspirée par Surveiller et punir (pour l’organisation de Cerclon) et par le Foucault de Gilles Deleuze (pour la pensée du dehors des voltés), était déjà, cinq ans avant La Horde, d’une grande richesse thématique – même si le discours (politique, philosophique) se fait parfois trop envahissant –, et témoignait de l’intérêt majeur que porte Alain Damasio au style, pour lui primordial (le style – autant dire la voix singulière de l’auteur –, trop souvent relégué au second plan, en science-fiction comme ailleurs, – comme si raconter une histoire ou extrapoler les découvertes scientifiques ne nécessitait pas la même attention formelle, ou comme si nos auteurs se contentaient du talent, oubliant leur aspiration au génie), comme il s’en explique dans notre entretien (cf. Galaxies n° 42).
2084, tout juste un siècle après le déroulement du plus célèbre roman de George Orwell. À Cerclon, parcelle rendue artificiellement habitable d’un satellite de Saturne, la vie des colons rescapés des guerres nucléaires qui ont ravagé la Terre est parfaitement réglée par le totalitarisme soft de l’idéal démocratique... Cerclon (Enfer climatisé constitué de sept secteurs circulaires entourant un disque central) est un modèle d’utopie et de société des loisirs, où égalité des chances, confort matériel, sécurité et bonheur sont garantis par le Clastre, un système transparent de classement des citoyens selon leur personnalité, leur exemplarité civique et leurs compétences (on pense à l’évaluation des habitants par leurs voisins dans Simulacres de Philip K. Dick). Du résultat des tests, renouvelés tous les deux ans, dépend non seulement votre emploi, votre rémunération, mais aussi votre identité même : chacun se voit attribuer un code, le plus souvent imprononçable, de une à cinq lettres, qui remplace son nom aux yeux omniprésents de l’administration et, par extension, des administrés… L’autre grande innovation de Cerclon est architecturale et technologique : d’innombrables drones et caméras, la transparence des murs et les tours panoptiques assurent préventivement la surveillance et la sécurité. La première conséquence de cette organisation, paradis de la norme et du politiquement correct, est l’annihilation des énergies et des volontés. Bénéficiant de tous les conforts domestiques, d’injections de bonheurs artificiels et d’une totale prise en main de leur vie par les pouvoirs publics, les Cercloniens deviennent, à tous points de vue, des faibles, des mous, des assistés – un troupeau aveugle. Cerclon est une gigantesque unité de soins palliatifs dirigée par un président cynique et, surtout, gérée par le Terminor, un puissant ordinateur central. Cette apathie, cet endormissement des sens et de l’intellect, écoeure la poignée d’opposants réunis sous le nom de la Volte. Leur but : par tous les moyens, électriser les consciences !... Redonner souffle et vitalité aux Cercloniens !... Briser leur servitude volontaire !... En un mot : résister ! Les voltés luttent, parfois à mort, pour promouvoir leur conception libertaire du monde – symbolisée par les grands espaces hostiles du Dehors, surface plus ou moins inhabitable et bombardée d’astéroïdes qui entoure Cerclon. Qualifiés de terroristes au moindre incident, l’universitaire Captp (dit Capt), lecteur assidu de Nietzsche et Foucault, sa petite amie Bdcht (dite Boule de Chat), Kamio le peintre, Slift le fonceur (alias le Snake) et leurs compagnons du Bosquet – les cinq meneurs du mouvement – vont radicaliser leur action pour saborder un pouvoir démocratique mais froidement ubuesque et, enfin, donner corps à leurs idéaux. Bravant le risque d’être condamnés au Cube, monstrueux jumeau du cœur du pouvoir politique, effroyable bloc où sont compactés tous les déchets, y compris radioactifs, des sept millions de Cercloniens, où chacun projette ses rêves et ses peurs (une Zone dans la Radzone…), les voltés n’hésiteront pas, pour parvenir à leurs fins, à recourir à la violence…
Cerclon, c’est zéropolis – « la nullité qui fait nombre », écrivait le philosophe Bruce Bégout à propos de Las Vegas. C’est l’État Unique de Nous autres de Ievgueni Zamiatine dont D503, le narrateur, constatait : « L’idéal […] sera atteint lorsque rien n’arrivera plus ; malheureusement… » (Gallimard, « L'Imaginaire », 1971, p. 36), c’est donc un peu la fin de l’histoire humaine, de ses horreurs comme de ses beautés. Cerclon, c’est une société dévitalisée, désenchantée (ou aux enchantements rigoureusement encadrés), sans valeurs transcendantes, où le « bonheur », tel que défini et imposé par la social-démocratie – un bonheur de boy-scouts, lisse, hygiénique, aimable –, est méticuleusement normé. Cerclon, c’est la version moderne, bien-pensante, soi-disant libérale, moins policière que policée, de l’asservissement du peuple par Big Brother dans 1984 – dont il ne faut jamais oublier qu’il ne sert qu’à masquer l’horrible vérité : il n’y a pas d’aliénés, seulement – insistons – des esclaves volontaires, des. C’est Le Meilleur des mondes sans l’eugénisme, soma compris, ou Révolte sur la lune sans autres chaînes à briser que l’inertie des habitants. C’est le cauchemar climatisé du Marcom de Philippe Curval. Une « société de consensus massif » (p. 59). Cerclon, c’est encore, cinq ans avant Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec, l’empire du nombre, le diktat des statistiques et des médias, l’univers du Terminor et de « l’orœil qui a tari l’énergie du toucher, du goût et de l’odeur » (p. 196), l’orœil, ce monstre symbolique enfanté – selon Kamio – par « l’œil et l’oreille copulant » (ibid.). On peut toujours s’en contenter. On peut bander pour les monades urbaines. Absorber les chaînes d’information comme une éponge. Attendre la mort sous perfusion. Mais l’alternative, pour Damasio, existe. Elle a pour nom : vivre.
Capt, le captain et héros du roman, se montre parfois d’une intolérable exigence (certains diraient fanatisme) mais reste animé d’un feu intérieur que nul ne peut éteindre, pas même les déferlements radioactifs du Cube. Capt vomit les tièdes comme il abhorre la soumission de ses concitoyens à l’épais vernis de règles et de lois qui phagocyte tout désir de vivre.
« Ce système n’avait qu’une exigence, qui relevait plus d’un goût supérieur et subconscient que d’un principe : ne se laisser faiblir par aucune de ces considérations morales et pudibondes qu’on appelait “les droits de l’homme”, “les droits de la femme”, “les droits de l’enfant”, “Le respect de la propriété”, “la liberté réciproque”… En clair, tout ce que trois millénaires de judéo-christianisme avaient cumulé dans la conscience clapotante des femmelettes, des retraités et des impotents, qui tous votaient, et qui, trois cents ans après l’invention du robinet en était encore à croire à l’eau sainte des bénitiers et à l’innocence des confessions. » (pp. 47-48, avec une faute au passage…)
Car bien entendu, les Cercloniens sont des êtres civilisés. Ils votent. Ils l’ont choisie, leur sécurité. Ils nous ressemblent !… Mais pour les Voltés, « La démocratie est une médiocratie… – Relayée par une médiacratie… » (p. 439) Médiocratie en effet, tant les talents sont étouffés par le poids des normes officielles. Les dirigeants ne sont pas des forts, mais plutôt les meilleurs d’entre les faibles – les plus « méritants » selon l’ordre mathématique du Clastre. Et médiacratie, puisque toute décision politique – voir le procès de Capt, dont le sort est scellé en direct par les holospectateurs – est motivée par l’impact présumé de sa mise en œuvre sur les médias… Autant dire que la chasse aux voix ne diffère aucunement d’une vulgaire campagne publicitaire. « Mais en quoi faire vendre serait-il différent de faire voter ? » se demande Capt. « Et même de gouverner ? Ne s’agit-il pas toujours, à partir d’une liberté présupposée, d’orienter ses choix ? » (p. 284) Le capitalisme et la démocratie, main dans la main, ont besoin d’une « sociologie des comportements qui soit capable de dégager les principales chaînes émotives ; d’en dresser une typologie fouillée ; d’examiner la mécanique intime des schèmes stimuli/réaction ; de segmenter les tendances sentimentales par âge, sexe, plasticité, réseau relationnel, sociostyles, etc. – tout cela en fonction des stratégies d’impact et des cibles visées. […] Pour finir, d’une gestion probabilitaire qui détermine non seulement les effets prévisibles des stratégies menées […] » (pp. 284-285) L’homme divisé, l’homme segmenté, l’homme machinisé... La chair, l’âme, traduites en nombres !…
« C’est un lieu commun, écrit Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne expliquée aux enfants, que nous ne sommes pas en 1984 dans la situation promise par Orwell. Le déni est hâtif. On a raison, du moins pour l’Occident, si l’on entend cette situation en un sens étroitement politologique ou sociologique. Mais si l’on fait attention à la généralisation des langages binaires, à l’effacement de la différence entre ici-maintenant et là-bas-alors, qui résulte de l’extension des télérelations, concomitant à l’hégémonie du négoce, on trouvera que les menaces qui pèsent du fait de cette situation, la nôtre, sur l’écriture, sur l’amour, sur la singularité sont, dans leur nature profonde, parentes de celles décrites par Orwell. » Sans parler des réseaux de plus en plus denses de caméras de surveillance, dont certaines, dans l’Angleterre d’aujourd’hui, rappellent à l’ordre les contrevenants via des hauts parleurs. Ça n’est pas anecdotique ! La Zone, c’est ici, c’est maintenant. Est moins visée par La Zone du Dehors une dictature de type communiste ou fasciste comme l’étaient Nous autres et 1984, que l’évolution présente de nos sociétés « intellectueuses », en lesquelles Alain Damasio voit sans doute la surpuissante expression du biopouvoir selon Michel Foucault, auteur que Capt enseigne d’ailleurs à ses étudiants, à qui il fait lire Surveiller et punir bien sûr, mais aussi La volonté de savoir qui s’intéresse à la « mise en discours » de la sexualité (c’est-à-dire moins à sa prétendue répression, qui pour Foucault n’est qu’une hypothèse, qu’au fait que la société ne cesse de parler de la sexualité et de sa répression ), avant d’étudier – en reprenant les thèses de Surveiller et punir – les liens qui existent entre cette mise en discours et la mise en place de mécanismes de pouvoir propres à la bourgeoisie. Capt et ses amis « volutionnaires », seraient donc animés par la volonté de savoir, tandis que La Horde ferait le récit de la quête d’une volonté pure ou plutôt d’une souveraine volonté de puissance… Les voltés adressent un formidable « Non ! » au monde postmoderne (le « Deviens ce que tu es ! » de la première version du roman s’est d’ailleurs mué aux éditions la Volte en un « Deviens ce que tu hais ! », p. 203, assez sibyllin au premier abord, mais qui nous semble souligner, non sans brutalité, la posture défensive, voire destructrice, de la Volte – car haïr, comme aimer, c’est être encore vivant, c’est déjà agir, c’est toujours devenir…).
*
Les murs cercloniens sont transparents, laissant les intérieurs accessibles aux regards de tous, notamment ceux à ceux des voyeurs et autres délateurs nichés dans les postes d’observation des tours panoptiques de trente étages qui dominent chaque secteur. Alain Damasio hérisse ses textes de tours : La Horde du contrevent a sa Tour d’Ær et les flèches d’Alticcio, les Altermondialistes de la nouvelle « Les Hauts Parleurs » vivent dans la Tour de Leuze, la Tour Borgès, la Tour Guattari, etc., sans oublier les phares de « So Phare Away ». La tour, chez Damasio, peut être métaphore de l’accumulation babélienne, ou tour de guet, ou de résistance, comme en Gondor. Mais revenons à notre Panoptique. Au prétexte du principe de transparence,que nous connaissons bien sans toujours en mesurer la portée, l’intimité n’échappe plus au contrôle. Le pouvoir, cependant, disparaît derrière le Cube, une architecture silencieuse, elle-même dissuasive (« cent mètres d’arête, vingt-six étages au-dessus du sol (un par Ministre), le Terminor et son réseau câblé en dessous, quatre façades de miroirs fumés et un astroport sur le toit »). À l’évidence, tout a été conçu dès l’origine pour que les forces du COP (Code de l’Ordre Public) n’aient pas à intervenir. Prenons les tours panoptiques. Prélevée de son contexte carcéral initial pour être replacée dans un cadre urbain, biopolitique, l’invention du philosophe utilitariste Jeremy Bentham contribue fortement à nous faire considérer la ville (la vie) elle-même comme une prison : celui qui se sait observé – ou plutôt, et c’est là tout le génie du système, celui qui se sait susceptible d’être observé (sous-entendu, par l’œreil) – se sent coupable, tel le pécheur sous le regard de Dieu, et n’a pas d’autre choix que de faire profil bas ! Tout citoyen est un délinquant potentiel qu’il s’agit de débusquer au plus tôt (il suffit d’un œil ou d’une main à découvert sur une image vidéo pour que l’entreprise Défordre identifie vos empreintes rétiniennes ou digitales). Rien de plus simple (et de plus économique !) : le travail du pouvoir « carcéviscéral » est facilité par le zèle de son troupeau et par ses certitudes satisfaites… Capt le théoricien en est évidemment conscient : « Notre démocratie, peut-être que c’est réussi en cela : tout le monde un peu flic, il n’y a plus de monopole réel du flicage. Mais tout le monde si modestement, si petitement, que personne n’est vraiment à abattre – mais personne ne sent vraiment bon non plus. » (p. 31). Quant à ces « délinquants », il ne s’agit jamais que d’individus fichés, surveillés pour leurs activités légèrement différentes de la norme – et qui dit fichés, dit peu enclins à récidiver…
Mais la peur, la culpabilisation et l’inévitable nouvel ordre moral qui s’instaure inévitablement ne sont pas les seules conséquences de la social-démocratie panoptique. À un niveau plus symbolique, c’est l’individu qui est menacé dans son indivisibilité même (le « crime parfait » selon Jean Baudrillard), comme Capt et ses élèves le prétendent au cours d’un beau et naïf concerto philosophique (avec contrepoint critique, relanceur, vulgarisateur…), dont Maurice G. Dantec s’est peut-être souvenu au moment d’écrire Cosmos Incorporated et Grande Jonction. Clastre rime opportunément avec cadastre : le peuple devient panel, l’individu simple unité cadastrale. Et nos voltés se battent avec ardeur pour reconquérir leur corps, leur âme… Leur Je !
Pour lire la seconde partie, cliquez ici.