L’Enchâssement de Ian Watson - 1 - SF et langage (13/01/2008)
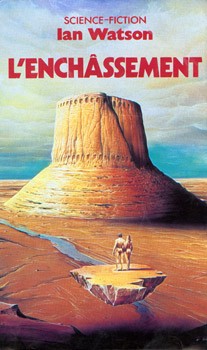
L’Enchâssement (The Embedding), publié en 1973 et traduit par Didier Pemerle, était le premier roman de Ian Watson (« le plus remarquable premier roman que j’ai lu depuis dix ans » écrivait James G. Ballard dans The New Statesman) ; il obtint en 1975 le prix Apollo pour sa traduction française. Né en Angleterre en 1943, cet ancien étudiant en linguistique, dont les débuts en science-fiction remontent à 1969 dans la revue New Worlds – et à qui l’on doit également Le modèle Jonas (The Jonah kit, 1975), L’inca de Mars (The Martian Inca 1978), L’ambassade de l’espace (Alien Embassy, 1977), le « space opera théologique » Le monde divin (God’s World, 1979) ou la novella La voix de Wormwood (A Speaker from the Wooden Sea, 2002) –, entretient dans ses romans l’idée que notre réalité peut être littéralement transcendée, que, par des moyens qui diffèrent d’une œuvre à l’autre – ici, le langage –, nous pourrions atteindre ce que Michael Bishop a désigné comme un « continuum cosmique », ou ce que les extraterrestres de L’Enchâssement appellent l’ « Autre-Réalité » – transcender la prison que constitue l’univers physique.
L’Enchâssement n’est certes pas le premier roman de science-fiction à s’articuler autour du langage et de ses théories. Dans « L’odyssée martienne » (« A Martian Odyssey », in Wonder stories, 1934) de Stanley G. Weinbaum, le membre de la première expédition martienne était confronté à l’étrangéité du langage des autochtones. En 1973, les lecteurs de Fiction pouvaient découvrir « Langage universel » (« Omnilingual »), récit de H. Beam Piper publié à l’origine dans Astounding Science Fiction en 1957, dans lequel une autre expédition se heurtait au langage d’une civilisation martienne disparue. Dans Les langages de Pao (The Languages of Pao, 1957) de Jack Vance (que Folio SF réédite en mars 2008), les langues sont des outils, des armes sociales utilisées pour manipuler les masses, à l’image – même si, ici, c’est d’abord pour améliorer la société jugée trop passive de la planète Pao que le sorcier Palafox scinde la langue paonaise en plusieurs branches artificielles – du Novlangue de 1984 de George Orwell (1949), sans doute le plus fameux prototype du genre. Plus encore que l’apparence ou le comportement, c’est le langage qui différencie deux cultures pour Jack Vance ; le message reçu par les scientifiques de La voix du maître 1968) de Stanislaw Lem, aussi insondable que les émanations de la planète Solaris, en est un autre exemple, tout aussi probant. Le langage est encore une arme, au sens littéral cette fois – et viral –, dans Babel 17 de Samuel R. Delany, qui, sans renoncer « à aucun des délicieux poncifs du genre », écrivait Gérard Klein dans sa préface, met en scène une impitoyable guerre du langage. D’Orwell à Delany, en passant par Vance, circule en effet l’idée que le langage ne se contente pas de refléter notre vision du monde : il l’informe, il altère nos perceptions, il façonne notre pensée – si le verbe peut être créateur, il peut également aliéner. Dans Babel 17 comme dans 1984, la nature totalitaire – technique – du langage est ainsi combattue par ce qui échappe à tout systématisme : l’amour et les infinies possibilités de la poésie contre le réductionnisme des algorithmes. Chez Philip K. Dick, le langage peut d’ailleurs créer de (presque) parfaites illusions : ainsi Ragle Gumm, le malheureux héros du Temps désarticulé (1959), découvre-t-il, effaré, que de simples mots écrits sur des morceaux de papier ont suffi à berner ses sens : « Notre réalité se situe dans un univers de mots, non de choses. D’ailleurs une chose, cela n’existe pas, c’est une Gestalt au sein de l’esprit. […] Le mot est plus réel que l’objet qu’il désigne. ». Plus tard, personne ne semble avoir relevé que son œuvre la plus emblématique, Ubik (1969), achevait d’accorder au langage sa toute puissance – il suffisait d’y déclarer « Je suis vivant et vous êtes morts » pour bouleverser radicalement jusqu’aux lois les plus immuables de la diégèse – pour voir des vivants se dessécher et des morts réapparaître qui n’avaient pourtant pas été conservés dans un moratorium. Ainsi que le stipulait déjà à mots couverts Jorge Luis Borges dans « Tlön, Uqbar, Orbis tertius », maîtriser le langage (en l’occurrence à travers l’édification d’une encyclopédie totale), c’est maîtriser l’univers.
Avec L’Enchâssement, Ian Watson propose apparemment une sorte de synthèse entre les spéculations d’un Vance ou d’un Delany d’une part, et les intuitions logocratiques d’un Dick ou d’un Borges d’autre part. Certes pas exempt de défauts, certes pas aussi psychédélique – bien qu’il brasse extraterrestres, indiens d’Amazonie, drogues diverses, gouvernements fourbes, expérimentations scientifiques et vertiges cosmiques –, que d’autres romans américains de la même période (je pense entre autres à Jack Barron et l’éternité, Tous à Zanzibar, Camp de concentration…), L’Enchâssement n’en constitue pas moins l’un des sommets de la science-fiction moderne, qu’aucun éditeur, pourtant, n’a cru bon de rééditer depuis vingt-deux ans (Camp de concentration n’est pas mieux loti, avec déjà vingt-quatre ans de purgatoire)…
2 - Les expériences de Chris Sole
À suivre…
15:40 | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : sf, science-fiction, critique littéraire, littérature, l'enchâssement, ian watson, langage |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Salut très cher.
Bien d'accord avec toi même si j'ai préféré, à ce bon bouquin, La cinquième tête de Cerbère, lu au même moment.
Tu le sais, Babel 17 est à mes yeux un des chefs-d'oeuvre méconnus de la SF : je me demande comment nul n'a encore songé à adapter cet excellent space opera...
Espérons que tu vas revenir à un rythme de publication davantage en accord avec ton rythme de lectures tout de même, effréné.
Amitiés.
Écrit par : Stalker | 13/01/2008
Babel 17 en lien.
Tu as oublié, dans ta liste, L'Etoile et le fouet d'Herbert, qui traite à sa façon la question de la compréhension entre deux êtres intelligents...
Écrit par : Stalker | 13/01/2008
Ah, cher Stalker, oui, je devrais tenir un rythme acceptable désormais, apès le faux départ du mois dernier. Je n'ai toujours pas lu La Cinquième tête de Cerbère, mais la Transhumaine m'en a acheté un exemplaire récemment - j'en rendrai sans doute compte ici.
Babel 17 est un roman passionnant, mais j'avoue que son côté space opera psychédélique avait un peu gâché mon plaisir. Je le relirai probablement. Quant à L'étoile et le fouet, tu me devances : il en sera un peu question dans la suite de l'article...
Écrit par : Transhumain | 13/01/2008
Cher Transhumain,
C'est toujours avec plaisir que je lis tes chroniques et ma culture très restreinte dans le domaine de la SF m'a, jusqu'à aujourd'hui, toujours freiné à intervenir.
Pourtant c'est avec surprise que dans cette liste d'oeuvres consacrées aux différents niveaux de perception de la réalité à travers le langage, je n'ai pas trouvé mention de Van Vogt. Il a écrit en 1945 (ce qui précède la plupart des autres oeuvres citées) "Le Monde des non-A" traduit par Boris Vian, puis deux suite - le tout constituant le "cycle du non-A".
Cet ouvrage a parait-il poussé de nombreux étudiants de l'époque à s'intéresser à la sémantique générale (dont il est beaucoup question dans le roman).
Je me permets humblement de te le conseiller tant il semble s'inscrire parfaitement dans le thème de cet article.
Écrit par : Rom1 | 14/01/2008
Cher Rom1, j'ai lu Le monde des non-A, mais, comme L'étoile et le fouet signalé par Juan, il en sera question dans le corps de l'article, dont ceci n'est qu'une introduction. Il est vrai que le titre donné à cette intro, "SF et langage", est un peu trompeur : je n'y visais pas l'exhaustivité. Bon, je la reverrai peut-être.
Et surtout, n'hésitez pas à intervenir : nul besoin d'être un grand spécialiste - ce que je ne suis d'ailleurs pas moi-même - pour avancer des idées.
Écrit par : Transhumain | 14/01/2008
Bonne année 2008 dans mes bonnes resolutions je vais essayer de lire un peu plus de SF et venir ici plus souvent et pas que pour la SF tous mes meilleurs voeux
Écrit par : Soleil | 14/01/2008
DANS LA POUSSIERE DES EAUX
Le langage ne se lit pas
Uniquement en mode horizontal
Et ses frontières ne sont pas bordées
Par une profondeur supposée
Par un présumé possesseur
Le langage trace son chemin
Au milieu des fractales du vent
Créant la matière des univers
En y injectant des hormones
Sans croissance mais polymorphes
Écrit par : gmc | 26/01/2008
Le dossier qui a inspiré cet article :
http://www.cafardcosmique.com/SF-LANGAGE-la-SF-est-elle-douee
Écrit par : Soleil vert | 29/11/2010
Je n'avais jamais lu cet articulet, mon soleil d'amour.
Écrit par : Transhumain | 30/11/2010
Ne pas oublier Epépé de Karinthy... Extrait de la 4ème de couverture : "Un linguiste hongrois nommé Budaï se rend à Helsinki où se prépare un congrès scientifique. Mystérieusement, son avion atterrit ailleurs, dans une ville immense et inconnue de lui. Plus troublant encore : la langue qu'on y parle lui est parfaitement inintelligible. Rien n'y fait, ni la science de Budaï — il maîtrise plusieurs dizaines de langues — ni ses méthodes de déchiffrement les plus éprouvées ne lui permettent de saisir un traître mot du parler local. Tandis qu'il cherche désespérément à retrouver sa route, le mur d'incompréhension se resserre chaque jour autour de lui. Avenues grouillantes de monde, métros, fêtes foraines, cultes religieux, défilés, émeutes : sous les apparences les plus familières d'une grande cité moderne, tout paraît absolument étrange et inhumain. Toujours au plus profond de l'incommunicabilité, Budaï fait un séjour en prison, connaît des amours éphémères, sombre dans la misère, se met à gagner sa vie comme portefaix et participe même à une insurrection à laquelle il ne comprend décidément rien."
Écrit par : Sébastien MEDARD | 23/05/2013