Amélie Nothomb : la mort du Verbe est son métier (à propos d'Acide sulfurique) (26/10/2005)
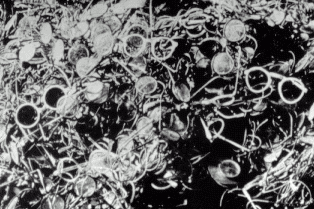
« Je dis :
― Est-ce qu’on ne pourrait pas mettre deux camions au lieu d’un seul pour gazer ? Les choses iraient plus vite.
― Non, dit Schmolde, j’ai dix chambres à gaz de 200 personnes, mais je n’ai jamais plus de quatre camions en état de marche. Si je mets un camion par chambre, je gaze 800 personnes en une demi-heure. Si je mets deux camions par chambre, je gazerais peut-être – peut-être ! – 400 personnes en un quart d’heure. Mais en fait, je ne gagnerais pas de temps. Car après cela, il m’en restera encore 400 à gazer.
Il ajouta :
― Il va sans dire qu’on ne me donnera jamais de camions neufs.
[…]
Finalement, un après-midi, l’idée me vint que je n’arriverais jamais à rien, si je continuais à tourner ainsi en plein vide, sans rien de concret pour fixer mes idées, et je décidai de reproduire, dans mon propre camp, l’installation de Treblinka, comme une sorte de station expérimentale qui me permettrait de mettre au point les méthodes nouvelles que je cherchais. Dès que ces mots : « station expérimentale » surgirent dans mon esprit, ce fut tout d’un coup comme si un voile se déchirait, la peur de l’échec se dissipa, et un sentiment d’énergie, d’importance et d’utilité entra en moi comme une flèche. »
Robert Merle, La Mort est mon métier.
Ayant un important travail rédactionnel à terminer d’urgence pour un ouvrage collectif à paraître au dernier trimestre 2006, j’ai dû, hélas, repousser de quelques semaines les articles promis ici même sur quelques romans indispensables de ce début de siècle – La Horde du contrevent d’Alain Damasio, La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq, Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec –, comme j’ai également dû remettre à plus tard d’innombrables lectures d’ouvrages reçus, achetés, empruntés, dont les piles instables, envahissant tout l’espace disponible, menacent à tout moment de s’écrouler... Après La Guerre des Mondes, le film sans âme de Steven Spielberg, vous ne m’en voudrez donc pas d’autoriser aujourd’hui mes sarcasmes, en guise de récréation, à jeter leur dévolu sur un auteur apprécié du public et, quoi qu’on en dise, estimé par la critique professionnelle, un auteur qui participe pourtant avec ses produits textuels – qu’on dirait écrits par un logiciel – à l’engloutissement de la littérature francophone mainstream dans un flatland où tout est plat, indéterminé, UniMonde faux et mécanique.
Jusqu’ici, je ne pensais à vrai dire pas grand chose des romans d’Amélie Nothomb, dont je n’avais lu que les trois premières oeuvrettes : Hygiène de l’assassin, inquiétante interview d’un écrivain monstrueux ; Le Sabotage amoureux, évocation fantasque – et inégale – de son enfance en Chine ; Les Combustibles enfin, récit dramatique dont l’emphase et la pauvreté, tant stylistiques que symboliques, m’avaient stoppé net dans mes fragiles velléités. Dans les deux premiers textes du moins subsistait-il une voix, reconnaissable entre toutes, certes agaçante, certes un peu vaine, mais plutôt caustique. Bref, si le talent d’Amélie Nothomb était selon moi grandement usurpé, elle-même m’était restée, allez savoir pourquoi, plutôt sympathique. Aussi, quand en cette rentrée littéraire 2005 la donzelle, au charme de laquelle, je le confesse, je ne suis pas totalement insensible, s’est trouvée, pour de mauvaises raisons, quasi unanimement conspuée par la Critique, alors mon esprit chevaleresque m’a fait perdre mon sang froid : puisque son Acide sulfurique, chahuté pour son sujet polémique – un rapprochement téméraire de la téléréalité et des camps de concentration –, était traîné dans la boue, ridiculisé, mis à l’index par les sempiternels défenseurs bien pensants de la « mémoire juive », eh bien, ah !, je la lirais, la chose !, d’autant que cette comparaison audacieuse pouvait déboucher, je le pressentais – j’avais tort –, sur d’abyssales réflexions, plonger au cœur des ténèbres, contempler la face du Mal…
La Critique, pour une fois, ne s’y était pas trompée : d’Acide sulfurique, il n’y a rien, ou presque, à tirer. L’idée de base – un nouveau jeu télévisé, subtilement intitulé « Concentration » : de nombreuses caméras filment vingt-quatre heures sur vingt-quatre les prisonniers d’un camp (arbitrairement embarqués au hasard des rafles), et ce sont les téléspectateurs, voyeurs impénitents, qui décident chaque jour lesquels d’entre eux seront exécutés –, cette idée donc, qui, je le maintiens, n’était pas plus stupide qu’une autre – et que plusieurs écrivains de science-fiction avaient déjà décliné, comme Pierre Bordage dans Wang –, n’est pas développée : parasitée par une liaison sadomasochiste entre l’héroïne et une kapo particulièrement bête, elle ne s’élève jamais au-dessus de la plus éthylique des discussions de comptoir. Tout au plus saisit-on au passage, au milieu d’une improbable enfilade de clichés, une ou deux phrases un peu moins creuses que les autres, comme l’importance que Pannonique, l’héroïne, accorde aux noms propres, et d’abord au sien propre bafoué par son numéro d’immatriculation (CKZ 114) – ce que d’autres ont déjà écrit, avec infiniment plus de sagesse. Le reste du temps, ces pages étiques, imprimées en corps 16, ne charrient qu’un vide absolu, une écriture plus grise, plus froide – mais d’une froideur stérile –, plus morte que le Dachau-Academy superficiellement dépeint. Or, il me semble que l’évocation, même allégorique, de l’Holocauste, des Camps et de leurs répliques, exige non seulement une intelligence, une profondeur exceptionnelles dont Amélie Nothomb, selon toute apparence, est dépourvue, mais encore une langue habitée, peuplée par la mémoire des morts, un Verbe salutaire – Lumière portée au pays de l’Ombre –, qui seuls sont capables, peut-être, d’échapper au vortex machinique de l’organisation des Camps, que Robert Merle avait si bien disséqué dans La Mort est mon métier. Ce que fait le haut gradé des Camps, il le fait non par sadisme, non par méchanceté, mais, écrit Robert Merle dans sa préface de 1972, « au nom de l’impératif catégorique, par fidélité au chef, par soumission à l’ordre, par respect pour l’État. Bref, en homme de devoir : et c’est en cela justement qu’il est monstrueux. » Il y avait là, j’en suis sûr, une piste à creuser, en s’intéressant par exemple aux nouvelles soumissions, aux valeurs contemporaines susceptibles, par des voies détournées, d’aboutir à de pareils désastres – ce qu’ont fait, à leur manière, Maurice G. Dantec et Michel Houellebecq dans leurs derniers romans. Or Acide sulfurique, au style étrangement absent – et faible –, étréci par son obsession du sadisme des subalternes, est d’emblée contaminé, malgré lui, par la logique industrielle que son auteur prétend pourtant dénoncer. C’est à mon sens cet échec, rarement signalé, non la qualité intrinsèque du roman, non son postulat de départ, qui est impardonnable. George Orwell l’avait parfaitement compris, qui dans 1984, chef d’œuvre qui me hante et dont je décèle de passionnants échos dans Cosmos Incorporated, écrivait l’agonie d’une humanité dépossédée de ce qui la distinguait des machines.
22:45 | Lien permanent | Commentaires (27) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Cher Olivier, soit ! C'est à peu près ce que l'on en dit tous ! Je pense que votre commentaire dans mes pages était assez précis : le rapprochement des deux thèmes, hormis scandaliser sur un plan éthique, est tenable, reste qu'il faille encore un écrivain digne de ce nom pour risquer un tel pari. Mais Nothomb n'est pas un écrivain, pas une plume, à peine une pointe bic qui rapporte des sous, comme une vache à lait que l'on traie tous les ans pour récupérer des fonds !
J'attends toujours pour ma part la grande oeuvre de Nothomb ! Mais arrivera-t-elle ? En attendant, j'ai plongé, sur vos conseils, dans Loterie solaire ! A lire et relire ! Voilà un roman digne de ce nom qui nous offre un panorama angoissant de notre modernité ! Et oui ! Le style et la grandeur de Philip K. Dick ! C'est bien ce qui manque à notre cabrette des lettres !
J'attends avec une impatience à peine contenue vos textes sur Dantec ! Je prépare les miens (pour le Jidécé normalement !)
Écrit par : Marc A. | 27/10/2005
Malgré tout le respect que j’ai pour George Orwell, je ne considère pas "1984" comme un chef d’œuvre. Un bon livre, certes, inspiré par un roman d’Evgueni Zamiatine "Nous autres", lequel est probablement un chef d’œuvre si ce mot n’est pas trop galvaudé. Du point de vue de l’écriture, Orwell est un peu faiblard, alors que Zamiatine est un écrivain bien supérieur à lui. Dans ses "Essais, articles, lettres" (préface à "1984", tome IV, je crois), Orwell reconnaît sa dette envers Zamiatine.
Deux écrivains s’en prennent assez durement à Orwell et à son livre le plus célèbre : Vladimir Nabokov, dans sa préface à "Brisure à senestre", le traite d’écrivassier, et Milan Kundera, dans ses "Testaments trahis", critique sa vision du totalitarisme, jugée caricaturale. Il faut dire qu’Orwell n’a pas connu le communisme de l’intérieur, contrairement à Kundera.
Écrit par : Sébastien | 27/10/2005
Cher Marc, merci de votre passage. "Loterie solaire" est loin d'être parfait du point de vue littéraire, mais quelle avance, en effet, sur l'inanité d'"Acide sulfurique" !
Sébastien, "Nous autres" de Zamiatine est un livre trop méconnu, que j'évoquerai bientôt ici, ainsi que l'amusant "Endiablade" de Boulgakov, mais pas autant, par exemple, que "L'Inassouvissement" de Witkiewicz, roman prophétique dont le jeune héros finit broyé par le Ministère de Mécanisation de la Culture - j'en reparlerai. Orwell ne cachait pas sa dette, mais puisque vous abordez la généalogie de "1984", ne vous arrêtez pas en si bon chemin... Vous remonterez ainsi, des contre-utopies (dont on trouve des équivalents bien avant Zamiatine) aux utopies de More et Bacon, jusqu'à "La République" de Platon.
Quant à Orwell, je vous trouve un peu léger... Nabokov, que j'admire, n'avait pas sa langue dans sa poche. Faut-il accorder quelque importance à ses propos ? Ou faut-il croire Houellebecq lorsqu'il traîte Nabokov de faiseur sous-joycien ?... Kundera, lui, fait la même erreur que la plupart des commentateurs d'Orwell, souvent des journalistes : ils ne s'attachent qu'au caractère politique manifeste du livre, à l'aspect caricatural de cet avenir concentrationnaire, alors qu'il convient, à mon sens, de s'intéresser surtout à son sens latent, à son récit de la dislocation du langage. Alors, vous comprendrez que "1984" demeure sans doute l'un des romans les plus décisifs du 20e siècle, celui qui a su le mieux restituer le mouvement de l'histoire contemporaine - qu'il jugeait, en grand pessimiste, irréversible. Le qualifier d'écrivaillon est grotesque - je remarque seulement que le même reproche est fait, à tort, à tous les grands auteurs de science-fiction, y compris à Philip K. Dick qui, pourtant, dans ses oeuvres les plus abouties ("Ubik", "Substance Mort", "Coulez mes larmes, dit le policier", la trilogie divine) avait atteint une quasi perfection formelle, dont feraient bien de s'inspirer nos littérateurs.
Écrit par : Transhumain | 27/10/2005
Alors que je consomme indistinctement SF et littérature blanche (ou du moins j’essaye), j'ai été déçu il y a quelques semaines lorsque je me suis lancé dans la lecture du fameux "1984" (d'ailleurs sous l'impulsion d'une fan d'Amélie Nothomb, bref j'aurais dû me méfier). La question de la défragmentation du langage est en soi l'une que j'estime des plus importantes de nos jours et elle se trouve dans "1984" étudiée avec une certaine profondeur, mais je ne sais pas si c'est parce que je ressortais d'une relecture des "TdO" et de "Villa Vortex" de Dantec ainsi que d'une plongée dans les oeuvres d'Artaud, Burroughs et Joyce, mais j'ai trouvé "1984" en deçà du chef d’œuvre qu’on m’annonçait à droite et à gauche. Les idées étaient là, mais le style et tout le processus littéraire pour les traiter à leur juste mesure étaient pour ainsi dire présents qu’en filigrane. Déception donc, même si j’affirme néanmoins qu’il s’agit d’un très bon livre et qu’il serait salvateur pour certains de le lire de toute urgence.
Quant à Amélie Nothomb, je n'ai pas lu son brûlot mais cette idée de comparer la téléréalité à la réalité des camps de concentrations a résonné dans ma tête comme une véritable insulte. Encore une fois, je compare ça avec ce que Dantec tente de faire, avec la place qu’Auschwitz prend dans son "oeuvre", et là je sens qu’il y a véritablement un fossé entre les écrivaillons de type Nothomb et les électrons libres comme Dantec (même si la production littéraire de ce dernier contient quelques fautes, quelques lourdeurs qui font que son projet n’est pas entièrement réalisé, faute de moyens je dirais).
Merci. J’attendais depuis belles lurettes une opinion un peu plus construite que la moyenne du dernier livre de Nothomb. Je vois que mon attitude de rejet vis-à-vis de celui-ci n’est peut-être pas si irraisonnable que ça. "La mort est mon métier" attend encore sur une étagère que je daigne le lire. Voici une nouvelle raison pour que je m'empresse de me plonger dedans...
Écrit par : skam | 27/10/2005
À noter que la traduction de 1984 est catastrophique, comme c'est souvent le cas en France avec les oeuvres d'anticipation, de SF ou d'heroic-fantasy, y compris les plus prestigieuses. On ne saurait trop conseiller aux anglophiles de découvrir ce chef-d'oeuvre (car c'en est un, y compris au niveau strictement littéraire) dans sa version originale, et aux autres de laisser le bénéfice du doute à un auteur défiguré par les margoulins de l'édition. En attendant qu'un jour quelqu'un s'attelle enfin à transposer en français correct la limpidité de cristal de ce texte magnifique.
Écrit par : George Kaplan | 27/10/2005
Merci de vos visites.
Skam, à la réponse de George Kaplan, j'ajouterais que la langue d'Orwell ne joue pas sur le même registre que celle des Artaud, Burroughs, Lautréamont, Joyce et tutti quanti. Dans "1984" il ne cherche pas à réinventer le langage, à le triturer, mais bien à relater sa disparition. Et même si la traduction, souvent approximative - ce qui, dans ce cas précis, est particulièrement gênant -, ne rend pas hommage au texte original, l'essentiel, qui n'est dû qu'à Orwell, est au moins partiellement transmis.
Tenez, j'en profite pour mentionner le beau "Miroirs noirs" d'Arno Schmidt (fort bien traduit par Claude Riehl, si j'en juge par la qualité du texte français), dont le narrateur, seul survivant - avec une femme - des guerres atomiques, est donc le dernier écrivain - le dernier homme. Je reviendrai un jour sur cet Allemand apocalyptique, dont la renommée en France est inversement proportionnelle à son génie.
Écrit par : Transhumain | 28/10/2005
Lorsqu'à l'occasion, en 2004, j'ai eu l'occasion d'interviewer Amélie Nothomb (dont le charme reste encore à déceler, pour ma part...), j'ai pu récolté quelques phrases qui (citées hors contexte) peuvent s'avérer intéressantes quant à l'étude de cet "Acide sulfurique" :
"[...]je montre au moins que ma langue est vivante, sans parler pour autant une langue débraillée : c’est tout sauf une langue morte et figée, bien que je prouve au moins que cette écriture-là est encore possible et fonctionne même très bien ! Alors je ne sais pas si c’est d’un apport considérable à la langue ; ce sera sans doute un témoignage intéressant – à supposer qu’il reste quelque chose de mon écriture dans l’avenir – de ce que l’on pouvait écrire avec succès à notre époque."
"N’en déplaise à mon amour pour Céline et Colette, [...]"
"Dieu sait si j’admire Voltaire!"
Qu'apportent donc ces indices intertextuels? d'une part, qu'Amélie Nothomb aspire à une "écriture précieuse", un style "archaïque" fondé sur le verbe non pas comme outil artistique et esthétique mais comme fin en soi - ce qu'elle (admettons-le) ne parvient que très partiellement à exécuter ; d'autre part, qu'elle admire et aime immodérément des gens de lettres qui ont politiquement participé à des régimes totalitaires (sans aucun jugement de valeur) et que le despotisme éclairé, à la lecture de ses pérégrinations juvéniles au Japon (pas en Chine, cher Transhumain!), semble recueillir son approbation la moins réservée. Ainsi, "Acide sulfurique" est loin d'être réussi : la satire n'est pas menée à son terme, le thème souffre de son âge et de sa fréquence dans les romans de gare ; il ne parvient pas même à la hisser au rang des re-visiteurs de mythes littéraires.
Sauf le respect de Benjamin Thiry, qui dans son (assez mauvais) site consacré à Nothomb (http://membres.lycos.fr/fenrir/nothomb.htm) déclare que "la jouissance d'Amélie Nothomb se place à jouer avec ce langage, y trouver ses marques et à transgresser les règles qu'elle ne connaît que trop bien", le dernier opus de la belge montre une syntaxe assommante à force de fioritures devenues banales, une ponctuation de moins en moins hiérarchisée, un vocabulaire proche de celui d'MC Solaar, et se fait l'emblème d'une "littérature" souffreteuse, proche de l'embolie.
Écrit par : Baltimore | 29/10/2005
Cher M., alias Baltimore - tu ne m'en voudras pas de te tutoyer -, je te remercie pour ces précisions fort instructives, qui confirment s'il en était besoin la futilité de la prose de miss Nothomb.
Peut-être vas-tu un peu vite en besogne, en revanche, en accusant Céline d'avoir "politiquement participé à des régimes totalitaires" : à ma connaissance il s'est "contenté", dirons-nous, de rédiger et de diffuser des pamphlets "abominablement antisémites" (sic) aussi géniaux qu'abjects, comme "Bagatelles pour un massacre" (1937) et "L'école des cadavres" (1938)... Le mari de Colette, par ailleurs, était Juif, aussi celle-ci paraît au-dessus de tout soupçon. Quant à Voltaire, hum, j'avoue mon ignorance : à quel régime totalitaire aurait-il adhéré ?...
Enfin, j'insiste : le récit du "Sabotage amoureux" - je reviens à Amélie - était bien situé en Chine, à Pékin, non au Japon (qui fut toutefois le théâtre, ni Nô ni Kabuki, de Stupeur et tremblements).
Bienvenue dans Fin de partie.
Écrit par : Transhumain | 29/10/2005
Il est étrange que Nothomb se plaigne de l'exhibition de la souffrance et de l'impudeur de la télé-réalité, alors même que ses propres romans ne parlent que de cela, et qu'elle s'y présente elle-même sous la figure de la victime qui jouit de ses humiliations, cf. Stupeur et tremblement. Si la téléréalité lui répugne, c'est parce qu'elle est très proche d'elle, qu'elle révèle la même face, mais sous un mode moins choc et 6ème arrondissement. C'est cela sans doute qui cause son dégoût, mais absolument pas l'exposition de la souffrance.
Écrit par : thierry | 29/10/2005
Ne confondons pas tout, Thierry. La mise en scène de la violence et de la souffrance n'est pas condamnable en soi - ce n'est pas pour rien si dans ma bibliothèque figurent des tueries comme "Miso soup", "American Psycho", "Fight Club", "Un prof bien sous tout rapport", "Histoire de l'oeil", "Paradoxia", Fjord", "Le Festin Nu", "Crash !", etc. -, pas même lorsqu'il s'agit de sa propre violence, de sa propre souffrance, et n'est nullement contradictoire avec la mise en accusation - légitime - de la passivité, du voyeurisme, du spectateur, qui sont, plus que l'exhibition, au coeur du roman. Le texte, d'ailleurs, évasif, elliptique, excessivement superficiel, n'est pas complaisant. Le problème est donc moins thématique, je le répète, que dialectique.
Ceci dit, pour abonder dans votre sens, nous pourrions écrire un torchon, que nous intitulerions "Doliprane 500". Il s'agirait d'une contre-utopie futuriste dans laquelle tous les livres vendus à moins d'un million d'exemplaire, selon les principes démocratiques, seraient intégralement détruits. Resteraient seulement, dieux vivants, quelques écrivains vedettes (Marc Lévy, Amélie Nothomb, Paulo Coelho, Alexandre Jardin) qui, forts de leur pouvoir, forceraient le pauvre peuple à écouter des lectures publiques de leur prose dégoulinante. Nous citerions évidemment Kierkegaard pour faire bonne figure. Jardin rendrait obligatoire l'enculage de chèvres ; la guimauve, sous l'impulsion de Marc Lévy, serait proclamée plat national ; et toute femme ne cachant pas son indécente chevelure sous un chapeau pourri serait condamnée à être gavée de fruits avariés avant d'être lapidée par une lesbienne sado-maso (loi Nothomb 2025). A la fin Paulo Coelho, ayant reçu un message divin sous forme de texto, mettrait fin à cette mascarade en déclarant, l'air pénétré : "ce que Dieu veut, Dieu l'obtient, et Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé d'interdire la littérature". Le système automatique à reconnaissance vocale de mise à feu des têtes nucléaires occidentales, programmé pour se déclencher au mot "littérature", ne s'enrayerait pas. Même les raéliens périraient.
Écrit par : Transhumain | 29/10/2005
Fin du Transhumain donc, ouf !
Signé : C. de la Balle
Écrit par : Balle, set et match ! | 29/10/2005
Tiens, un troll.
Écrit par : Transhumain | 30/10/2005
Concernant le rapport entre réalité et téléréalité, et la fascination malsaine de notre époque pour les petites choses de la vie, le banal, le trivial, même le vulgaire, je te signale le livre de Bruce Bégout, La découverte du quotidien, chez Allia. C'est un bouquin excellent et l'introduction sur le rapport de l'époque, du quotidien et de la philosophie est vraiment très bonne.
Bien à toi (et que la transhumanité transite encore, car aucun terme ne lui est fixé)
Écrit par : Frédérique | 31/10/2005
Merci Frédérique, le livre est sur la liste - d'une longueur cauchemardesque - de mes futures lectures. Bruce Bégout est un écrivain d'une rare intelligence, dont je n'ai lu que "Zéropolis" et "L'éblouissement des bords de route", ainsi qu'un texte passionnant sur l'évolution urbanistique, dans la revue Inculte. A propos de "La découverte du quotidien", lire la présentation de l'ouvrage par l'auteur lui-même, dans l'indispensable Zone du Stalker : http://stalker.hautetfort.com/archive/2005/10/27/le-mensonge-quotidien-par-bruce-begout.html, déjà parue, en partie, dans les pages d'Inculte.
Quant au terme "transhumanité", que je ne considère qu'avec une certaine ironie, il contient en lui-même la notion de constante mutation : l'humanité ne cesse d'évoluer, la stase est son ennemie mortelle. Bien à toi.
Écrit par : Transhumain | 31/10/2005
Le froid Transhumain est assez naïf, des tas d'Allemands des deux sexes divorçérent de leurs conjoints Juifs ou en partis Juifs et devinrent des Nazis convaincus, pas seulement des conformistes poncutellement antisémites, ces derniers devaient quand même être dans les milieux privilégiés, la majorité. Magda Goebbels, ex Quandt, fut le paradigme des fous qui y croyaient et le film "La Chute" ne doit pas être trés loin de ce qu'elle fut.
Passant de The War of the Worlds à Ms Nothom et son dernier enfant raté est une note de Transhumain critiquant les critiques, qui eux encensent des navets et des ouvrages, que l'on éspére erreur de parcours.
Le probléme avec Céline est qu'il est un styliste génial, un écrivain majeur, je me fout complétement des ses idées politiques, comme je ne pardonne à d'autres de faire de mauvais films ou d'écrire des romans dela même eau.
En Art la forme est la premiére qualité sine qua non. Pas une bonne morale, que je compare au Streussel, cette pâte sucrée coupée en petits morceaux qui améliore les tartes germaniques en courronnant le dessus, comme la créme fraiche qui améliore mais ne pourrait faire un met en solitaire.
Écrit par : Traube | 01/11/2005
Traube
Avant d'encenser la forme, tu devrais d'abord surveiller ton orthographe. Avec trois fautes par phrase, la souci formel a du plomb dans l'aile.
Écrit par : franck | 01/11/2005
Franck, je t'emmerde!
Mieux vaut des fautes d'orthographe qu'un crane vide de chercheur de poux petit-bourgois fort en dictée!
Écrit par : Traube | 01/11/2005
Traube, ainsi que tous les petits trolls de passage, je vous ai déjà dit d'essuyer vos pieds avant d'entrer. Franck, cependant, n'a pas tort : je me fous des fautes de frappe, mais lorsque le discours est rendu obscur par la faute d'un français mal maîtrisé, c'est une autre affaire. C'est à toi de faire l'effort d'écrire correctement, pas à nous de te déchiffrer...
Écrit par : Transhumain | 01/11/2005
Vous êtes un fichu petit-bourgeois Transhumain, dommage que vous soyez si aggrésif.
Écrit par : Traube | 01/11/2005
Et bing, encore une belle faute. Cerise sur le gateau! En fait la fin de partie, c'est surtout celle de la culture et de la maîtrise de la langue. Après cette perte, tout est possible. Des Traube, il y en a des milliers qui courent les rues avec une syntaxe aussi défaillante que leur pensée.
Écrit par : benjamin | 02/11/2005
Benjamin chercheur de poux aggggggrésif car avec un seul g agrésif je n'arrive pas vraiment a lui tapper sur sa frimousse de Akademischeproletariatmitglieder, pa vraiment traduisible mais je vous dis merde avec des tas de r merrrrrrrrrrde!
Écrit par : Traube | 02/11/2005
Acide sulfurique est indubitablement une vraie faute de gout, avec un projet de départ douteux, un traitement soporifique et un résultat vraiment pauvre, pas une seconde à la hauteur de ce qu'il semblait vouloir s'annoncer.
Et il y en a eu d'autres, de mauvais livres de Nothomb. Pas d'aussi mauvais, mais tout de même.
Cependant, cette fille a du génie, un génie tout à fait inégal, qui marche par fulgurances, qui n'est pas très contrôlé, mais qui est indiscutablement là. Peut être que Biographie de la faim est le seul de ses livres où cela transparait sans doutes possibles.
Après... c'est réellement une écriture féminine, et c'est certain que quand on sort d'un Dantec par exemple, ça manque un peu d'envergure. le côté psychologisant, quand il est raté, est vraiment insupportable.
Et pourtant, je l'aime !
Écrit par : Se7th | 03/11/2005
"c'est réellement une écriture féminine, et c'est certain que quand on sort d'un Dantec par exemple, ça manque un peu d'envergure."
C'est quoi, une "écriture féminine" ? C'est une écriture qui manque d'envergure ? Etrange, comme qualificatif...
Sinon, je suis ravi d'apprendre que Les Combustibles sont un "récit dramatique". J'avais bêtement cru que c'était une pièce de théâtre... :)
*Celeborn
Écrit par : *Celeborn | 04/11/2005
Oui Céléborn, mais dans mon souvenir - je n'ai pas vérifié -, ce n'était pas précisé sur la page de titre. J'ai donc considéré qu'il pouvait s'agir soit d'une pièce, soit d'un roman sous forme de pièce... D'où ma prudence !
Écrit par : Transhumain | 04/11/2005
Tu as raison d'être prudent, d'autant que ce n'est pas écrit sur la couverture et qu'on ne le trouve pas au rayon théâtre de la FNAC, mais avec les autres ouvrages de la miss. Toutefois, pour avoir mis la chose en scène sans en avoir changé une virgule, et devant un public qui a trouvé ça très bien, je peux affirmer tranquillement que c'est une pièce de théâtre, et que l' "écriture théâtrale" fonctionne extrêmement bien !
*Celeborn, sans accents :)
Écrit par : *Celeborn | 04/11/2005
acide suflurique.
"Ca casse pas trois clou un marteau" me dirait mon grand-père.
En fait je me contrebalance de la critique de ce livre médiocre.
Je voulais juste dire qu'après mon deuxième passage, ma caboche avait enfin fait le lien entre le titre du blog et Beckett.
Vous jouez les mots?
En attendant transhumain sur mon blog...
Écrit par : Edmin. 8 | 15/11/2005
Oui, Beckett, admirable Beckett, dont il sera longuement question ici, un jour...
Écrit par : Transhumain | 15/11/2005