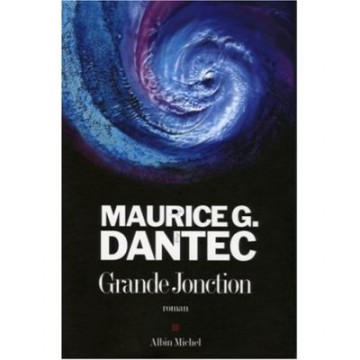
“Bored of the things
that you are.
And now at the things
that you were.
How does it feel to destroy
everything by your guilt?”
Justin K. Broadrick, Your Path to Divinity, in album Jesu.
Les critiques de l’œuvre de Maurice G. Dantec ont ceci de paradoxal, qu’elles la considèrent généralement comme l’une des plus marquantes de l’époque, tout en formulant de sérieuses réserves (Juan Asensio, qui s’agace à juste titre de « très pesants tics de langage », d’un style « lourdement cinématographique » ou encore d’une « fastidieuse monodie accumulative », sans parler de « fautes de goût » adolescentes, ou Jean-Louis Kuffer, qui reproche à Dantec, non moins légitimement – mais avec un stupide préjugé sur la bande dessinée –, sa paranoïa « ravageuse », ses lourdes « béquilles idéologiques », ses « personnages terriblement stéréotypés » et, surtout, un hiatus énorme « entre la substance théologique dense mais plaquée et cette dramaturgie de bande dessinée »). L’an dernier, ne qualifiais-je pas moi-même Cosmos Incorporated d’échec littéraire, l’accusant, un peu violemment, de s’aspirer dans son propre trou noir ? Aujourd’hui Grande Jonction, qui sur le fond ne fait qu’approfondir les thèmes essentiels du roman précédent, pourrait représenter un nouveau danger pour son auteur. Je pense, comme mon ami Juan, aux critiques, professionnels ou amateurs, qui hier conchiaient un écrivain fasciste et/ou illisible, et qui, sans crier gare, et sans le moindre amour-propre, retournent aujourd’hui leur veste et, avec la même superficialité que leurs précédentes attaques, vantent les mérites romanesques d’un écrivain retrouvé, ce qui reste encore le plus sûr moyen, et le plus vil, de s’en débarrasser. Ne pas céder aux sirènes du grand cirque. D’un autre côté, la richesse de certaines analyses, comme celle, remarquable, de Bruno Gaultier, tendent à surestimer une œuvre certes importante, voire indispensable, mais aussi souvent poussive, naïve, maladroite – une œuvre monstrueuse, en perpétuelle mutation, que son mouvement frénétique empêche d’atteindre la grâce. En un sens, la série de textes de Bruno, parce qu’elle énonce clairement et intelligemment les ressorts narratologiques et métaphysiques du roman, lui est supérieure (mais en un sens seulement, car elle ne saurait exister sans l’œuvre première)… Le danger, pour Dantec, serait donc d’une part de croire à une nouvelle plénitude médiatique alors qu’il n’est, aux yeux et entre les mains des journalistes, qu’un pantin réac’ et rock n’roll, et d’autre part, en dépit d’une authentique humilité (que j’ai pu constater lors de notre rencontre), de croire à la lettre les bienveillants exégètes qui, grisés par leur analyse, élèvent son œuvre au niveau des plus grands. Je m’étonne par exemple que personne, ou presque, n’ait encore souligné combien l’envol final des derniers hommes libres de Grande Jonction, parcelle canadienne arrachée à son socle terrien, est à la fois sublime et ridicule, s’étirant d’un égal élan vers la Bible , et vers La soupe aux choux… Que retenir, donc, de cet épais roman de science-fiction théologique dont la forme même s’attache, au mépris de toute prudence, à figurer la lutte inégale entre la Bête et la beauté ? Le blog du Transhumain reprend son rythme.
Après avoir fait imploser Cosmos Incorporated en cours de route, après avoir lutté contre la fausse parole pour que renaisse le verbe dont nous serions selon lui constitués, Maurice G. Dantec se trouvait, pour nous, dans une position littéraire inconfortable. Allait-il s’emparer de ce verbe qui l’obsède tant et cesser enfin de tourner autour, ou allait-il inlassablement reproduire le même échec ? Grande Jonction, suite directe de Cosmos Incorporated, se meut en effet délibérément entre ces deux territoires incompossibles – qu’en vain cependant, Dantec tente de lier –, autrement dit, à leur impossible jonction, au cœur de la Centrale de Narration cosmogonique évoquée par Gabriel Link de Noval à l’heure de sa transformation, à l’aube de la création de son Arche céleste. Tragique récit d’une lutte pour un territoire menacé, Grande Jonction narre à la manière d’un western – et parce qu’en ces terres réside encore quelque beauté échappant à la grisaille de la Machine-Monde –, en en déclinant tous les codes (attaque d’un camion/diligence par les néo-islamistes/indiens ; défense d’un Fort Alamo ; shérif inflexible et tutti quanti), les hauts faits d’une guerre qui oppose à la fin du 21e siècle quelques irréductibles – une poignée de femmes, d’hommes et d’androïdes qui littéralement refusent de se laisser réduire, qui défendent leur âme d’essence divine à sa déclinaison chiffrée – à l’emprise infernale de la chose, l’Anome, survivance omnipotente de la Métastructure , qui s’apprête à engloutir le monde. À Grande Jonction en effet, aux alentours du cosmodrome, au lieu même où tout commença – et où tout finira, provisoirement –, un nouveau mal se répand. Ne sont plus touchés les seuls détenteurs de systèmes bio-embarqués – ceux-là continuent de décéder les uns après les autres, tués par les dispositifs artificiels qui les avaient aidés à survivre. Désormais la chose, « l’Après-Machine », ne s’attaque plus seulement au mécanique, ni même au biologique, mais directement à ce qui selon Dantec définit l’homme en tant que tel : le symbolique, le langage, le pouvoir de nommer les choses (qu’on se souvienne de Primo Levi, qui dans Si c’est un homme écrivait la nécessité vitale de ne pas considérer les individus comme des matricules, ou comme des unités interchangeables). Les malades contaminés par le métavirus se mettent à débiter du langage binaire, suite ininterrompue de 1 et de 0, de plus en plus vite, jusqu’à se muer en modems organiques, avant d’exploser en débris numériques, la version codée de leur être exposée aux yeux de tous, sur les murs. L’écriture elle-même disparaît littéralement des livres et de tout autre support : les pages redeviennent vierges, les unes après les autres, effaçant les mondes qu’elles contenaient. En d’autres termes, la chose « machinise » ce qui reste de l’humanité, essaie d’en éliminer l’essence. Et transforme le monde en Camp de concentration global. Le salut de l’humanité, moins menacée numériquement que symboliquement (puisque le travail de l’Anome est de réduire l’humanité, de la diviser, non de la détruire totalement, ce qu’illustre magnifiquement l’épique bataille finale), ne tient qu’à un fil, ou plutôt à six cordes, celles de la guitare électrique de Gabriel Link de Nova, ange christique de douze ans dont la musique rock, par laquelle communient les mortels (Link, le lien), guérit définitivement les malheureuses victimes du métavirus. Gabriel, prophète dont les mains avaient déjà le pouvoir de préserver les machines électroniques, puis électriques, s’impose comme la réponse surnaturelle à la chose qui le ronge. Autour de lui se réunit en effet une communauté de valeureux croisés, un « Reste » par qui l’humanité continue malgré tout d’exister : Chrysler Campbell, l’ordinateur humain, tueur loyal à la froide intelligence, et son acolyte Youri McCoy, fasciné par les derniers chrétiens et amoureux de la belle Judith Sévigny ; Balthazar, le cyberchien de Cosmos Incorporated qui rôde dans les couloirs déserts de l’hôtel Laïka ; le shérif Wilbur Langlois, la Loi incarnée, bouclier d’airain du Territoire ; Milan Djordjevic, père adoptif de Gabriel, et l’androïde Sydia Nova, sa mère adoptive ; et ces envoyés du Vatican, qui convoient une bibliothèque d’ouvrages théologiques à l’intention des derniers hommes libres. En face, la chose semble s’être incarnée en la personne d’un androïde qui offre à ses fidèles l’immortalité en échange de leur singularité (leur âme) – donnant naissance à une néo-humanité (une « Anomanité ») de « clones » indifférenciés dont la conscience est purement collective (comme, récemment, dans Les Noctivores de Stéphane Beauverger, dont la suite, La cité nymphale, paraît prochainement, nous y reviendrons en temps voulu).
Dans sa critique de Cosmos Incorporated (Galaxies n°39), Sam Lermite (dont je vais publier dans quelques jours un excellent texte consacré à Minuscules flocons de neige depuis dix minutes de David Calvo) parlait à juste titre d’un « roman sur la science de la fiction ». Et de fait, nous assistons encore, avec Grande Jonction, récit de l’anomie du langage, à la représentation esthétique du combat opposant l’Anome et le Logos, comme le suggère cette belle pensée de Josef Ratzinger, citée par l’auteur en exergue de la deuxième partie (et qui fait écho au Nous, fils d’Eichmann de Gunther Anders longuement commenté dans Cosmos Inc.) : « Aujourd'hui, si la loi universelle de la machine est acceptée, il ne faut pas oublier que les camps pourraient préfigurer la destinée d’un monde qui adopte leur structure. Les machines qui ont été mises au point imposent la même loi. Selon cette logique, l’homme doit être interprété comme un ordinateur et cela n’est possible que s’il est traduit en nombres. La Bête est un nombre et transforme en nombres. Toutefois, Dieu a un nom et nous appelle par notre nom. Il est la personne et recherche la personne. » L’enjeu du roman est limpide : comment figurer l’indicible, comment écrire la dévolution du langage – et donc de l’humanité – sans y succomber à son tour ? Le chef d’œuvre de George Orwell, 1984, sans doute l’un des romans les plus importants de l’histoire, y répondait magistralement, et le plus simplement du monde : le langage n’est pas un simple système de codage d’informations, il n’est pas strictement utilitaire : il est vecteur de singularité, de beauté, par sa richesse, par sa liberté de dire l’amour, mais aussi parce qu’il transmet un héritage – un témoignage. L’omniprésence dans Grande Jonction de la musique rock, qui contamine le roman jusqu’à son style (nous allons y venir), nous rappelle précisément que la singularité, la spécificité individuelle, naît moins du néant, que d’une patiente et laborieuse étude d’un socle culturel commun (d’où l’importance cruciale des 13000 volumes convoyés par les soldats du Vatican). La littérature, comme le rock, ne font pas, en théorie, qu’exploiter un « temps de cerveau disponible », pour reprendre les termes employés par Patrick Le Lay à TF1 : comme le principe divin selon Jean Duns Scott, abondamment cité dans le roman, ils transmettent, ils unifient tout en singularisant.
Du rock, Dantec essaie donc de conserver un rythme, un tempo particulier, tout en répétitions, en scansions, d’où les variations personnelles, que nous qualifions un peu facilement de « fulgurances » (en omettant de rappeler que pour que ces dernières surviennent, il faut en maîtriser la genèse, savoir enfouir la beauté pour la mieux faire surgir), sont censées émerger. Sans parler des titres de chapitres, qui reprennent tous le titre d'une chanson, ou le nom d'un groupe, à commencer par Radiohead. Le roman dans son ensemble est ainsi conçu comme une chanson rock (Bruno Gaultier en dissèque fort bien les mécanismes), Welcome to the Territory, orchestrée par Gabriel Link de Nova. Et c’est précisément là que le bât blesse. En effet, la langue syncopée de Grande Jonction, qui dans ses meilleurs passages peut évoquer le style quasi slamé de Chuck Palahniuk (Fight Club), souffre le reste du temps d’un pénible déficit de singularité, d’un excès de machinisme, évidemment problématique dans le cas qui nous intéresse. Loin d’hypnotiser le lecteur, loin de l’immerger dans un éblouissant trip littéraire, les refrains en anglais de Welcome to the Territory alourdissent inutilement une prose déjà trop mécanique. Si Dantec martèle ainsi ses idées, si les mêmes phrases reviennent sans cesse, comme des mantras, c’est que l’auteur, aveuglé par la puissante lumière qu’il trouve dans la prière, essaie à son tour de nous faire entrer en transe. En vain. Comme si U2 jouait du Rammstein (ou du Laibach…).
À plusieurs reprises, de longues descriptions de la flore étique de Grande Jonction s’insèrent dans la narration, tout droit sorties d’un quelconque dictionnaire botanique. La critique s’en est d’ailleurs moquée, sans pourtant chercher à en saisir le sens. Or, si ces maladroits passages auraient pu sans dommage être réduits et mieux répartis, disséminés dans le texte comme autant de graines de combat, ils n’en témoignent pas moins de la lutte, à l’œuvre au cœur de la diégèse comme dans l’écriture elle-même, pour la survie du langage. Nommer les choses, nous l’avons dit, même s’il ne s’agit que de mauvaises herbes, permet en effet à l’auteur de ne pas céder à la destruction du langage. Mais la beauté du verbe se fait trop rare, et sans vraie cohérence : ça ne fonctionne pas, ça tourne à vide. D’autant, effet sans doute involontaire, qu’à ces listes d’espèces végétales (dont la poésie s’estompe rapidement) fait écho la précision mécanique avec laquelle l’auteur, comme à son habitude, inventorie les nombreuses armes et méthodes de combat employées.
En outre, hormis Gabriel Link de Nova et, dans une moindre mesure, Youri McCoy, les personnages sont bien trop stéréotypés pour vraiment prendre vie. Dantec ne parvient jamais, par exemple, à nous communiquer la beauté de Judith, même lorsqu’elle est perçue par les yeux de ses prétendants. Judith ne reste, pour nous, qu’un fantasme adolescent de beauté féminine. Une créature dont l’âme se limite aux formes plantureuses. Une poupée aux yeux morts. Quant aux héros, réduits à leurs fonctions minimales, ils évoquent davantage de rigides avatars de shoot them up (cette analogie me frappe soudain : la tentative dantécienne de nommer les choses, plantes ou automatiques, de leur redonner une existence annihilée par l’Anome, renvoie aux listes d’items auxquels le gamer d’un jeu de survie comme Resident Evil est confronté…) que des êtres autonomes, doués d’une vie propre. Erreur fatale dans un roman dont l’enjeu est bien la sauvegarde d’une étincelle de lumière divine. Pensez que même Feric Jaggar, le leader nazi de Rêve de fer de Norman Spinrad, qui extermine les impurs dans la joie et l’exaltation, même cette caricature de héros de fantasy ou de space opera était bien plus émouvante, plus vivante que les personnages de Grande Jonction… Dans la première partie, Youri McCoy (personnage privilégié, de loin le plus intéressant, car sans doute le plus proche de Dantec, dont nous suivons le cheminement spirituel jusqu’à sa conversion) et son mentor Chrysler Campbell recensent toutes les victimes de la chose. Ils enregistrent et analysent les données, chacun à sa manière, mathématique pour Chrysler, plus affective, métaphysique pour Youri, Ils sont les « médecins du Camp », comme Youri le répète à longueur de temps, c’est-à-dire qu’ils font eux-mêmes partie de la dévolution (nous faisant comprendre au passage combien cette analyse purement numérique de la situation est absurde), mais y compris, et c’est sur ce point que je voudrais insister, de la dévolution narrative. Certes, comme le rappelle Bruno Gaultier, le personnage de Judith vaut surtout pour l’amour qu’il inspire à Gabriel et à Youri, mais cet amour lui-même reste lettre morte, ne jaillit jamais d’un verbe dantécien tout simplement impuissant. Il faut se demander si cette antienne de Youri McCoy, « Nous sommes les médecins du Camp », n’est pas le code d’accès au système du roman. Certes, nous savons que Maurice G. Dantec a écrit Grande Jonction très vite, trop vite, en quelques mois, avec une facilité qui ne laisse pas d’inquiéter. Mais ce leitmotiv de McCoy ne saurait être fortuit : l’auteur aurait-il donc tenté ce pari insensé, d’enfermer sciemment ses personnages, et leur univers, dans la grisaille machinique de l’Anome, pour mieux les sauver ensuite ?... À l’échelle du roman, cela n’a aucun sens, mais à celle d’un cycle ? Délire d’interprétation ? Sans doute. Et cependant.
L’espoir n’est pas mort. Grande Jonction est un roman métaphysique passionnant, sans conteste, surtout pour l’indéniable élan intellectuel qu’il suscite chez certains lecteurs – quoique, ne nous leurrons point : je ne sache pas que nos girouettes de la presse aient vraiment compris ce que Dantec essaie de leur dire –, mais qui échoue encore une fois formellement à se hisser à la hauteur de ses admirables ambitions. Je le répète : j’aime la démarche courageuse de Maurice G. Dantec ; je préfère mille fois son échec (qui, tout de même, n’est jamais complet) aux réussites étriquées d’écrivains sans envergure, dont le nombril, sujet ou moteur de fiction, constitue l’indépassable horizon. Mais l’espoir subsiste encore, disais-je. Avec son Arche de lumière (qui, selon que l’on est bienveillant envers l’auteur, ce qui est mon cas, ou que l’on est son adversaire, provoquera une émotion toute métaphysique ou bien suscitera le souvenir de l’effarant final de certain navet, cité en introduction de cet article, où flatulences et onomatopées tenaient lieu de dialogues…), Gabriel Link de Nova conduit les derniers hommes libres dans l’espace, hors de Grande Jonction (hors du lieu diégétique, mais aussi, hors du roman) vers ce Ring qui, en orbite, échappe à l’emprise de l’Anome. Ainsi est-ce non sans impatience, et non sans inquiétude – car le successeur de Grande Jonction n’a plus droit à l’erreur –, que nous attendrons le troisième et, en théorie, dernier volet de cette trilogie annoncée, où nous devrions retrouver, peut-être enfin transcendée, cette nouvelle communauté de l’Anneau.






