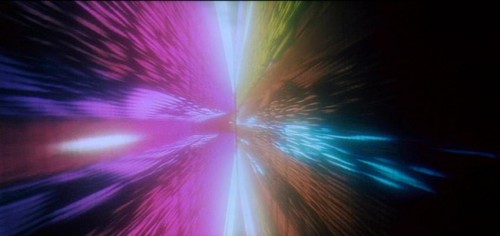En deux articles seulement, nous avons réussi l’exploit, d'une part de réfuter l’hypothèse M lehmanienne, celle de la métaphysique comme variable cachée de la science-fiction – qui aurait précipité son déni par les élites au 20e siècle –, puis d'autre part, d’y revenir, non sans l’avoir quelque peu métamorphosée : la SF réussie, qui ne saurait être phagocytée par ses codes, son kitsch, son fandom, est celle qui remplit la fonction W (« W » pour « Wonder », « W » pour « M » inversé de « Métaphysique »), la SF qui sait jouer des écarts entre une démarche rationnelle, réaliste, et un objet métaphysique. Cette science-fiction-là, génératrice du sense of wonder et du unheimlich (ou, diraient les anglosaxons, du numinous) – un certain émerveillement, un réenchantement du Réel technologique et scientifique –, ouvre son lecteur au sublime kantien, à la transcendance (plus qu’à la métaphysique). Pourtant cette transcendance qui nous élève, ce sublime qui nous ravit, cette terreur sacrée qui nous saisit, sont quasiment absents de Retour sur l’horizon, l’anthologie de Serge Lehman à l’origine de notre sympathique discussion (et d’un thread de centaines de pages sur le forum d’ActuSF). De quoi sont alors faits les textes qui la composent ? Passons l'anthologie au crible de notre Troisième Œil.
Retour sur l'horizon – ainsi baptisée en hommage à la précédente anthologie de Lehman, Escales sur l'horizon, publiée en 1998 au Fleuve Noir, où figuraient des textes de Laurent Genefort, Roland C. Wagner, Ayerdhal, Richard Canal et d'autres dont, déjà, Jean-Claude Dunyach et Thomas Day – s'ouvre, après la préface que nous avons déjà évoquée, avec Effondrement partiel d’un univers en deux jours de Fabrice Colin/Emmanuel Werner, nouvelle en deux parties : d'abord, une lettre adressée à Serge Lehman par Fabrice Colin, dans laquelle il évoque l'étrange parcours d'un texte dickien qu'il n'aurait pas écrit ; ensuite, le texte en question. La lettre inaugurale vaut surtout pour son entame (« Cher Serge, cette courte lettre pour te prévenir que je ne répondrai pas, en définitive, à ton appel à textes ; tu m’en vois évidemment navré, et le moins que je te doive est une explication »), avant de se diluer dans une note d'intention un peu vaine. Et la nouvelle (une androïde rencontre quelqu’un – Philip K. Dick – qui lui raconte un texte en cours d’écriture, récit qui se révèle être sa propre histoire), publiée à sa suite sous le pseudonyme d’Emmanuel Werner (auquel on doit l'excellent roman Infabula chez L'Atalante), est une schizofiction pas inintéressante par ses jeux de miroirs – littérature et réel s'égalent dans de complexes mises en abyme métafictionnelles –, mais jamais vraiment à la hauteur du créateur d'Ubik et de la Trilogie Divine. Impression d'avoir lu un synopsis, puis un synopsis détaillé. Fabrice Colin – qui répète à l'envi qu'il n'a jamais lu Dick –, ici, fait surtout du Colin : mauvais signe. Gageons que Big Fan, son nouveau roman, sera plutôt de la trempe de Kathleen ou de La Mémoire du Vautour.
Une fatwa de mousse de tramway de Catherine Dufour, récit véridique (du moins selon l'auteur) de la vente de produits défectueux (mais aux profits juteux) à une centrale nucléaire, bénéficie de la verve plutôt efficace et de l’humour incisif de l’auteur du Goût de l’immortalité, mais manque singulièrement d’envergure et d’horizon esthétique. Sans intérêt.
Sur un thème analogue, Éric Holstein, s’il ne brille pas par son originalité – l'extension du domaine commercial a déjà fourni des palettes de fictions plus ou moins féroces –, nous amuse un temps avec Tertiaire, texte au name-droping un peu envahissant, dans lequel tout aspect de la vie quotidienne est soumis aux lois des marchés financiers et aux coups de dés des traders, au mépris de toute autre considération, éthique ou affective. Emerson Mighty (on peut aussi acheter un pack identité), trader à mi-chemin entre Frédéric Beigbeider et les yuppies de Brett Easton Ellis, le comprendra à ses dépens. Ça se lit sans déplaisir, mais sans jamais décoller vraiment.
Première escale. Tertiaire est le premier véritable récit de science-fiction de l'anthologie. Il est aussi le premier à avoir soulevé la moitié d'une paupière à votre serviteur. Quant à la variable de Serge Lehman, elle n'est pas cachée, mais, pour l'heure, carrément absente (même par voie de réification), tout comme le sense of wonder qui, pour Lehman, est le dénominateur commun du corpus de la science-fiction... Nous sommes d'ailleurs d'accord avec cette proposition, à cet énorme détail près que pour nous – l'amicale des Transhumains Associés – notre théoricien confond un peu vite plusieurs effets distincts. Le vertige ressenti face aux paradoxes borgésiens – un vertige intellectuel qui est aussi acte métaphysique, parce qu'en fictionnisant le monde lui-même, il renvoie une image du divin – n'est pas le sense of wonder de la science-fiction, dont le surgissement nécessite l'accaparement du divin par la science et/ou la technique. Le sense of wonder, c'est cette émotion, cette exaltation que je ressens lorsque Greg Egan découvre dans L'Énigme de l'Univers la Théorie du Tout, et active ainsi la fonction W : démarche hyper-rationnelle VS événement métaphysique (la création de l'univers). Quand je lis Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Borges (où les métaphysiciens considèrent la métaphysique comme une branche de la littérature fantastique...), je ne ressens pas cette puissance toute nietzschéenne du sense of wonder, mais bien l'effroi du fou qui comprend soudain que tout monde n'est qu'une fiction, une « hypothèse indécidable », un livre. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec ces trois premiers textes à des années-lumière de tout vertige intellectuel, métaphysique ou poétique. Pour l'heure, l'horizon est admirablement plat. Poursuivons.
Les Fleurs de Troie de Jean-Claude Dunyach, spécialiste du format court, déploient leurs corolles sans génie. Nouvelle déception, heureusement agrémentée de quelques fulgurances. « Au-dehors, le ciel est aussi monochrome et plat qu’un fond d’écran. Des dirigeables en vol stationnaire ponctuent la voûte céleste de pixels morts. À l’horizon, le fil lointain de l’ascenseur spatial se perd dans les nuées, en divisant le ciel. Moire et moi possédons chacun notre moitié du monde, et la fêlure qui nous sépare n’est pas plus épaisse qu’un cheveu, tant qu’on ne s’en approche pas. » Belle métaphore du thème central du texte, la division, l'individualisation du réel. Tandis que sa femme, Moire, s'immerge dans la réalité artificielle du Simplexe, plus excitante que la terne réalité quotidienne, et pendant que sur les plages se croisent les fantomatiques silhouettes des Analogues, le narrateur noie son désarroi en explorant la ceinture d'astéroïdes en quête de métaux précieux. Là-bas, il est confronté à une forme de vie parasitique qui va menacer tout ce qui lui est cher... Si les lignes consacrées au départ de Moire pour le Simplexe sont excellentes, la partie spatiale des Fleurs de Troie, qui ne s'y articule qu'au prix d'artifices trop évidents – même si nous aurons compris que ces Fleurs extraterrestres ne sont que les extensions métaphoriques de la dépossession du héros qui, après avoir été abandonné de tous, finit par s'abandonner lui-même – finit par dissoudre complètement la tension et la sensibilité d'un récit bien loin des meilleures short stories de l'auteur (Déchiffrer la trame, La Stratégie du requin et d'autres, disponibles dans ses recueils chez L'Atalante). Quand l'Usain Bolt de la SF s'essaie au-demi-fond, ça coince...
Avec son univers kafkaïen et, certes, non science-fictif (un homme, Delme, est inquiété par les autorités parce qu’il reçoit des courriers subversifs, et non parce qu'il en écrit...), Pirate de Maheva Stephan-Bugni est plutôt réussi mais n’emporte pas totalement l’adhésion. La faute, peut-être, comme tant d’autres nouvelles de cette anthologie, à un style trop efficace, et pas assez vivant, auquel manque cette intensité organique propre aux grands textes, ce qui fait leur nécessité. Et, tandis que chez Franz Kafka, le Château ou la bureaucratie broient inexorablement les pauvres K, ici le héros parvient à tirer son épingle d'un jeu dont il s'approprie les règles. Du Kafka sans l'angoisse, donc ; restent une atmosphère, et de belles idées, comme l'échange final de petits dessins, à travers le guichet d'une obscure administration, qui fait définitivement basculer le récit dans le fantastique le plus étrange. Rappelons du reste qu'il s'agit du premier texte de l'auteur, qui fait déjà preuve ici d'une grande maîtrise, et que nous suivrons volontiers si, comme on le suppose, d'autres textes devaient suivre.
Viennent ensuite Laurent Kloetzer et ses Trois singes. L’idée de la bombe iconique, signe qui provoque la mort (reprise science-fictive d’un thème classique du fantastique) utilisé par l'armée pour nettoyer la planète de ses populations indésirables (coup de bol, les occidentaux seraient immunisés) est malheureusement plus prometteuse que féconde. La nouvelle est incontestablement efficace – décidément le mot-clé de l'anthologie –, d'une mauvaise foi qui plaira peut-être à la Ligue des Droits de l'Homme et à l'internationale altermondialiste, mais son auteur n’exploite pas son potentiel métaphysique. On est quand même beaucoup plus proche, le rire en moins, d'une version politique et musclée de la fameuse blague qui tue des Monty Python que, par exemple, du Babel 17 de Samuel Delany. Métaphore des mots qui tuent et de la violence intellectuelle, la bombe iconique de Trois Singes ne nous éblouit ni ne nous enténèbre, mais prolonge le trait plat.
Deuxième escale. Deux textes de science-fiction sur trois : voilà qui rétablit l'équilibre, sans pour autant donner du grain à moudre à l'hypothèse M du préfacier. Sans gagner la stratosphère littéraire, le niveau s'est légèrement élevé, et nous avons découvert un auteur, Maheva Stephan-Bugni. Mais de sense of wonder, point, en dépit de thèmes qui s'y prêtaient pourtant chez Jean-Claude Dunyach (séparation eganienne du Réel et de son double) et Laurent Kloetzer (le symbole qui tue).
Avec Thomas Day (pseudonyme de Gilles Dumay, éditeur de l'anthologie), nous passons enfin à la vitesse supérieure. L’auteur de La Voie du Sabre livre en effet avec sa novella « Lumière Noire » l’un des meilleurs textes de l’anthologie, un récit énergique, truffé de références (plusieurs hommages à Cormac McCarthy : De si jolis chevaux, Un enfant de Dieu, La Route ; Par-delà le bien et le mal de Nietzsche...) et d'images saisissantes. Nous sommes dans un futur relativement proche, en Amérique, dix ans après une Singularité, un grand crash informatique qui a précipité la civilisation dans une ère post-apocalyptique dominée par l'entité artificielle Lumière Noire. Celle-ci régule la population humaine (détruisant tout groupe humain de plus de trois personnes) et essaime ses drones sur le territoire américain. Nous suivons un jeune canadien au sang indien, Jasper, qui tente de rejoindre Jenny, programmeuse à l'origine du logiciel anti-hackers qui a évolué jusqu'à devenir conscient. Lumière Noire. Dieu auto-proclamé de ce monde – et peut-être d'au-delà –, qui donne naissance à des Anges nommés Alasdair ou Ezéchiel... Mais bien sûr la divinité et la toute-puissance de Lumière Noire ne sont qu'une parodie technique de Dieu, et n'en épuisent nullement le mystère. En livrant sa version post-cyberpunk de La Route, en assumant une certaine trivialité, Thomas Day illustre parfaitement ce qui distingue la littérature de science-fiction des autres genres. Ici, point de miracle qui ne soit accompli par une intelligence identifiable et plus ou moins incarnée, en tout cas réifiée. Pour Serge Lehman, c'est en mettant en scène des dieux vivants comme Lumière Noire que la science-fiction s'aventure en métaphysique. Ce n'est cependant qu'à la toute fin du récit, lorsque Lumière Noire s'apprête à investir l'Univers, quand se creuse soudain la faille infinie entre le dieu artificiel et le vrai Dieu, que surgit enfin, pour la première fois de l'anthologie, la fonction W de la science-fiction, et une rumeur de sense of wonder...
Après cette incontestable réussite, la brève nouvelle d'André Ruellan,Temps mort, bien qu'écrite en une langue irréprochable, tombe comme un cheveu sur la soupe et vaut surtout pour la transition avec le texte suivant, dont nous allons parler d'un instant à l'autre. Nous suivons dans Temps mort l'agonie d'un homme, Walter, atteint d'un cancer en phase terminale, qui erre dans ses fantasmes ou ses souvenirs de Laura. Mourir, est-ce, littéralement ou métaphoriquement, rejoindre celle qu'on a aimée ? Je n'en sais foutre rien. Et à vrai dire…
À vrai dire, parlons donc plutôt des Trois livres qu’Absalon Nathan n’écrira jamais de Léo Henry, sans conteste, comme Lumière Noire, l'un des textes les plus marquants de l’anthologie. Léo Henry, c'est l'un des deux auteurs (l'autre étant Jacques Mucchielli) du remarquable recueil aux éditions L'Altiplano, Yama Loka Terminus, que m'avait conseillé avec insistance Alain Damasio et que j'évoquais il y a quelques semaines chez les joyeux drilles du Fric Frac Club. Léo Henry est également auteur d'un recueil chez l'Oxymore, Les Cahiers du Labyrinthe, que je n'ai pas lu, et scénariste de la série de bande dessinée Sequana. Le narrateur Cantor, employé par Mozart Assassiné (la fondation à l’origine d’une cité-république construite autour des vingt-six pourcents d’artistes, le « reste de travailleurs [œuvrant] pour eux, à leur formation, à la production et à la diffusion de leurs œuvres, à la promotion à travers le monde »), « essaie de rattraper ceux qui peuvent encore l’être », il « aide les génies contrariés à accoucher de leurs œuvres tardives ». Aucun potentiel artistique ne doit être négligé. Dès lors notre ami s’infiltre dans l’esprit d’Absalon Nathan, mort depuis vingt et un jours, prêt à lui extorquer les histoires qu’il n’a jamais écrites. Alors, Absalon lui en raconte trois, qui toutes mettent en scène des écrivains. Dans Les Bucoliques au crépuscule, Anselme Juin écrit son chef d’œuvre, une sorte d’Ada ou l’ardeur (une idylle sensuelle entre deux enfants) qui provoque l’ire des médias et des associations, et le pousse au suicide. Abraham Nolde, lui, mange littéralement ses victimes pour leur subtiliser l’essence dont seront faits ses livres, avant de finir dans l’assiette du Grand Écrivain en mal d'inspiration… Le troisième et dernier récit est celui d’Antonin Brown. Dans un pays où les Années Pures ont purgé de toute l’histoire, où la seule forme littéraire existante est la forme brève et poétique, un homme publie des nouvelles qui connaissent un grand succès. Et pour cause : il s’agit rien de moins que des chefs d’œuvres du genre, La Métamorphose de Kafka, Le Nez de Gogol, Au cœur des ténèbres de Conrad, ou encore Le Horla de Maupassant. Mais quand vient le tour de Pierre Ménard, auteur du Quichotte, la célèbre fiction de Jorge Luis Borges, qui ne fonctionne qu’avec la reconnaissance du roman de Cervantès, le doute s’insinue chez ses compatriotes… Borges, on y pense, forcément – comme au Calvino de Si par une nuit d’hiver un voyageur –, pour le Ménard mais aussi pour L’Approche d’Almotasim, vraie-fausse critique d’un roman imaginaire : Les Trois Livres qu’Absalon Nathan n’écrira jamais vaut moins pour son argument science-fictif, somme toute assez artificiel, que pour ces trois histoires passionnantes liées par une même inspiration souterraine. Les trois perles de l’anthologie sont donc des livres que personne n’a jamais écrits…
Troisième escale. Avec une excellente nouvelle de science-fiction, Lumière Noire et un petit chef d'oeuvre, Les Trois livres qu'Absalon Nathan n'écrira jamais, l'anthologie prend enfin son envol... La fonction W n’est guère opérante et le sense of wonder toujours aux abonnés absents, mais on se prend à espérer que la suite soit du tonneau dont Léo Henry a fait son vin.
Hélas. Avec Penchés sur le berceau des géants, Daylon, des images plein la tête (il est d’ailleurs illustrateur), démontre un talent stylistique indéniable, mais trop systématique. Des images poétiques et métaphoriques ne suffisent pas à faire une bonne fiction. Des géants flottent en orbite, arrimés à la Terre par une ancre, et – peut-être – liés au mystérieux Essaim qui les menace. Peut-être une métaphore de la postmodernité, d'une civilisation qui a choisi la division – y compris de ses mythes – comme principe essentiel. La descente des géants – semblables en cela au monolithe de 2001, Odyssée de l'espace – a également permis un saut technologique considérable. Le héros, Denez, essaie d'empêcher sa dulcinée Callista de participer à une opération qui vise à détruire l'Essaim. La présence de ces géants et de cet Essaim aurait pu accoucher d'un grand récit de science-fiction, elle n'accouche que d'une bluette tristement statique et affectée sur fond de mystères cosmiques et d’émeutes urbaines, qui ennuie plus qu’elle ne fascine.
Il fallait bien alors la verve primesautière et jubilatoire de Philippe Curval dans la veine drolatique de Lothar Blues pour nous réveiller. Dans Dragonmarx nous suivons l'endoctrinement rouge mécanique, la formation et l'ascension de Siegfried, le jeune héros des Chiens Rouges – repliés dans un Ring invincible, forteresse protégée par les illusions du socialisme magique et de l'anneau des Nibelungen –, jusqu'à sa lutte finale contre l'hydre (réifiée) du capitalisme, et l'inversion de toutes les valeurs... L'auteur de Cette chère humanité livre ici une sorte de Rêve de fer au second degré où la faucille et le marteau ont remplacé les insignes nazis. Si Dragonmarx, trop long, semblable à une blague qui a trop duré, n'est pas aussi décisif que les meilleurs textes de L'Homme qui s'arrêta, recueil récemment publié – dans un désolant silence critique (auquel j'ai hélas contribué) – par la Volte, il se distingue néanmoins du reste de l'anthologie par sa franche liberté et son total irrespect des codes du genre.
Satire toujours, avec Terre de Fraye de Jérôme Noirez. L’auteur de Leçons du Monde Fluctuant excelle dans ce mélange de pure science-fiction façon Avatar et d’humour décalé à la The Host. Clioné, champion de surf et star planétaire, flanqué d’un SDF japonais alcoolique, homosexuel et ancienne vedette du kabuki (sic), s’envoie en l’air avec Miroua, un(e) extraterrestre androgyne surgie du Bloop (sic, bis) avec des milliers d’autres créatures grouillantes, et plane sur les vagues de l’altérité. Pour communiquer avec les humains, Miroua déroule un lexique étrange, fait d'homonymes, d'homophones et de termes associés, extrêmement troublant et en soi significatif. Chacune de ses répliques désarçonne moins par sa naïveté que par sa manière extraordinairement habile de décomposer le discours et de renvoyer à ses interlocuteurs, tel un Miroua déformant, une image révélatrice. Terre de Fraye souffre certes de quelques outrances et complaisances – celles-là même qui m'avaient rendu pénible la lecture du pourtant fort inventif Leçons du monde fluctuant –, et peut-être, comme beaucoup d'auteurs français, du syndrome Johan Heliot (surtout ne jamais se prendre au sérieux) mais s’offre des séquences d’une beauté burroughsienne, comme cette scène incroyable où les créatures, candides à la gueule de mugwumps en attente de gestation, régurgitent des litres de sperme (humain) dans la gorge de leur dernier client, dans le bordel où d'infâmes les exploitaient. Bloop. Dommage, tout de même, que la fin soit si foutraque.
Quatrième escale. Une fantaisie bizarre, dont on ne sait quoi penser (Dragonmarx), une rêverie languissante (Penchés sur le berceau des géants) et un joyeux trip (terre de Fraye) : l'impression d'ensemble s'élève un peu, mais sans gagner la stratosphère littéraire. L'image, certes hilarante, d'un Bill Clinton au crâne recouvert par un poulpe bloopesque, n'est il est vrai guère de nature à susciter craintes et tremblements.
L’inclassable et pénultième Je vous prends tous un par un de David Calvo tranche nettement avec ce qui précède. L'auteur de Minuscules flocons de neige réussit en quelques pages habitées à nimber d’une inquiétante étrangeté – et d’une puissance électrique – le dialogue (ou monologue ?) d’un homme en guerre avec, quoi ? les mouches ? des envahisseurs d’un autre monde ? Nous ne le saurons pas. Mais nous kifferons… Parce que nous autres, Transhumains Associés, aimons la folie qui traverse la prose de monsieur Calvo.
Le vertige logique, qui ouvre à la transcendance, ce grand absent de Retour sur l'horizon, figure en creux dans Hilbert Hôtel, la nouvelle fantastique de Xavier Mauméjean qui clôt l'anthologie. Celle-ci se déroule dans un hôtel aux dimensions infinies (transposition littérale d'une illustration des ensembles infinis par le mathématicien allemand David Hilbert). Comme d'habitude Mauméjean, l’homme à la barbe de philosophe et au verbe indolent ne convainc qu'à moitié, ici avec les pérégrinations borgéso-kafkaïennes d'un nouvel employé aux couloirs, qui cependant s'interroge : si l'hôtel est infini, d'où viennent les clients ? Peut-on faire face à un afflux infini et soudain de clients ?... C'est que Xavier Mauméjean ne fait pas que singer la Bibliothèque de Babel de Borges, ou la Ville concentrationnaire de Ballard. À la bibliothèque (le savoir, la mémoire, les histoires), à la ville (l’utilitaire, le social, le politique) succède l’hôtel, lieu du passage, de l’apatride, de l’insécurité soigneusement entretenue par d’immuables et rigides conventions. Comment concilier une pratique nomade et un lieu d'hébergement infini, et infiniment sclérosé ?...
Terminus. Tout le monde descend. Au terme de notre (long) voyage en science-fiction (croyait-on), le bilan est plus que mitigé. Si plusieurs textes sont anecdotiques ou sans intérêt, aucun n’est mauvais, et l’on en compte quatre ou cinq plutôt réussis, dont un petit chef d’œuvre, Les Trois Livres qu’Absalon Nathan n’écrira jamais. Au rang des quasi satisfactions, on notera également l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs – Maheva Stephan-Bugni, Éric Holstein, Daylon – aux univers très personnels. Reste à régler, chez eux comme chez d'autres, ce problème récurrent du défaut d'organicité que j’évoquais plus haut à propos de Pirate... On perçoit chez tous ces auteurs l’existence d’univers singuliers, la recherche d’une efficacité dans le style et la narration, mais il manque à certains la chair qui leur permettrait de marquer durablement nos esprits de leur empreinte. Par chair, j’entends cette trame d’échos, de correspondances invisibles, tissée par le travail poétique de la langue et de la composition, qui donne une cohérence symphonique au texte (voir par exemple, pour rester dans le domaine de l'imaginaire, La Horde du contrevent d'Alain Damasio). Manquent également à appel, dans la plupart des textes, le sense of wonder attendu par l’amateur du genre, et la « fonction W » que j’identifiais il y a quelques jours comme l’élément-clef de la science-fiction. Et pour cause : à mon sens, un bon tiers des textes présentés n’est pas de la SF. Ce n'est pas qu'un problème d'étiquette ou de catégorie. Il y a un grand malentendu entre l'horizon d'attentes du lecteur, à qui sont annoncés en sous-titre « quinze grands récit de science-fiction », et la réalité de ces textes. Quant aux autres, ils s’intéressent moins aux questions scientifiques qu’aux vertus métaphoriques du genre. Et la « variable cachée », la métaphysique ? Nous la cherchons encore. Où est Dieu dans ce livre, où est le sublime, sinon dans les enchâssements métafictionnels de Léo Henry et, à la rigueur, dans ceux plus ternes de Fabrice Colin, c’est-à-dire dans des fictions qui surplombent le genre sans lui appartenir ?... Nous l’avons suggéré : le processus de réification des métaphores décrit par Serge Lehman dans plusieurs articles théoriques interdit toute métaphysique. Les seules fictions de SF réellement métaphysiques sont celles qui problématisent les questions métaphysiques. Un dieu réifié, comme dans Lumière Noire, n’est plus un dieu, il devient une image vive, rayonnant d’une multiplicité de sens, au-delà du bien, du mal, et de toutes les choses premières et dernières. Et c’est justement, entre autres, parce qu’elles ne se laissent pas comprendre aisément – parce qu’elles nous prennent et nous dépossèdent, pour reprendre la belle formule de Systar –, que les littératures d’imaginaire nous plaisent autant.