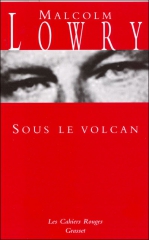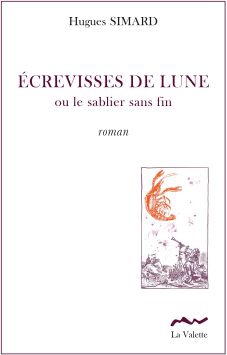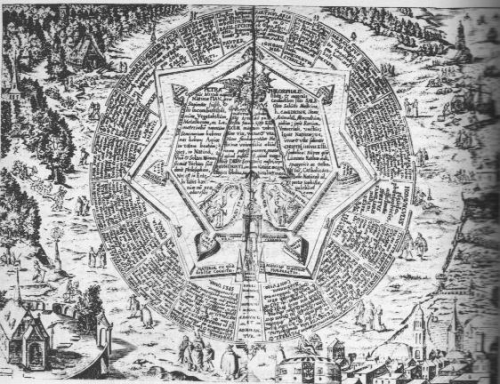Comme d'habitude chez Emmanuel Carrère, depuis L'Adversaire, Le Royaume n'est pas vraiment un roman – comme si le nom de son protagoniste d'alors, Jean-Claude Romand, avait frappé de son sceau démoniaque toute tentative romanesque. Le Royaume, donc, n'est pas un roman. C'est un essai, c'est un péplum, c'est un livre d'histoire, c'est une autofiction : disons simplement qu'il est inclassable, et qu'il entrelace très habilement ce que Carrère appelle son « sujet », ici les origines du christianisme, en même temps que sa vie personnelle – cette fameuse période, qui a duré trois ans, au cours de laquelle Carrère a vécu dans la foi, la ferveur, la dévotion, rédigeant des dizaines de cahiers de commentaires de l'évangile de Jean –, voire très intime (mais comme il le dit lui-même, il lui en coûte plus d'évoquer publiquement son rapport à Dieu et à la religion, que la pornographie qu'il consomme sur ses lieux de villégiature, comme nous l'apprenons par exemple lorsqu'il compare son excitation esthétique devant un tableau de Van der Weyden à son « émotion » au visionnage de vidéos de femmes anonymes qui se masturbent, dont nous saurons presque tout).
Son sujet officiel, donc, c'est raconter les premiers temps du christianisme, quand il n'y avait pas encore d'église constituée, quand les apôtres de Jésus se disputaient son héritage, quand les textes qui composent le Nouveau Testament n'avaient pas encore été écrits et diffusés – au temps même de leur genèse. Mais Emmanuel Carrère n'aime pas le roman historique : « faire dire à des personnages de l'Antiquité, en toge ou jupette, des choses comme "Salut à toi, Paulus, viens donc dans l'atrium", il y a des gens capables de faire ça sans sourciller, moi pas. C'est le problème du roman historique, a fortiori du péplum : j'ai tout de suite l'impression d'être dans Astérix. ». Il fait donc œuvre de fiction, mais à sa manière, sans jamais se départir d'une attitude de prudence, d'honnêteté, de tiédeur diront les esprits malins, qui consiste à nous indiquer régulièrement qu'ici il extrapole, que là il exploite les interstices de la tradition et des témoignages historiques, qu'ici encore il fait un choix, plausible mais pas forcément le plus communément admis, pour les besoins de son récit. Il me plaît de croire que... J'imagine volontiers que... Carrère multiplie les indications du genre. Il veut nous plonger dans le réel de l'époque, à travers les sources, à travers la narration aussi, mais en restant toujours à distance du discours apologétique. Son maître en la matière, prévient-il, c'est Ernest Renan, l'auteur anathémisé en son temps d'une monumentale Histoire des origines du Christianisme. Et son point d'entrée dans l'époque apostolique, c'est Luc.
Emmanuel Carrère s'identifie beaucoup à Luc, le Gentil, l'observateur, l'enquêteur, le scribe sans génie mais à l'honnêteté sans faille, auteur d'un évangile, probablement des Actes des Apôtres et, selon Carrère, sans doute de l'épître de Jacques. C'est avec lui, et avec un souci commun de vérité historique (lire l'incipit de son évangile) que nous accompagnerons Paul, le génie, le fanatique, le fou-furieux, dans son périple évangélisateur, dans son opposition avec les Romains, jusqu'à la destruction du Temple et de Jérusalem (on y croise Flavius Josèphe, Néron ou encore Sénèque, dont un faussaire du IVe siècle avait imaginé une correspondance avec Paul) mais aussi et surtout avec les judéo-chrétiens de Jérusalem, que Carrère surnomme les « circoncis », guidés par Pierre et Jacques le frère de Jésus, attachés aux rites judaïques – tandis que Paul et ses frères au prépuce intact (ou non) considèrent que l'observation des rites est une insulte faite à la parole du Christ.
Luc, donc, c'est Carrère. Paul fonde sa communauté sur la seule foi en la Résurrection, mais Carrère n'y croit pas du tout à la Résurrection, il trouve ça sidérant, il a certes écrit le scénario d'une série, Les Revenants, qui met en scène le retour de plusieurs morts parmi les vivants, mais il n'y croit pas, et c'est à peine, à le lire, si Luc lui-même y croit vraiment. À vrai dire, la figure même du Christ, autour de laquelle Carrère ne cesse de louvoyer sans l'approcher vraiment (attitude très mystique en un sens), ne semble pas vraiment l'intéresser. Jésus insaisissable, reste donc son message, non dénué d'ambiguïté : l'auteur nous rappelle la violence symbolique de certaines paroles (ces pharisiens qui l'invitent sous son toit et qu'il ne cesse d'insulter) ou de certaines paraboles (le fils prodigue, et son injustice flagrante). Mais subsiste quelque chose d'irréductible, et à vrai dire d'assez indéfinissable, qui transparaît d'une manière ou d'une autre dans tous les textes canoniques et dont Luc se fait lui aussi le fidèle rapporteur : Dieu est Amour, et le chrétien voué à faire œuvre de charité. Et nous en arrivons là au vrai sujet du livre : le cœur du christianisme, le Royaume – ce qui fait qu'Emmanuel Carrère, bien que revenu d'entre les croyants, reste fasciné par une religion au point de lui consacrer plus de six cents pages, sans jamais réussir vraiment, et pour cause, à en percer le secret (ce qui fait écrire à l'excellent Pierre Cormary, usant d'une formule dont en kafkaïen je suis méchamment jaloux, que « Le Royaume aurait pu s'appeler Le Château »).
Mais c'est quoi, au fait, le Royaume ? Pour les chrétiens c'est le royaume de Dieu, bien sûr, mais ça ne suffit pas, quand on a dit ça on n'a rien dit. Pour certains c'est un au-delà, d'accord, mais pour d'autres, et ce, dès l'époque apostolique, c'est autre chose, c'est un au-delà, oui, mais un au-delà de la perception. Paul avait promis l'avènement imminent du Fils de l'homme, la fin du monde connu, la résurrection des morts. Quand ses ouailles se sont rendu compte que rien de tout cela n'était arrivé, Paul ne s'est pas démonté et leur a dit : si, c'est arrivé, le monde messianique est accompli, seulement il faut croire pour le voir, ce monde-là est faux, seuls les vrais chrétiens ont accès au Royaume.
Et ça, c'est un postulat à la Philip K. Dick – et une idée gnostique qu'ont d'ailleurs exploité plusieurs apocryphes, comme les évangiles de Thomas et de Judas. Dans ses dernières années, l'auteur du Maître du Haut-Château a écrit plusieurs romans, ainsi qu'un journal métaphysique, dans lesquels il exprimait toujours plus ou moins la même idée : le monde dans lequel nous vivons est un faux, un simulacre, une illusion chargée de nous maintenir dans l'erreur. Je vous passe les détails de sa construction cosmogonique, inspirée du manichéisme, du zoroastrisme et du corpus jungien (ceux que ça intéresse peuvent se référer à ce texte consacré à sa Tétralogie Divine), et trop complexe et délirante pour qu'on s'y attarde ici, mais pour faire vite, c'est ce que Dick appelait l'Empire et pour lui l'Empire n'avait jamais pris fin. Seulement, il avait eu un aperçu du réel.
Pour Carrère l'incroyant, c'est ça, au fond, le Royaume, c'est ce qu'il appelle « la réalité de la réalité », c'est-à-dire une autre manière de regarder le monde, et de regarder son prochain. Le Royaume, c'est le sermon sur la montagne, c'est les béatitudes, ce sont ces paroles, inouïes, incroyablement subversives à l'époque, comme aujourd'hui, par lesquelles le Christ renversait toutes les valeurs : le faible est le fort, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier... Il y a là quelque chose de très fort, une idée folle (folie du christianisme, décrit Carrère : folie de la foi en la résurrection, folie du croyant qui voit le Royaume, folie des béatitudes...), contre nature (le dernier sera la premier, ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça, c'est insensé), mais Carrère y trouve tout de même quelque réconfort – une idée qu'il essaie de ne jamais oublier dans sa vie de bobo – autant dire de nanti – paisible.
Carrère a beau ne plus croire, il est profondément troublé par ce message. À la toute fin du livre, il nous raconte qu'une lectrice de Limonov l'a invité à participer à une retraite dans une communauté de l'Arche, au cours de laquelle il participe au rite du lavement des pieds. Et il vit ce moment étrange, même dans cet environnement très kitsch de chants catholiques, comme une épiphanie lévinasienne. C'est d'ailleurs le sens de cette cérémonie qui s'origine chez Jean : Jésus veut laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge dont il était ceint, et devant Simon-Pierre qui se récrie, il dit, en substance, que n'est pas digne de figurer au Royaume celui qui ne suit pas son exemple.
Quand Emmanuel Carrère se penche sur son propre cas, tant qu'il se dévoile, qu'il nous livre ses tergiversations en pâture, son livre, parfaitement construit, est passionnant. Passionnantes, également, ses réflexions purement exégétiques, et même théologiques parfois, sur la genèse de certains textes ou sur le sens d'une parabole, et je tiens personnellement pour de la pure forfanterie les critiques affirmant, comme Pierre Assouline, n'y avoir strictement rien appris. Je trouve ça d'une prétention abyssale. Mais pour un livre sur le cœur des chrétiens, sur le mystère de la foi, Le Royaume manque singulièrement de Verbe (et comment, lorsque sont évoqués ses séjours à Patmos, ne pas songer au formidable Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe ?). Carrère écrit en scénariste, il se contente d'articuler les chapitres, les idées et les phrases. Il multiplie les comparaisons anachroniques, jamais gratuites mais aux effets souvent douteux ; il enchaîne les platitudes, il emploie un registre de langue bien trop relâché pour toucher au cœur. Bien ténue, la flamme de son Logos. Les plus belles phrases du livre sont des citations, elles viennent de Péguy, de Yourcenar, de saint-Jean ou de Paul lui-même !
Comme si, se faisant l'égal de Luc, mais ne cessant de nous rappeler son agnosticisme jusqu'à l'agacement, Emmanuel Carrère avait voulu garder ses distances avec le Royaume, autant qu'avec ces fous de Chrétiens. Mais en bon lecteur de Dick, qui revient comme un leitmotiv – et jusqu'à la synchronicité avec l'épisode de la baby-sitter dickienne –, notre auteur sait bien que le fou (comme le hibou) n'est pas toujours celui que l'on croit. Si Carrère, quoi qu'il en dise, doute autant (même au temps de son fanatisme, on sent bien qu'il était littéralement hanté par la peur panique de perdre la foi), c'est qu'il sait, lui qui a plongé dans les méandres de l'esprit de Jean-Claude Romand, lui a écrit une biographie de Philip K. Dick (Je suis vivant et vous êtes morts), lui qui a écrit La Moustache, il sait, donc, que la réalité n'est jamais qu'une propriété de l'esprit. Regarder son prochain dans les yeux, l'appeler par son nom et lui laver les pieds, le faire exister, le rendre réel, ni son supérieur, ni son inférieur, ni même son égal, pour citer le mantra qu'il aime répéter – tel est, peut-être, le vrai Royaume.
Le Royaume d'Emmanuel Carrère, P.O.L., 2014, 638 pages.