African psycho d’Alain Mabanckou (19/03/2006)
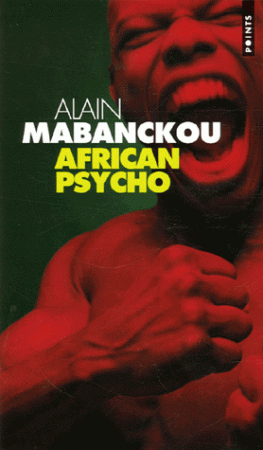
« En fait, l’idéal pour moi serait de bénéficier d’une couverture médiatique aussi large que celle qu’avait eue mon idole Angoualima, le plus célèbre des assassins de notre pays. »
A. Mabanckou, African psycho
« Depuis lors, si j’ai pu nourrir la fugitive pensée d’attenter à la vie d’une antique brebis, d’une poule chargée d’ans et autre menu fretin, cela est cadenassé dans le secret de mon cœur ; mais pour les plus hautes sphères de l’art, je suis tout à fait inqualifié, je l’avoue. »
Thomas De Quincey, De l’Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts.
En 1990, Bret Easton Ellis publiait American psycho, roman-culte de toute une génération. Patrick Bateman, un yuppie new-yorkais beau, riche et superficiel, assassinait hommes et femmes avec une extrême sauvagerie, et avec la même cool attitude qui caractérisait le moindre de ses actes. Cette critique du nihilisme contemporain était évidemment à double tranchant : American psycho, dont l’impact littéraire, est-il besoin de la rappeler, fut comparable à celui de De sang froid de Truman Capote, fut rapidement élevé au rang d’objet hype, par ceux-là mêmes que le roman décrivait non sans génie. Les succédanés, pâles copies de l’original, ne tardèrent pas à polluer les rayons des librairies. Parmi eux cependant, émergèrent quelques œuvres ambitieuses, dont le projet n’était pas tant de détourner une part du succès d’American psycho, que de confronter cette référence désormais incontournable, à d’autres réalités, à d’autres sociétés, à d’autres écritures. Dans Miso soup (Picquier, 1999), Murakami Ryû plonge son lecteur dans un Tokyo de morts-vivants où le crime se revendique comme le mode ultime d’expression ; Baptiste Bucadal, le prof de philo du premier roman d’Éric Bénier-Bürckel, Un prof bien sous tout rapport (Pétrelle, 2000), viole torture, tue et dévore ses jeunes victimes pour seulement exister, pour ne plus être aspiré par le néant du monde. Après les réussites notables de ces Japanese et French psychos, c’est tout naturellement – et non sans appréhension – qu’attiré par le titre, par la couverture et par le nom d’Alain Mabanckou dont je connaissais l’excellent blog mais pas encore l’œuvre, j’ai impulsivement acheté la réédition en poche d’African psycho. Nulle prétention dans cette variation géographique, mais au contraire, une secrète ironie que le lecteur ne comprend qu’au terme de son voyage.
Grégoire Nakobomayo, dit « Tête rectangulaire » ou « Boule à zéro », rêve depuis son enfance de devenir sinon l’égal, du moins le disciple du grand Angoualima, serial killer qui défraya jadis la chronique du pays (le Congo ?) et qui avait fini par se pendre. Grégoire a enfin décidé de passer à l’acte, comme en attestent les premiers mots du roman : « J’ai décidé de tuer Germaine le 29 décembre. J’y songe depuis des semaines parce que, quoi qu’on en dise, tuer une personne nécessite une préparation à la fois psychologique et matérielle. » Seulement Grégoire semble moins doué pour le meurtre que pour la mécanique automobile… Comme s’il lui fallait sans cesse repousser l’acte fatidique, il nous relate l’histoire de sa vocation de tueur, depuis sa jeunesse d’ « enfant ramassé » jusqu’à aujourd’hui. Et, à mesure que sa vie nous parvient sous forme de bribes, est dessiné le portrait d’un jeune homme certes dérangé, mais dont les pulsions meurtrières et les prétentions esthétiques ne l’emportent jamais sur son impuissance, son narcissisme.
Ce qui fascine Grégoire, chez Angoualima, n’est pas tant sa folie meurtrière que sa capacité, certes monstrueuse mais efficace, d’interpeller le monde (« Je chie sur la société ! »). Il lui importera donc moins de tuer beaucoup que de tuer bien pour à son tour être craint et célébré, c’est-à-dire pour se sentir exister. En cela tous les psychos littéraires se ressemblent : Patrick Bateman, en dépit de tous ses crimes sanguinaires perpétrés en plein cœur de la société capitaliste, ne parvenait pas dans American psycho à éveiller l’attention d’une société indifférente, pour qui la mort violente n’était en quelque sorte que la manifestation la plus extrême de l’ordre social ; Éric Bénier-Bürckel radicalisera la situation jusqu’à l’absurde dans Un prof bien sous tout rapport : bien que certaines de ses propres élèves aient disparu, Bucadal ne sera jamais inquiété par la police – au royaume du relativisme, le meurtre n’est qu’une manière comme une autre de « s’affirmer »… American psycho et Un prof bien sous tout rapport, chefs d’œuvre ambigus, mettaient ainsi en scène leur inévitable enrôlement dans la machine postmoderne – le lecteur était horrifié, et cependant fasciné – par la quête ontologique de leurs personnages monstrueux. African psycho diffère cependant de ce modèle, pour au moins deux raisons. Premièrement, Alain Mabanckou a manifestement souhaité évité pareille ambivalence : son livre nous parle moins d’un tueur que de l’admiration d’un gamin pour la mise en scène, pour l’esthétique, des crimes commis par un tueur nihiliste – Angoualima – le narrateur retranscrit d’ailleurs une émission radiophonique dont le thème du jour est : Angoualima, mythe ou réalité ? Réagissez !. Comme l’écrit avec justesse Yves Chemla dans un remarquable article, « [d]ans African psycho, […] le personnage travaille, il a un métier, plus que des occupations ; il s'est construit par l'expérience ; il est réputé d'une grande laideur ; il a construit sa maison, son atelier ; il a un modèle unique, Angoualima. Il veut accomplir des meurtres et par là obtenir une existence sociale, et n'y parvient pas, alors que tout était relativement facile pour Patrick Bateman. Ses discours sont avant tout ceux de ses échecs sur ce terrain. Si le premier échoue à dire et à témoigner, et à être entendu et à être cru, le second ne parvient pas à accomplir. » Et si Germaine finit par être assassinée au couteau comme Grégoire projetait de le faire, ce dernier, impuissant au moment de commettre le viol – le sexe est pour lui littéralement innommable puisque sexes masculin et féminin sont systématiquement appelés « chose-là », de manière indifférenciée –, est de surcroît dépossédé de son meurtre, comme l’était Archibald de la Cruz dans le film de Luis Buñuel. A l’opposé d’un Raskolnikov que l’assassinat d’une vieille usurière menait à la ruine morale, Grégoire n’est jamais rongé par la culpabilité et cependant ne se résout pas à agir ; le héros de Crime et châtiment sombre délibérément dans la déchéance criminelle au lieu de travailler honnêtement, quand Grégoire travaille dur dans son atelier de réparation ; et surtout, si Rodion Romanovitch Raskolnikov imaginait (à tort) s’élever au-dessus de l’intelligence des hommes en s’arrogeant le droit de tuer, Grégoire, nous l’avons dit, ne cherche que la reconnaissance de sa simple existence. L’Ascension finale d’Angoualima, absurde parodie christique (« Ça veut dire que je dois arriver au ciel pour le jugement dernier. Mais j’ai de bons avocats, et il paraît qu’ils n’ont jamais perdu un seul procès là-haut »), s’impose d’ailleurs contre le parfait contrepoint du finale dostoïevskien. Tandis que Raskolnikov ne connaissait la rédemption qu’au terme d’infernaux tourments – dont le camp de travail où il était emprisonné loin de son aimée n’était pas le plus douloureux –, le fantôme d’Angoualima reste bloqué sur le mode de l’invective, de la haine, et de l’Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts.
Ainsi le narrateur d’African psycho, croyant nous conter son accession au panthéon des tueurs, nous informe surtout sur sa condition de sous-homme – « enfant ramassé », abandonné par sa mère à la naissance, il reste un paria aux yeux des autres –, et sur celle de ses pairs. L’histoire de Grégoire, qui en tant que telle n’est pas si remarquable, est le prétexte pour Alain Mabanckou de montrer combien la prolifération de la prostitution, de la corruption, du crime et du viol, la pauvreté, l’anormale promiscuité d’enfants livrés à eux-mêmes et occupés à reproduire les pires exemples des aînés – « Enlève ta culotte ! On va faire comme les papas et les mamans ! C’est toi maman et c’est moi papa. […] Je fais ça avec les grands dehors ! s’emporta-t-il. J’en ai marre de faire chaque fois la maman, aujourd’hui c’est moi qui fait le papa, enlève ta culotte, vite ! » (pp. 26-28) –, devraient nous être insupportables. Pour cela Alain Mabanckou utilise une voix d’enfant, celui que Grégoire est resté, et qui rappelle un peu Birahima dans Allah n’est pas obligé. Dans l’âpre roman d’Ahmadou Kourouma, où les atrocités étaient racontées sur le mode du conte-randonnée, Birahima, armé d’un « kalach » et de quatre dictionnaires, ponctuait sa narration de jurons malinkés invariablement complétés de leur traduction en français (« Aujourd’hui, ce 25 décembre 199…, j’en ai marre. Marre de raconter ma vie, marre de compiler les dictionnaires, marre de tout. Allez vous faire foutre. Je me tais, je dis plus rien aujourd’hui… A gnamokodé (putain de ma mère) ! A faforo (sexe de mon père) ! »[1]). Grégoire Nakoboyamo, dans African psycho, revendique sa vulgarité, celle de la rue dont il est issu, et un certain intérêt pour la littérature – en tant qu’énonciation de mythes référentiels. Grégoire est un enfant, plein de haine envers sa mère qui l’a abandonné – quant au père, il est bien sûr figuré par Angoualima, aîné tutélaire, mais aussi démon dont le caractère insaisissable n’est que l’écho de cette ascendance inconnue –, et plein de mépris envers les femmes, toutes les femmes – qui pour lui sont des putes du « pays d’en face » –, dont la chose-là le dégoûte tant qu’il ne comprend pas que les blancs veulent y « mettre leur bouche [...] alors qu'ils sont conscients que c'est une autoroute que tout le monde emprunte à deux cent-vingt kilomètres à l'heure ». Le sexe de l’homme comme celui ce la femme, par lesquels nous naissons tous, dans lesquels, ou autour desquels, nous nous aimons, ne sont que des chose-là, symboles abjects de la corruption d’un monde infernal.
Les mots servant à nommer les choses et les lieux (le quartier Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot, le cimetière des Morts-qui-n’ont-pas-droit-au-sommeil, le groupe musical C’est-toujours-les-mêmes-qui-bouffent-dans-ce-pays-de-merde, les buvettes Boire fait bander, Buvez, ceci est mon sang, Verre cassé-Verre remboursé, Ici c’est chez vous, Bois et paye demain, Pas de problème on verra après, Même le président boit, les rues Cent-francs-seulement et Papa-Bonheur-c’est-moi, etc.), très imagés donc, pourraient paraître pittoresques, voire exotiques, mais en soulignent surtout l’absurdité. La ville où se déroule le récit, n’est jamais nommée ; nous savons seulement qu’elle est traversée par un cours d’eau – rebaptisé « la Seine » par le Maire – qui charrie inlassablement la merde des hauts quartiers vers la ville basse, métaphore transparente de l’Afrique des Grands Lacs, poubelle de l’Occident, ou plus généralement de l’Afrique des pauvres, souillée par la corruption de quelques nantis. L’immondice, la déjection, la merde, semblent d’ailleurs caractériser le pays tout entier (« Dans la rue Têtes-de-Nègres, la population défèque partout, de jour comme de nuit »), condamner à singer l’Occident sans bénéficier des mêmes moyens et des mêmes conditions. Voici donc la deuxième différence essentielle entre African psycho et son « modèle » américain : il y a dans le projet meurtrier de Grégoire – dont Yves Chemla a noté la parenté avec le Grégoire Samsa de La Métamorphose –, comme une tentative têtue et désespérée d’échapper au devenir-excrément d’un monde pourri jusqu’à l’os, d’inverser les rôles, de « chier sur le société » comme aimait à le répéter son idole et grand maître, le démon Angoualima aux douze doigts, avec qui Grégoire s’entretient au cimetière. Raskolnikov avait tué pour de troubles raisons philosophiques, mais aussi pour gagner quelque argent, dans un contexte de grande pauvreté ; Bateman tuait par désoeuvrement, dans une société de consommation où les biens et les richesses abondaient ; Nakobomayo, lui, rêve de « couverture médiatique » dans l’Enfer africain où par endroits les cadavres s’amoncellent.
Il est dès lors difficile de pas voir en Grégoire le double fictif d’un écrivain confronté à la représentation de la violence – pas tant celle du psychopathe que celle de la déchéance de toute une société, voire, comme le suggère Yves Chemla, d’un certain « exotisme de l’horreur » qui selon lui guetterait les littératures africaines[2]. Il y a ainsi au cœur du projet littéraire d’African psycho un refus catégorique de la surenchère, dont on trouve d’ailleurs une belle (et drôle !) métaphore dans l’émission-culte relatée par Grégoire sous le nom « Et alors ? Croyez-moi ! », dans laquelle Angoualima est affublé des plus extraordinaires attributs. Alain Mabanckou évite sciemment la litanie de souffrances et d’atrocités dont la triste réalité, sous la plume d’écrivains aussi talentueux que Mongo-Beti ou Kourouma, devient fascinante, source de plaisir littéraire pour des Occidentaux qui ne sont pourtant pas pour rien dans le délabrement de certaines régions de l’Afrique noire. D’où cette « économie de la désolation » permise par la multiplication des types de registres et de discours dans le roman. « Le psychopathe, conclut Yves Chemla, réinvente la réalité, pour que l'auteur parvienne à en donner le sens : la culture de mort généralisée, le mépris des femmes, la différenciation radicale et la proximité cinglante ». Il n’est pas certain cependant qu’au bout du compte, cette économie soit réellement efficace. African psycho met certes tout en œuvre – avec talent – pour nous faire entrevoir une réalité si terrible que toute représentation fidèle devient problématique, mais ce choix courageux a aussi pour conséquence d’exclure le roman de son propre champ de bataille, comme si l’impuissance de Grégoire était aussi celle de l’écrivain.
Alain Mabanckou, African psycho, éd. du Seuil, Points, 2006, 220 pages, 6,90€.
[1] A. Kourouma, Allah n’est pas obligé (Seuil, Points, 2000), p. 130.
[2] Y. Chemla ne commet cependant pas l’erreur de condamner cette représentation de l’horreur et de la souffrance. Ainsi, écrit-il que « le roman africain de ces dernières années, de Kourouma à Monenembo, de Mongo Beti à Kossi Effoui, rend compte avec acuité des souffrances, de la difficulté non pas de vivre mais bien de survivre en conservant à tout prix son intégrité. Mais à force de dénonciation, à force de donner cette représentation de l'horreur d'abord à ceux qui en oublient qu'ils en sont la cause, directe et indirecte, les Occidentaux, les Blancs, -ceux qui acceptent trop facilement de confondre les instruments de la perversion et l'objet même du désir - l'auteur se rend compte que le glissement vers un exotisme de l'horreur guette tout écrivain. ».
20:55 | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Cette note, riche d'informations par ses parallèles et ses références, (merci pour cela) noie un peu ce que pourrait être une lecture lambda. Comme je voudrais bien m'y retrouver, il me semble que vous évitez une différence fondamentale entre les romans de " non-fiction" comme De sang froid et les autres, les romans de fiction purement subjectifs.
Truman Capote sur la base d'une documentation précise transforme littérairement une enquête incontournable et le supplément subjectif qu'il apporte à une réalité de fait , ajoute à celle ci, lui donne valeur de signe comme le recto et verso de quelque chose qui résiste et peut rester insaisissable. Chez Bret Easton Ellis il semble qu'il n'y ait rien de cet ordre mais plutôt objectivation de fantasmes ou réglement de compte du "roman familial "; indéniable talent pour l' échauffement de cervelle à jet continu comparé à une écriture qui requiert précisément la chaleur du courage, le sang froid .
Comme vous y invitez, il reste à lire African psycho ...
Écrit par : le ptyx | 20/03/2006
Bonjour,
Oui, bien sûr, De sang froid et American psycho n'ont a priori que peu de choses en commun, exceptée une influence énorme. Ceci étant dit, qu'il s'agisse ou non de fiction n'a, de mon point de vue, que peu d'importance : je lis avec le même plaisir, et sans distinction de ce genre, Truman Capote et James Ellroy, par exemple.
Cordialement.
Écrit par : Transhumain | 20/03/2006