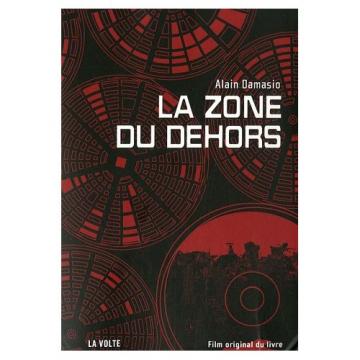Jackson Pollock, Number 1, 1948
« Les hommes aiment bâtir et se tracer des chemins, d’accord. Mais pourquoi aiment-ils aussi passionnément la destruction et le chaos ? Ça, dites-le moi un peu. J’ai envie de déclarer deux mots moi-même à ce sujet. N’est-ce pas, peut-être que s’ils aiment tant la destruction et le chaos (et il est indéniable qu’il leur arrive d’aimer ça très fort, la chose est là), c’est qu’ils craignent eux-mêmes instinctivement d’atteindre leur but et d’achever le bâtiment qu’ils sont en train de construire ? »
Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol.
« La puissance du dehors est constituée par un rayonnement cosmique d’ondes, de messages, de musiques que l’écrivain reçoit et répercute comme un “écho sonore”. Dans ce cas, il se sent médium des voix émises dans l’univers, et c’est évidemment la phénomène médiumnique qui caractérise particulièrement la relation avec les puissances du dehors. »
E. Morin, Le vif du sujet.
Reconquérir le Je, disions-nous – ou le Soi, si l’on préfère. Celui-ci, cependant, a besoin pour exister de se différencier de l’autre, et, dans l’ontologie damasienne, d’être lié aux autres, or le système cerclonien, qui encourage le narcissisme et l’individualisme, disjoint plus qu’il ne lie :
« Connectés à nous-mêmes, nous plongeons en apnée dans notre intériorité pour trouver à nos problèmes une solution qui n’existe qu’hors de nous, à l’air libre, dans ce qui nous arrache et nous excentre. L’individualisme ne fait qu’amplifier ce repli maladif, cette peur du mal connu, du “pas de chez nous” puis du “pas comme moi”, de l’étrange puis de l’étranger, jusqu’à redouter le tout proche, avec lequel on n’ose désormais partager ses désirs et ses flux. » (p. 97)
Le lien, donc. Il y a déjà, dans La Zone, une belle tentative de narration polyphonique. Les changements de narrateur sont introduits par le signe « > », nous rappelant les échanges sur les messageries instantanées, et donnant l’impression de passer d’un champ de vision à un autre, au travers, par exemple, d’un écran de télésurveillance… L’inflexible engagement de Capt, la révolte humaniste de Kamio, le radicalisme de Slift, donnent une vision plurielle de la Volte, qu’on peut dès lors considérer, selon le point de vue, comme un mouvement politique, comme un idéal utopique ou comme une organisation terroriste – elle est tout cela. Et comme La Horde, La Zone est entièrement écrit à la première personne, comme si l’usage du Je était pour Alain Damasio le seul moyen, absolument le seul, d’établir un lien charnel entre son lecteur d’une part, et l’univers, les personnages par lui créés d’autre part. Mais Capt en reste le principal protagoniste, en même temps que le premier narrateur. Il capte – naturellement ! – l’attention, au détriment des autres voltés ou simples Cercloniens qui donnent alors l’impression de graviter autour de lui. La Zone du Dehors réussit à nous faire appréhender le mouvement volutionnaire sous différents angles, incarnés par ses leaders, mais peine à le faire vivre pleinement, autrement que comme une extension de Capt lui-même. Ici le mouvement, ou nomadisme – autre grand thème damasien – l’emporte largement sur le lien.
Le Je doit également – c’est l’enjeu de ce roman – pouvoir s’articuler avec un ailleurs : en l’occurrence, le Dehors (« Les mêmes mouvements lient le plus profond de ton ventre au plus lointain des forces qui font l’univers et qui, puisque tu vis à corps ouvert, peuvent te traverser – et toi les capter, te composer avec, accroître ta puissance d’être libre. Ton corps vit, échange. », disait un passage de la première édition du livre, supprimé de la version éditée par la Volte en 2007). Que signifie vraiment ce titre, la « Zone du Dehors » ?… Puissance de la métaphore. Prenons d’abord connaissance des réflexions de Capt, le principal intéressé.
« Qui pouvait dire “Mon Dehors” ? Personne. Sauf à rire. […] Trop immense, trop changeant, trop violent : ingérable. Une vraie sauvagerie de rocs, d’éclats d’aérolithes et de cratères brisés à coups de météores, avec des dalles saignées au sable sec, des collines brutes striées au râteau des vents cosmiques et, face au ciel, les crêtes, déchiquetées d’ammoniac et de gel. Espaces perdus… […] La définition la plus claire que les pouvoirs avaient finalement donnée au Dehors tenait en ce mot : Zone. Et ce mot était le grand sac qui enveloppait tout, qui ne cherchait surtout pas à décomposer cette complexité mouvante de formes et de forces qui, au reste, faisait peur.La Zone du Dehors, c’était simplement ce qui n’était pas Cerclon : un non-Cerclon, si l’on voulait. Un non-lieu… un non-lieu pour tous les délinquants, les tueurs et les fous furieux. Pour tous les voltés dont j’étais. » (p. 24)
On reconnaît là une allusion – comme tout le roman sans doute, mais nous laisserons les philosophes de formation se pencher sérieusement sur la question – à la « pensée du dehors » de Foucault (initialement réservée à la littérature et à Blanchot), dont Deleuze a fait une pensée nomade. Le Dehors : un monde chaotique, instable et sans sujet, non-lieu purement hors norme, tempétueux, tordu par ses potentialités, qui précéderait le savoir. Le Dehors, qui est l’en-dehors des normes, crée un écart au sein de la société de contrôle, et c’est cet écart, plus que le Dehors lui-même, qui est au cœur du roman (sans doute pourrait-on rapprocher le Dehors de Damasio, qu’on ne peut théoriquement pas nommer puisqu’il est en-dehors de toute connaissance, de la « différance » de Jacques Derrida). Capt poursuit :
« Le Dehors, c’est l’intime vent, court, vif, qui flue au fond de nos tripes. Il circule en nous, il serpente entre tous nos atomes de matière, accélère, décélère, jaillit, donne du rythme, agite ! Et la matière cherche à le calmer, à le mettre en cellule, veut le bloquer, le fait buter. Elle fixe. Elle assigne. Si elle bouge, c’est comme le sang, par les réseaux établis. Alors que le Dehors, qui vient de nulle part, eh bien va partout, court-circuite les réseaux, il lie ce qui ne l’a jamais été : les reins aux seins, la bouche aux mains, les mains au monde… Il nous aère. » (p. 30)
Métaphoriquement, le Dehors serait donc voisin de l’âme, de ce qui fait que nous ne sommes pas des machines de chair, mais des êtres (Damasio développera cette idée dans La Horde du contrevent, avec l’invention des « vifs »). Le Dehors anime ce qui, sans lui – mais ceci, comprenez-le bien, est pure vue de l’esprit, car il n’y a pas de « sans lui » – resterait inanimé. Dans le roman, on le voit, cohabitent deux visions antagonistes d’une même réalité. À première vue, la « Zone » et le « Dehors » désignent un même territoire parfaitement localisé, tout simplement l’extérieur de Cerclon, désert, à l’abandon, néfaste pour l’organisme. Mais si la Zone inquiète, symbolise l’autre, l’étranger, le milieu hostile – elle est le point de vue des normés –, en revanche le Dehors (qui en science-fiction comme en fantasy a déjà trouvé d’innombrables formes) attire, il symbolise pour les voltés un espoir, un idéal – nous allons y revenir dans un instant.
À propos, qu’est-ce, au juste, qu’une « zone » ?... Le terme désigne généralement un territoire soumis à l’armée ou à un régime particulier, sur le plan administratif, économique ou légal, ou bien, par extension, un faubourg caractérisé par un habitat misérable, une banlieue industrielle, mal aménagée, d'une grande agglomération urbaine, ou encore un périmètre de « non-droit ». Elle évoque donc les marginaux, les délinquants, un « non-lieu » aux franges de la civilisation, un espace dangereux, ou menaçant… Mais la zone, c’est aussi un domaine abstrait à l'intérieur duquel se développe une activité mentale ou psychologique : zones sombres, zones claires de la conscience ; zone de rêve, de tristesse ; zone floue de la mémoire… Enfin, la zone peut désigner une classe, une catégorie (par exemple : « une œuvre “de seconde zone” »), et donc, chez Damasio, faire référence au Clastre évoqué plus haut, habile fusion de « classe », de « caste », et, bien entendu, du verbe « castrer » (sans oublier le cadastre déjà évoqué) : les clastrés, pour les voltés, ne sont-ils pas émasculés, désespérément mous, amorphes, aussi mornes que normés, maintenus artificiellement en vie comme les larves humaines exploitées par les machines dans Matrix ?...
Maintenant, revenons à notre Dehors, autour duquel s’orbite le roman. Pour dire les choses le plus simplement possible, le Dehors, c’est l’extérieur, c’est l’Autre – perçu non plus comme un alien mais comme une richesse potentielle –, le voyage, le rêve, lafolie. N’en restons pas aux lieux communs. Le Dehors : ce qui n’est pas là, mais qui rend tout là possible. Ce n’est pas tant un lieu en effet, comme l’expliquait Capt plus haut, qu’un non-lieu où alimenter ses désirs. Pour les héros damasiens, l’« autre côté », le Dehors de La Zone (ou l’Extrême-Amont de La Horde), c’est l’espace de l’imagination, de la liberté, la terra incognita qui échappe, ou pas, disons qui peut échapper à la raison, et confère un sens renouvelé à la vie (on ne croit d’ailleurs pas si bien dire : la suite du poème de Paul Éluard cité dans la Tour d’Ær de La Horde, « la Terre est bleue comme une orange », aurait révélé à Oroshi que les mots ne mentent pas…). Ce Dehors, ici opposé à la société de contrôle panoptique de Cerclon, n’est rien de moins que l’en-dehors des normes – et qui, en un sens, les contient –, et l’écart qu’il crée avec l’empire du Normal devient l’excès pur, la subversion, seule susceptible d’ouvrir la voie au changement radical du « Dedans » (car bien entendu, tout dehors suppose un Dedans, qui n’est toutefois que celui du Dehors ou, selon Deleuze, son pli, « comme si le navire était un plissement de la mer », comme l’écrit celui-ci dans son Foucault…). Si Capt, conduit devant le Président, refuse la tentation du pouvoir, ce n’est pas par quelque faiblesse congénitale de la pensée de gauche (étant bien entendu que la social-démocratie n’a rien à voir avec la gauche) qui piquerait des deux dès qu’il s’agirait de se prendre le réel en pleine poire, c’est plutôt qu’il ne saurait se satisfaire de la subrogation d’une norme par une autre, d’un ordre par un autre, quels qu’ils soient. La pensée du dehors est une pensée des écarts. Au temps de l’aboulie généralisée, le Dehors est cet espace de liberté qui subsiste au-dessus de la social-démocratie et de ses lois, innombrables, de ses statistiques et de ses règles sociologiques qui régentent la vie des citoyens – à ce titre, et en tant que pur Dehors comme « hors norme », il est toujours la cible du pouvoir (le remplacement des noms personnels pour des codes n’en est qu’une des manifestations les plus visibles), en même temps que son moteur : chaque nouvelle loi suppose sa transgression, un écart que vient combler une nouvelle loi, qui elle-même crée un nouvel écart, et ainsi de suite... Autrement dit si le Dehors est un non-lieu, il a en revanche toujours lieu, sous la forme de l’Écart. La Zone du Dehors est alors la confrontation d’une peur, d’une mise au ban – symbolisée par le Cube, sorte de dedans du Dedans –, et d’un espoir, d’un idéal du hors-norme dont la réalisation, d’ailleurs impossible, importe moins que le mouvement qu’il suscite – l’Écart. Dans Stalker d’Andrei Tarkovski, la Zone n’est-elle précisément ce non-lieu où le désir, la quête d’un idéal, valent davantage que leur assouvissement, leur achèvement ? La Zone du Dehors, c’est donc la conquête des marges, le creusement des écarts, contre les forces nihilistes des sociétés sécuritaires.
Ce que nous dit le roman, son ontologie, très simple au fond, au-delà même de son discours politique, c’est que le sujet ne peut se construire, ne peut être, que si son univers visible, son Dedans, s’articule à un Dehors absolu. Vivre, c’est être en mouvement, c’est « vagabondir », opérer des écarts. Les voltés cherchent avant tout à se prouver qu’ils ne sont pas de simples goupilles d’orgue, mais bien des hommes doués de déraison. Jusque là, tout va bien. Mais sans doute touchons-nous là à leur tragique erreur, celle qui a suscité tant de commentaires : le Dehors, non-lieu abstrait sans lequel le Dedans serait un lieu mort et routinier seulement peuplé d’automates, ne saurait être investi, de quelque manière que ce soit. Rappelons l’évidence : le Dehors est toujours dehors. La difficulté d’interprétation du roman est que le Dehors cerclonien, cette zone inhospitalière, existe physiquement mais ne se superpose pas au concept qu’il métaphorise. Y fonder une Anarkhia, à cet égard, est absurde : même à l’extérieur de Cerclon, les voltés sont toujours au-dedans – ils en font d’ailleurs rapidement l’expérience, rattrapés par les anciens diagrammes. La construction d’Anarkhia n’a de sens que si elle n’impose aucun ordre nouveau, que si elle est sans cesse remodelée par un Dehors souverain – et c’est ainsi que la conçoit Capt, trop naïf pour comprendre que telle entreprise est vouée à un effondrement semblable à celui de Cerclon. Le parallèle est discrètement suggéré par l’auteur lui-même, « Anarkhia I » renvoyant inévitablement à « Cerclon I » par leur chiffre, mais aussi par leur histoire (Cerclon aussi a été conçu comme une utopie, en réaction au désastre terrien).
*
Voyons à présent comment cette dialectique du Dehors est interprétée en termes politiques. La Volte, donc, veut libérer le peuple du joug de sa mollesse universelle, libérer l’énergie des hommes, où qu’elle se trouve. Sa profession de foi se décline en quatre points fondamentaux :
1. La liberté inconditionnelle des forces de vie ;
2. La volonté de créer ;
3. L’exaltation de la multiplicité des pensées, des perceptions et des sentiments donc du non-conforme, du hors-norme et du subversif qui en sont la condition ;
4. La vitalité.
Mais si La Zone du Dehors est bien le récit d’un combat, l’affirmation d’une volonté – celle de semer la révolte –, celle-ci reste néanmoins négative, ou du moins dirigée contre la perfection empoisonnée du système – symbolisée par le cercle de Cerclon, et par le terrible Cube, cette incroyable déchetterie cosmique –, contre la narcose sociale. Comment, en vérité, pourrait-il en être autrement, étant donné qu’elle se situe par rapport au Dehors, dont nous avons dit qu’il n’est, par nature, jamais atteignable ? La Volte prétend certes encourager les forces de vie, la création. L’Écart. Capt, comme Alain Damasio, veut surtout « inventer ce que vivre peut être ». Vivre : c’est-à-dire métamorphoser le Dedans par le Dehors – rompre la routine mortifère. Les armes de la Volte ? La parole. Le contact direct avec les habitants, pourtant assez hostiles à leur égard – mais trop mous pour leur tenir tête – ; les « Clameurs », ces petites boules enregistreuses, dissimulées dans le paysage urbain, qui diffusent bribes poétiques ou messages politiques à l’approche des passants ; ou encore, le « concerto philosophique » cité plus haut, sans doute irréalisable car sa forme même, qui suppose la participation à parts égales du professeur et des élèves, exige de ces derniers la connaissance préalable de son contenu… Cet épisode résume à lui seul la limite du système damasien, qui fait mine de croire qu’il est possible de bâtir quelque chose en faisant table rase des fondations (et en oubliant que la nature humaine n’obéit jamais aux schèmes préétablis). C’est, encore une fois, négliger le fait que le Dehors n’a de sens que combiné avec le Dedans – aller de l’avant, faire bouger les lignes, oui, mais sans pour autant détruire ce qui fut construit. La philosophie des marges, ou philosophie du Dehors défendue par Capt n’est pas sans rappeler la « littérature des poubelles » (ou des réseaux, ou des filières) d’Antoine Volodine (cf. Lisbonne dernière marge, éditions de Minuit), qui s’oppose bien évidemment, dans son univers post-exotique, à la littérature officielle. Ah ! S’il ne s’était agi que de littérature (mais pour Foucault, la littérature a cessé d’être subversive depuis Blanchot)… Les actions les plus spectaculaires de la Volte, cependant, éloignée de toute expérience poétique, sont incontestablement concrètes, et violentes : il y a d’abord ces lames acérées qui, placées sur des portes automatiques, déchiquettent les jambes d’une petite fille (le fait qu’elle soit bourgeoise excuse-t-il cet acte odieux ?) ; il y a ensuite le sabotage, à grande échelle, d’une immense fête où tous les porteurs d’implants cérébraux sont durement touchés ; il y a, enfin, la désastreuse prise d’assaut de la tour d’holovision. La Volte est certes animée par des forces positives – puiser au Dehors de quoi transformer les rapports de force –, elle voudrait construire, mais elle ne sait que déconstruire. Son dessein avoué : « intellectrocuter » les masses, réveiller les consciences, fonder une communauté anarchiste « à côté » des pouvoirs. Creuser les écarts. Capt (« Sartre » en russe, nous apprend Damasio dans notre entretien pour Galaxies !) est l’écrivain engagé, à la fois poète et prosateur, pour qui la parole est action, celui par qui souffle enfin, sur Cerclon, le contrevent de la révolte (la « rêve-volte »), ou plutôt, de la volte, et de la liberté individuelle. Capt et ses compagnons ne se veulent pas tant ré-volutionnaires – avec ce que cela comporte de réaction à une situation subie –, que « volutionnaires ». Ils souhaitent s’affranchir d’un système, ne plus lutter contre lui (leur V n’est pas celui de Vendetta), non plus détruire, mais proposer un nouveau monde. Mais construire en-dehors des pouvoirs et des normes, n’est-ce pas simplement en créer de nouveaux ? N’est-ce pas rester au-dedans, toujours aussi loin du Dehors qu’auparavant ? Capt :
« Il n’y a pas d’aliénation ! Ce n’est pas le critère qui décide de la valeur des vies qu’on mène. Le vrai critère, c’est la vitalité. C’est être capable de bondir, de s’arracher sans cesse à soi-même pour créer, s’accroître, devenir autre, et autre qu’autre, sans cesse. Sentir le neuf. “Qui ne sent pas la bombe cuite et le vertige comprimé n’est pas digne d’être vivant”, a dit Artaud. Je voudrais bâtir un monde qui sente la bombe cuite et le vertige de vivre – et que vous le bâtissiez avec nous… » (p. 448. Notons que le « nous » était initialement un « moi », dans l’ancienne version…)
Voilà qui est gênant. S’agit-il, une fois pour toutes, de s’installer ailleurs, ou bien, où que l’on soit, de sentir la bombe cuite et le vertige comprimé ? S’agit-il de se donner l’illusion d’habiter un Dehors, ou bien, par un combat de tous les instants, de créer des écarts avec Cerclon ? Même si Capt finit par fonder Anarkhia, nous avons vu plus haut qu’il n’a, au fond, jamais cessé de lutter contre un système jugé – non sans raison ! – oppressant, et qu’il lui importe moins de fonder une société idéale, que de ruer dans les brancards. La désintégration finale du symbole du pouvoir cerclonien par les voltés n’est évidemment pas fortuite, à la fois signe fort adressé aux Cercloniens, et confirmation de la nature destructrice du groupuscule. La Zone du Dehors s’achève ainsi par un anéantissement (tandis que La Horde, nous le verrons, beaucoup plus subtile, ouvre sur une (re)naissance). Au-delà des utopies en effet, « Le monde a une réalité. C’est d’elle qu’il faut partir, non d’un modèle idéal qu’il s’agirait d’approcher au plus près. Le monde est. Le monde est ce qu’il est. » (p. 292) C’est que, en bon deleuzien, Alain Damasio ne conçoit pas la gauche comme autre chose qu’un permanent « devenir minoritaire », pour reprendre la formule du philosophe, une force d’opposition et non de pouvoir. Repensez à ce que nous écrivions plus haut, à propos du Dehors. Anarkhia, qui est à Capt ce que l’Eldorado était à Aguirre, est une aberration : le Dehors ne saurait être habité – il est toujours, par nature, au-dehors de tout. Cette confusion pourrait bien être à l’origine du malaise provoqué, à la lecture, par les agissements de la Volte. Affirmons-le : la Volte, bien qu’elle s’en défende, est assurément un groupe terroriste, qui à un nihilisme en oppose un autre.
Quoi qu’il en dise, Capt, dont l’idéal d’autodétermination et d’autodifférenciation s’incarnera en Caracole dans La Horde, se perçoit malgré tout comme un aliéné par la faute de ses serviles concitoyens. Mais aliéné, il l’est seulement au sens où l’entendait Artaud, c’est-à-dire (et Capt, comme Damasio, n’ignore pas ces mots) « un homme qui a préféré devenir fou, dans le sens où socialement on l’entend, que de forfaire à une certaine idée supérieure de l’honneur humain » (Vang Gogh le suicidé de la société). D’une idée supérieure de l’honneur humain à une opposition entre hommes supérieurs et sous-hommes, il n’y a qu’un pas qui, s’il est franchi, peut mener à de meurtrières extrémités – au terrorisme. Dans Généalogie de la morale, Nietzsche écrit :
« […] et nous trouverons que le fruit le plus mûr de l’arbre est l’individu souverain, l’individu qui n’est semblable qu’à lui-même, l’individu affranchi de la moralité des mœurs, l’individu autonome et supra-moral (car “autonome” et “moral” s’excluent), bref l’homme à la volonté propre, indépendante et persistante, l’homme qui a le droit de promettre, – celui qui possède en lui-même la conscience fière et vibrante de ce qu’il a enfin atteint par là, de ce qui s’est incorporé en lui, une véritable conscience de la liberté et de la puissance, le sentiment d’être arrivé à la perfection de l’homme. » (F. Nietzsche, Généalogie de la morale, deuxième dissertation – La « faute », la « mauvaise conscience » et ce qui leur ressemble, in Œuvres, R. Laffont, « Bouquins », 1993, pp. 804-805)
Voilà qui ferait une épitaphe idéale pour Capt – l’existentialiste, le captain, celui qui devient malgré lui le héros de « Capturez Captp », un programme de « virtue » (un jeu en réalité virtuelle, un peu l’inverse de la virevolte), où celui-ci est désigné comme l’ennemi numéro un – qui, comme Nietzsche, témoigne d’une haute conception de l’homme, si haute en vérité, si noble qu’elle en devient littéralement dangereuse – jusqu’au terrorisme. Et en effet, Capt et la Volte (séparée de ses éléments les plus modérés, que les voltés appellent la Molte) adoptent une posture d’authentiques terroristes, certes moins aveugles, moins nihilistes que les djihadistes d’Al-Qaida, mais néanmoins violents, fermement décidés à imposer au troupeau leur point de vue de moutons noirs… On trouve en effet dans La Zone l’idée extrêmement dérangeante, liée ici à l’interprétation damasienne du Surhomme nietzschéen – nous y reviendrons posément à propos de La Horde –, que le terrorisme serait plus vivant, plus vif, que les zombies de la société de consommation. Mais par chance Alain Damasio prend soin de ne jamais faire de Capt un messie qu’on suivrait aveuglément. Au moins ses personnages, loin de se prononcer en faveur de « tous les fanatismes » comme a pu le faire un Nabe, gardent-ils en toute circonstance leur indépendance d’esprit. Ne pas oublier : si l’individu est effectivement conscience constituante du monde, il n’en fait pas moins partie intégrante… On n’est jamais vraiment dehors.
*
L’échec majeur de cet impressionnant premier roman réside dans son excès de discours. À trop vouloir parler du Dehors, Alain Damasio a omis de s’y confronter lui-même. La Zone du Dehors ressemble trop à un essai avorté, mis en fiction, pour que la magie opère. C’est brillant, intellectuellement riche, et ambigü à souhait, mais lui manque ce supplément d’âme qui fait d’une œuvre comme La Horde du contrevent une fenêtre ouverte sur l’invisible. Restent tout de même quelques passages, superbes, ayant tous trait soit au Dehors, soit au Cube, les deux grandes métaphores de ce roman. Ne revenons pas sur le Dehors, largement évoqué en ces pages. Le Cube, lui, déchetterie ultime de la Radzone où Capt, plongé dans un enfer radioactif où le temps semble aboli, purge sa peine – avant d’en sortir en Christ ressuscité –, est un anti-dehors, lieu sans horizon, avec lequel nul ne peut composer. L’autre Cube, à Cerclon, où siègent les ministres, en est le reflet lisse, poli, imperméable aux tourments du monde extérieur, sans la moindre connexion avec le Dehors : le désir, l’imprévu, y sont exclus, remplacés par le Terminor et ses toutes-puissantes statistiques. Les espaces inhospitaliers mais ouverts du Dehors d’un côté, l’espace clos des deux Cubes de l’autre, constituent les deux pôles dialectiques du livre (désir, devenirs / raison du plus grand nombre, empire de la division), tels que nous les avons précédemment explorés. Quand au discours se substitue l’image poétique, quand l’idée est métamorphosée, quand Alain Damasio quitte enfin le domaine balisé de l’explicite et de ses slogans pour s’ouvrir à l’infini de la création d’univers, alors le texte déploie une autre dimension.
« Bon, et la volonté, le diable sait de quoi… »
Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol
Pour lire la première partie, cliquez ici.