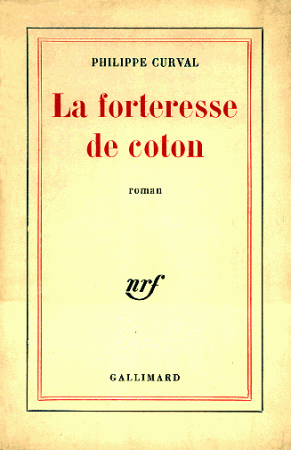
« L’univers (que d’autres appellent la Bibliothèque) se compose d’un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d’aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. »
Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel » in Fictions.
« Ceux qui ont peur ont perdu. »
Jules Echnort.
Fin de partie, le blog du Transhumain a aujourd’hui un an. J’adresse avant toutes choses un grand merci à tous mes lecteurs et lectrices, silencieux ou non, toujours plus nombreux. Qu’il me soit également permis de saluer tout particulièrement le valeureux Juan Asensio[1], dont le soutien n’a jamais faibli en dépit de nos irrémédiables divergences, ainsi que Sébastien Wojewodka, grand spécialiste de l’œuvre de David Cronenberg, auteur de deux remarquables études consacrées à eXistenZ et à Spider et dont l’amitié m’est plus que précieuse : inestimable. Du premier texte publié ici, réfutation polémique des inepties de Jean-Claude Guillebaud et plaidoyer iconoclaste pour un transhumanisme respectueux de l’individu comme de l’espèce comme process, aux dernières critiques littéraires consacrées à James Flint ou à Fabrice Colin, en passant par mon étude encore inachevée de Ténèbres de Dario Argento, cette expérience a toujours été motivée par la volonté inflexible de porter quelque lumière en des lieux trop obscurs – et, parfois, de porter le glaive du Verbe contre notre mortelle ennemie, la Médiocrité.
Ce labeur désintéressé, cet ahurissant mais inflexible investissement personnel, n’auront pas été vains puisqu’ils m’ont d’abord permis d’être publié dans Le Journal de la Culture, l’inégale mais généreuse revue de Joseph Vébret récemment transformée en Presse Littéraire, à laquelle ont collaboré, entre autres, Matthieu Baumier, Jean-Jacques Nuel, Muriel Cerf, Gabriel Matzneff, Ludovic Maubreuil et Sarah Vajda. Depuis le changement de formule et de périodicité, j’anime chaque mois dans La Presse Littéraire la « chronique des nouveaux mondes » consacrée à la science-fiction et, plus généralement, à la littérature des marges. Je vous annonce en outre qu’à la demande de David Kersan, j’ai officiellement rejoint les membres de la rédaction du Ring, aux côtés de Maurice G. Dantec, Renaud Camus, Alexandre Del Valle, Christian Combaz, Juan Asensio, Philippe Muray, Laurent James, Emily Tibbatts, Philippe Rivac et Jean-Louis Costes… Ma critique de Cosmos Incorporated, en trois parties, n’y est évidemment pas pour rien. Vous devriez bientôt lire sur le Ring quelques critiques littéraires initialement prévues pour Fin de partie. N’en dévoilons pas plus...
Si je n’hésite pas à écrire sous d’autres cieux, d’autres voix – et non des moindres – se feront aussi entendre dans Fin de partie. Le texte que j’ai choisi de mettre en ligne pour célébrer à ma façon cet anniversaire, s’intitule « Une barbarie fondamentale ». Il s’agit de la superbe préface, rédigée par Anne Tronche en 1979 à l’occasion de la réédition chez Denoël d’un chef d’œuvre de Philippe Curval hélas tombé dans l’oubli, La Forteresse de coton, qui cependant, bien que ne relevant absolument pas de la science-fiction, renaît chez « Folio SF ». A mon grand regret, cette nouvelle édition a été expurgée de la belle préface d’Anne Tronche, vraisemblablement jugée trop intellectuelle par l’éditeur[2]. Bien qu’ayant déjà consacré à Philippe Curval un dossier dans la revue Galaxies[3] – constitué d’une nouvelle inédite, d’un article et d’une interview – ainsi qu’une chronique dans La Presse Littéraire n°3 (à paraître), j’éprouve toujours le plus grand plaisir à faire découvrir cette œuvre libre, inclassable, extraordinairement vivante. Tenez, c’est bien simple : bien qu’infiniment plus lyrique, plus romantique – mais pas moins torturée –, La Forteresse de coton figure en bonne place dans ma bibliothèque idéale, non loin des Yeux d’Ezéchiel sont ouverts de Raymond Abellio, de La Femme des sables de Abé Kôbô ou encore de Crash! de James G. Ballard…
Mais trêve de bavardages. Anne Tronche, auteur de plusieurs livres d’arts et compagne de Philippe Curval, exprime dans son texte, bien mieux que je ne saurais le faire, l’urgence de dévorer La Forteresse de coton, cette tragique et envoûtante histoire de désir, de folie et de mort, dont le dénouement fantastique dans les eaux glauques, à la fois matricielles et mortifères des canaux de Venise – où le héros meurt et renaît –, anéantit définitivement les prétentions du roman réaliste.
Une barbarie fondamentale, préface à La Forteresse de coton (Denoël, Présence du Futur, 1979)
 « Il est des livres qui résistent à toute tentative de classification. Étrangers aux normes des fichiers et dotés d’un genre trop inhabituel pour que l’étiquette d’une chapelle ou d’une tendance puisse s’y apposer, ils dérivent vers nous indifférents aux modes, aux dictatures de la forme, ayant pour seule énergie cinétique une barbarie fondamentale. Il semble à les écouter entendre des voix qui agitent la pensée nocturne, il semble à les observer découvrir un furoncle sur le corps de la littérature. La Forteresse de coton est, sans conteste, de ceux-là. A évoquer ce titre depuis tant d’années, puisque ma première lecture remonte à sa première parution[4], il me semble retrouver cet étrange climat de désespérance, de fièvre et de doute dans lequel sa découverte m’avait plongée. Et s’il fallait en justifier l’insertion dans « Présence du futur »[5], il conviendrait de préciser qu’elle n’est certes pas plus conforme aux options de base qu’une collection de science-fiction présuppose, qu’aux schémas fictionnels sur lesquels la littérature générale a bâti sa forteresse. Mais c’est justement cette non-conformité, cette non-adaptation aux règles des genres reconnus, qui lui assurent cette qualité spéculative par laquelle se reconnaît toute expression s’autorisant à faire sauter quelques serrures mentales pour explorer les possibilités non prévisibles de l’utopie. C’est-à-dire d’un imaginaire qui ne s’en prend pas exclusivement, ou pas du tout, à ce qui ressort de la scénographie ou du décor, mais bien à la structure du récit, à son espace-temps, aux mécanismes qui en règlent l’évolution dans la durée.
« Il est des livres qui résistent à toute tentative de classification. Étrangers aux normes des fichiers et dotés d’un genre trop inhabituel pour que l’étiquette d’une chapelle ou d’une tendance puisse s’y apposer, ils dérivent vers nous indifférents aux modes, aux dictatures de la forme, ayant pour seule énergie cinétique une barbarie fondamentale. Il semble à les écouter entendre des voix qui agitent la pensée nocturne, il semble à les observer découvrir un furoncle sur le corps de la littérature. La Forteresse de coton est, sans conteste, de ceux-là. A évoquer ce titre depuis tant d’années, puisque ma première lecture remonte à sa première parution[4], il me semble retrouver cet étrange climat de désespérance, de fièvre et de doute dans lequel sa découverte m’avait plongée. Et s’il fallait en justifier l’insertion dans « Présence du futur »[5], il conviendrait de préciser qu’elle n’est certes pas plus conforme aux options de base qu’une collection de science-fiction présuppose, qu’aux schémas fictionnels sur lesquels la littérature générale a bâti sa forteresse. Mais c’est justement cette non-conformité, cette non-adaptation aux règles des genres reconnus, qui lui assurent cette qualité spéculative par laquelle se reconnaît toute expression s’autorisant à faire sauter quelques serrures mentales pour explorer les possibilités non prévisibles de l’utopie. C’est-à-dire d’un imaginaire qui ne s’en prend pas exclusivement, ou pas du tout, à ce qui ressort de la scénographie ou du décor, mais bien à la structure du récit, à son espace-temps, aux mécanismes qui en règlent l’évolution dans la durée.Tous les thèmes décisifs de La Forteresse de coton mettent en cause l’optimisme béat de l’ordre, le réconfort de la mesure, les bondieuseries de la logique. L’amour s’y vit mal, la projection du désir y oscille entre le dégoût et l’adhésion au dégoût de la maladie, l’aventure mentale des personnages n’y est qu’une chute délictueuse vers la mort ou la folie. Aujourd’hui que je tente de faire revivre mes premières impressions de lectrice, je ne me souviens pas d’une histoire tissée par la cohérence d’une anecdote bien troussée. Des scènes sans suite me reviennent, des images, des « flashes » qui me permettent de penser que les mots se sont davantage injectés en moi comme sous l’effet d’une seringue hypothermique, qu’agencés harmonieusement en mon esprit. Sans doute parce que La Forteresse de coton, pénétré d’un romantisme de rupture, est un ouvrage qui, tout en connaissant la qualité du froid de table rase, avoisine fréquemment les 42° , signe d’une fièvre intense.
Au sein d’un curieux équilibre blanc, l’histoire contée est celle d’une aberration. Les mécanismes qui en assurent le déroulement traduisent l’impossibilité d’adhérer à n’importe quel système social, politique, idéologique comme aux lois les plus simples de la survie quotidienne, qui tentent tous de régler abusivement l’alchimie des rêves, des espoirs et des passions. En dépit du phénomène ganglionnaire que ce refus biologique et global suppose, les personnages se vouent à des rites de passage. Ce qui leur permet de se lier un court temps à celui ou à celle auquel ils demandent beaucoup trop : le dépassement de l’indifférence et de la solitude. Le feu et les pactes rituels, par lesquels toute imposture devient duplicité, permettent à cette entité si peu innocente qu’est le couple, de se créer une voie d’épreuves entre la naissance et l’agonie, entre le feu et la combustion lente. Sous le ciel étonnamment blanc de Venise, au cœur des places gagnées par endroit par des taches de moisissure verdâtres, dans les venelles où le silence s’emploie à prolonger l’heure de la sieste, les protagonistes captifs du jeu au-delà du jeu, cherchent désespérément à croire qu’ils se trouvent du même côté du mur qui les sépare. Dans leur crainte d’être rattrapés par les ombres du doute, mais traînant déjà derrière eux le cadavre de leur passion contrariée, ils cherchent à pénétrer plus avant dans les chemins de la pensée contraire, à se perdre dans les marécages de la fin de toute réflexion raisonnable, à dénoncer toute interprétation réaliste du monde.
Est-ce la vie à deux et son corollaire, la mise en ordre des passions, qui travaille et ronge ainsi les personnages, ou est-ce le haut mal de la vie tout court ? Je dois avouer que cette question m’a longtemps préoccupée. Et ce, en raison même du rôle que le hasard des circonstances m’a amenée à jouer auprès de Philippe Curval. Le désespoir qui traverse toutes les phrases du récit, paraît révéler que l’ennui s’en prend toujours aux affaires de cœur quand celles-ci ne sombrent pas dans la folie la plus dérangeante, ou bien que la provocation mentale et affective peut seule convertir la vacuité en substance. Depuis, la patiente fréquentation de l’auteur et de son œuvre m’a enseigné que son expression était marquée par le rêve de l’apatride. Et qu’à l’encontre de ceux qui cherchent obstinément à consolider leurs racines, lui s’emploie à cisailler ce qui pourrait le lier définitivement à un sol, à une généalogie terrestre, à une histoire familiale. D’où son attirance pour un futur qui déterritorialise les faits et les comportements humains, d’où son désir de projeter son écriture vers des zones qui confèrent une existence identique aux lois de l’espèce et aux hasards des intuitions volatiles. Persuadé qu’il n’y a point d’évolution qui ne soit destructrice, du moins dans ses moments d’intensité, il associe bizarrement l’avènement de la lucidité, au culte de la folie créatrice. Il ne faut donc pas s’étonner si la plupart du temps, les personnages de ses fictions romanesques, las de dépendre de ce qui leur est extérieur, cherchent à faire dépendre ce qui leur est extérieur d’eux-mêmes. Face à un quotidien qui semble interdire toute possibilité de rencontres vivables, ils ne cessent d’exiger le désordre de l’imaginaire, à contredire la maturité de leur apparence par l’immaturité lumineuse de leurs rêves.
Plus un esprit court de dangers, plus il ressent le besoin de multiplier les malentendus à son sujet. Philippe Curval, lors de la réalisation de La Forteresse de coton, n’a pas échappé à cette fatalité. Brodant les mots de son récit avec quelques touches d’une préciosité baroque, il attire l’attention sur les effets de style pour cacher combien les énigmes du récit sont couleur de noyade. De même, qu’en explorant un certain nombre de voluptés parmi lesquelles : l’ivresse, la gastronomie, l’érotisme, il paraît s’attarder à la table des moments heureux, alors même qu’il découvre à quel point les plaisirs ne conduisent pas à la satiété quand on puise à pleine main dans le vide.
En fait, toute l’histoire de La Forteresse de coton est bâtie sur un unique sentiment, celui du dépaysement dans la durée. L’effort mis pour rejoindre le plan de la réalité épuise les sentiments et transforme les gestes les plus accessoires du quotidien en genre équivoque. Si bien que l’objet de cette réalité devenant diffus, les personnages succombent à son imprécision. Étouffant dans la double impossibilité de vivre et de mourir, ces voyageurs pour eaux profondes, ces fidèles sujets de l’exil total, n’ont plus qu’à se laisser captiver par les parfums d’une schizophrénie, peut-être salvatrice.
 Il est des livres qui, trouvant leur rythme respiratoire dès les premières pages, conduisent le lecteur vers le mot « fin » avec l’assurance que donne la connaissance préalable de l’itinéraire. D’autres, à l’image de La Forteresse de coton sont en proie à des tachycardies émotives, à des ruptures narratives qui dévient le récit de ce qui pouvait passer précédemment pour une trajectoire. Ainsi, dans La Forteresse de coton, le dernier chapitre rompt avec les significations convenues d’une histoire crédible pour se faire complice de l’énigme. Comme si en quête d’un autre ordre, l’auteur lançait un défi à l’évidence de l’artifice romanesque, à l’optique générale du genre littéraire et opérait une disjonction brutale entre la réalité et les signes de sa réinvention. Le livre lu et reposé, il nous faut mentalement contaminer notre souvenir des premiers chapitres par les connaissances acquises durant le déchiffrement des dernières pages. Comme si le récit nous avait donné en fin de course une clé de passe à multiples entrées pour un sésame trompeur. Le dédoublement final du personnage principal dans le pressentiment voilé d’un retour au fœtus assassiné par sa descendance, l’adulte, accompagne comme une ligne mélodique la fuite de l’écriture hors des territoires balisés par la logique romanesque. Tout se passe comme si le roman renonçait quelques pages avant la fin à sa fonction, coupait court à la hantise moderne de la psychologie convaincante et se donnait la capacité métaphysique de s’élever au-dessus de sa catégorie. N’est-ce pas là le propos de toute littérature spéculative ? N’est-ce pas là le but de toute pensée qui, pour se protéger des médiocres et irrespirables certitudes de son temps, s’emploie à élever une protestation contre la vérité qui, tout en étant parfaitement relative et éphémère, parvient presque toujours à devenir doctrinaire ? C’est peut-être là le sort de l’expression littéraire de Philippe Curval, d’avoir toujours à combattre contre elle-même, pour que jamais elle n’ait à se figer sous un label mortifère et culturel, pour que jamais une forme définitive ne prenne forme en elle au point de convertir en principes ses nuits. »
Il est des livres qui, trouvant leur rythme respiratoire dès les premières pages, conduisent le lecteur vers le mot « fin » avec l’assurance que donne la connaissance préalable de l’itinéraire. D’autres, à l’image de La Forteresse de coton sont en proie à des tachycardies émotives, à des ruptures narratives qui dévient le récit de ce qui pouvait passer précédemment pour une trajectoire. Ainsi, dans La Forteresse de coton, le dernier chapitre rompt avec les significations convenues d’une histoire crédible pour se faire complice de l’énigme. Comme si en quête d’un autre ordre, l’auteur lançait un défi à l’évidence de l’artifice romanesque, à l’optique générale du genre littéraire et opérait une disjonction brutale entre la réalité et les signes de sa réinvention. Le livre lu et reposé, il nous faut mentalement contaminer notre souvenir des premiers chapitres par les connaissances acquises durant le déchiffrement des dernières pages. Comme si le récit nous avait donné en fin de course une clé de passe à multiples entrées pour un sésame trompeur. Le dédoublement final du personnage principal dans le pressentiment voilé d’un retour au fœtus assassiné par sa descendance, l’adulte, accompagne comme une ligne mélodique la fuite de l’écriture hors des territoires balisés par la logique romanesque. Tout se passe comme si le roman renonçait quelques pages avant la fin à sa fonction, coupait court à la hantise moderne de la psychologie convaincante et se donnait la capacité métaphysique de s’élever au-dessus de sa catégorie. N’est-ce pas là le propos de toute littérature spéculative ? N’est-ce pas là le but de toute pensée qui, pour se protéger des médiocres et irrespirables certitudes de son temps, s’emploie à élever une protestation contre la vérité qui, tout en étant parfaitement relative et éphémère, parvient presque toujours à devenir doctrinaire ? C’est peut-être là le sort de l’expression littéraire de Philippe Curval, d’avoir toujours à combattre contre elle-même, pour que jamais elle n’ait à se figer sous un label mortifère et culturel, pour que jamais une forme définitive ne prenne forme en elle au point de convertir en principes ses nuits. »

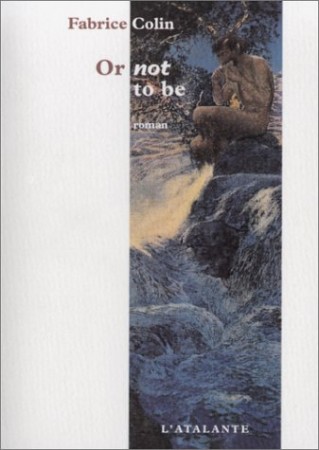
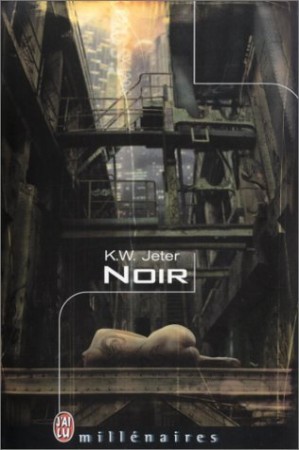

 J’avais été favorablement impressionné, il y a quelques années, par le premier roman de James Flint – admirablement traduit par Claro – : Habitus, œuvre aussi imparfaite qu’inventive et prophétique, nous conviait sur plus de 700 pages à un fascinant parcours à travers l’histoire de l’informatique au cours de la seconde moitié du 20e siècle – ou comment l’ère des réseaux aura raison de l’être humain… Après Douce Apocalypse,
J’avais été favorablement impressionné, il y a quelques années, par le premier roman de James Flint – admirablement traduit par Claro – : Habitus, œuvre aussi imparfaite qu’inventive et prophétique, nous conviait sur plus de 700 pages à un fascinant parcours à travers l’histoire de l’informatique au cours de la seconde moitié du 20e siècle – ou comment l’ère des réseaux aura raison de l’être humain… Après Douce Apocalypse,  recueil de nouvelles certes mineur mais sous-estimé par la critique (nous retiendrons tout particulièrement « Auto-assistance », texte ludique sous forme de test de personnalité ; « Lieux stratégiques », inquiétante variation autour du délire sécuritaire ; « Rêves d’un futur parfait », cauchemar psychosexuel nanotechnologique ; et « Esquisse pour un futur biotechnologique », implacable panorama historique des biotechnologies de 1980, date à laquelle la Cour suprême des Etats-Unis autorisa les brevets portant sur la vie génétiquement créée, jusqu’à 2060, année de la légalisation par le Congrès du clonage humain), les éditions Au Diable Vauvert publient aujourd’hui le dernier roman de James Flint, Electrons libres, traduit cette fois par Alfred Boudry. Ce Book of Ash s’avère plus drôle que Habitus, plus relâché aussi – à la construction composite de celui-là succède la nonchalance, la linéarité de celui-ci – ; le génie n’y transparaît plus qu’en creux, fuyant, insaisissable comme une ombre – celle de Jack Reever, le sculpteur pour déchets atomiques transmutés, sur les traces duquel nous sommes cordialement invités à marcher. Avant de nous pencher plus avant sur ces passionnants Electrons libres, plus profonds qu’ils n’en ont l’air, revenons sur Habitus. Voici ce que j’écrivis avec enthousiasme pour le numéro 28 de la revue Galaxies, en 2003 :
recueil de nouvelles certes mineur mais sous-estimé par la critique (nous retiendrons tout particulièrement « Auto-assistance », texte ludique sous forme de test de personnalité ; « Lieux stratégiques », inquiétante variation autour du délire sécuritaire ; « Rêves d’un futur parfait », cauchemar psychosexuel nanotechnologique ; et « Esquisse pour un futur biotechnologique », implacable panorama historique des biotechnologies de 1980, date à laquelle la Cour suprême des Etats-Unis autorisa les brevets portant sur la vie génétiquement créée, jusqu’à 2060, année de la légalisation par le Congrès du clonage humain), les éditions Au Diable Vauvert publient aujourd’hui le dernier roman de James Flint, Electrons libres, traduit cette fois par Alfred Boudry. Ce Book of Ash s’avère plus drôle que Habitus, plus relâché aussi – à la construction composite de celui-là succède la nonchalance, la linéarité de celui-ci – ; le génie n’y transparaît plus qu’en creux, fuyant, insaisissable comme une ombre – celle de Jack Reever, le sculpteur pour déchets atomiques transmutés, sur les traces duquel nous sommes cordialement invités à marcher. Avant de nous pencher plus avant sur ces passionnants Electrons libres, plus profonds qu’ils n’en ont l’air, revenons sur Habitus. Voici ce que j’écrivis avec enthousiasme pour le numéro 28 de la revue Galaxies, en 2003 :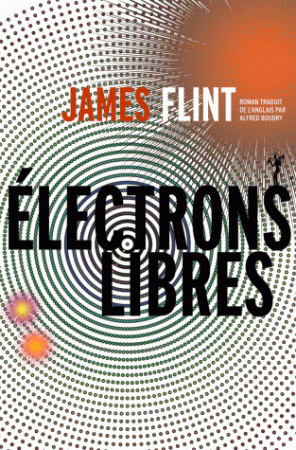 Dans Electrons libres, road-book aussi drôle qu'inquiétant – plus simple, plus touchant, moins métastatique qu'Habitus –, les métaphores sont plus discrètes, moins systématiques, mais d’une violence parfois surprenante. Ainsi les Etats-Unis, que traverse son personnage Cooper James équipé d’un appareil photographique – dont les clichés
Dans Electrons libres, road-book aussi drôle qu'inquiétant – plus simple, plus touchant, moins métastatique qu'Habitus –, les métaphores sont plus discrètes, moins systématiques, mais d’une violence parfois surprenante. Ainsi les Etats-Unis, que traverse son personnage Cooper James équipé d’un appareil photographique – dont les clichés , était selon lui un puissant sortilège : représentant le palais (le pouvoir politique), le temple (la religion), le grenier à blé (le pouvoir véritable), les trois murs (divisés en cinq blocs sur le plan) entourés d’un cercle (le mur d’enceinte) puis d’un second (les maisons agglomérées autour du centre du pouvoir), le symbole « a changé une société clairsemée de nomades, d’agriculteurs de subsistance et de chasseurs-cueilleurs en ce que nous appelons aujourd’hui une civilisation » (p. 451). Or, Jack Reever postulait que les physiciens nucléaires, avec leur trinité proton, neutron, électron, capables de recréer sur la surface de la Terre l’énergie divine du Soleil, sont les alchimistes modernes, ceux dont les travaux furent selon lui à l’origine du développement des lotissements pavillonnaires, construits autour de la nouvelle citadelle inexpugnable, Atomville – la Nouvelle Atlantide. C’est pour conserver la trace de notre civilisation, pour en communiquer à quelque Droctulft des temps futurs non une vulgaire copie mais un symbole mystérieux que L’Herme de granit de Jack Reever, renfermant des cendres dont la légende dira qu'elles sont les siennes, s’élève finalement en plein désert toxique, au cœur des Zones contaminées.
, était selon lui un puissant sortilège : représentant le palais (le pouvoir politique), le temple (la religion), le grenier à blé (le pouvoir véritable), les trois murs (divisés en cinq blocs sur le plan) entourés d’un cercle (le mur d’enceinte) puis d’un second (les maisons agglomérées autour du centre du pouvoir), le symbole « a changé une société clairsemée de nomades, d’agriculteurs de subsistance et de chasseurs-cueilleurs en ce que nous appelons aujourd’hui une civilisation » (p. 451). Or, Jack Reever postulait que les physiciens nucléaires, avec leur trinité proton, neutron, électron, capables de recréer sur la surface de la Terre l’énergie divine du Soleil, sont les alchimistes modernes, ceux dont les travaux furent selon lui à l’origine du développement des lotissements pavillonnaires, construits autour de la nouvelle citadelle inexpugnable, Atomville – la Nouvelle Atlantide. C’est pour conserver la trace de notre civilisation, pour en communiquer à quelque Droctulft des temps futurs non une vulgaire copie mais un symbole mystérieux que L’Herme de granit de Jack Reever, renfermant des cendres dont la légende dira qu'elles sont les siennes, s’élève finalement en plein désert toxique, au cœur des Zones contaminées.
