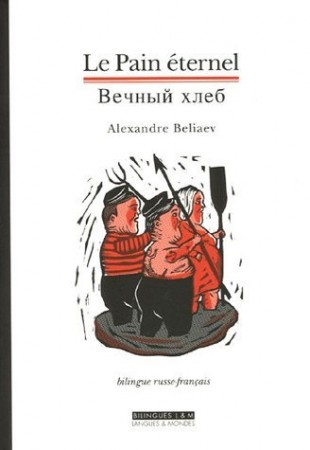
« La Nature est prodigue. Sur une centaine de plants, un ou deux seulement survivraient ; sur une centaine d’espèces, une ou deux.
Mais pas l’homme. »
T. M. Disch, Génocides
Avant de commencer l’année 2006 par quelques critiques de nouveautés – L’Ultime tabou de Franca Maï (le Cherche Midi, 2005), Electrons libres de James Flint (Au Diable Vauvert, 2006)… –, ou de curiosités et rééditions – Les géocroiseurs d’Eric Pessan (La Différence, 2004), Le Gambit des étoiles de Gérard Klein (Le Livre de poche « Science-fiction », 2005), Dernière conversation avant les étoiles, passionnante et frustrante série d’entretiens avec Philip K. Dick déjà évoquée ici… –, permettez-moi de clore le mouvementé chapitre 2005 par l’évocation d’une rareté slave miraculeusement échouée dans ma boîte à lettres.
De la science-fiction russe, le lecteur français ne connaît rien ou presque : hormis Evgueni Zamiatine (Nous autres, Gallimard « L’imaginaire », 1971) et Arcadi & Boris Strougatski (Stalker, Denoël « Présence du futur », 1994) – ainsi, à la rigueur, qu’Ivan Efremov, dont le nom nous est plus familier que l’œuvre, et peut-être Vladimir Volkoff, dont les éditions L’Âge d’homme ont réédité récemment La Guerre des pieuvres et Le tire-bouchon du bon Dieu, écrits en français –, nous serions bien en peine de citer d’autres noms marquants… Or si l’on croit la préface de l’anthologiste Leonid Heller à l’introuvable Livre d’or de la science-fiction soviétique (Pocket, 1984), le genre avait suscité sous le régime communiste de nombreux textes tantôt inféodés au Parti, tantôt farouchement critiques, mais souvent admirables.
Remercions donc les éditions Langues & Mondes/L’Asiathèque qui nous font aujourd’hui découvrir (en version bilingue !) le talent d’un certain Alexandre Beliaev (1884-1942) dont la biographie, brièvement esquissée par la traductrice (Aselle Amanaliéva-Larvet) en introduction, est déjà un roman... Fasciné par Jules Verne et par la science, le jeune Beliaev « construisait des ailes en paille, attachait des balais à ses bras ou s’accrochait à un parapluie ou à un parachute fait d’un drap, montait sur le toit et… se jetait dans le vide. » (p. 8), abandonna un séminaire religieux imposé par son père et devint juriste avant de se consacrer au théâtre pendant quinze ans, non sans avoir construit des barricades en 1905 pendant les émeutes de Moscou. Frappé d’une pleurésie, il resta paralysé des membres inférieurs de 1916 à 1922 (« C’est là que j’ai réfléchi et perçu tout ce que peut subir une “tête sans corps”. », p. 9), devint chercheur, collabora à divers journaux et rédigea ses premiers textes de science-fiction. A la fin des années trente, à Pouchkine (!) au sud de Léningrad, Beliaev rencontra Alexeï Tolstoï (autre auteur de science-fiction dont on peut lire une nouvelle dans Le Livre d’or mentionné plus haut) et publia de nombreux textes. « En 1940, il subit une opération aux reins […]. Beliaev suivit l’intervention dans un miroir accroché devant lui à sa demande. » (p. 12). Il décède en 1942 dans Pouchkine occupée par les nazis.
Le Pain éternel, recueil de quatre nouvelles choisies et traduites par Aselle Amanaliéva-Larvet, prouve s’il en était encore besoin – les récalcitrants sont nombreux ! – que la science-fiction, en spéculant sur notre avenir, s’intéresse avant tout à notre temps présent. De fait, plusieurs problèmes envisagés ici par Alexandre Beliaev[1] nous concernent directement.
La longue nouvelle de 1928 qui donne son titre au recueil, « Le Pain éternel », relate les espoirs suscités par la formidable invention du professeur Brojer : une substance vivante et nourrissante semblable à une gelé d’œufs de grenouilles, laquelle, si l’on en mange la moitié, se régénère totalement en une seule journée – si bien qu’un seul pot suffit en principe à nourrir un individu tout au long de sa vie. Seulement, le secret du scientifique n’aurait jamais dû être éventé : pour une bouchée de cette pâte miraculeuse – version science-fictive de La Nappe magique et d’autres contes du même type –, les pauvres pêcheurs de l’île de Fair vont s’entretuer avant d’être phagocytés par des industriels sans scrupule, puis par l’Etat qui s’arroge le monopole du commerce de la pâte. Las ! Si le professeur Brojer, qui réservait son invention à l’éradication de la famine, n’avait déposé aucun brevet, il avait pour cela une bonne raison : le produit semblait en tous points parfait, mais ses expériences n’étaient pas encore achevées ! Or, alors que tout le monde, dans le pays et au-delà des frontières, semble posséder son pot de précieuse mixture, celle-ci commence à croître anormalement, à déborder, à envahir les maisons, jusqu’à s’étendre, invincible, sur terre comme à la surface des mers… L’humanité saura-t-elle trouver une parade à cette apocalypse grotesque et métastatique ?... La course effrénée au profit, l’impasse d’une éthique officielle corrompue par les enjeux économiques, l’espérance savamment entretenue par les marchands en la fin de tous les maux au moyen d’un produit-miracle, ont raison de la plus élémentaire prudence. En manipulant ainsi la vie, en substituant à une chaîne alimentaire traditionnelle un mode d’alimentation aussi nouveau qu’artificiel, le professeur Brojer savait que le pire était envisageable – mais n’en travaillait pas moins avec acharnement. Cela ne vous rappelle rien ? ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES. De même que le clonage humain ne devient problématique que s’il est considéré en termes fantaisistes plutôt que rationnels, de même ne condamnons ni ne portons aux nues les techniques transgénétiques – chez Beliaev, moraliste optimiste, point de technophobie, au contraire : le salut viendra encore de la science et de la technique. Soyons positivistes, gardons-nous donc de la cadavérique stase réactionnaire, mais montrons-nous inflexibles et refusons toute exploitation commerciale d’organismes transgéniques dont l’innocuité pour l’homme et pour son environnement, ne l’oublions jamais, reste encore à prouver…
« La Lumière invisible », le second texte du recueil, s’avère lui aussi d’une sidérante modernité. Un médecin ambitieux (Kruss) permet à un aveugle (Dobbel) de voir non pas le monde visible tel que nous le voyons, mais seulement, grâce à un récepteur connecté à ses nerfs optiques, le monde électrique tel que le « voient » les galvanomètres. A la splendeur du paysage inédit qui s’offre à notre aveugle aux yeux électrique succède hélas rapidement la monotonie de la vie sociale : Dobbel, engagé par la Compagnie générale d’électricité au titre d’appareil vivant d’expérimentation, s’ennuie ferme. Kruss lui rend sa vision « normale ». Dobbel, désormais privé d’emploi, orphelin des beautés de la « lumière invisible », voit comme vous et moi, mais le monde n’est-il pas d’une tristesse à pleurer ?... Ici, l’apport cybernétique est bien décrit comme une positive extension du corps humain, et non comme la profanation d’un temple sacré. Inutile de préciser que je souscris intégralement à cette vision prototranshumaniste des anthropotechniques.
Dans la troisième nouvelle, « Monsieur le rire », un jeune ingénieur-mécanicien avide de réussite, Spaulding, entreprend de découvrir l’ultime secret du rire, source de succès assurés. Mais dès l’instant où il y parvient, au terme d’une implacable démarche rationnelle, Spaulding tue tout rire en lui. « Je me suis volé à moi-même… », lance-t-il au comble du désespoir (p. 283). Je ne résiste pas à l’envie de vous offrir la conclusion de ce texte aussi drôle que féroce : « Les plus grands artistes comiques finissent souvent dans une mélancolie noire, disait le médecin. Mais son jeune assistant, un original et un amateur de paradoxes, assurait que Spaulding avait été tué par l’esprit américain de mécanisation. » (p. 283)… Américain, vraiment ? Ou soviétique ?... Je suis décidément stupéfait de trouver dans les textes de ce Russe d’avant-guerre une telle acuité de regard – acuité, mais aussi ambivalence : ne cachons pas que chaque texte pourrait sans doute être interprété de très différente manière –, non seulement sur les forces à l’œuvre, soviétiques et capitalistes, mais encore sur la richesse et la complexité du progrès scientifique. Ici en effet, vous l’aurez noté, ce n’est pas l’analyse du vivant en soi qui est condamnée, mais seulement la confusion de l’inerte et du métaphysique : considérer l’homme, qui est créature productrice d’âme, comme une simple machine – alors qu’il est une machine, certes, mais infiniment complexe, et que les choses de l’esprit relèvent de l’indéterminé –, est une grossière erreur passible de mécanisation du monde – où l’on en revient à Anders et à Dantec...
Dans « Cap à l’ouest » enfin, dernier texte du Pain éternel, Beliaev se montre diablement ingénieux. Le « Grand Esprit », surhomme aux facultés mentales extraordinaires, fruit du long travail de scientifiques eugénistes, est sur le point de mourir. La communauté scientifique, affolée à l’idée de devoir se passer, même momentanément, des lumières d’un tel cerveau , lui demandent alors de chercher toutes affaires cessantes le moyen de prolonger sa propre vie, de façon à pouvoir mener à bien le projet en cours… Notre Grand Esprit, se basant sur les théories relativistes, a alors l’idée fantastique de s’installer avec son laboratoire et ses assistants dans une grande fusée volant indéfiniment vers l’ouest (c’est-à-dire dans le sens inverse de la rotation terrestre) à la vitesse, censée relativiser le déroulement du temps, de mille six cent soixante-six kilomètres et six dixièmes à l’heure. Le résultat est au-delà des espérances : le Grand Esprit ne vieillit plus mais… pour lui, comme pour les autres passagers, le temps s’est arrêté ! Pire : suite à une erreur de calcul après plusieurs rebondissements, le pilote augmente encore la vitesse de la fusée… dans laquelle un physicien envoyé en reconnaissance ne trouve que des bébés, tous morts à l’exception d’un seul, le Grand Esprit sauvé par son intelligence supérieure… Passons sur l’aspect scientifique du texte, en grande partie obsolète – même si demeure intact le mystère d’éventuels paradoxes temporels –, et saluons plutôt l’audace et l’humour mordant de Beliaev, qui pour un prétexte matérialiste que n’aurait pas renié le Parti, souffla à ses contemporains que c’est à l’ouest, seulement à l’ouest que le renouveau naîtrait…
Il n’y a pas de hasard. « Ce n’est pas parce que deux nuages se rencontrent que l’éclair jaillit, écrivait Raymond Abellio, c’est afin que l’éclair jaillisse que les nuages se rencontrent ». Le Pain éternel surgit en France précisément au moment où nous avons cruellement besoin non de maîtres à penser (ce que ne sont ni le footballeur Lilian Thuram, ni le populiste Nicolas Sarkozy, pas plus d’ailleurs qu’Alain Finkielkraut[2]) mais de passeurs (stalkers) comme Alexandre Belaiev, réactionnaires ou progressistes, apocalyptiques ou utopistes, mais toujours prophétiques – des grands écrivains d’anticipation capables de nous faire entrevoir la « lumière invisible ».
Tenez, puisque vous êtes encore là, j’en profite pour vous signaler aussi la parution le 5 janvier 2006 d’un inattendu Omnibus intitulé Catastrophes, brièvement présenté par Michel Demuth (« le malheur a commencé dès que le premier feu a été allumé »[3]) et réunissant des œuvres assez datées (Terre brûlée de John Christopher, Soleil vert de Harry Harrison, et le remarquable Génocides de Thomas Disch) et deux autres que je n’ai jamais lues (La fin du rêve de Philip Wyle et La Goélette des glaces de Michael Moorcock). Cinq romans cataclysmiques pour le prix d’un : largement de quoi reprendre du poil de la bête ! Le 21e siècle sera transhumain ou ne sera pas.
[1] Après vérification, la traduction française d’un roman d’Alexandre Beliaev, L’Homme amphibie, est disponible depuis 1988 aux éditions Radouga (Moscou).
[2] Alain Finkielkraut, dont on devine quelle fut la réaction au coup d’éclat de Marc-Edouard Nabe, en 1985, sur le plateau d’Apostrophes… ou celui de Renaud Camus dans son journal de 1994, La campagne de France... Dénombrer les Juifs parmi les invités d’une émission, et dénombrer les Noirs dans le onze de départ de l’équipe de France de football, relève de la même logique.
[3] M. Demuth, « La Terre gronde, le ciel tombe, il gèle en enfer… Les nouveaux voyages de Gulliver » in Catastrophes (Omnibus, 2006), p. IV.




 Sous forme de dossier d’instruction (transcriptions d'écoute, articles de journaux, lettres, etc.), Reproduction interdite déroule son implacable démonstration avec une rigueur, une froideur d’entomologiste qui renvoie au lecteur ses lâches compromissions. Le juge Norbert Rettinger, avec l'aide de la belle commissaire de police Nora Simonot, exhume une affaire d'ampleur internationale, mettant gravement en cause divers gouvernements et multinationales, et ébranlant la puissante industrie du clone. Nous sommes en France, en 2037. Les clones humains, génétiquement amputés d’une petite partie du cerveau et donc profondément débiles, sont depuis longtemps utilisés à des fins médicales (transplantations d'organes, transfusions sanguines, expériences diverses...), industrielles (recyclage des déchets...) et militaires (chair à canon), depuis que les dernières résistances d'ordre éthique ont été balayées grâce, entre autres, à l'acceptation par l'Eglise de la non-humanité du clone, désormais considéré comme un robot organique, sans plus de droit qu’un autocuiseur. Tout le monde s'en accommode, vous, moi, vos enfants, sauf quelques agitateurs subversifs volontiers qualifiés de terroristes fanatiques. Mais à la suite de divers rebondissements, les millions de clones « élevés » dans le camp CP24 doivent être supprimés, de la même façon qu’un cheptel d’animaux est aujourd’hui abattu dès que plane un soupçon de contamination par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Entre temps, Rettinger aura appris à considérer les clones, qui pour lui n’étaient que de la chair à son service, comme ses égaux en droit.
Sous forme de dossier d’instruction (transcriptions d'écoute, articles de journaux, lettres, etc.), Reproduction interdite déroule son implacable démonstration avec une rigueur, une froideur d’entomologiste qui renvoie au lecteur ses lâches compromissions. Le juge Norbert Rettinger, avec l'aide de la belle commissaire de police Nora Simonot, exhume une affaire d'ampleur internationale, mettant gravement en cause divers gouvernements et multinationales, et ébranlant la puissante industrie du clone. Nous sommes en France, en 2037. Les clones humains, génétiquement amputés d’une petite partie du cerveau et donc profondément débiles, sont depuis longtemps utilisés à des fins médicales (transplantations d'organes, transfusions sanguines, expériences diverses...), industrielles (recyclage des déchets...) et militaires (chair à canon), depuis que les dernières résistances d'ordre éthique ont été balayées grâce, entre autres, à l'acceptation par l'Eglise de la non-humanité du clone, désormais considéré comme un robot organique, sans plus de droit qu’un autocuiseur. Tout le monde s'en accommode, vous, moi, vos enfants, sauf quelques agitateurs subversifs volontiers qualifiés de terroristes fanatiques. Mais à la suite de divers rebondissements, les millions de clones « élevés » dans le camp CP24 doivent être supprimés, de la même façon qu’un cheptel d’animaux est aujourd’hui abattu dès que plane un soupçon de contamination par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Entre temps, Rettinger aura appris à considérer les clones, qui pour lui n’étaient que de la chair à son service, comme ses égaux en droit. Si la SF contemporaine n’est pas aussi riche que celle des années soixante, soixante-dix — son véritable « âge d’or » avec les chefs d’œuvre de Dick, Brunner, Spinrad, Disch, Silverberg, Jeury, Curval, Ballard, Herbert, Vonnegut, etc. ―,
Si la SF contemporaine n’est pas aussi riche que celle des années soixante, soixante-dix — son véritable « âge d’or » avec les chefs d’œuvre de Dick, Brunner, Spinrad, Disch, Silverberg, Jeury, Curval, Ballard, Herbert, Vonnegut, etc. ―, 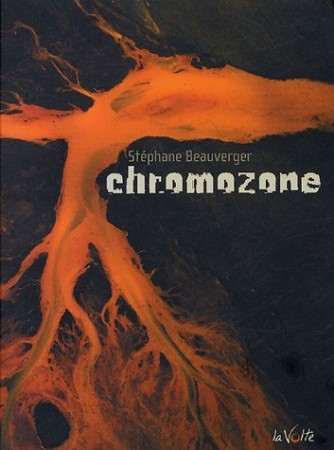 Chromozone est un récit choral, à l’anglo-saxonne, qui nous fait suivre en alternance et à la troisième personne les aventures de Gemini — jeune prisonnier d’un camp de réfugiés dominé par les violents Keltics —, de Teitomo — flic pur et dur qui travaille pour le plus offrant dans les « zones de couleur » communautaires de Marseille —, d’Ogre — machine à tuer pour qui « il n’y a plus de place en ce monde pour la bêtise », véritable leitmotiv du roman —, de Justine — femme (à poigne) de l’inventeur d’un éventuel antivirus révolutionnaire —, et de Khaleel — homme génétiquement modifié qui traite les informations phéromoniques et fournit ses synthèses sous forme de sueur, avant de se découvrir un effrayant don de prescience… Dans ce futur proche en effet, les technologies informatiques ont été anéanties par un mégavirus militaire, le « Chromozone », qui a contraint les consortiums et multinationales à développer un nouveau mode de communication et de stockage de l’information : les phéromones… La catastrophe a eu une autre grave conséquence : les nations ont éclaté en communautés, en territoires ethniques ou tribaux — Beauverger n’est cependant jamais caricatural —, abandonnant l’ordre public et la justice à des milices privées — c’est la loi de la jungle urbaine ; dans Chromozone, seuls les plus forts et les plus malins survivent, souvent au détriment des autres.
Chromozone est un récit choral, à l’anglo-saxonne, qui nous fait suivre en alternance et à la troisième personne les aventures de Gemini — jeune prisonnier d’un camp de réfugiés dominé par les violents Keltics —, de Teitomo — flic pur et dur qui travaille pour le plus offrant dans les « zones de couleur » communautaires de Marseille —, d’Ogre — machine à tuer pour qui « il n’y a plus de place en ce monde pour la bêtise », véritable leitmotiv du roman —, de Justine — femme (à poigne) de l’inventeur d’un éventuel antivirus révolutionnaire —, et de Khaleel — homme génétiquement modifié qui traite les informations phéromoniques et fournit ses synthèses sous forme de sueur, avant de se découvrir un effrayant don de prescience… Dans ce futur proche en effet, les technologies informatiques ont été anéanties par un mégavirus militaire, le « Chromozone », qui a contraint les consortiums et multinationales à développer un nouveau mode de communication et de stockage de l’information : les phéromones… La catastrophe a eu une autre grave conséquence : les nations ont éclaté en communautés, en territoires ethniques ou tribaux — Beauverger n’est cependant jamais caricatural —, abandonnant l’ordre public et la justice à des milices privées — c’est la loi de la jungle urbaine ; dans Chromozone, seuls les plus forts et les plus malins survivent, souvent au détriment des autres.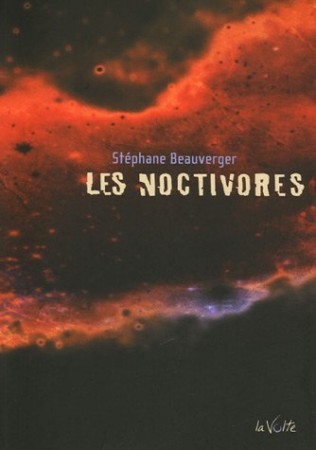 La narration des Noctivores, suite directe du précédent, est plus linéaire. Huit ans après les massacres de Marseille, une version mutante du virus Chromozone qui exacerbe la violence de ses hôtes divise le territoire entre « zombies » contaminés et éléments « sains ». Deux génies se disputent alors le pouvoir : Khaleel, le prophète doué de prescience reclus dans son bunker, a développé un contre-virus technologique aux effets insidieux tandis que Peter Lerner, inexpugnable démiurge à l’origine de la pandémie, phagocyte littéralement l’humanité avec ses hordes de Noctivores. Cendre, jeune Sauveur des Soubiriens Révélés doué d’un terrifiant pouvoir ― par la prière, il foudroie les porteurs du virus ― et jeté au cœur du maelström, devient l’enjeu de ces deux grands manipulateurs. Mais quand les renégats d’Ouessant et les bombardiers Chamans s’en mêlent, le chaos menace de détruire cet ordre précaire. Comme l’assènent sans arrêt les sbires post-humains de Peter Lerner, « il est peut-être temps d’en finir avec la violence »…
La narration des Noctivores, suite directe du précédent, est plus linéaire. Huit ans après les massacres de Marseille, une version mutante du virus Chromozone qui exacerbe la violence de ses hôtes divise le territoire entre « zombies » contaminés et éléments « sains ». Deux génies se disputent alors le pouvoir : Khaleel, le prophète doué de prescience reclus dans son bunker, a développé un contre-virus technologique aux effets insidieux tandis que Peter Lerner, inexpugnable démiurge à l’origine de la pandémie, phagocyte littéralement l’humanité avec ses hordes de Noctivores. Cendre, jeune Sauveur des Soubiriens Révélés doué d’un terrifiant pouvoir ― par la prière, il foudroie les porteurs du virus ― et jeté au cœur du maelström, devient l’enjeu de ces deux grands manipulateurs. Mais quand les renégats d’Ouessant et les bombardiers Chamans s’en mêlent, le chaos menace de détruire cet ordre précaire. Comme l’assènent sans arrêt les sbires post-humains de Peter Lerner, « il est peut-être temps d’en finir avec la violence »…
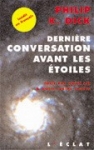 Cette « présence » aurait fait revivre à l’auteur, en une série de flashs-back psychiques, les premiers temps chrétiens. Or le mystérieux Métatron du Zohar et du Livre d’Enoch, s’il est absent de L’Ancien Testament comme du Nouveau, est parfois considéré comme l’autre nom de YHVH… Notons qu’au fil des entretiens Dick se contredit de plus en plus, au point que ses apparitions, dont il finit par nier le caractère strictement angélique pour en faire d’hideuses mais édéniques créatures d’un monde lointain dont nos mystiques auraient un aperçu – et qui ne serait autre que l’au-delà des religions terriennes –, ne nous apparaissent de manière évidente (et émouvante) que comme le délirant tohu-bohu d’une imagination hors du commun dopée au Penthotal et au whiskey
Cette « présence » aurait fait revivre à l’auteur, en une série de flashs-back psychiques, les premiers temps chrétiens. Or le mystérieux Métatron du Zohar et du Livre d’Enoch, s’il est absent de L’Ancien Testament comme du Nouveau, est parfois considéré comme l’autre nom de YHVH… Notons qu’au fil des entretiens Dick se contredit de plus en plus, au point que ses apparitions, dont il finit par nier le caractère strictement angélique pour en faire d’hideuses mais édéniques créatures d’un monde lointain dont nos mystiques auraient un aperçu – et qui ne serait autre que l’au-delà des religions terriennes –, ne nous apparaissent de manière évidente (et émouvante) que comme le délirant tohu-bohu d’une imagination hors du commun dopée au Penthotal et au whiskey Dans
Dans