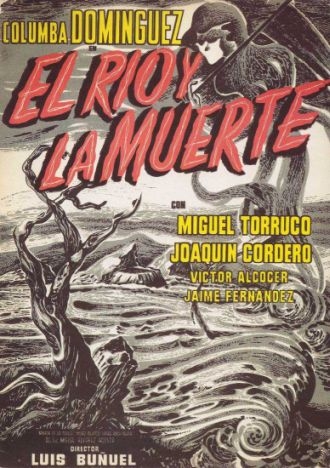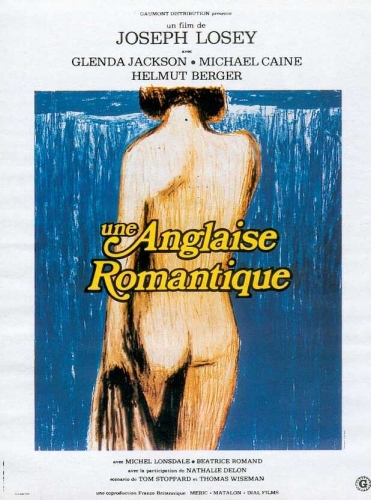Je réagis ici à la chronique du Jardin schizologique par Stéphane Gourjault (le même Gourjault qui qualifiait La Horde du contrevent, le magnifique livre d'Alain Damasio, de roman « moyen », « trop long », « trop complexe », « pas intéressant », « pas forcément à découvrir », « assez peu aisé à lire », avec des « tournures de phrases complexes » qui ne « servent pas le récit » et sont même « superflues », et j'en passe !), sur le site ActuSF. Si je souhaite laisser à notre ami la responsabilité de son jugement esthétique – quoique, ici les questions esthétiques en rejoignent d'autres, et quoiqu'il y aurait beaucoup à dire sur la pauvreté affligeante de la critique SF –, quelques reproches adressés au livre exigent quelque éclaircissement. Parce que, tout de même, faut pas pousser Tranzu dans les orties. Trouver nos nouvelles illisibles, soit. Il n'est pas le premier. Mais le faire en se prenant autant au sérieux, c'est un peu fort de café.
D'abord, j'aurais manqué de « déontologie », en tant qu'anthologiste au sommaire de l'ouvrage que j'ai dirigé. Allons donc ! Ainsi que je l'ai déjà expliqué dans une interview accordée... au site ActuSF (!), dont Stéphane Gourjault ne peut pas ne pas avoir eu connaissance, les choses sont très claires : aucune nouvelle n'a été écartée au profit de False Reversion. Nous avons retenu tous les textes que nous jugions dignes de figurer au sommaire, et rejeté tous les autres. J'ai déjà écrit tout cela en interview, et nous assumons entièrement nos choix. Si Stéphane veut des détails, qu'il lise l'interview. N'y revenons plus, je vous prie.
Ensuite, le livre est accusé de donner une image « caricaturale » des schizophrènes, « celle de gens vraiment dérangés, qu’il faudrait peut-être enfermer, tous, sans distinction, tant ils agissent de manières particulièrement folles, voire meurtrières, en oubliant d’évoquer qu’on peut la guérir autrement qu’à l’aide de cellules capitonnées et de traitements chimiques lourds »... Ah. Nous n'avons pas dû lire les mêmes textes. Stéphane Gourjault voit des personnages fous à lier et à enfermer, je ne vois que la souffrance d'êtres désocialisés, et en quête éperdue d'unité. Mais passons. La subjectivité, tout ça. Quant à ce que nous aurions oublié d'évoquer... Ce cher Stéphane aurait dû mieux se renseigner (au fait, écrire n'importe quoi, est-ce déontologique ?). La schizophrénie, on ne la guérit pas vraiment. Certains cas parviennent à une évolution positive sans déficit (après au moins dix ans de traitement neuroleptique), mais l'évolution peut aussi mener à l'affaiblissement d'esprit, ou à la démence. On ne la guérit pas, donc, on la traite. Avec une médication lourde – principalement des antipsychotiques, et ce, pour une raison très simple : selon les hypothèses les plus communément admises, l'origine de la maladie serait neurobiologique (la principale hypothèse incrimine le système de neuromodulation dopaminergique, comme le rappellent les passages barbares de False Reversion). Ceci n'est pas une caricature, ou un fantasme, mais une dramatique réalité (ça y est, je pontifie !). Les psychothérapies individuelles, familiales ou sociales jouent un rôle essentiel aujourd'hui, mais seulement en complément du traitement pharmacologique. D'ailleurs, peu importe, puisqu'aucune des treize nouvelles ne prétend donner un aperçu, même infime, d'une thérapie, quelle qu'elle soit. Nos personnages agissent parfois comme des déments ? Certains sont même – en apparence du moins – des meurtriers ? Quelques uns se suicident ? Et alors ?!? Nous parlons de littérature, ou bien ?...
À l'évidence, le problème du billet d'opinion de Stéphane Gourjault n'est pas là. Interpréter n'est pas délirer. Il n'a tout simplement jamais été question d'écrire sur la schizophrénie, avec un cahier des charges (pouah !) représentatif des symptômes, des prises en charge ou des traitements. La littérature clinique est déjà suffisante (si Stéphane le souhaite, je peux lui fournir une bibliographie abondante...). Si soit dit en passant, j'avais malgré tout voulu réunir des textes sur le sujet, j'aurais dû exclure d'emblée plusieurs des nouvelles au sommaire : Sextuor pour solo de Francis Berthelot se situe du côté des troubles dissociatifs de l'identité, Née du givre de Mélanie Fazi est une variation sur le double, M.I.T. de Philippe Curval évolue entre transmigration des âmes et personnalités multiples, le narrateur d'Effondrement des colonies souffre à mon avis d'une forme particulière d'autisme, Connect I Cut s'intéresse explicitement – il cite ses sources, à savoir le cas Joey de La Forteresse vide de Bruno Bettelheim – à l'autisme infantile, etc. Non, vraiment, c'est grotesque.
 Bref, rien ne laissait penser – je n'ai commis aucune préface lénifiante, et le texte de quatrième de couverture parle non pas de nouvelles sur la schizophrénie, mais bien de nouvelles schizophréniques – à un pensum didactique, ou même à de simples prétentions pédagogiques. Il n'a jamais été question de délivrer le moindre « message », cette stupide tarte à la crème de la critique du dimanche. Encore moins de prodiguer au lecteur Gourjault un « apprentissage de lecture » (sic) ou un « élargissement de sa vision de la littérature » (sic) ! Quelle étrange idée. Il s'agissait seulement, et avant tout, de restituer, par des procédés esthétiques, une certaine expérience. Déambuler avec les schizos, dans leur jardin, joindre notre regard au leur, pour reprendre une belle image employée tout à l'heure par un volté. Abandonner la distance clinique. Voir avec eux, et non les voir, eux. « Le lecteur a plutôt l’impression d’avoir été placé sur le seuil d’un univers flou et lointain qu’il n’a pas envie de franchir. » écrit Stéphane Gourjault. Sans le savoir, notre top critique a touché du doigt l'essence même de cette anthologie. Ne s'est-il donc pas interrogé sur le sens du titre du livre, et sur celui de la phrase de Francis Berthelot citée en couverture ?... Le Jardin schizologique est une « invitation au passage », selon les mots du mystérieux volté. Un passage en effet, celui d'une rive – celle où évoluent les bien portants – à l'autre – celle, floue et lointaine (du moins tant qu'on se tient à distance), des schizos. Refuser ce geste, se détourner de leur univers parce qu'il est trop hermétique, et se contenter d'attendre qu'ils s'invitent dans le vôtre, bien consensuel, c'est, à jamais, et sciemment, rester un étranger.
Bref, rien ne laissait penser – je n'ai commis aucune préface lénifiante, et le texte de quatrième de couverture parle non pas de nouvelles sur la schizophrénie, mais bien de nouvelles schizophréniques – à un pensum didactique, ou même à de simples prétentions pédagogiques. Il n'a jamais été question de délivrer le moindre « message », cette stupide tarte à la crème de la critique du dimanche. Encore moins de prodiguer au lecteur Gourjault un « apprentissage de lecture » (sic) ou un « élargissement de sa vision de la littérature » (sic) ! Quelle étrange idée. Il s'agissait seulement, et avant tout, de restituer, par des procédés esthétiques, une certaine expérience. Déambuler avec les schizos, dans leur jardin, joindre notre regard au leur, pour reprendre une belle image employée tout à l'heure par un volté. Abandonner la distance clinique. Voir avec eux, et non les voir, eux. « Le lecteur a plutôt l’impression d’avoir été placé sur le seuil d’un univers flou et lointain qu’il n’a pas envie de franchir. » écrit Stéphane Gourjault. Sans le savoir, notre top critique a touché du doigt l'essence même de cette anthologie. Ne s'est-il donc pas interrogé sur le sens du titre du livre, et sur celui de la phrase de Francis Berthelot citée en couverture ?... Le Jardin schizologique est une « invitation au passage », selon les mots du mystérieux volté. Un passage en effet, celui d'une rive – celle où évoluent les bien portants – à l'autre – celle, floue et lointaine (du moins tant qu'on se tient à distance), des schizos. Refuser ce geste, se détourner de leur univers parce qu'il est trop hermétique, et se contenter d'attendre qu'ils s'invitent dans le vôtre, bien consensuel, c'est, à jamais, et sciemment, rester un étranger.
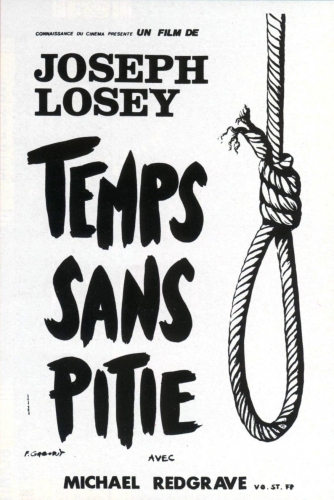




 Bref, rien ne laissait penser – je n'ai commis aucune préface lénifiante, et le texte de quatrième de couverture parle non pas de nouvelles sur la schizophrénie, mais bien de nouvelles schizophréniques – à un pensum didactique, ou même à de simples prétentions pédagogiques. Il n'a jamais été question de délivrer le moindre « message », cette stupide tarte à la crème de la critique du dimanche. Encore moins de prodiguer au lecteur Gourjault un « apprentissage de lecture » (sic) ou un « élargissement de sa vision de la littérature » (sic) ! Quelle étrange idée. Il s'agissait seulement, et avant tout, de restituer, par des procédés esthétiques, une certaine expérience. Déambuler avec les schizos, dans
Bref, rien ne laissait penser – je n'ai commis aucune préface lénifiante, et le texte de quatrième de couverture parle non pas de nouvelles sur la schizophrénie, mais bien de nouvelles schizophréniques – à un pensum didactique, ou même à de simples prétentions pédagogiques. Il n'a jamais été question de délivrer le moindre « message », cette stupide tarte à la crème de la critique du dimanche. Encore moins de prodiguer au lecteur Gourjault un « apprentissage de lecture » (sic) ou un « élargissement de sa vision de la littérature » (sic) ! Quelle étrange idée. Il s'agissait seulement, et avant tout, de restituer, par des procédés esthétiques, une certaine expérience. Déambuler avec les schizos, dans