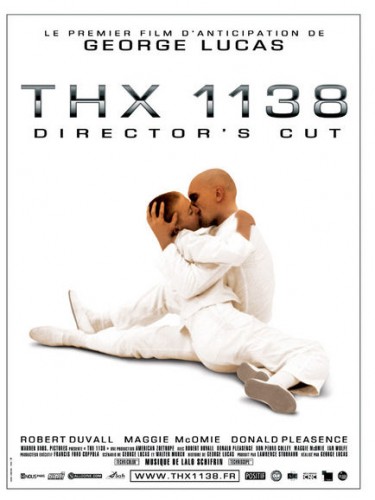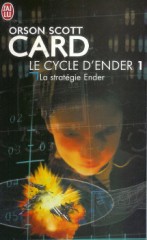Photographie : Olivier Noël
Atrocity Exhibition. Bourdonnement électrique du drone postindustriel. Cette exposition unique - à laquelle les officiels eux-mêmes n'étaient pas conviés - offrait une caractéristique assez inquiétante : l'omniprésence, dans les œuvres présentées, des thèmes apocalyptiques. Les installations, entre lesquelles évoluait Thomas Becker, lui évoquaient les jardins de Locus Solus aussi bien que son propre réel, comme s'il avait d'ores et déjà, depuis toujours semblait-il, parfaitement assimilé leur potentiel psychopathologique - comme s'il en avait perçu le singulier pouvoir d'enchâssement. Les nappes hypnotiques du drone, soufflées par les nombreuses enceintes du Centre, se synchronisaient à ses influx nerveux. À l'approche de la quatrième salle, elles s'estompaient progressivement pour laisser place à un tintement édénique, aux limites de la perception.
Crystal World. Soleil prismatique traversant le visiteur. Thomas Becker pénétra dans une grotte hérissée de cristaux efflorescents, au milieu desquels l'attendait une alvéole, et dans cette alvéole, un siège vitrifié aux mille reflets, sur lequel, second, il se lova. Oubliée, sa berline ; effacés de sa mémoire, les grandes surfaces ; remisée dans la banlieue de son esprit, l'exposition - ces zones grises de la pénombre. Bien qu'intégralement vêtu de noir dans sa matrice de cristal, pantalon tee-shirt chaussures imperméable, Thomas irradiait de l'intérieur, transparent soudain, minéralisé dans ses rêves de paix éternelle ; frappé par l'immortalité du temps asymptotique qui pétrifiait la forêt de cristal, il se remémorait ses amours passées, dont l'image se diffractait à l'infini. Se figer dans un tableau de Max Ernst.
Crash test. Des bruits distordus de combustion, de chocs brutaux et de tôles froissées arrachèrent Thomas à son immortalisation. À contrecœur, mais irrésistiblement attiré par cette symphonie d'Armageddon routier, Thomas Becker abandonna sa niche d'éternité. Guidé par la bande-son d'auto-désastres, il s'engagea d'un pas mesuré dans une longue galerie tubulaire sur la surface numérique de laquelle était projeté le film, fragmentaire et répétitif, d'accidents automobiles au ralenti. Fracas fantomatiques. À l'entrée, un sobre panneau, blanc sur noir : « AUTOMOBILE - Les millions de voitures de cette planète sont stationnaires, et leur mouvement apparent constitue le plus grandiose rêve collectif de l'humanité ». Projet de Glossaire du XXe siècle. Les déformations du corps de Thomas, percuté par les pare-chocs des coupés qui le traversaient en rafales de part en part, ressortaient-elles du rêve, elles aussi ? Immobile à contre-monde, il pensait à un autre texte de Ballard : « ce que nos enfants doivent craindre, ce ne sont pas les voitures lancées sur les autoroutes de demain mais le plaisir que nous trouvons nous-mêmes à calculer les plus élégants paramètres de leur mort ». Dans son bas-ventre, les trémulations annonciatrices de nouvelles salves.
Corpses. Troublé par sa réaction aux stimuli visuels et sonores, Thomas Becker quitta précipitamment l'exposition, sans égard pour les autres visiteurs, ni pour le gardien qu'il bouscula au passage. Les portes automatiques s'ouvrirent enfin sur la nuit précoce d'une soirée d'hiver. Il fit quelques pas dans l'air glacé, alluma une cigarette et se mit à observer son environnement. L'architecture déjà démodée du Centre s'insérait sans heurt dans le morne paysage de la zone industrielle et de ses enseignes aux lueurs criardes. En face, au-dessus des portes coulissantes d'un motel, de l'autre côté de la voie rapide où filaient la faune suburbaine et les représentants de commerce changés en traînées lumineuses, blanches à l'arrivée, rouges au départ : un large écran LCD. Thomas profita d'une pause inexplicable dans le trafic pour traverser en courant les voies et le remblai. Ses pas crissaient sur le gravier, et tandis que fluaient à nouveau les mouvantes constellations des phares, Thomas s'approcha de l'écran plat. D'abord, il n'y vit que la retransmission du trafic, sans doute filmé par une caméra dissimulée dans quelque élément de signalisation, en direct aurait-on dit, ou en léger différé, comme le suggérait le décalage étrange des vrombissements derrière son dos. Mais bientôt, les voitures à l'écran se mirent à se comporter bizarrement, à zigzaguer, à accélérer ou à piler sans raison apparente, Jusqu'au crash silencieux des collisions en chaîne. À l'écran : pare-brise étoilés ou explosés ; habitacles écrasés ; roues orphelines. Le sang, les os, les corps, restaient encore invisibles. Hébété, Thomas Becker se retourna vers la voie express : rien d'anormal. Retour à l'écran : une silhouette sur le bord de la route. Vêtement sombres, imperméable noir, cigarette à la main. L'homme vidéo regarda à sa gauche, puis à sa droite, et s'engagea sans hésiter.
Dans un spasme, alors que l'enfer se déchaînait soudain dans ses tympans, Thomas Becker assista à sa propre dislocation.
(Texte rédigé à l'occasion de l'Evento 2009)