
« Il n’y a de réel, il n’y a d’imaginaire qu’à une certaine distance. Qu’en est-il lorsque cette distance, y compris celle entre le réel et l’imaginaire, tend à s’abolir, à se résorber au seul profit du modèle :
― elle est maximale dans l’utopie, où se dessine une sphère transcendante, un univers radicalement différent […]
― elle se réduit de façon considérable dans la science-fiction : celle-ci n’est le plus souvent qu’une projection démesurée, mais non qualitativement différente, du monde réel et de la production. […]
― elle se résorbe totalement à l’ère implosive des modèles. Les modèles ne constituent plus une transcendance ou une projection, ils ne constituent plus un imaginaire par rapport au réel, ils sont eux-mêmes anticipation du réel, et ne laissent donc place à aucune sorte d’anticipation fictionnelle – ils sont immanents, et ne laissent donc place à aucune transcendance imaginaire. Le champ ouvert est celui de la simulation au sens cybernétique, c’est-à-dire celui de la manipulation tous azimuts de ces modèles […] mais alors rien ne distingue cette opération de la gestion et de l’opération même du réel : il n’y a plus de fiction. »
Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation.
« Notre réalité se situe dans un univers de mots, non de choses. D’ailleurs une chose, cela n’existe pas, c’est une Gestalt au sein de l’esprit. […] Le mot est plus réel que l’objet qu’il désigne. »
Philip K. Dick, Le Temps désarticulé.
Le plot de Cosmos Incorporated – plot, comme dans Plotkine – est d’une simplicité enfantine. « S’il est venu ici, c’est pour tuer un homme. » Sergueï Diego Plotkine, le personnage principal, se rend à Grande Jonction pour tuer le Maire de cette ville. Plotkine n’a pas de mémoire, ou plutôt celle-ci paraît se réassembler – quoique de troublante manière – à mesure que le tueur passe les examens ultratechnologiques de la Métastructure de Contrôle. Cette fraction Nord-américaine de l’Occident – l’Europe est désormais islamiste – est régie par les lois de l’UMHU, l’UniMonde Humain dont la devise est « UNIMONDE HUMAIN, UN MONDE POUR TOUS – UN DIEU POUR CHACUN ». Plotkine, pour préparer son forfait, reçoit l’aide d’El Señor Métatron, intelligence artificielle de sécurité extrêmement perfectionnée.
Cette première partie du roman (pp. 11-247) judicieusement intitulée « Input », qui nous plonge dans le dark age du simulacre, l’UMHU, Zéropolis techno-totalitaire de l’ère des modèles, s’articule autour de deux thématiques principales, inextricablement liées : le devenir-Machine du monde d’une part, tel que prophétisé par Günther Anders dans ce livre essentiel qu’est Nous, fils d’Eichmann, et que représente ici la Métastructure de Contrôle ; d’autre part la révélation à Plotkine que cet univers technicien dévolutif n’est peut-être que l’envers du décor, une fiction en dissimulant une autre – Plot-kiné, le point en mouvement, l’Image-Mouvement de la Vérité Révélée.
Dans son court mais excellent essai Zéropolis, Bruce Bégout désigne Las Vegas, non-lieu de l’urbanité moderne, avant-garde de la ville contemporaine, comme l’espace de la « nullité qui fait nombre »[1]. Grande Jonction n’est ainsi que l’anticipation visionnaire de cette utopie consumériste et schizophrène gouvernée par l’immédiateté et « l’impulsivité itérable »[2], et où « les humains sont des extensions prothétiques de l’urbanisme » (Cosmos Inc., p. 140). Ses hôtels à capsules renvoient au Profanateur de Philip K. Dick, sa technologie futuriste est celle des romans cyberpunk de William Gibson qui, dans Identification des schémas, annonçait l’avènement du « monde-miroir ». L’UMHU, l’UniMonde Humain, le Monde Humain Uni, n’est que marques et acronymes, références sans référents, dissolution du langage dans la Machine Relativiste ; il est aussi la démocratie terminale, le système inhumain de termination ― Unimanité/Unanimité/inhumanité. Le médium est le message. La carte devient le territoire.
Cosmos Incorporated rompt avec la poésie acronymique du cyberpunk. Ce mélange de termes anglais, sigles, néologismes et majuscules n’est qu’une manifestation actualisée du Novlangue orwellien tel qu’analysé par Jean-François Lyotard dans Le Postmoderne expliqué aux enfants. L’avalanche majusculaire n’y a d’ailleurs jamais l’impact symbolique que Frank Herbert avait insufflé au récit de Dune : tout, en UMHU, est indéterminé. « Le vocabulaire du Novlangue [écrit George Orwell en appendice de 1984] était construit de telle sorte qu’il pût fournir une expression exacte, et souvent très nuancée, aux idées qu’un membre du Parti pouvait, à juste titre, désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées et même les possibilités d’y arriver par des méthodes indirectes. L’invention des mots nouveaux, l’élimination surtout des mots indésirables, la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu’elle fût, contribuaient à ce résultat. »[3]
Or, pour Lyotard, « […] si l’on fait attention à la généralisation des langages binaires, à l’effacement de la différence entre ici-maintenant et là-bas-alors, qui résulte de l’extension des télérelations, à l’oubli des sentiments au bénéfice des stratégies, concomitant à l’hégémonie du négoce, on trouvera que les menaces qui pèsent du fait de cette situation, la nôtre, sur l’écriture, sur l’amour, sur la singularité sont, dans leur nature profonde, parentes de celles décrites par Orwell. » L’UMHU est donc aussi, bien qu’aucune réelle menace de dictature centralisée ne pèse sur l’unimanité qui le peuple, un monde structurellement totalitaire. Un monde de chiffres, perdu pour l’imaginaire.
« Le prodige tient d’une synthèse dévolutive de toute l’espèce biologique connue sous le nom d’homo sapiens ; 5 ou 6 millions d’années depuis les primates du Pliocène pour en arriver là, se dit Plotkine, c’est à se demander si la Parabole de la Chute ne se réfère pas à l’instant même où nous sommes descendus de l’arbre. » (Cosmos Inc., p. 69) « La dévolution n’est pas qu’un phénomène technique. D’ailleurs le constat lui-même est absurde. La dévolution est, par définition, anthropologique parce que la technique, c’est le moment de division infinie de l’anthropogenèse. » (Cosmos Inc., p. 284) Précisément le Progrès, naïvement défini par Bacon comme la somme cumulative et positive des connaissances, génère toujours plus de complexité – c’est l’entropie. De ce Second principe de thermodynamique, George Orwell a d’ailleurs bâti son 1984 : le Progrès, pour lui, crée les conditions de son propre ralentissement, jusqu’à l’inversion irréversible du processus. Sur la Parabole de la Chute, Dantec a sans doute vu juste. Pour Lewis Mumford, le langage n’était autre que la première des technologies. Le langage, qui permet l’émergence hors de l’univers indéterminé de la schizophrénie, est volonté de puissance. Aporie du constat : le Verbe du commencement est aussi celui de la fin (« L’idéal, c’est clair, sera atteint lorsque rien n’arrivera plus. »[4]).
L’UMHU est la figure soft du Camp de Concentration (Plotkine, « l’Homme-venu-du-Camp », nouvelle version de la servitude volontaire de l’État unique de Nous autres d’ugène Zamiatine, de l’emprise du Big Brother de 1984 ou du Panoptique selon Michel Foucault dans Surveiller et punir. Soft, comme chez Burroughs, parce qu’il ne s’agit pas tant d’un État policier que d’un asservissement de l’humain par la Machine-Monde. L’individu, devenu pièce de la Machine, est incapable de se représenter l’ensemble de la Monade urbaine[5] – et pour cause, puisque dans Cosmos Incorporated, il n’y a plus rien à se représenter. C’est ce que Günther Anders appelle un « processus de co-machinisation ». La machine devient monde – le monde devient machine. L’UMHU consacre l’avènement du « royaume millénariste du totalitarisme technique »[6], c’est-à-dire le Camp d’extermination de l’humanité, le Successeur totalement inhumain prophétisé par Jean-Michel Truong.
L’individu se meut dans le bonheur non pas programmé mais circonscrit de la société du spectacle. Weltanschauung comme fait hallucinatoire total. « Dans une société où personne ne peut plus être reconnu par les autres, chaque individu devient incapable de reconnaître sa propre réalité. L’idéologie est chez elle ; la séparation a bâti son monde »[7]. Plotkine est schizophrène à double titre, d’abord en raison de sa mémoire fragmentaire et paradoxale, ensuite parce que dans l’univers régressif narcissique de l’UMHU, le moi est écrasé par la « présence-absence »[8] de la Machine-monde. Les rapports du signifiant et du sens sont altérés.
L’anomalie du fonctionnement symbolique de l’esclave volontaire de l’UMHU, cependant, serait à l’origine du défaut de langage. Pour le schizophrène la croyance délirante possède le caractère réel de l’évidence subjective ; la substitution du signifiant au signifié est impossible. Le mot, selon Lacan, est « le meurtre de la chose ». Seul, Plotkine n’aurait donc jamais pu échapper à l’emprise de la Machine. Il était dès lors logique que son salut vînt de l’extérieur – d’El Señor Métatron. La Métastructure de Contrôle ne serait-elle donc que l'envers luciférien du Royaume de Dieu ?
« La quotidienneté même de l’habitat terrestre élevé au rang de valeur cosmique, hypostasié dans l’espace – la satellisation du réel dans la transcendance de l’espace – c’est la fin de la métaphysique, c’est la fin du phantasme, c’est la fin de la science-fiction, c’est l’ère de l’hyperréalité qui commence. »
Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation.
A venir : Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec (The Novel That Exploded – 3 – Trou Noir).
[1] B. Bégout, Zéropolis (Allia, 2002), p. 15
[2] Ibid., p. 109.
[3] G. Orwell, 1984 (Gallimard, Folio, 2002), p. 422.
[4] E. Zamiatine, Nous autres (Gallimard, L’Imaginaire, 1971) p. 36.
[6] G. Anders, Nous, fils d’Eichmann (Rivages, Bibliothèque, 1999), p. 85.
[7] G. Debord, La Société du spectacle (Gallimard, Folio, 1992), p. 207.
[8] Ibid., p. 208.






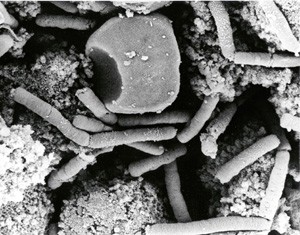




 Comment justifier cette scène, et cet acte terrible – dont la conséquence picturale,également motif de l'affiche officielle, rappelle à la fois la pochette de l'album mythique du groupe d'Alan Vega, Suicide et la fresque sanglante projetée par un bras tranché, sur un mur vierge, dans Ténèbres de Dario Argento ? Même si nous écartons, preuve vidéo à l'appui, la pure et simple négation des faits, nous sommes en mesure d’apporter un début d’explication. En premier lieu, Majid paraît pauvre, désabusé, dépressif. En second lieu, si lors de leur confrontation Majid semblait inquiétant, sarcastique, vraisemblablement coupable, la scène revue par l’image vidéo ne nous montre qu’un Georges/Auteuil menaçant, presque hystérique, face à un Majid amical et effondré… Sans doute n’en fallait-il pas plus pour décider cet homme brisé à franchir la dernière porte… Car en fin de compte, avouons que nous ne savons fichtre pas qui, de Majid ou de son fils, de Georges lui-même ou de Pierrot, de Pierre ou de la femme de Georges – sur qui pèse un soupçon d'adultère – a enregistré ces cassettes VHS. Peut-être même pourrions-nous, si le film était clos, identifier plusieurs « coupables », comme dans les gialli de Mario Bava et Daro Argento (Ténèbres, encore)...
Comment justifier cette scène, et cet acte terrible – dont la conséquence picturale,également motif de l'affiche officielle, rappelle à la fois la pochette de l'album mythique du groupe d'Alan Vega, Suicide et la fresque sanglante projetée par un bras tranché, sur un mur vierge, dans Ténèbres de Dario Argento ? Même si nous écartons, preuve vidéo à l'appui, la pure et simple négation des faits, nous sommes en mesure d’apporter un début d’explication. En premier lieu, Majid paraît pauvre, désabusé, dépressif. En second lieu, si lors de leur confrontation Majid semblait inquiétant, sarcastique, vraisemblablement coupable, la scène revue par l’image vidéo ne nous montre qu’un Georges/Auteuil menaçant, presque hystérique, face à un Majid amical et effondré… Sans doute n’en fallait-il pas plus pour décider cet homme brisé à franchir la dernière porte… Car en fin de compte, avouons que nous ne savons fichtre pas qui, de Majid ou de son fils, de Georges lui-même ou de Pierrot, de Pierre ou de la femme de Georges – sur qui pèse un soupçon d'adultère – a enregistré ces cassettes VHS. Peut-être même pourrions-nous, si le film était clos, identifier plusieurs « coupables », comme dans les gialli de Mario Bava et Daro Argento (Ténèbres, encore)...