« Tout est connecté à la fin. »
D. DeLillo, Outremonde.
 Les insuffisances du dernier roman de William Gibson, présenté comme le grand œuvre post-cyberpunk, annoncé en grandes pompes par son éditeur Au Diable Vauvert, ont semble-t-il été escamotées par l’œil soudain complaisant d’une Critique spécialisée en mal de figures de proue – comme Dick, comme Ballard, Gibson devient à son tour une référence très in, le nouveau symbole du politiquement incorrect et de la subversion générique alors qu’il n’en est, au mieux, qu’une clé d’accès parmi d’autres. Identification des schémas (Pattern recognition) se lit certes sans déplaisir et fait même preuve d’une intelligence de vue, d’une lucidité pas si fréquentes dans la littérature contemporaine ; il n’en souffre pas moins de contradictions gênantes.
Les insuffisances du dernier roman de William Gibson, présenté comme le grand œuvre post-cyberpunk, annoncé en grandes pompes par son éditeur Au Diable Vauvert, ont semble-t-il été escamotées par l’œil soudain complaisant d’une Critique spécialisée en mal de figures de proue – comme Dick, comme Ballard, Gibson devient à son tour une référence très in, le nouveau symbole du politiquement incorrect et de la subversion générique alors qu’il n’en est, au mieux, qu’une clé d’accès parmi d’autres. Identification des schémas (Pattern recognition) se lit certes sans déplaisir et fait même preuve d’une intelligence de vue, d’une lucidité pas si fréquentes dans la littérature contemporaine ; il n’en souffre pas moins de contradictions gênantes.
Comme vous le savez sans doute, William Gibson (à ne surtout pas confondre avec l’autre Gibson, Mel…) est surtout connu pour Neuromancien, œuvre fondatrice du mouvement cyberpunk parue en 1984. Depuis, il continue d’explorer les conséquences, néfastes ou lumineuses, de la révolution informatique – jusqu’à ses implications sur la création littéraire et artistique. Ses récits sont des romans noirs hi-tech où la technologie la plus pointue côtoie la pauvreté des intouchables – l’occasion pour l’auteur d’évoquer la corrélation inévitable entre ces deux aspects du monde moderne. Dans Neuromancien, l’environnement technologique des Hackers et du cyberspace, alors très novateur – et tout aussi dépaysant que n’importe quelle planète imaginaire – primait sur l’intrigue stricto sensu, ou le style, en vérité assez quelconques. Avec les romans suivants, la forme s’épure, en même temps que l’avant-gardisme s’amenuise : les textes de Gibson s’apparentent à des séries B de plus ou moins bonne facture, qu’on peut trouver pleines de suspense, charmantes (Lumière virtuelle et son héroïne Chevette) ou un peu outrées (Idoru), voire carrément indigestes (Tomorrow’s parties), même si Gibson réussit toujours à nous enchaîner le temps d’un chapitre, ou grâce à une idée directrice originale : Laney par exemple, le personnage de Tomorrow’s parties, était capable, en s’immergeant dans les réseaux, de localiser avec précision les « points nodaux » de l’information (de « reconnaître les schémas », déjà), ce qui lui permettait de prévoir, sinon d’influencer, le cours de certains événements – l’Histoire étant comprise comme un grand livre déterministe dont les possibles seraient déjà écrits… Il existe bien une idée de ce type dans Identification des schémas, suffisamment alléchante pour susciter ma curiosité de lecteur de science-fiction, mais le titre qui s’y réfère se révèle plutôt trompeur – j’y reviendrai –, et l’idée en question, trop vague, perd rapidement tout son sel – elle joue en quelque sorte le rôle de McGuffin, prétexte sans valeur intrinsèque d’une intrigue un peu paresseuse.
Nous y suivons les pérégrinations de Casey Pollard, l’as du design publicitaire et « chasseuse de cool » free lance (en clair : elle débusque les formes et les tendances pour les créateurs de publicités) chargée par Hubertus Bigend, businessman aussi ambigu que séduisant, d’enquêter sur un mystérieux « Film », œuvre d’origine inconnue, diffusée anonymement sous forme de fragments épars sur le Web – et qui intéresse Bigend pour son formidable potentiel marketing. Qui est l’auteur de ce film magnifique qui déchaîne les passions d’une communauté de fans, et qui évoque à ses exégètes – dont Casey fait partie – le cinéma d’Andrei Tarkovski ? Le Film est-il déjà achevé, et dévoilé fragment par fragment à dessein, ou bien assiste-t-on à un work in progress d’un nouveau genre, happening anonyme pour cinéphiles maniaques ? Casey Pollard souffre par ailleurs d’une curieuse phobie, qu’on pourrait nommer le syndrome « no logo » : elle ne supporte pas la vue des logos des grandes marques – l’un d’entre eux, le bibendum Michelin, lui cause même d’indicibles malaises (!). Pour une championne du logo, voilà qui ne laisse pas d’étonner…
L’environnement technologique, plus encore que dans Neuromancien, est donc essentiel : celui qui maîtrise le langage le plus contemporain – lexique informatique, pratiques de communication – pourra seul appréhender pleinement un récit où l’héroïne passe le plus clair de son temps sur son ordinateur portable à arpenter les forums de l’Internet. C’est ainsi dans le réel le plus moderne que voudrait s’inscrire le roman, alors qu’il ne fait en réalité que l’affleurer. Le concept de « monde-miroir », partout repris en chœur (comme un slogan publicitaire, justement) renforce cette impression : du Réel, Gibson n’a retenu que la désincarnation, le squelette de silice, un indice d’impact cognitif – c’est d’ailleurs dans ce renversement des valeurs que réside l’intérêt principal du roman : c’est avec la Toile et sa virtualité aux possibilités infinies que Casey s’évade de la terne réalité d’un monde-miroir frappé du sceau du consumérisme effréné. Attitude logique, il faut le noter, de la part de cet acteur majeur du cyberpunk : elle sous-entend en effet que le Réel doit s’effacer devant le miracle de l’univers numérique, nouveau domaine de l’inconnu. Selon Gibson le désenchantement du monde s’accompagne – mais il a tort – d’un enchantement de l’infosphère…
D’autres territoires, tangibles ceux-là, seront foulés par une Casey de plus en plus déphasée, puisque son enquête la mènera jusqu’au Japon des otakus – où, comme dans les films de Shinya Tsukamoto (réalisateur cyberpunk, auteur entre autres de Tetsuo et de Tokyo Fist), on passe en l’espace de deux rues de l’univers aseptisé des sararymen au quotidien sordide des laissés pour compte – et dans la Russie gagnée par la fièvre capitaliste. Identification des schémas, ou le roman de la mondialisation ? En quelque sorte. Comme Transparences, le thriller d’Ayerdhal également publié au Diable Vauvert et pareillement accueilli avec un enthousiasme immérité, Identification des schémas prétend donner une vision critique et panoptique du Marché où tout peut s’acheter et se vendre, un monde où les différences entre nations s’effacent au profit d’un processus d’uniformisation générale. Le sentiment produit par ces deux romans est celui d’une profonde déprime, autant due à la forme qu’ils empruntent qu’à leur triste constat d’impuissance : Transparences diluait son intrigue dans d’inutiles longueurs psychologiques et s’empêtrait dans d’inextricables écheveaux d’agents doubles, d’espionnage et de contre-espionnage – dommage, car la première page (Ann X nageant dans les courants d’une foule anonyme) était sans doute ce que l’auteur, piètre styliste, avait écrit de plus beau jusqu’ici, et promettait mieux que cette enquête multinationale – ; Identification des schémas, moins verbeux que Transparences, exploite une idée excellente – ce mystérieux Film, qui évoque un temps La maison des feuilles de Mark Z. Danielewski – avant de se disperser peu à peu dans une intrigue à la fois foisonnante et étrangement superficielle, déceptive, aussi plate que le monde-miroir qu’elle stigmatise pourtant avec conviction. D’une certaine manière, Transparences comme Identification des schémas sont le reflet le plus évident de ce monde qu’ils réprouvent, où les aspérités sont gommées, où les protubérances sont aplanies, où la subversion même s’avère rigoureusement inefficace – sinon par l’acte terroriste, comme paraît d’ailleurs le suggérer Gibson avec son évocation du onze septembre 2001 – que certains trouveront pudique, d’autres artificielle. L’analogie entre les deux romans s’arrête là cependant : contrairement à Transparences, qui développait les théories du complot chères à son auteur – et qui me laissent indifférent –, Identification des schémas se veut le reflet d’un monde complexe, moins tentaculaire que neuronal, moins politique que systémique.
Le style de Gibson, plus précis qu’autrefois, plus audacieux peut-être avec de timides tentatives minimalistes, peine cependant à trouver son relief ; l’auteur ne parvient pas à donner vie à son personnage-miroir (ou personnage-fantôme, comme le père de Casey, disparu dans les attentats du World Trade Center) dont l’errance – l’égarement – s’avère aussi bien littéraire que littérale. Car en fait d’identification des schémas, nous assistons plutôt à leur dissolution ; et c’est très précisément la lacune essentielle du roman que de n’offrir aucune échappatoire : Gibson a parfaitement saisi à quel point l’univers cyberpunk fait désormais partie de notre quotidien ; en d’autres termes, le monde réel, vivant, humain, laisse peu à peu sa place à ses icônes (le monde-miroir, encore, un monde déjà mort selon lui), mais à travers cette réflexion sur la représentation du monde comme in-volonté, il échoue à dessiner de nouveaux schémas. Très loin de l’aspect novateur de Neuromancien, qui participait à la naissance d’une mythologie, et contrairement à ce qu’affirme une Critique volontiers complaisante envers les effets d’annonce d’éditeurs habiles – et déjà adeptes du monde-miroir –, l’impact du nouveau roman de William Gibson promet d’être minime : la réalité a rattrapé le mythe et l’a régurgité, démultiplié, en une telle profusion de formes que ce dernier se confond désormais avec le monde : comment un ré-enchantement serait-il alors possible ? Selon une presse spécialisée trop prompte à réagir (réflexes pavloviens ?) aux stimuli bien rôdés des éditeurs et des diffuseurs, Identification des schémas serait à la littérature générale ce que Neuromancien était à la science-fiction, c’est-à-dire une petite révolution en soi, l’ouverture vers une nouvelle génération de romans borderline, ce dont on me permettra de douter sérieusement : s’il fallait chercher un roman-clé parmi les parutions récentes, un roman électrochoc, susceptible de remuer un peu le corps mort-vivant d’une littérature prophylactique, Villa Vortex de Maurice G. Dantec paraîtrait alors plus approprié que les soins palliatifs prodigués sans conviction par William Gibson et consort – une chose est vraie cependant : la science-fiction d’aujourd’hui est à chercher dans ses marges plutôt qu’en son cœur. Il va sans dire qu’idéologiquement, les deux romans sont fort éloignés puisque Identification, roman logocide, peut être lu comme le triste constat d’un échec définitif – l’homme est vaincu par la technique, l’humanité est étrécie à un seuil critique par les communications aériennes et numériques – quand Villa Vortex, roman logocrate, déclare une guerre farouche – fanatique ? – mais perdue d’avance à cette acculturation pourtant prédite de longue date par Georges Bernanos.
L’erreur de la Critique a été, aussi bien pour Transparences d’Ayerdhal que pour cette Identification des schémas, d’accorder a priori des qualités exceptionnelles à des oeuvres qui accomplissent certes honnêtement leur office de divertissements – au sens kierkegaardien : ils vous rapprochent, en suspendant l’écoulement du temps, et presque à votre insu, de l’heure de votre mort… – mais qui souffrent par ailleurs de défauts patents, formels et théoriques. Peut-être la Critique a-t-elle été leurrée par l’irruption de ces deux auteurs, habituellement restreints à un public de science-fiction (en France, quelques milliers de lecteurs seulement), dans les univers du thriller et de la littérature générale. Mais même s’ils s’en tirent avec les honneurs, Gibson et Ayerdhal plafonnent à vingt mille lieues du génie d’un Thomas Pynchon ou d’un Don DeLillo (ou même d’un James Ellroy).
 DeLillo justement, dans son prophétique et monumental Outremonde (Actes Sud, 1999), élaborait un récit choral et diachronique sans autre lien manifeste qu’une simple balle de baseball, tandis que se tissait une trame sous-jacente de plus en plus dense qui éclatait dans l’épilogue : une religieuse du Bronx, à l’heure de sa mort, rejoignait non pas un paradis illusoire mais la connaissance infinie des réseaux. Là où DeLillo réussit à suggérer l’existence de certains schémas – la civilisation s’érige sur ses propres déchets, au point que l’un des personnages, contemplant le chantier des tours du World Trade Center, est pris de malaise en songeant à ces ruines en devenir ! – en même temps que la vanité de prétendre les identifier, Gibson établit un simple état des lieux sans profondeur réelle, sans véritable originalité thématique – Bret Easton Ellis et Chuck Palahniuk, entre autres, écrivent depuis longtemps sur cette société consumériste où la marque fait office de passeport social et où les tours de verre côtoient les pauvres hères. De cette rumeur du monde, amplifiée chez DeLillo, réenchantée chez Pynchon, William Gibson ne restitue qu’un écho aussi froid qu’un miroir. « Le cyberespace est-il une chose à l’intérieur du monde ou bien est-ce le contraire ? Lequel contient l’autre, et comment peut-on en être sûr ? » demande DeLillo à la fin d’Outremonde. Paradoxalement, le concept de monde-miroir réduit cette interrogation à néant, parce qu’il suggère que le cyberespace est déjà plus réel que le monde. Identification des schémas n’est qu’un thriller minimaliste et sans relief, roman-miroir intéressant mais imperméable à tout espoir de transcendance.
DeLillo justement, dans son prophétique et monumental Outremonde (Actes Sud, 1999), élaborait un récit choral et diachronique sans autre lien manifeste qu’une simple balle de baseball, tandis que se tissait une trame sous-jacente de plus en plus dense qui éclatait dans l’épilogue : une religieuse du Bronx, à l’heure de sa mort, rejoignait non pas un paradis illusoire mais la connaissance infinie des réseaux. Là où DeLillo réussit à suggérer l’existence de certains schémas – la civilisation s’érige sur ses propres déchets, au point que l’un des personnages, contemplant le chantier des tours du World Trade Center, est pris de malaise en songeant à ces ruines en devenir ! – en même temps que la vanité de prétendre les identifier, Gibson établit un simple état des lieux sans profondeur réelle, sans véritable originalité thématique – Bret Easton Ellis et Chuck Palahniuk, entre autres, écrivent depuis longtemps sur cette société consumériste où la marque fait office de passeport social et où les tours de verre côtoient les pauvres hères. De cette rumeur du monde, amplifiée chez DeLillo, réenchantée chez Pynchon, William Gibson ne restitue qu’un écho aussi froid qu’un miroir. « Le cyberespace est-il une chose à l’intérieur du monde ou bien est-ce le contraire ? Lequel contient l’autre, et comment peut-on en être sûr ? » demande DeLillo à la fin d’Outremonde. Paradoxalement, le concept de monde-miroir réduit cette interrogation à néant, parce qu’il suggère que le cyberespace est déjà plus réel que le monde. Identification des schémas n’est qu’un thriller minimaliste et sans relief, roman-miroir intéressant mais imperméable à tout espoir de transcendance.
William Gibson – Identification des schémas. Au Diable Vauvert, 2004. Trad. de l’américain par Cédric Perdereau.
D. DeLillo, Outremonde.
 Les insuffisances du dernier roman de William Gibson, présenté comme le grand œuvre post-cyberpunk, annoncé en grandes pompes par son éditeur Au Diable Vauvert, ont semble-t-il été escamotées par l’œil soudain complaisant d’une Critique spécialisée en mal de figures de proue – comme Dick, comme Ballard, Gibson devient à son tour une référence très in, le nouveau symbole du politiquement incorrect et de la subversion générique alors qu’il n’en est, au mieux, qu’une clé d’accès parmi d’autres. Identification des schémas (Pattern recognition) se lit certes sans déplaisir et fait même preuve d’une intelligence de vue, d’une lucidité pas si fréquentes dans la littérature contemporaine ; il n’en souffre pas moins de contradictions gênantes.
Les insuffisances du dernier roman de William Gibson, présenté comme le grand œuvre post-cyberpunk, annoncé en grandes pompes par son éditeur Au Diable Vauvert, ont semble-t-il été escamotées par l’œil soudain complaisant d’une Critique spécialisée en mal de figures de proue – comme Dick, comme Ballard, Gibson devient à son tour une référence très in, le nouveau symbole du politiquement incorrect et de la subversion générique alors qu’il n’en est, au mieux, qu’une clé d’accès parmi d’autres. Identification des schémas (Pattern recognition) se lit certes sans déplaisir et fait même preuve d’une intelligence de vue, d’une lucidité pas si fréquentes dans la littérature contemporaine ; il n’en souffre pas moins de contradictions gênantes.Comme vous le savez sans doute, William Gibson (à ne surtout pas confondre avec l’autre Gibson, Mel…) est surtout connu pour Neuromancien, œuvre fondatrice du mouvement cyberpunk parue en 1984. Depuis, il continue d’explorer les conséquences, néfastes ou lumineuses, de la révolution informatique – jusqu’à ses implications sur la création littéraire et artistique. Ses récits sont des romans noirs hi-tech où la technologie la plus pointue côtoie la pauvreté des intouchables – l’occasion pour l’auteur d’évoquer la corrélation inévitable entre ces deux aspects du monde moderne. Dans Neuromancien, l’environnement technologique des Hackers et du cyberspace, alors très novateur – et tout aussi dépaysant que n’importe quelle planète imaginaire – primait sur l’intrigue stricto sensu, ou le style, en vérité assez quelconques. Avec les romans suivants, la forme s’épure, en même temps que l’avant-gardisme s’amenuise : les textes de Gibson s’apparentent à des séries B de plus ou moins bonne facture, qu’on peut trouver pleines de suspense, charmantes (Lumière virtuelle et son héroïne Chevette) ou un peu outrées (Idoru), voire carrément indigestes (Tomorrow’s parties), même si Gibson réussit toujours à nous enchaîner le temps d’un chapitre, ou grâce à une idée directrice originale : Laney par exemple, le personnage de Tomorrow’s parties, était capable, en s’immergeant dans les réseaux, de localiser avec précision les « points nodaux » de l’information (de « reconnaître les schémas », déjà), ce qui lui permettait de prévoir, sinon d’influencer, le cours de certains événements – l’Histoire étant comprise comme un grand livre déterministe dont les possibles seraient déjà écrits… Il existe bien une idée de ce type dans Identification des schémas, suffisamment alléchante pour susciter ma curiosité de lecteur de science-fiction, mais le titre qui s’y réfère se révèle plutôt trompeur – j’y reviendrai –, et l’idée en question, trop vague, perd rapidement tout son sel – elle joue en quelque sorte le rôle de McGuffin, prétexte sans valeur intrinsèque d’une intrigue un peu paresseuse.
Nous y suivons les pérégrinations de Casey Pollard, l’as du design publicitaire et « chasseuse de cool » free lance (en clair : elle débusque les formes et les tendances pour les créateurs de publicités) chargée par Hubertus Bigend, businessman aussi ambigu que séduisant, d’enquêter sur un mystérieux « Film », œuvre d’origine inconnue, diffusée anonymement sous forme de fragments épars sur le Web – et qui intéresse Bigend pour son formidable potentiel marketing. Qui est l’auteur de ce film magnifique qui déchaîne les passions d’une communauté de fans, et qui évoque à ses exégètes – dont Casey fait partie – le cinéma d’Andrei Tarkovski ? Le Film est-il déjà achevé, et dévoilé fragment par fragment à dessein, ou bien assiste-t-on à un work in progress d’un nouveau genre, happening anonyme pour cinéphiles maniaques ? Casey Pollard souffre par ailleurs d’une curieuse phobie, qu’on pourrait nommer le syndrome « no logo » : elle ne supporte pas la vue des logos des grandes marques – l’un d’entre eux, le bibendum Michelin, lui cause même d’indicibles malaises (!). Pour une championne du logo, voilà qui ne laisse pas d’étonner…
L’environnement technologique, plus encore que dans Neuromancien, est donc essentiel : celui qui maîtrise le langage le plus contemporain – lexique informatique, pratiques de communication – pourra seul appréhender pleinement un récit où l’héroïne passe le plus clair de son temps sur son ordinateur portable à arpenter les forums de l’Internet. C’est ainsi dans le réel le plus moderne que voudrait s’inscrire le roman, alors qu’il ne fait en réalité que l’affleurer. Le concept de « monde-miroir », partout repris en chœur (comme un slogan publicitaire, justement) renforce cette impression : du Réel, Gibson n’a retenu que la désincarnation, le squelette de silice, un indice d’impact cognitif – c’est d’ailleurs dans ce renversement des valeurs que réside l’intérêt principal du roman : c’est avec la Toile et sa virtualité aux possibilités infinies que Casey s’évade de la terne réalité d’un monde-miroir frappé du sceau du consumérisme effréné. Attitude logique, il faut le noter, de la part de cet acteur majeur du cyberpunk : elle sous-entend en effet que le Réel doit s’effacer devant le miracle de l’univers numérique, nouveau domaine de l’inconnu. Selon Gibson le désenchantement du monde s’accompagne – mais il a tort – d’un enchantement de l’infosphère…
D’autres territoires, tangibles ceux-là, seront foulés par une Casey de plus en plus déphasée, puisque son enquête la mènera jusqu’au Japon des otakus – où, comme dans les films de Shinya Tsukamoto (réalisateur cyberpunk, auteur entre autres de Tetsuo et de Tokyo Fist), on passe en l’espace de deux rues de l’univers aseptisé des sararymen au quotidien sordide des laissés pour compte – et dans la Russie gagnée par la fièvre capitaliste. Identification des schémas, ou le roman de la mondialisation ? En quelque sorte. Comme Transparences, le thriller d’Ayerdhal également publié au Diable Vauvert et pareillement accueilli avec un enthousiasme immérité, Identification des schémas prétend donner une vision critique et panoptique du Marché où tout peut s’acheter et se vendre, un monde où les différences entre nations s’effacent au profit d’un processus d’uniformisation générale. Le sentiment produit par ces deux romans est celui d’une profonde déprime, autant due à la forme qu’ils empruntent qu’à leur triste constat d’impuissance : Transparences diluait son intrigue dans d’inutiles longueurs psychologiques et s’empêtrait dans d’inextricables écheveaux d’agents doubles, d’espionnage et de contre-espionnage – dommage, car la première page (Ann X nageant dans les courants d’une foule anonyme) était sans doute ce que l’auteur, piètre styliste, avait écrit de plus beau jusqu’ici, et promettait mieux que cette enquête multinationale – ; Identification des schémas, moins verbeux que Transparences, exploite une idée excellente – ce mystérieux Film, qui évoque un temps La maison des feuilles de Mark Z. Danielewski – avant de se disperser peu à peu dans une intrigue à la fois foisonnante et étrangement superficielle, déceptive, aussi plate que le monde-miroir qu’elle stigmatise pourtant avec conviction. D’une certaine manière, Transparences comme Identification des schémas sont le reflet le plus évident de ce monde qu’ils réprouvent, où les aspérités sont gommées, où les protubérances sont aplanies, où la subversion même s’avère rigoureusement inefficace – sinon par l’acte terroriste, comme paraît d’ailleurs le suggérer Gibson avec son évocation du onze septembre 2001 – que certains trouveront pudique, d’autres artificielle. L’analogie entre les deux romans s’arrête là cependant : contrairement à Transparences, qui développait les théories du complot chères à son auteur – et qui me laissent indifférent –, Identification des schémas se veut le reflet d’un monde complexe, moins tentaculaire que neuronal, moins politique que systémique.
Le style de Gibson, plus précis qu’autrefois, plus audacieux peut-être avec de timides tentatives minimalistes, peine cependant à trouver son relief ; l’auteur ne parvient pas à donner vie à son personnage-miroir (ou personnage-fantôme, comme le père de Casey, disparu dans les attentats du World Trade Center) dont l’errance – l’égarement – s’avère aussi bien littéraire que littérale. Car en fait d’identification des schémas, nous assistons plutôt à leur dissolution ; et c’est très précisément la lacune essentielle du roman que de n’offrir aucune échappatoire : Gibson a parfaitement saisi à quel point l’univers cyberpunk fait désormais partie de notre quotidien ; en d’autres termes, le monde réel, vivant, humain, laisse peu à peu sa place à ses icônes (le monde-miroir, encore, un monde déjà mort selon lui), mais à travers cette réflexion sur la représentation du monde comme in-volonté, il échoue à dessiner de nouveaux schémas. Très loin de l’aspect novateur de Neuromancien, qui participait à la naissance d’une mythologie, et contrairement à ce qu’affirme une Critique volontiers complaisante envers les effets d’annonce d’éditeurs habiles – et déjà adeptes du monde-miroir –, l’impact du nouveau roman de William Gibson promet d’être minime : la réalité a rattrapé le mythe et l’a régurgité, démultiplié, en une telle profusion de formes que ce dernier se confond désormais avec le monde : comment un ré-enchantement serait-il alors possible ? Selon une presse spécialisée trop prompte à réagir (réflexes pavloviens ?) aux stimuli bien rôdés des éditeurs et des diffuseurs, Identification des schémas serait à la littérature générale ce que Neuromancien était à la science-fiction, c’est-à-dire une petite révolution en soi, l’ouverture vers une nouvelle génération de romans borderline, ce dont on me permettra de douter sérieusement : s’il fallait chercher un roman-clé parmi les parutions récentes, un roman électrochoc, susceptible de remuer un peu le corps mort-vivant d’une littérature prophylactique, Villa Vortex de Maurice G. Dantec paraîtrait alors plus approprié que les soins palliatifs prodigués sans conviction par William Gibson et consort – une chose est vraie cependant : la science-fiction d’aujourd’hui est à chercher dans ses marges plutôt qu’en son cœur. Il va sans dire qu’idéologiquement, les deux romans sont fort éloignés puisque Identification, roman logocide, peut être lu comme le triste constat d’un échec définitif – l’homme est vaincu par la technique, l’humanité est étrécie à un seuil critique par les communications aériennes et numériques – quand Villa Vortex, roman logocrate, déclare une guerre farouche – fanatique ? – mais perdue d’avance à cette acculturation pourtant prédite de longue date par Georges Bernanos.
L’erreur de la Critique a été, aussi bien pour Transparences d’Ayerdhal que pour cette Identification des schémas, d’accorder a priori des qualités exceptionnelles à des oeuvres qui accomplissent certes honnêtement leur office de divertissements – au sens kierkegaardien : ils vous rapprochent, en suspendant l’écoulement du temps, et presque à votre insu, de l’heure de votre mort… – mais qui souffrent par ailleurs de défauts patents, formels et théoriques. Peut-être la Critique a-t-elle été leurrée par l’irruption de ces deux auteurs, habituellement restreints à un public de science-fiction (en France, quelques milliers de lecteurs seulement), dans les univers du thriller et de la littérature générale. Mais même s’ils s’en tirent avec les honneurs, Gibson et Ayerdhal plafonnent à vingt mille lieues du génie d’un Thomas Pynchon ou d’un Don DeLillo (ou même d’un James Ellroy).
 DeLillo justement, dans son prophétique et monumental Outremonde (Actes Sud, 1999), élaborait un récit choral et diachronique sans autre lien manifeste qu’une simple balle de baseball, tandis que se tissait une trame sous-jacente de plus en plus dense qui éclatait dans l’épilogue : une religieuse du Bronx, à l’heure de sa mort, rejoignait non pas un paradis illusoire mais la connaissance infinie des réseaux. Là où DeLillo réussit à suggérer l’existence de certains schémas – la civilisation s’érige sur ses propres déchets, au point que l’un des personnages, contemplant le chantier des tours du World Trade Center, est pris de malaise en songeant à ces ruines en devenir ! – en même temps que la vanité de prétendre les identifier, Gibson établit un simple état des lieux sans profondeur réelle, sans véritable originalité thématique – Bret Easton Ellis et Chuck Palahniuk, entre autres, écrivent depuis longtemps sur cette société consumériste où la marque fait office de passeport social et où les tours de verre côtoient les pauvres hères. De cette rumeur du monde, amplifiée chez DeLillo, réenchantée chez Pynchon, William Gibson ne restitue qu’un écho aussi froid qu’un miroir. « Le cyberespace est-il une chose à l’intérieur du monde ou bien est-ce le contraire ? Lequel contient l’autre, et comment peut-on en être sûr ? » demande DeLillo à la fin d’Outremonde. Paradoxalement, le concept de monde-miroir réduit cette interrogation à néant, parce qu’il suggère que le cyberespace est déjà plus réel que le monde. Identification des schémas n’est qu’un thriller minimaliste et sans relief, roman-miroir intéressant mais imperméable à tout espoir de transcendance.
DeLillo justement, dans son prophétique et monumental Outremonde (Actes Sud, 1999), élaborait un récit choral et diachronique sans autre lien manifeste qu’une simple balle de baseball, tandis que se tissait une trame sous-jacente de plus en plus dense qui éclatait dans l’épilogue : une religieuse du Bronx, à l’heure de sa mort, rejoignait non pas un paradis illusoire mais la connaissance infinie des réseaux. Là où DeLillo réussit à suggérer l’existence de certains schémas – la civilisation s’érige sur ses propres déchets, au point que l’un des personnages, contemplant le chantier des tours du World Trade Center, est pris de malaise en songeant à ces ruines en devenir ! – en même temps que la vanité de prétendre les identifier, Gibson établit un simple état des lieux sans profondeur réelle, sans véritable originalité thématique – Bret Easton Ellis et Chuck Palahniuk, entre autres, écrivent depuis longtemps sur cette société consumériste où la marque fait office de passeport social et où les tours de verre côtoient les pauvres hères. De cette rumeur du monde, amplifiée chez DeLillo, réenchantée chez Pynchon, William Gibson ne restitue qu’un écho aussi froid qu’un miroir. « Le cyberespace est-il une chose à l’intérieur du monde ou bien est-ce le contraire ? Lequel contient l’autre, et comment peut-on en être sûr ? » demande DeLillo à la fin d’Outremonde. Paradoxalement, le concept de monde-miroir réduit cette interrogation à néant, parce qu’il suggère que le cyberespace est déjà plus réel que le monde. Identification des schémas n’est qu’un thriller minimaliste et sans relief, roman-miroir intéressant mais imperméable à tout espoir de transcendance.William Gibson – Identification des schémas. Au Diable Vauvert, 2004. Trad. de l’américain par Cédric Perdereau.



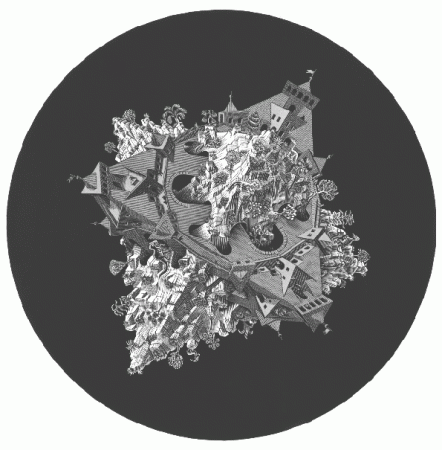
 Roman labyrinthique
Roman labyrinthique 

 « Toutes les humiliations qu’il avait subies pouvaient être balayées par cet acte très simple d’annihilation : le MEURTRE ! » Ces mots prononcés en prologue (issus du livre) justifient les actes de Peter Neal, le meurtre s’y annonce d’emblée comme une cérémonie de libération. Or Tenebrae, le titre du film, est le nom d’un office liturgique particulier, au cours duquel les bougies de l’autel sont éteintes une à une, plongeant peu à peu l’église dans la pénombre, jusqu’à l’obscurité qui évoque les ténèbres spirituelles de la trahison (par
« Toutes les humiliations qu’il avait subies pouvaient être balayées par cet acte très simple d’annihilation : le MEURTRE ! » Ces mots prononcés en prologue (issus du livre) justifient les actes de Peter Neal, le meurtre s’y annonce d’emblée comme une cérémonie de libération. Or Tenebrae, le titre du film, est le nom d’un office liturgique particulier, au cours duquel les bougies de l’autel sont éteintes une à une, plongeant peu à peu l’église dans la pénombre, jusqu’à l’obscurité qui évoque les ténèbres spirituelles de la trahison (par 