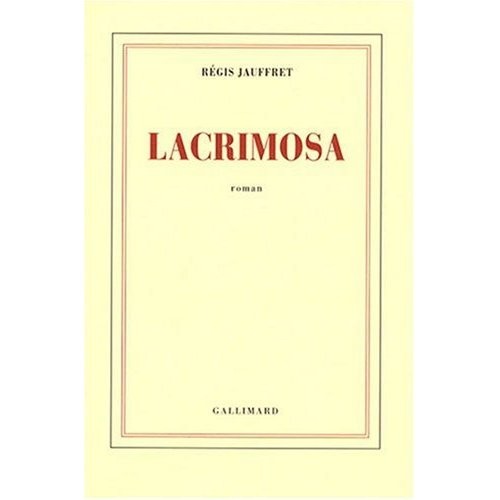Pour peu qu’on accepte d’ôter le temps d’une projection les œillères idéologiques que nous trimballons tous plus ou moins, Entre les murs s’impose non comme un chef d'œuvre, mais comme un grand moment de cinéma. Réalisateur des remarqués Ressources humaines et L’Emploi du temps, Laurent Cantet adapte un roman de François Bégaudeau et filme une classe de quatrième d’un collège parisien classé en ZEP. Avant d’entrer plus avant dans l’analyse et l’interprétation, balayons immédiatement un malentendu : Entre les murs n’est pas un documentaire. Du reste, contrairement à ce qu’affirment certains, comme mon ami François, les auteurs n’ont jamais entretenu cette confusion : il suffit pour s’en convaincre de lire leurs entretiens, où est dévoilée la méthode d’atelier de Laurent Cantet. Certes, les acteurs sont tous des non professionnels : François Bégaudeau incarne son double François Marin, et les élèves et les autres professeurs, tous très bons (à l’exception du professeur de techno qui pète les plombs, vraiment pas convaincant !) ont été recrutés au collège Françoise Dolto, proche du collège Jean Jaurès où s’est déroulé le tournage. Certes encore, en captant avec ses trois caméras HD des scènes de classe aussi improvisées qu’encadrées – les jeunes protagonistes n’avaient pas lu le scénario –, en filmant aussi bien les dialogues que leur périphérie – un élève qui se balance sur sa chaise, une autre qui somnole, la tête posée à même sa table, etc. –, le film revêt inévitablement un caractère documentaire, évidemment renforcé par le filmage HD très neutre, au plus près des visages, des corps, des gestes et des paroles. Mais les élèves jouent des rôles prédéterminés, souvent à contre-emploi (Frank Keita par exemple, qui joue Souleymane, serait en réalité un garçon très calme). Et surtout, Laurent Cantet non seulement sait où il va – nous restons dans le cadre général du livre de Bégaudeau –, mais encore procède, comme nous le verrons, à une authentique et très habile mise en scène de la situation. Dès lors, il devient rigoureusement impossible d’identifier un discours, une idéologie, défendus par Entre les murs. Puisque nous sommes en présence non d’un documentaire mais d’une « représentation de représentation » du réel, nous nous contenterons alors de l’interpréter.
 Le dispositif formel d’Entre les murs (Palme d’Or à Cannes) est extrêmement simple. Certains ont noté le positionnement des caméras, toujours du même côté de la classe, en arbitre impartial du jeu qui se déroule sous nos yeux. Nous avons d’une part le professeur, avec sa personnalité propre, ses idées, ses méthodes – bonnes ou mauvaises –, son système pédagogique, ses positions sur la discipline, ses errements et ses dérapages, un professeur, en somme, qui fait ce qu’il peut pour faire son travail, transmettre un savoir et éveiller ces adolescents à la réflexion, à la curiosité, bref, à l’intelligence en acte ; nous avons de l’autre les élèves agités, inattentifs, parfois violents, avec leur tchatche, leurs insultes, leur langage spécifique – un langage rompu aux arcanes du combat, comme le note justement Pierre Cormary dans une critique à charge par ailleurs très confuse, dont je ne partage pas du tout les conclusions –, leurs railleries incessantes et leur tragique incapacité à assimiler les leçons de leurs enseignants, mais aussi avec leur incroyable vitalité. François Marin/Bégaudeau n’incarne pas l’excellence. Il n’a même pas valeur d’exemple. À l’inverse de son collègue professeur d’histoire et géographie, il ne se drape pas dans les principes, alors il tâtonne, multipliant les erreurs, « charriant » plus qu’à son tour, jusqu’à comparer le comportement de deux greluches à celui de « pétasses », provoquant alors de sérieux remous…
Le dispositif formel d’Entre les murs (Palme d’Or à Cannes) est extrêmement simple. Certains ont noté le positionnement des caméras, toujours du même côté de la classe, en arbitre impartial du jeu qui se déroule sous nos yeux. Nous avons d’une part le professeur, avec sa personnalité propre, ses idées, ses méthodes – bonnes ou mauvaises –, son système pédagogique, ses positions sur la discipline, ses errements et ses dérapages, un professeur, en somme, qui fait ce qu’il peut pour faire son travail, transmettre un savoir et éveiller ces adolescents à la réflexion, à la curiosité, bref, à l’intelligence en acte ; nous avons de l’autre les élèves agités, inattentifs, parfois violents, avec leur tchatche, leurs insultes, leur langage spécifique – un langage rompu aux arcanes du combat, comme le note justement Pierre Cormary dans une critique à charge par ailleurs très confuse, dont je ne partage pas du tout les conclusions –, leurs railleries incessantes et leur tragique incapacité à assimiler les leçons de leurs enseignants, mais aussi avec leur incroyable vitalité. François Marin/Bégaudeau n’incarne pas l’excellence. Il n’a même pas valeur d’exemple. À l’inverse de son collègue professeur d’histoire et géographie, il ne se drape pas dans les principes, alors il tâtonne, multipliant les erreurs, « charriant » plus qu’à son tour, jusqu’à comparer le comportement de deux greluches à celui de « pétasses », provoquant alors de sérieux remous…
 Au centre, donc, la caméra. D’autres critiques ont par ailleurs évoqué le morcellement de l’espace par le montage. Au plan d’ensemble, Laurent Cantet préfère ici le plan rapproché et le gros plan : c’est avec la même neutralité que sont non pas jugés mais observés François Marin/Bégaudeau, ses élèves, ses collègues dans la salle des profs ou au conseil de classe… Observés, non froidement comme les cobayes de quelque expérience, non comme des figures générales (« prof », « élèves ») mais avec empathie, c’est-à-dire considérés comme des individus à part entière, dans toute leur singularité. S’il y a bien confrontation, donc, entre une classe et un professeur, cette classe n’en est pas moins constituée d’élèves d’origines sociales et ethniques diverses, qui eux aussi ont leur histoire, leurs préoccupations, et leur personnalité propres. Le jeu de champs et contrechamps serrés qui fusent au rythme quasi slamé des répliques, vise moins à « donner raison » aux méthodes de Marin (par exemple lors de ses face-à-face avec son rival idéologique, le prof d’histoire), dont nous avons vu qu’elles étaient pour le moins discutables – surtout en matière de discipline –, qu’à nous faire reconsidérer les débats autour de l’école – malgré toutes les réserves, souvent d’une violence hors de propos, que suscitent ses choix pédagogiques, Marin/Bégaudeau parvient parfois à ses fins mieux que quiconque –, ainsi qu’à mettre en scène un rapport de force – à chacun son territoire : s’ils tolèrent tout juste l’autorité du professeur dans l’enceinte de la salle de cours, les élèves s’opposent violemment à lui lorsque ce dernier, dans une séquence d’une rare intensité, s’en prend à eux dans la cour, leur domaine… Reste que cette fragmentation de l’espace tend à égaliser la parole (« Pour vous, enculé, c’est comme pour nous, pétasse »), à relativiser l’importance des uns et des autres, à embrasser avec la même bienveillance la parole du professeur et celle des élèves. C’est d’ailleurs le principal reproche fait au film par ses détracteurs, souvent professeurs eux-mêmes… Ils ont tort : si Entre les murs épouse le point de vue de Marin/Bégaudeau, il n’en montre pas moins ses inquiétantes impasses. À cette fragmentation paritaire et égalitaire de l’espace, qui fait clairement écho à la perte de pouvoir du professeur, s’ajoute un troisième choix essentiel de mise en scène, d’autant plus discret qu’il n’est pas visible, et décisif pour la compréhension du film : l’aplatissement temporel.
Au centre, donc, la caméra. D’autres critiques ont par ailleurs évoqué le morcellement de l’espace par le montage. Au plan d’ensemble, Laurent Cantet préfère ici le plan rapproché et le gros plan : c’est avec la même neutralité que sont non pas jugés mais observés François Marin/Bégaudeau, ses élèves, ses collègues dans la salle des profs ou au conseil de classe… Observés, non froidement comme les cobayes de quelque expérience, non comme des figures générales (« prof », « élèves ») mais avec empathie, c’est-à-dire considérés comme des individus à part entière, dans toute leur singularité. S’il y a bien confrontation, donc, entre une classe et un professeur, cette classe n’en est pas moins constituée d’élèves d’origines sociales et ethniques diverses, qui eux aussi ont leur histoire, leurs préoccupations, et leur personnalité propres. Le jeu de champs et contrechamps serrés qui fusent au rythme quasi slamé des répliques, vise moins à « donner raison » aux méthodes de Marin (par exemple lors de ses face-à-face avec son rival idéologique, le prof d’histoire), dont nous avons vu qu’elles étaient pour le moins discutables – surtout en matière de discipline –, qu’à nous faire reconsidérer les débats autour de l’école – malgré toutes les réserves, souvent d’une violence hors de propos, que suscitent ses choix pédagogiques, Marin/Bégaudeau parvient parfois à ses fins mieux que quiconque –, ainsi qu’à mettre en scène un rapport de force – à chacun son territoire : s’ils tolèrent tout juste l’autorité du professeur dans l’enceinte de la salle de cours, les élèves s’opposent violemment à lui lorsque ce dernier, dans une séquence d’une rare intensité, s’en prend à eux dans la cour, leur domaine… Reste que cette fragmentation de l’espace tend à égaliser la parole (« Pour vous, enculé, c’est comme pour nous, pétasse »), à relativiser l’importance des uns et des autres, à embrasser avec la même bienveillance la parole du professeur et celle des élèves. C’est d’ailleurs le principal reproche fait au film par ses détracteurs, souvent professeurs eux-mêmes… Ils ont tort : si Entre les murs épouse le point de vue de Marin/Bégaudeau, il n’en montre pas moins ses inquiétantes impasses. À cette fragmentation paritaire et égalitaire de l’espace, qui fait clairement écho à la perte de pouvoir du professeur, s’ajoute un troisième choix essentiel de mise en scène, d’autant plus discret qu’il n’est pas visible, et décisif pour la compréhension du film : l’aplatissement temporel.
Plus encore que le livre de François Bégaudeau, le film de Laurent Cantet anéantit systématiquement toute notion de durée et de temporalité. Entre les murs se déroule tout au long d’une année scolaire, du premier au dernier jour, et l’on assiste à quelques événements incontournables de la vie scolaire, comme un conseil de classes et quelques incursions en salle des profs, mais d’une scène à l’autre rien n’indique qu’une période plus ou moins longue a éventuellement pu s’écouler. Comme l’indique le titre, nous restons entre les murs du collège : ni les tenues vestimentaires, ni les événement extérieurs, ne nous donnent le moindre indice d’une quelconque progression. Il est bien fait référence à la Coupe d’Afrique des Nations, mais le football revient comme un leitmotiv dans la bouche des élèves comme l’une de leurs préoccupations majeures, et ne rompt pas avec cette impression de stase temporelle. En fait, les deux seuls événements marquants qui débordent du cadre de la vie scolaire, sont la menace d’expulsion de la mère chinoise en situation irrégulière du jeune Wei, et l’exclusion définitive de Souleymane, dont le père risque alors de le renvoyer au Mali. Or, le film ne se préoccupe plus par la suite du sort de la mère de Wei, et Souleymane doit son exclusion au comportement du professeur, qui par souci de dialoguer avec ses élèves, avec leurs propres armes, a laissé la situation s’envenimer… C’est Marin, en traitant Esmaralda et sa collègue déléguée de classe de « pétasses », qui ouvre des brèches dans l’équilibre instable qu’il avait instauré. Mais cet incident ne change rien. Pas même pour Souleymane en définitive : celui-ci sera envoyé dans un autre collège, de la même façon que Carl, exclu ailleurs, est arrivé à Dolto. Les mois passent donc sans que nous en prenions conscience, et surtout sans que le bagage scolaire et le comportement de certains élèves – la plupart… – n’ait évolué d’un iota. Oh, il y a bien cette scène inattendue, qui voit Marin/Bégaudeau estomaqué par la petite Esmeralda, lectrice improbable de La République de Platon, mais c’est sur le conseil de sa sœur, et non sous l’autorité de l’institution, que la jeune fille s’y est intéressée… Le triptyque final d’Entre les murs (le constat d’échec de la petite Henriette ; le match de foot dans la cour ; les deux derniers plans de la salle de classe vide) n’enlève rien à la bienveillance du film envers ses jeunes protagonistes, bien au contraire, mais s’avère d’un pessimisme rare. D’abord, donc, il y a Henriette, cette jeune élève effacée, qui ne pipait mot pendant les cours, et qui vient après l’ultime cours de l’année, le regard perdu, avouer à son professeur – ébranlé par la révélation – qu’elle n’a rien appris, et même rien compris, durant toute son année scolaire... Ensuite, il y a ce match de foot dans la cour, séquence magnifique, faussement anodine, qui montre une dernière fois la vitalité de ces enfants, mais aussi l’échec total d’un environnement scolaire qui n’aura pas réussi à leur faire accepter et assimiler d’autres valeurs, d’autres connaissances que les noms des clubs et des joueurs. Même en cours de français, on préfère parler de la défaite du Mali face au Maroc qu’apprendre les différents registres de langue. Enfin, les deux plans de la salle de classe vidée de ses élèves, chaises et tables sens dessus dessous, enfoncent le clou avec une simplicité exemplaire : les élèves ne sont pas là. Ils n’ont jamais vraiment été là. Ils s’agitent en tout sens sans raison, ils tchatchent dans le vide, contredisant les sages paroles tatouées en arabe sur le bras de Souleymane (« Si ce que tu as à dire n’est pas plus important que le silence, alors tais-toi »), et n’attendent strictement rien de l’école.
Entre les murs est une histoire d’enfermement. Une année est passée et rien, ou presque, n’a changé. Les professeurs sont désabusés (citons de mémoire la présentation de l’un d’entre eux, lors d’un tour de table au début du film : « J’enseigne dans ce collège depuis… oumph, un certain nombre d’années déjà… Bienvenue aux nouveaux. Et bon courage… »), impuissants (ils ont perdu tout pouvoir et se raccrochent à n’importe quoi, par exemple une machine à café, mais même elle finit par leur échapper), prisonniers au sein même de leur établissement (quand Marin se réfugie dans la cantine pour y fumer une cigarette, la femme de ménage lui fait une remontrance), et contraints de voir leurs joies et satisfactions déplacées exclusivement dans le monde extérieur (l’annonce de la grossesse en salle des profs). Quant aux élèves, ils attendent la quille, sans aucun égard pour leur avenir. La cour du collège est d’ailleurs filmée d’une fenêtre en hauteur, comme du haut d’un mirador. Laurent Cantet réussit le tour de force de réaliser un film sur l’école et sur ce qui se joue de crucial entre ses murs, sans raccourci simpliste, tout en nous faisant accéder à la singularité de ses protagonistes – jusqu’à nous les faire aimer, sans pathos, sans les artifices et clichés habituels de la fiction. À la fois électrisant et terrifiant – superbe.



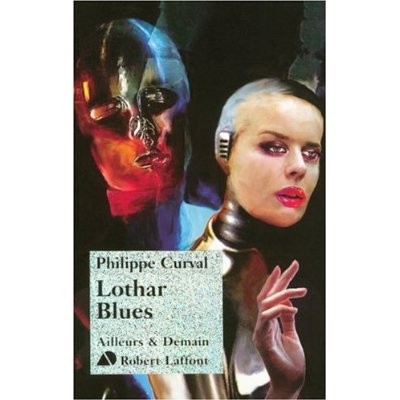

 Enfin, signalons un article de Denis Labbé consacré à
Enfin, signalons un article de Denis Labbé consacré à