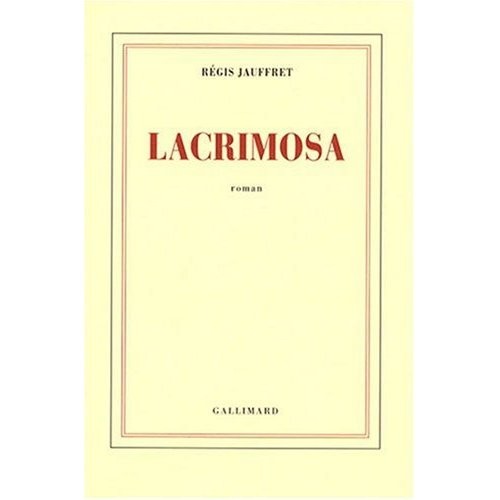
« Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.
Amen. »
Requiem
« Chère Charlotte,
Vous êtes morte sur un coup de tête d’une longue maladie. Le suicide a déferlé sur vous comme une marée noire, et vous vous êtes pendue. » (p. 9)
Par ces mots commence l’étrange prosopopée épistolaire de Régis Jauffret. Lacrimosa prend la forme de la correspondance imaginaire de l’auteur – ou plutôt de son double, appelons-le l’énonciateur –, avec Charlotte, jeune amante qui se serait suicidée avec un foulard dans la maison de ses parents. Par ses lettres, censées retracer certains fragments de la vie de Charlotte, l’énonciateur cherche à prolonger la vie de la défunte, à la ressusciter pour mieux enterrer son propre sentiment de culpabilité… Chez Jauffret – l’écrivain du conditionnel, des vies hallucinées, des héroïnes perdues ou schizophrènes (Clémence Picot, Promenade, Univers, Univers…) –, on usurpe les identités, on s’invente des vies, on perd son adhérence au réel. Et c’est bien ainsi que débute Lacrimosa, qui dans les premières lettres de l’énonciateur affuble Charlotte d’une famille surréaliste de frappadingues aux noms improbables (Pindo), acteurs d’un sitcom macabre qu’on pourrait rapprocher de celle d’INLAND EMPIRE de David Lynch, avec ses hommes-lapins. Ce délire microfictif culmine dans la deuxième lettre à Charlotte, où le suicide – dont plusieurs versions nous sont données – n’est que le point de départ d’une suite de gags étranges, avec un philosophe burlesque (Gaston Kiwi) et un invraisemblable médecin (Hippocampe Dupré) dont la compagne Mazda est un panda géant, qui ensemble défient la logique et la roue du temps pour donner à Charlotte – dont Dupré refuse d’abord d’admettre le décès [1] – une seconde chance : « Maintenant la journée d’hier était revenue, vierge, pas encore vécue. Il suffisait de donner un coup de dents au foulard pour qu’il se déchire, ou même de le jeter comme un vieux mouchoir. Vous décideriez enfin de rompre avec le suicide, cet amant dépravé qui tout au long de votre histoire n’avait fait que vous enfoncer ses crocs dans le cou, et boire votre souffrance comme un vampire. » (p. 50) Or, c’est justement cette relecture ludique du réel que lui reproche Charlotte dans ses lettres d’outre-tombe – ces « dégradantes histoires où [il aime] à ridiculiser les pauvres gens tombés sous la coupe de [son] cerveau démantibulé » (p. 27). La morte traite son pauvre amour d’écrivassier (p. 51), d’escroc (p. 73), de charognard [2], l’accuse de bricoler la phrase (p. 51). Dès que l’écrivain affabule – ce qu’il fait sans discontinuer –, dès qu’il se laisse envahir par ses métaphores, par son travestissement compulsif de la réalité – par exemple, ces vacances à Djerba, ou cette liaison de la jeune femme avec un skipper –, Charlotte proteste, vitupère, rue dans les brancards et somme le malotrus de la réécrire. Pourquoi la réanime-t-il grossièrement, alors qu’elle n’aspire qu’au repos ? Pourquoi mentir, pourquoi ne pas l’écrire telle qu’elle était ? Le dispositif de Lacrimosa, cette manière si ostentatoire de donner la parole à une morte, ne prennent tout leur sens et n’échappent au ridicule que parce qu’ils se prennent eux-mêmes comme objets. On comprend très tôt que le roman, métafictionnel, ne fait que mettre en scène un dialogue intérieur, le combat entre l’écrivassier, l’artificier, celui qui plaque ses accords sans égard pour son héroïne, et celle, réelle ou fictive, qu’il dépossède de son essence, de son identité. Jauffret, il est vrai, ne se contente pas de faire parler une morte. Celle-ci n’est pas dupe : à travers elle, c’est encore l’énonciateur qui parle : « Je ne suis plus je. Je suis devenue toi, la parodie de moi dans ta voix qui me promène, me pousse comme un landau dont le bébé a gelé » (p. 72) Charlotte sait donc n’être qu’un personnage, pantin manipulé par l’auteur. « Tu t’en moques bien que les âmes soient des fictions, et que nous n’ayons même pas les flammes de l’enfer pour réchauffer nos os glacés. Pourvu que tu puisses m’imaginer, je te fais le même profit que si j’étais vivante. » (p. 129). Jauffret, « en concubinage avec Word » (p. 143), s’accuse de faire la putain, de mentir pour nous complaire [3]. Mais cette violente autocritique n’est, à son tour, qu’une nouvelle imposture. Si Lacrimosa se referme sur la voix de Charlotte, qui finit par admettre que, peut-être, tout cela n’aura pas été vain, c’est pour signifier la victoire de l’énonciateur. « Quand on meurt, on devient imaginaire » (p. 154), se lamente la pendue, qui feint de ne pas comprendre l’essentiel. Quand on meurt, on devient un personnage, en effet. Or, personnage de fiction, Charlotte ne l’est que par intermittence : l’énonciateur n’a remporté son duel qu’in extremis, n’accouchant que du squelette de la jeune femme (p. 218), dont la chair n’est perceptible que de loin en loin, quand l’énonciateur résiste aux récriminations de la jeune femme et transcende une réalité parfois triviale. Lacrimosa met surtout en évidence, à défaut de le célébrer tout à fait – Clémence Picot était autrement plus vraie –, le miracle du verbe qui, par la métaphore, la poésie et l’imagination, permet aux morts et à ceux qui ne sont jamais nés, de sourire et d’exister.
[1] Niant l’évidence, sans se départir de sa bonhomie naturelle, le docteur Dupré tente sans succès de réanimer le cadavre avec une injection d’adrénaline, avant de s’énerver :
« ― Après tout, cette tête de linotte n’a qu’à continuer à être morte.
Il a lancé la seringue comme une fléchette. Elle s’est plantée dans une plinthe.
― Tout ce que je peux faire, c’est demander son internement. » (p. 39)
Toi et les tiens vous êtes des charognards. Vous vous nourrissez de cadavres et de souvenirs. Vous êtes des dieux ratés, les bibliothèques sont des charniers. Aucun personnage n’a jamais ressuscité. Dostoïevski, Joyce, Kafka, et toute cette clique qui t’a dévergondé, sont des malappris, des jean-foutre, des fripons, des coquins, des paltoquets ! Ils ont expulsés leur époque par les voies naturelles pour en barbouiller toutes ces feuilles de papier aux traînées noires et tristes comme des canaux où les mots flottent ventre à l’air comme des poissons d’eau douce bouillis par la canicule. » (pp. 112-113)
[3] « Jaquettes et couvertures s’exhibent dans les vitrines dans les vitrines, comme leurs consoeurs les putes d’Amsterdam. Sur les plateaux des médias chacun montre un morceau de son âme, comme un tapin un bout de sa poitrine pour que le client paye et monte jusqu’à la chambre voir le reste à son aise. Sache que la littérature doit avoir en toute circonstance l’élégance de plaire. » (p. 85)


Commentaires
C'est vrai, il ne s'agit pas d'une célébration. J'ai un peu l'impression qu'il s'agit d'une conviction à laquelle se raccrocher.
Possible. La question est : une fois morts, sommes-nous différents de personnages de fiction ?...
Certains ont cette chance. Les autres disparaissent, simplement.
Vous n'avez, hélas (?), que trop raison.
"Lacrimosa met surtout en évidence, à défaut de le célébrer tout à fait – Clémence Picot était autrement plus vraie –, le miracle du verbe qui, par la métaphore, la poésie et l’imagination, permet aux morts et à ceux qui ne sont jamais nés, de sourire et d’exister."
Il ne faudrait pas exagérer. Lacrimosa, c'est du Marc Lévy amélioré.
Oh, c'est vous qui exagérez, Silencieuse. Le livre de Jauffret est en effet raté, mais ce simple jugement ne m'intéresse pas : son projet, ce qu'il remue, m'a intéressé. Et ce que dit clairement la phrase que vous citez, c'est que Lacrimosa réussit à dire ce qu'il échoue à faire : donner vie à des personnages, à un monde. Marc Lévy n'aurait jamais pu écrire Clémence Picot. Jamais.
Olivier,
Votre verbe rayonne miraculeusement trop.
Retirez donc toutes les métaphores (d'un goût douteux) de ce roman et vous aurez en quelques phrases un résumé lucide de "Et si c'était vrai". Si Jauffret essaye de nous dire que la littérature est morte et qu'il fait partie des assassins, il s'y prend très mal : son écriture se perd dans une victimisation insupportable, un galimatia de culpabilité larmoyante. Ce livre ne m'a fait ni pleurer, ni rire, ni réfléchir, juste m'énerver, hurler à chacune de ses fuites stylistiques.
Je suis déçue par cet écrivain dont on me recommandait vivement la lecture. Je lirai probablement Clémence Picot...
Oui, lisez Clémence Picot, d'une autre trempe. J'ai prévu d'en parler ici, mais je prends mon temps.
Vous avez raison de parler de "fuites stylistiques" à propos de Lacrimosa (qui ne m'a jamais fait vibrer, moi non plus). Elles sont le véritable sujet du livre.
écriture dans le refus, pas apaisé, régis jauffret, la peur et la non-acceptation en fait.
très joli et pertinent passage dans votre article "...le miracle du verbe qui, par la métaphore, la poésie et l’imagination, permet aux morts et à ceux qui ne sont jamais nés, de sourire et d’exister."