« Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps le visage est ce qui nous interdit de tuer. »
E. Lévinas, Éthique et Infini.
« Un meurtre excepté, rien ne marquera ses pas sur la terre »
Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan.
« Suis-je gardien de mon frère ? »
Caïn.
« Car sachez, mes Pères, que chacun de nous est assurément coupable ici-bas de tout envers tous, non seulement par la faute collective de l’humanité, mai chacun individuellement, pour tous les autres sur la terre entière. »
F. Dostoïevski, Les Frères Karamazov.
Tous les trois ans, l’histoire recommence. On voit des bons films, parfois des très bons comme, cette année, L’Homme de Londres de Béla Tarr, Gomorra de Matteo Garrone – Grand Prix cannois mérité –, Entre les murs de Laurent Cantet – belle Palme d’Or – ou No country for old men de Joel et Ethan Coen, sans pour autant que l’un d’entre eux puisse revendiquer la qualification de chef d’œuvre. On s’enthousiasme comme on peut. Et puis, sans crier gare, arrive le nouveau film de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Les cinéastes belges ayant déjà été primés plusieurs fois à Cannes (deux palmes d’or pour Rosetta et L’Enfant), on se contentera du prix du scénario obtenu par Le Silence de Lorna, même si en l’occurrence, il serait vraiment dommage de ne retenir que cela : ce nouvel opus, d'une austérité, d'une rigueur toutes bressoniennes, mais également très physique, comme chez Cassavetes, confirme en effet, s’il en était besoin, le génie des deux réalisateurs, maîtres de la mise en scène et immensément doués pour la direction d’acteurs. Jérémie Rénier (La Promesse, L’Enfant, Le Silence de Lorna), Olivier Gourmet (La Promesse, Le Fils, et des apparitions dans les deux suivants), Émilie Dequenne (Rosetta), Morgan Marine (Le Fils, Le Silence de Lorna), Deborah François (L’Enfant), et aujourd’hui la kosovar Arta Dobroshi, sont certes de « nouveaux talents », mais surtout des modèles, au sens bressonien, dont les deux frères ont su exploiter un physique, une vitalité, une présence qui leur appartiennent en propre, mais qui ne trouvent leur plus haute expression que dans ces films. Dans Le Silence de Lorna, Jérémie est stupéfiant en junkie, et Arta Dobroshi, qui n’avait jusqu’ici tourné que dans quelques films tchèques et albanais, nous hantera longtemps. Et de la qualité de leur interprétation dépend entièrement la réussite, la cohérence d’un grand film éthique centré autour du point pivotal d’une rencontre entre deux êtres – du point de vue de l'un d'entre eux. Les frères Dardenne citent souvent l’influence déterminante de la philosophie d’Emmanuel Lévinas. Il nous a donc semblé pertinent de proposer une voie d’accès à la compréhension du Silence de Lorna, à la lumière de l’éthique lévinassienne.
Tout commence, évidemment, comme une chronique ordinaire de la vie urbaine, mais la zone industrielle de Seraing a laissé sa place aux décors plus lisses de Liège, et la caméra 35mm supplante la 16mm des précédents films : cette soudaine (et relative) distance – l’image est moins granuleuse, moins chahutée aussi – n’est évidemment pas fortuite : l’énonciateur du Silence de Lorna observe l’abjection comme la rédemption avec la même compassion. Cette fois, les Dardenne s’attaquent aux mariages blancs et aux filières d’émigrants d’Europe de l’est. Jeune Albanaise, Lorna (Arta Dobroshi, qui porte son repli sur son visage) n’a épousé Claudy (Jérémie Rénier, stupéfiant), un jeune camé, qu’afin d’obtenir la nationalité belge. Employée dans un pressing, elle partage provisoirement un appartement – mais pas son lit – avec Claudy, et rêve d’ouvrir son propre snack avec son petit-ami, qu’elle ne voit que rarement, lorsqu’il passe par la Belgique… Pour y parvenir, Lorna accepte un contrat avec un truand taximan, Fabio (Fabrizio Rongione), qui la maintient constamment sous pression : pour une somme rondelette, qui va lui permettre d’obtenir le prêt bancaire essentiel à la réalisation de son rêve, elle devra – une fois que Claudy aura succombé d’une opportune overdose… – épouser un mafieux Russe, lui aussi en quête de papiers en règle…

Dans cette première partie, Lorna est d’abord entièrement dévouée à ses objectifs : obtenir la nationalité belge, une carte d’identité en règle, et toucher l’argent d’un deuxième mariage blanc. Cette Lorna est toujours dans la satisfaction du besoin, elle entretient avec le monde un rapport exclusivement économique, utilitariste, qui ne porte que sur la quiddité de l’être : l’Autre est un objet, un être sans visage, un phénomène auquel on attribue un prix – un outil, qui a une valeur, mais uniquement commerciale. Le truand, le futur mari russe et, bien sûr, Claudy – dont elle cautionne le meurtre –, représentent tous une certaine somme quantifiable, d’ailleurs figurée dans le film par les liasses du taximan, ou l’enveloppe du junkie, qui leur sont systématiquement associés. Même Sokol, son petit ami, apparaît surtout comme un point d’ancrage, pour Lorna, dans une réalité morale acceptable. Même devant lui, Lorna ne se met pas à nu – ne dévoile pas le total dénuement de son âme.
Lévinas signale qu’en présence de l’autre, « il faut parler de quelque chose », de la pluie ou du beau temps, ou de n’importe quoi. Parler, et accueillir la parole, c’est reconnaître cette présence. Lorsque aucune parole n’est échangée, la gêne s’installe. Mais Lorna, qui n’est que volonté de puissance, voudrait nier la présence de Claudy. S’il la fait revenir en urgence du pressing, c’est juste qu’il a « besoin de parler ». Mais Lorna n’en a cure. Dans leur appartement, il l’appelle, encore et encore, tandis qu’elle cherche à s’endormir, mais elle ne répond pas, sourde à ses supplications. Lorna vit perpétuellement dans la dissimulation, le mensonge, la feinte, le simulacre et, bien sûr, le silence. Elle se réfugie en elle-même pour ne pas avoir à subir le jugement de l’autre, envers sa conduite immorale ou, plutôt, indifférente – irresponsable. Son propre visage ne laisse transparaître aucune émotion, sinon la contrariété. Tout l’enjeu de cette première partie – dont le lieu central est évidemment l’appartement, le lieu privilégié, naturel, de l’hospitalité – est une révélation, celle du Désir métaphysique, celle de l’Infini, celle de sa responsabilité irrésiliable et démesurée envers l’Autre. À mesure que se concrétisent ses espoirs d’une vie normale, Lorna en effet va enfin commencer à voir Claudy sous un nouveau jour, jusqu’à l’épiphanie de leur étreinte – « l’accueil du visage », dans le face-à-face. Cette rencontre inattendue avec l’Autre, qu’enfin elle écoute, qu’enfin elle regarde, à qui enfin elle parle et à qui elle se manifeste, lui révèle son incommensurabilité – l’Infini dont il est la trace –, et fait naître en elle la honte et le sentiment de responsabilité. Lorna passe donc du besoin, qui la constituait en tant que Même, au Désir, qui la constitue en tant que dépendant de l’Autre. Or la demeure est le lieu naturel où se fait la première rencontre de l’altérité, cette brèche ouverte dans la jouissance d’un Moi solipsiste : c’est naturellement dans ce lieu nu du quotidien, que se manifeste, dans le film, la révélation.

Le moment de cette révélation, Lévinas le nomme « épiphanie du visage », une forme d’hospitalité, si l’on veut, qui « coïncide avec le Désir d’Autrui absolument transcendant », et qui n’est possible que dans la droiture du face-à-face (comme le dit Derrida, « la face n’est visage que dans le face-à-face »). Autrui n’est plus alors un objet, purement « phénoménal », il ne se présente pas sous l’aspect d’une forme liée à une valeur numéraire : le visage fait naître dans le Même la Bonté, et l’interdiction éthique du meurtre. Tu ne tueras point. C’est ça, l’épiphanie du visage. « Tenu en éveil par le visage, par ce contact plus intime que celui de la caresse sur une peau et plus brûlant que le plus ardent Désir, le Moi assigné à responsabilité témoigne prophétiquement de l’Infini et fait advenir en ce monde un commencement d’humanité », écrit Simone Plourde dans Emmanuel Lévinas : Altérité et responsabilité (Cerf, « la Nuit surveillée », 1996). La scène extraordinaire de l’étreinte entre Claudy et Lorna, qui brise la distance instaurée par les cinéastes, constitue l’acmé de la première partie du film – le but vers lequel elle tendait entièrement. Enfin, après avoir refusé de regarder ses interlocuteurs en face (voir ces deux photogrammes, qui montrent Lorna détourner le regard, respectivement, d’un Claudy implorant et du Russe qu’elle doit épouser), enfin donc, Lorna accueille Claudy, enfin elle lui manifeste sa non-indifférence, enfin elle lui parle, enfin elle sort d’elle-même, enfin elle devient « autrement qu’être », enfin elle entrevoit toute la misère, et toute la hauteur, de l’Autre, enfin elle endosse sa responsabilité (et devient gardienne de son argent), enfin, saisie par l’afflux ininterrompu de sa présence, elle s’offre à lui en face-à-face, dans toute sa nudité : « Me voici ! » Voilà ce que montre cette scène d’une intensité inouïe (comme les deux scènes d’automutilation, qui prouvent que pour Lorna son propre corps est un « objet » manipulable, un simple outil comparable au téléphone portable, omniprésent dans ce film, comme d'ailleurs dans L'Enfant), en plan-séquence, où deux corps, où les deux visages dévoilent leur dénuement et se donnent pleinement, gratuitement, l’un à l’autre, l’un-pour-l’autre. La grande réussite formelle du film est d’avoir su montrer, par la direction d’acteurs, par le saisissement des corps en plans séquences, combien la bonté, la résistance éthique au meurtre, passe par le sensible. Certes, pour Lévinas, la caresse cherche, fouille, mais ne se saisit de rien ; le rapport érotique « dé-visage », il est ambigu, équivoque, parce qu’il restreint la responsabilité au couple : un égoïsme à deux, en somme (le Moi aime l’amour que l’Autre lui porte). Ce qui permet de dépasser ce repli sur soi de l’Éros, de « re-visager » l’Autre, c’est la possibilité de l’enfantement.
Dès lors la mort de Claudy ouvre une béance irrémédiable : dans le temps narratif (extraordinaire, terrible ellipse ; disjonction et confusion du temps synchronique du présent diégétique, et du temps diachronique du rapport à l’Infini), dans l’espace (Lorna déménage, le film se déplace), et, inévitablement, dans la psyché de Lorna, déchirée par une culpabilité absolue. Lorna n’avait vécu que dans le mensonge, la manipulation et la dissimulation ; c’est logiquement, morcelée par la mort de Claudy, dont elle sait être responsable devant tous, au point de se substituer à lui en quelque sorte, qu’elle accorde foi à une fiction – cet enfant, né de sa révélation, et qui n’existe que dans son imagination (comme si croire en lui suffisait à le faire exister). Le désordre schizophrénique de Lorna, dans les dernières scènes, n’est pas de nature psychanalytique (relation sujet/objet), mais éthique (relation Même/Autrui) : c’est l’Autre qu’elle porte en son sein, ou plutôt son propre être-pour-l’autre (son corps n’est plus un outil, il porte en lui l’idée, même métaphorique, de l’Infini) avorté : c’est aussi l’Absence qui témoigne de sa faillite, et qui exclut le reste du monde de cette nouvelle altérité entrevue et tuée dans l'oeuf. Elle en cherche la trace dans le contact avec l’écorce d’un arbre. Et elle lui parle, à cette Absence – sans qu’elle puisse répondre. La séquence finale, ponctuée par quelques notes d’une sonate de Beethoven, où Lorna se calfeutre et se recroqueville dans une cabane obscure au fond des bois en chuchotant à son enfant imaginaire (« J’ai laissé mourir ton père, je ne te laisserai pas mourir »), est bouleversante. Lorna se retire du monde sensible.
Ni condamnation, ni rédemption, mais possibilité d'une rédemption : Le Silence de Lorna, en grande œuvre éthique, ne nous dit pas comment agir avec Autrui, mais nous montre ce qui se noue d’essentiel, de crucial, d’éminemment humain, dans la nécessaire révélation du face-à-face.
 Je connais peu de postures aussi agaçantes que celle du cinéphile passéiste, aux yeux duquel toute œuvre réalisée par un cinéaste vivant n’est à voir que pour mieux la compisser. Je n’ai, il est vrai, visionné en salles qu’un très petit nombre de films cette année, mais non seulement ces rares élus ne m’ont pas déçu, mais encore, ils m’ont souvent enthousiasmé. Les frères Coen, monolithiques (No Country For Old Men), Arnaud Desplechin, toujours inventif (Un conte de Noël), Béla Tarr, élégiaque (L’Homme de Londres), Laurent Cantet, imprévisible (Entre les murs) et Matteo Garrone, impressionnant (Gomorra), m’ont encore prouvé la vitalité intacte d’un cinématographe du XXIe siècle cependant élevé à sa plus haute expression par deux films d’exception, Le Silence de Lorna de Luc et Jean-Pierre Dardenne, et Hunger (en photo ici) de Steve McQueen, certes pas exempt de défauts mais d’une si stupéfiante beauté que nous ne retiendrons qu’elle.
Je connais peu de postures aussi agaçantes que celle du cinéphile passéiste, aux yeux duquel toute œuvre réalisée par un cinéaste vivant n’est à voir que pour mieux la compisser. Je n’ai, il est vrai, visionné en salles qu’un très petit nombre de films cette année, mais non seulement ces rares élus ne m’ont pas déçu, mais encore, ils m’ont souvent enthousiasmé. Les frères Coen, monolithiques (No Country For Old Men), Arnaud Desplechin, toujours inventif (Un conte de Noël), Béla Tarr, élégiaque (L’Homme de Londres), Laurent Cantet, imprévisible (Entre les murs) et Matteo Garrone, impressionnant (Gomorra), m’ont encore prouvé la vitalité intacte d’un cinématographe du XXIe siècle cependant élevé à sa plus haute expression par deux films d’exception, Le Silence de Lorna de Luc et Jean-Pierre Dardenne, et Hunger (en photo ici) de Steve McQueen, certes pas exempt de défauts mais d’une si stupéfiante beauté que nous ne retiendrons qu’elle. Bien que guidés par ma seule intuition, mes errements dans le labyrinthe musical mondial n’ont pas été moins fructueux : l’électro dépressive de Blue Shif Emissions de Christ ; l’album éponyme, entre Tétris, punk et New Wave, de Crystal Castles ; les guitares et autres machines de Justin Broadrick (cf. photo ci-contre) et Jesu (Pale Sketches – dont j’ai pu glisser un extrait lors de mon passage dans l’émission d’Éric Vial sur Fréquence Protestante –, Why are we not perfect ?, et J2 avec l’ex-Swans Jarboe, dont le Tribal Limbo résonne encore dans mes neurones) ; Battles et leur single de la mort Atlas (l’album s’intitule Mirrored), détonnant mélange de riffs, de samples et d’Alvin et les Chipmunks (si, si) ; Person Pitch de Panda Bear et ses boucles psychédéliques qui vous font sourire connement ; Earth et son Omen’s and Portents I – The Driver (sur l’album The Bees Made Honey in the Lion’s Skull) d’une pureté étonnante, idéale (j’imagine) pour rouler dans le désert ; le dub hip hop noise de The Bug, alias Kevin Martin (London Zoo) ; le dernier Sigur Rós, plus festif mais toujours beau (Með suð í eyrum við spilum endalaust) et son Festival aux extases quasi-religieuses) ; la cosmic disco de Hans-Peter Lindstrøm (Where you go, I go too) ; l’électro-Krautrock mort-vivant de Zombie Zombie (A Land for Renegades) ; et l’ambient torturée de Portishead (Third, et sa corne finale qui me rappelle immanquablement les tripodes de War of the Worlds de Spielberg), ont tous habité mes innombrables voyages en métro ou en RER. Et les concerts de Sigur Rós (au Zénith) et de Killing Joke (au Trabendo) furent d’inoubliables moments de grâce et de furie. Et je ne passerai pas sous silence la prestation énergique des excellents Idem au Nouveau Casino (merci, sTeF) ; le concert, un peu trop lisse mais efficace, de Radiohead à Bercy, et la grandiose représentation de l’opéra de David Cronenberg et Howard Shore, The Fly au Théâtre du Châtelet, injustement désintégré par une critique qui n’y a visiblement rien entendu. Tandis que, après le spectacle, Sébastien et moi devisions tranquillement en compagnie de Philippe Curval et de sa charmante épouse Anne Tronche, un journaliste de Variety nous interrogea ; de notre mini-interview sur le trottoir, notre reporter a surtout retenu dans son article quelques mots de Philippe (« “Maybe the music's in danger of being monotonous, but the opera's a fascinating case of a director commenting on his earlier work,” said French writer Philippe Curval after the show »), non sans relever, quoique anonymement, l’enthousiasme des « Cronenberg fans » (autrement dit : Sébastien et moi). Belle moisson musicale, donc.
Bien que guidés par ma seule intuition, mes errements dans le labyrinthe musical mondial n’ont pas été moins fructueux : l’électro dépressive de Blue Shif Emissions de Christ ; l’album éponyme, entre Tétris, punk et New Wave, de Crystal Castles ; les guitares et autres machines de Justin Broadrick (cf. photo ci-contre) et Jesu (Pale Sketches – dont j’ai pu glisser un extrait lors de mon passage dans l’émission d’Éric Vial sur Fréquence Protestante –, Why are we not perfect ?, et J2 avec l’ex-Swans Jarboe, dont le Tribal Limbo résonne encore dans mes neurones) ; Battles et leur single de la mort Atlas (l’album s’intitule Mirrored), détonnant mélange de riffs, de samples et d’Alvin et les Chipmunks (si, si) ; Person Pitch de Panda Bear et ses boucles psychédéliques qui vous font sourire connement ; Earth et son Omen’s and Portents I – The Driver (sur l’album The Bees Made Honey in the Lion’s Skull) d’une pureté étonnante, idéale (j’imagine) pour rouler dans le désert ; le dub hip hop noise de The Bug, alias Kevin Martin (London Zoo) ; le dernier Sigur Rós, plus festif mais toujours beau (Með suð í eyrum við spilum endalaust) et son Festival aux extases quasi-religieuses) ; la cosmic disco de Hans-Peter Lindstrøm (Where you go, I go too) ; l’électro-Krautrock mort-vivant de Zombie Zombie (A Land for Renegades) ; et l’ambient torturée de Portishead (Third, et sa corne finale qui me rappelle immanquablement les tripodes de War of the Worlds de Spielberg), ont tous habité mes innombrables voyages en métro ou en RER. Et les concerts de Sigur Rós (au Zénith) et de Killing Joke (au Trabendo) furent d’inoubliables moments de grâce et de furie. Et je ne passerai pas sous silence la prestation énergique des excellents Idem au Nouveau Casino (merci, sTeF) ; le concert, un peu trop lisse mais efficace, de Radiohead à Bercy, et la grandiose représentation de l’opéra de David Cronenberg et Howard Shore, The Fly au Théâtre du Châtelet, injustement désintégré par une critique qui n’y a visiblement rien entendu. Tandis que, après le spectacle, Sébastien et moi devisions tranquillement en compagnie de Philippe Curval et de sa charmante épouse Anne Tronche, un journaliste de Variety nous interrogea ; de notre mini-interview sur le trottoir, notre reporter a surtout retenu dans son article quelques mots de Philippe (« “Maybe the music's in danger of being monotonous, but the opera's a fascinating case of a director commenting on his earlier work,” said French writer Philippe Curval after the show »), non sans relever, quoique anonymement, l’enthousiasme des « Cronenberg fans » (autrement dit : Sébastien et moi). Belle moisson musicale, donc.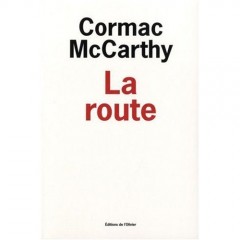 La situation est plus nettement critique si je me tourne vers ma bibliothèque : si l’on excepte, en science-fiction, les rééditions ou nouvelles traductions (Le Temps incertain et Soleil chaud poisson des profondeurs de Michel Jeury, Sauvagerie, La Forêt de cristal, Le Monde englouti et les Nouvelles complètes vol. 1 de J.G. Ballard), pas grand-chose en effet à se mettre sous la dent – mais je n’ai lu ni 2666, ni Contre-Jour, et pas plus les Volodine/Bassmann). Bastard Battle de Céline Minard, Pixel Juice et NymphoRmation de Jeff Noon, ont réussi à me surprendre (comme, dans une moindre mesure, Lothar Blues de Philippe Curval et Lacrimosa de Régis Jauffret), mais en définitive leurs jouissives étincelles ont été totalement éclipsées par une étoile autrement plus intense : La Route de Cormac McCarthy. Depuis près d’un an en effet, le père et l’enfant poursuivent leur errance crépusculaire sur les gris sentiers de mon cortex. L’émotion est intacte : leur feu brille, miraculeux, dans la nuit littéraire contemporaine, qu’heureusement éclairent aussi d’un lustre éternel les astres du passé : Dostoïevski (Carnets du sous-sol, Le Double, Les Frères Karamazov), Gogol (Nouvelles de Petersbourg), Melville (Moby Dick et sa quête concentrique de Dieu, relu dans la sublime traduction d’Armel Guerne) ou Nabokov, dont le Lolita irradie encore, tel un soleil noir, sur mon trente-deuxième hiver, ont tout emporté sur leur passage.
La situation est plus nettement critique si je me tourne vers ma bibliothèque : si l’on excepte, en science-fiction, les rééditions ou nouvelles traductions (Le Temps incertain et Soleil chaud poisson des profondeurs de Michel Jeury, Sauvagerie, La Forêt de cristal, Le Monde englouti et les Nouvelles complètes vol. 1 de J.G. Ballard), pas grand-chose en effet à se mettre sous la dent – mais je n’ai lu ni 2666, ni Contre-Jour, et pas plus les Volodine/Bassmann). Bastard Battle de Céline Minard, Pixel Juice et NymphoRmation de Jeff Noon, ont réussi à me surprendre (comme, dans une moindre mesure, Lothar Blues de Philippe Curval et Lacrimosa de Régis Jauffret), mais en définitive leurs jouissives étincelles ont été totalement éclipsées par une étoile autrement plus intense : La Route de Cormac McCarthy. Depuis près d’un an en effet, le père et l’enfant poursuivent leur errance crépusculaire sur les gris sentiers de mon cortex. L’émotion est intacte : leur feu brille, miraculeux, dans la nuit littéraire contemporaine, qu’heureusement éclairent aussi d’un lustre éternel les astres du passé : Dostoïevski (Carnets du sous-sol, Le Double, Les Frères Karamazov), Gogol (Nouvelles de Petersbourg), Melville (Moby Dick et sa quête concentrique de Dieu, relu dans la sublime traduction d’Armel Guerne) ou Nabokov, dont le Lolita irradie encore, tel un soleil noir, sur mon trente-deuxième hiver, ont tout emporté sur leur passage.







 Le dispositif formel d’Entre les murs (Palme d’Or à Cannes) est extrêmement simple. Certains ont noté le positionnement des caméras, toujours du même côté de la classe, en arbitre impartial du jeu qui se déroule sous nos yeux. Nous avons d’une part le professeur, avec sa personnalité propre, ses idées, ses méthodes – bonnes ou mauvaises –, son système pédagogique, ses positions sur la discipline, ses errements et ses dérapages, un professeur, en somme, qui fait ce qu’il peut pour faire son travail, transmettre un savoir et éveiller ces adolescents à la réflexion, à la curiosité, bref, à l’intelligence en acte ; nous avons de l’autre les élèves agités, inattentifs, parfois violents, avec leur tchatche, leurs insultes, leur langage spécifique – un langage rompu aux arcanes du combat, comme le note justement Pierre Cormary dans une
Le dispositif formel d’Entre les murs (Palme d’Or à Cannes) est extrêmement simple. Certains ont noté le positionnement des caméras, toujours du même côté de la classe, en arbitre impartial du jeu qui se déroule sous nos yeux. Nous avons d’une part le professeur, avec sa personnalité propre, ses idées, ses méthodes – bonnes ou mauvaises –, son système pédagogique, ses positions sur la discipline, ses errements et ses dérapages, un professeur, en somme, qui fait ce qu’il peut pour faire son travail, transmettre un savoir et éveiller ces adolescents à la réflexion, à la curiosité, bref, à l’intelligence en acte ; nous avons de l’autre les élèves agités, inattentifs, parfois violents, avec leur tchatche, leurs insultes, leur langage spécifique – un langage rompu aux arcanes du combat, comme le note justement Pierre Cormary dans une  Au centre, donc, la caméra. D’autres critiques ont par ailleurs évoqué le morcellement de l’espace par le montage. Au plan d’ensemble, Laurent Cantet préfère ici le plan rapproché et le gros plan : c’est avec la même neutralité que sont non pas jugés mais observés François Marin/Bégaudeau, ses élèves, ses collègues dans la salle des profs ou au conseil de classe… Observés, non froidement comme les cobayes de quelque expérience, non comme des figures générales (« prof », « élèves ») mais avec empathie, c’est-à-dire considérés comme des individus à part entière, dans toute leur singularité. S’il y a bien confrontation, donc, entre une classe et un professeur, cette classe n’en est pas moins constituée d’élèves d’origines sociales et ethniques diverses, qui eux aussi ont leur histoire, leurs préoccupations, et leur personnalité propres. Le jeu de champs et contrechamps serrés qui fusent au rythme quasi slamé des répliques, vise moins à « donner raison » aux méthodes de Marin (par exemple lors de ses face-à-face avec son rival idéologique, le prof d’histoire), dont nous avons vu qu’elles étaient pour le moins discutables – surtout en matière de discipline –, qu’à nous faire reconsidérer les débats autour de l’école – malgré toutes les réserves, souvent d’une violence hors de propos, que suscitent ses choix pédagogiques, Marin/Bégaudeau parvient parfois à ses fins mieux que quiconque –, ainsi qu’à mettre en scène un rapport de force – à chacun son territoire : s’ils tolèrent tout juste l’autorité du professeur dans l’enceinte de la salle de cours, les élèves s’opposent violemment à lui lorsque ce dernier, dans une séquence d’une rare intensité, s’en prend à eux dans la cour, leur domaine… Reste que cette fragmentation de l’espace tend à égaliser la parole (« Pour vous, enculé, c’est comme pour nous, pétasse »), à relativiser l’importance des uns et des autres, à embrasser avec la même bienveillance la parole du professeur et celle des élèves. C’est d’ailleurs le principal reproche fait au film par ses détracteurs, souvent professeurs eux-mêmes… Ils ont tort : si Entre les murs épouse le point de vue de Marin/Bégaudeau, il n’en montre pas moins ses inquiétantes impasses. À cette fragmentation paritaire et égalitaire de l’espace, qui fait clairement écho à la perte de pouvoir du professeur, s’ajoute un troisième choix essentiel de mise en scène, d’autant plus discret qu’il n’est pas visible, et décisif pour la compréhension du film : l’aplatissement temporel.
Au centre, donc, la caméra. D’autres critiques ont par ailleurs évoqué le morcellement de l’espace par le montage. Au plan d’ensemble, Laurent Cantet préfère ici le plan rapproché et le gros plan : c’est avec la même neutralité que sont non pas jugés mais observés François Marin/Bégaudeau, ses élèves, ses collègues dans la salle des profs ou au conseil de classe… Observés, non froidement comme les cobayes de quelque expérience, non comme des figures générales (« prof », « élèves ») mais avec empathie, c’est-à-dire considérés comme des individus à part entière, dans toute leur singularité. S’il y a bien confrontation, donc, entre une classe et un professeur, cette classe n’en est pas moins constituée d’élèves d’origines sociales et ethniques diverses, qui eux aussi ont leur histoire, leurs préoccupations, et leur personnalité propres. Le jeu de champs et contrechamps serrés qui fusent au rythme quasi slamé des répliques, vise moins à « donner raison » aux méthodes de Marin (par exemple lors de ses face-à-face avec son rival idéologique, le prof d’histoire), dont nous avons vu qu’elles étaient pour le moins discutables – surtout en matière de discipline –, qu’à nous faire reconsidérer les débats autour de l’école – malgré toutes les réserves, souvent d’une violence hors de propos, que suscitent ses choix pédagogiques, Marin/Bégaudeau parvient parfois à ses fins mieux que quiconque –, ainsi qu’à mettre en scène un rapport de force – à chacun son territoire : s’ils tolèrent tout juste l’autorité du professeur dans l’enceinte de la salle de cours, les élèves s’opposent violemment à lui lorsque ce dernier, dans une séquence d’une rare intensité, s’en prend à eux dans la cour, leur domaine… Reste que cette fragmentation de l’espace tend à égaliser la parole (« Pour vous, enculé, c’est comme pour nous, pétasse »), à relativiser l’importance des uns et des autres, à embrasser avec la même bienveillance la parole du professeur et celle des élèves. C’est d’ailleurs le principal reproche fait au film par ses détracteurs, souvent professeurs eux-mêmes… Ils ont tort : si Entre les murs épouse le point de vue de Marin/Bégaudeau, il n’en montre pas moins ses inquiétantes impasses. À cette fragmentation paritaire et égalitaire de l’espace, qui fait clairement écho à la perte de pouvoir du professeur, s’ajoute un troisième choix essentiel de mise en scène, d’autant plus discret qu’il n’est pas visible, et décisif pour la compréhension du film : l’aplatissement temporel.




