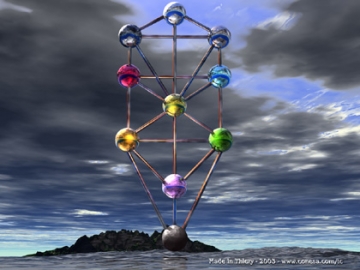« On m’appelle l’Exterminateur. […]
Ma mission présente : dénicher ceux qui vivent encore et les exterminer. Pas les corps, mais les moules, les matrices, comprends-tu ? – mais non, j’oublie que tu ne peux pas comprendre… Il n’en reste que quelques-uns, et un seul suffirait à pourrir toute la soupe. »
William S. Burroughs, Le Festin Nu.
« – S’il vous plaît, Mademoiselle ! Avez-vous déjà vu une vache se traire toute seule ? Et c’est pourtant avec soulagement qu’elle donne son lait. Du reste, puisqu’il est impossible de franchir l’Ange Gardien sans s’être préalablement débarrassé de son corps, dites-moi un peu quel sens cela aurait-il de laisser pourrir dans la rue de beaux morceaux tels que les vôtres ? »
Cesare Battisti, Avenida Revolución.
En attendant des critiques plus fraîches – je pense entre autres à Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec et à La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq, dont l’omniprésence médiatique ne doit pas oblitérer l’intérêt –, revenons sur un autre écrivain, vraisemblablement mineur mais non moins lucide (et, quand les nécessités matérielles se font moins pressantes, vraiment talentueux), qui, l’an dernier, fit lui aussi couler beaucoup d’encre, quoique pour de fort mauvaises raisons : je veux parler bien sûr de mon ami Cesare Battisti, en cavale depuis plus d’un an après la trahison d’un gouvernement français lâche, pusillanime, oublieux, semble-t-il, de certains développements étranges des temps passés. L’injure ne doit certes pas disparaître si facilement du souvenir, comme aurait dit Ducasse, mais une fois proclamé mon mépris, le mieux que je puisse, faire, sans doute, est encore de montrer à ces serpents qui, d’eux ou de leur malheureuse cible, restera dans la mémoire des hommes autrement – est-il seulement besoin de le préciser ? – que pour ses perfidies. Plutôt que de m’étendre en vain sur cette bien triste affaire, je vous propose donc une critique largement révisée, jadis publiée sur le site Mauvais Genres, de son livre le plus étonnant, le plus libre, le plus poignant : Avenida Revolución.
Reproduisons au préalable, afin que vous sachiez de quoi il retourne – et pour clouer le bec à certain poujadiste intellectuel, dont le nom ne mérite pas d'être mentionné, qui m’accuse sur son site aussi fat que médiocre de représenter, je cite, une littérature « de l’ésotérisme et de l’occultisme » ! –, le résumé qu’en fait Claude Mesplède, éminent spécialiste du roman policier, pour amazon.com : « Fils d'un sculpteur d'anges, Antonio Casagrande est expert-comptable dans une biscuiterie milanaise où il a du mal à supporter son patron. Il se console de son ennui en rêvant de voyages devant sa mappemonde. Un jour, il gagne un voyage en camping-car qui doit lui permettre de traverser l'Amérique du Nord. Après une arrivée mouvementée à Mexico, il récupère le véhicule, roule jusqu'à Tijuana, ville frontière avec les États-Unis, s'installe dans un terrain de camping et sympathise avec des actrices de films pornos. Mais une tornade se déchaîne. Les eaux dévastent tout, et Antonio perd sa voiture, son argent, son passeport, tout en sauvant un touriste italien qui lui ressemble et qui disparaît en lui confiant son propre passeport. Antonio tente de poursuivre son voyage mais, pourchassé par la police, il doit survivre à Tijuana, mêlé aux centaines de pauvres qui tentent vainement de franchir la frontière. »
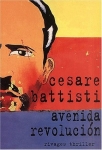 Au-delà de ses péripéties endiablées, Avenida Revolución conte l’aventure intérieure d’un homme ordinaire gagné par la folie (et/ou, nous le verrons, par le désespoir). S’il fallait le définir en quelque mots, l’indexer selon les modes commerçantes – l’étiqueter comme une vulgaire marchandise –, nous pourrions alors le classer au rayon des « feuilletons » policiers, pour la succession échevelée des rebondissements narratifs ; aussi bien qu’au rayon des « romans noirs » pour son contexte – un Mexique rongé par la misère et la corruption – et le parcours de Casagrande – sexe, violence, alcool en milieu interlope. Mais en lieu et place de la soupe fadasse que promettait une aussi commune bouillabaisse – surtout de la part d’un auteur qui s’était rendu coupable d’un « Poulpe » franchement calamiteux (quasiment un euphémisme…) intitulé J’aurai ta Pau (mais aussi, tout de même, d’un excellent roman sur les années de plomb : Dernières cartouches chez Rivages) –, Avenida Revolución s’impose comme une œuvre extrêmement cohérente bien qu’hétéroclite, inventive bien que référentielle et, ce qui ne gâche rien, aussi palpitante que le mieux construit des thrillers. L’aspect le plus intéressant du roman cependant est sans conteste son incursion imprévue dans l’onirisme : ni lyrisme pompier ni fantastique avéré, Avenida Revolución nous plonge dans la réalité subjective d’Antonio Casagrande, au coeur de son esprit imaginatif et pertrbé, dans un œil du cyclone pas si éloigné des fantasmes-fiction de William S. Burroughs.
Au-delà de ses péripéties endiablées, Avenida Revolución conte l’aventure intérieure d’un homme ordinaire gagné par la folie (et/ou, nous le verrons, par le désespoir). S’il fallait le définir en quelque mots, l’indexer selon les modes commerçantes – l’étiqueter comme une vulgaire marchandise –, nous pourrions alors le classer au rayon des « feuilletons » policiers, pour la succession échevelée des rebondissements narratifs ; aussi bien qu’au rayon des « romans noirs » pour son contexte – un Mexique rongé par la misère et la corruption – et le parcours de Casagrande – sexe, violence, alcool en milieu interlope. Mais en lieu et place de la soupe fadasse que promettait une aussi commune bouillabaisse – surtout de la part d’un auteur qui s’était rendu coupable d’un « Poulpe » franchement calamiteux (quasiment un euphémisme…) intitulé J’aurai ta Pau (mais aussi, tout de même, d’un excellent roman sur les années de plomb : Dernières cartouches chez Rivages) –, Avenida Revolución s’impose comme une œuvre extrêmement cohérente bien qu’hétéroclite, inventive bien que référentielle et, ce qui ne gâche rien, aussi palpitante que le mieux construit des thrillers. L’aspect le plus intéressant du roman cependant est sans conteste son incursion imprévue dans l’onirisme : ni lyrisme pompier ni fantastique avéré, Avenida Revolución nous plonge dans la réalité subjective d’Antonio Casagrande, au coeur de son esprit imaginatif et pertrbé, dans un œil du cyclone pas si éloigné des fantasmes-fiction de William S. Burroughs.
A première vue donc, Avenida Revolución décrit la descente aux enfers d’un petit comptable italien à la frontière américano-mexicaine, où il est brutalement confronté à des univers dangereux, sordides et pathétiques, mais aussi à une humanité plus chaleureuse, plus authentique que dans sa froide Italie du nord. Les jeunes qui « adoptent » Antonio sous le sobriquet de « Chompetta », enfants livrés à eux-mêmes, parias contraints de voler pour survivre – et pour subvenir aux besoins vitaux de leurs proches –, évoquent ceux de Los Olvidados de Luis Buñuel, cinéaste avec qui Battisti partage, en plus d’une rage commune contre la bourgeoisie et toutes les formes organisées du pouvoir, cette singulière capacité à mêler inextricablement rêve et réalisme cru, horreur et poésie. Evidemment, il ne serait pas moins pertinent de chercher des références chez ses compatriotes : citons au moins Vittorio De Sica (les enfants de Sciuscia) et Federico Fellini, dont la démesure aussi bien que l’humanisme ont visiblement marqué Battisti. Mais s’il fallait trouver des équivalents cinématographiques, il faudrait peut-être se tourner, en plus de Buñuel, vers le Japonais Shohei Imamura (La Femme insecte) : comme lui, Battisti passe sans problème et avec une force accrue du naturalisme le plus dur au grotesque grinçant, évitant ainsi tout misérabilisme, et tout militantisme ostentatoire : plutôt l’inquiétante fantaisie de Dr Akagi, en somme, que le sentimentalisme social de Miracle à Milan. Curieusement Avenida Revolución, pourtant indéniablement personnel, ne cesse en effet d’inspirer de nouvelles correspondances. Kafka en est un autre exemple, parmi les plus évidents : Avenida Revolución recèle son lot de bureaucratie insensée, d’acharnement absurde de la justice, de mouvements de résistance (puis d’autodestruction), et même d’insectes grouillants, métaphores de sa prodigieuse (et tragique) métamorphose… On pense aussi au Céline de Voyage au bout de la nuit parfois – toutes proportions gardées –, pas tant pour son style, nettement moins inventif, moins abrasif, que pour cette urgence à établir un constat aussi banal qu’essentiel : la violence, la misère dont les petites gens sont les victimes impuissantes, sont totalement inutiles. L’une des figures majeures d’Avenida Revolución est ce fameux mur de Tijuana, le cerco, rempart de tôle ondulée édifié à la frontière du Mexique et des Etats-Unis pour endiguer l’immigration de Latino-Américains cherchant un avenir meilleur. Le mur, cause de nombreuses mort chaque année – déshydratation en été, froid en hiver, noyade pour ceux qui, prêts à tout, essaient de contourner l’obstacle, tirs sans sommation des militaires frontaliers… –, et dont on peine à croire qu’il n’est pas le fruit de l’imagination de Cesare Battisti, existe pourtant réellement. Il hante même Antonio Casagrande, qui fait de son franchissement, comme de nombreux habitants – ils sont plus d’un demi-million – de Tijuana, un objectif ultime, une Terre Promise. Lieu de tous les désirs, il symbolise à merveille les espoirs des personnages. Antonio, dans sa fièvre délirante, va d’ailleurs jusqu’à provoquer une révolution trash, poussant le peuple à ensevelir le cerco sous des montagnes d’excréments pour provoquer sa destruction ! Le mur abattu – le lecteur, incrédule, croit rêver –, enfin terrassé par la merde qu’il prétendait contenir, de nouveaux problèmes surviennent, rétablissant en quelque sorte l’ordre des choses. Le chaos, les pillages, la barbarie, succèdent à l’ordre destitué – les habitants frontaliers partent, mus par le « rêve américain » – nous savons ce qu’il adviendra de la plupart d’entre eux –, mais la misère et son cortège d’infamies restent.
L’une des figures majeures d’Avenida Revolución est ce fameux mur de Tijuana, le cerco, rempart de tôle ondulée édifié à la frontière du Mexique et des Etats-Unis pour endiguer l’immigration de Latino-Américains cherchant un avenir meilleur. Le mur, cause de nombreuses mort chaque année – déshydratation en été, froid en hiver, noyade pour ceux qui, prêts à tout, essaient de contourner l’obstacle, tirs sans sommation des militaires frontaliers… –, et dont on peine à croire qu’il n’est pas le fruit de l’imagination de Cesare Battisti, existe pourtant réellement. Il hante même Antonio Casagrande, qui fait de son franchissement, comme de nombreux habitants – ils sont plus d’un demi-million – de Tijuana, un objectif ultime, une Terre Promise. Lieu de tous les désirs, il symbolise à merveille les espoirs des personnages. Antonio, dans sa fièvre délirante, va d’ailleurs jusqu’à provoquer une révolution trash, poussant le peuple à ensevelir le cerco sous des montagnes d’excréments pour provoquer sa destruction ! Le mur abattu – le lecteur, incrédule, croit rêver –, enfin terrassé par la merde qu’il prétendait contenir, de nouveaux problèmes surviennent, rétablissant en quelque sorte l’ordre des choses. Le chaos, les pillages, la barbarie, succèdent à l’ordre destitué – les habitants frontaliers partent, mus par le « rêve américain » – nous savons ce qu’il adviendra de la plupart d’entre eux –, mais la misère et son cortège d’infamies restent.
Demeure surtout l’émouvant désenchantement de Cesare Battisti, témoin de l’entropie universelle, dont le regard sur ses propres idéaux révolutionnaires (et sur la lutte armée) s’est profondément modifié (ici en filigrane, cette désillusion était même au cœur de cet autre excellent roman, Dernières cartouches). Malgré le parcours que l’on sait, en dépit des épreuves endurées, dont l’exil n’est pas la moindre, Cesare Battisti ne laisse jamais place dans Avenida Revolución à l’aigreur, à la rancune ou à la haine. La conscience politique de l’auteur est certes intacte, toujours aussi vive, mais, comme il est dit dans Dernières cartouches, la fin ne justifie pas les moyens. Les deux romans, extrêmement lucides, expriment tous deux la volonté de détruire l’ordre établi, mais aussi l’impérieuse – et implicite – nécessité d’en instituer un autre tout aussi solide, sans quoi le chaos, selon le fameux second principe de la thermodynamique, menace. Cesare Battisti, étranger à toute mondanité, marqué dans sa chair et dans son âme par un passé de lui seul connu, n’oublie jamais de replacer l’homme au cœur de ses préoccupations.
La vérité, en effet, est à chercher ailleurs. Antonio, à ses heures perdues, écrit des textes étranges, fiction hallucinée, fantastique, incantatoire. Il lui arrive aussi, nous apprend-on dès les premières pages, de rêver à des voyages, de « faire comme si », seul dans son appartement en proie aux parasites, pointant un endroit au hasard sur sa mappemonde avant de laisser dériver son imagination. Or, au début du roman, en cette soirée qui bouleverse la vie du héros, la mappemonde désigne le Mexique. Ce détail, apparemment simple rime avec la suite, constitue en fait le premier tournant décisif d’un récit à entrées multiples. Antonio, grâce à un miraculeux billet de loterie, s’envole en effet vers le Mexique, comme si son petit jeu fantasmatique avait su infléchir le Réel. Un lecteur distrait s’en tiendrait d’ailleurs à cette description objective des faits, mais comment ne pas deviner qu’Antonio n’est sans doute qu’un aventurier en chambre, employé houellebecquien victime de sa misérable condition ? Ces aventures sont-elles donc rêvées par un Casagrande endormi ? imaginées par un Casagrande en mal de fantaisie ? écrites par un Casagrande écrivain ?...
Les deux premiers chapitres, à y regarder de plus près, nous livrent déjà toutes les clés du roman : les cafards, la tempête (évoquée dès la première page), le Mexique, la femme objet de désir (Brigida, matrice de la Silvia de la partie mexicaine) et la misère affective et sexuelle, les velléités d’écriture, l’usurpation d’identité (son patron, Martini, lui demande de se faire passer pour lui auprès d’un client hollandais), le désespoir, s’y trouvent déjà… Une brève analyse rétrospective de ces deux chapitres (l’introduction milanaise) nous renseigne de surcroît sur l’indétermination ontologique de toutes les pages qui suivront : père castrateur, désir de s’évader de son quotidien balisé, banal et conventionnel, peur de voir les cafards proliférer dans son appartement – autant d’éléments développés au cours de l’aventure proprement dite, parfois directement mais le plus souvent soumis au « travail » de l’inconscient, selon la terminologie freudienne…
Luigi Trombetta, le mystérieux écrivain italien avec qui Casagrande échange son identité – la quête d’identité est l’un des thèmes majeurs de Battisti –, est évidemment son Doppelganger, son double de fiction, alter ego viril et baroudeur. Tous les personnages (Gomez H., Silvia, Trombetta…) représentent d’ailleurs une part de Casagrande, dont l’inconscient fait mieux que surgir dans le récit : il le crée. La prolifération des sergents Gomez H. par exemple, clones-flics particulièrement sournois (révélateurs de l’imposture du héros), est assurément la manifestation déformée de cette angoisse liée aux cancrelats, en même temps qu’une tentative désespérée de retour à l’ordre mental. L’obsession d’Antonio pour la taille réduite de son pénis et pour ses performances sexuelles, est de même annoncée, dans l’introduction milanaise, par l’évocation de ce père castrateur – matériau idéal pour lui inventer une sexualité vaillante et débridée. Le statut de comptable d’Antonio refait lui-même surface de loin en loin, comme si la réalité objective, captive du piège schizophrénique, cherchait à se manifester d’une manière ou d’une autre à la conscience du héros. Comme dans un rêve, Antonio semble réaliser avec son périple mexicain ses désirs les plus intimes…
Battisti, plus retors que jamais, a eu par ailleurs, comme je l’ai suggéré plus haut, l’astucieuse idée du roman dans le roman, dévoilé en une dizaine de fragments ouvertement fantastiques et allégoriques tout au long du récit, qui tendent par le jeu naturel des comparaisons à modérer, voire à annihiler nos soupçons. Et pourtant le lecteur, pas si bête, devine que les événements dont Antonio est témoin, sont presque aussi improbables que ceux, franchement délirants, qu’il imagine dans son roman. Autant vous prévenir : rien ne vous permettra de trancher. Fantasme, inconscient et réalité diégétique finissent par se confondre, par s’entortiller, par annihiler nos vaines tentatives pour découvrir l’insaisissable vérité, comme chez William Burroughs, qu’Avenida Revolución rappelle par bien des égards (mais dans une version populaire, accessible au plus grand nombre car travestie en roman noir) : Antonio écrit dans un état second, ne découvrant sa prose (surréaliste, terrifiante, pornographique, traversées par des fantasmes homosexuels) qu’après coup, comme Burroughs lui-même (ainsi que le montrait admirablement l’adaptation à l’écran par David Cronenberg). De toute évidence le Tijuana de Casagrande – de Cesare Battisti ? – renvoie au Tanger de Burroughs, ce lieu des possibles, des désirs comme de toutes peurs (et le Milan fantastique du roman d’Antonio est un peu son Interzone personnelle). Au début du récit, Casagrande submerge son appartement de produit contre les cafards, or Burroughs lui-même n’usait-il pas d’une telle poudre comme d’un puissant (et destructeur) psychotrope ? L’inhalation de la Black Death (la Mort Noire) aurait-elle suscité ces aventures abracadabrantesques ?…
A la fin, Antonio Casagrande, empêtré dans son labyrinthe schizophrénique, n’a d’autre choix (comme le laisse entendre Gomez H. à plusieurs reprises) que de se donner la mort, d’une balle dans la poitrine, dans les flots de l’océan. Intervient alors l’avant-dernier paragraphe : « La détonation se répercuta dans l’appartement, au troisième étage. » Est-il vivant ? Est-il mort ? Est-il à Milan ? A Tijuana ? Comment savoir ?... Quoi qu’il en soit, Avenida Revolución ne serait pas tant le récit initiatique attendu que la chronique ludique, « populaire » et hallucinée d’un homme sans qualité en proie à la solitude, au désespoir, et au suicide.
Cesare Battisti, Avenida Revolución, Rivages « Thriller », 2001, traduit de l’italien par Claude Sophie Mazéas et Silvia Bonucci.