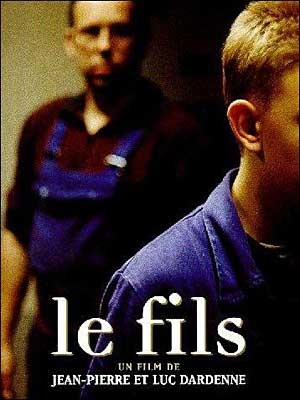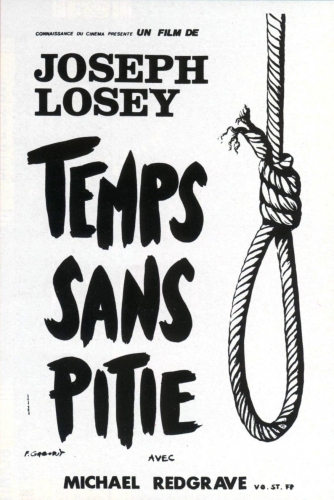Voir Tropical Malady (Sud Pralad, 2004), le quatrième long-métrage du cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul (qu’une amie appelle affectueusement Chapichapo) après le cadavre exquis Mysterious Object at Noon, le sublime Blissfully Yours et l'inédit et musical The Adventure of Iron Pussy, et avant Syndromes and a Century et la Palme d’Or 2010 Oncle Boonmee, constitue l’une des expériences cinématographiques les plus fascinantes qui soient. Le revoir aujourd’hui n’atténue en rien son pouvoir d’envoûtement.

La première heure du film montre l’amour et le désir naissants d’un jeune soldat, Keng, et d’un jeune homme de la campagne, Tong, dans un climat serein, relaxant, entre dancing désuet, salle de cinéma et promenades champêtres – quiétude quasi absolue que vient seulement troubler la scène du temple, prélude à l’inquiétante étrangeté de la seconde partie. Blissfully Yours était entrecoupé en son milieu de son générique, comme pour mieux marquer son virage sensualiste : à une première partie ancrée dans une réalité sociale, urbaine et rurale, succédait une stupéfiante escapade dans la nature sauvage – comme si le film rêvé, le seul qui vaille, devait obligatoirement échapper aux contraintes et conventions du cinéma commercial. Dans Tropical Malady, c’est une chanson pop, presque un clip – point d’orgue du ravissement des deux garçons –, qui sépare les deux parties. Coquetterie post-wong kar-waïesque ? Certainement pas. Le rôle de cette chanson semble dépasser la simple délimitation : elle agit comme un rituel magique et vous plonge dans une torpeur, une certaine somnolence, dont vous ne sortirez plus jusqu’à la fin du film.

Un jeune soldat (Keng ?) – traque dans la jungle un chaman (Tong ?) capable de prendre l’apparence d’animaux. Cette deuxième heure, presque muette, que nous traversons comme sous l’effet d’une drogue douce, rythmée par les stridulations des insectes, le chant d’oiseaux exotiques, des cris mystérieux et des visions hallucinantes (le fantôme d’une vache éventrée quitte son corps et se fond dans la nature ; un arbre s’illumine ; un singe parle…) conte la traque fantastique du soldat en treillis et de l’homme-tigre, nu. Curieusement, il semble que peu de spectateurs aient compris – si tant est qu’il y ait vraiment besoin de comprendre un film d’une telle intensité sensorielle – Tropical Malady et l’articulation entre ses deux chapitres. Rien de plus simple, pourtant. Souvent présentée comme la suite certes allégorique mais bien chronologique de l’histoire d’amour entre les deux hommes, cette lente et nocturne course-poursuite n’en est en vérité qu’une variation, un point de vue – une autre manière, hors de la narration, hors des contingences, hors du temps social, de donner corps à ce qui se noue entre les deux garçons : dans cette autre réalité, celle de l’innocence originelle, peurs et pulsions, amour et désirs, arborent de bien étranges atours. Keng, dont la première partie nous laissait entrevoir les techniques de conquête, est pris à son propre piège, dévoré par sa proie, ainsi qu’en témoigne la rencontre finale du soldat et du tigre-miroir à la voix magnétique, qui l’aspire dans son propre monde, mystérieux.

D’une bluette romantique, et ‘un conte pour enfants, Apichatpong Weerasethakul a fait un chef d’œuvre d’une puissance hypnotique absolument unique dans l’histoire du cinéma.