« Oh, there's weirdo perversions galore !
Guns, hookers and drugs by the score;
Critics should pan it,
They really should ban it,
Or at least put it front of the store »
 Après les psychédélicieux Vurt et Pollen, les éditions la Volte publient aujourd’hui, avec deux nouvelles couvertures signées Corinne Billon, deux autres livres du punk de Manchester, Jeff Noon : un roman, NymphoRmation, et un recueil de
Après les psychédélicieux Vurt et Pollen, les éditions la Volte publient aujourd’hui, avec deux nouvelles couvertures signées Corinne Billon, deux autres livres du punk de Manchester, Jeff Noon : un roman, NymphoRmation, et un recueil de nouvelles, d’histoires, bon, enfin, de fragments, dubs et remix en tout genre : Pixel Juice – respectivement traduits par Alfred Boudry et Marie Surgers. Je remets donc Jeff Noon en première page, avec d’abord un retour sur Pollen (critique parue dans Galaxies n°40 en 2006), puis avec NymphoRmation et Pixel Juice. Si vous ne vous êtes toujours pas plongés dans l’univers désaxé de ce fou-furieux, va falloir vous bouger le cul.
En 1997, les éditions Flammarion publiaient dans leur collection de littérature étrangère un premier roman remarquable, Vurt (1993), alors auréolé d’un prix Arthur C. Clarke. Jeff Noon avait imaginé un monde futuriste totalement déjanté dans lequel le continuum des rêves et des espaces intérieurs interférait (de manière limitée) avec le Réel. Prégnant, original, Vurt était pourtant passé relativement inaperçu ; Alice automate, publié en France l’année suivante, encore plus.
 Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles…
Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles…
Taxi-chien à la cool, Coyote est tué par une jeune fille mystérieuse répondant au nom de Perséphone, d’une façon plus qu’étrange – d’un baiser, la tueuse a introduit dans la gorge de sa victime une fleur létale dont les racines s’implantent dans les poumons – alors qu’il la convoyait à Manchester. Tandis que Sibyl l’Ombre-flic (qui peut capter les dernières pensées d’un mort) et Zéro le chien flic enquêtent sur ce meurtre – sous le regard désapprobateur du chef de la police, Kracker –, Boda, malheureuse conductrice d’Xcab, fuit les sbires de Colombus chargés de l’éliminer. Heureusement, le DJ hippy Gombo Yaya, défoncé 24h/24, entreprend d’aider Boda au nez et à la barbe d’une police un peu dépassée par les événements – d’autant que, pour couronner le tout, le taux de pollen dans l’atmosphère mancunienne ne cesse d’augmenter… Peu à peu la fièvre gagne les habitants, les éternuements se multiplient, la morve coule à flot. Seuls les « Dodos » (celles et ceux qui ne peuvent rêver et n’ont donc pas accès au Vurt), semblent immunisés : ce pollen empoisonné serait-il d’origine vurtuelle ?
L’enjeu de ces « futurs mystères de Manchester » (le Vurt de Pollen, contemporain de La balle du néant, est assez semblable à la Psychosphère de Roland C. Wagner) n’est rien de moins que la tentative d’invasion du Réel par l’une des plus puissantes créatures du Vurt, John Barleycorn, et son épouse Perséphone. Dans ce réservoir d’inconscient collectif qu’est le Vurt, Barleycorn est la représentation personnifiée du Mal ; il est Satan, il est Lucifer, il est Hadès.
On a souvent comparé Jeff Noon à William Gibson. Ce n’est pas immérité, mais nous dirions plutôt que Noon serait un Gibson sous acide, amateur – comme Ballard – de Dali plutôt que d’informatique, et qui aurait laissé libre cours à son imagination. Dans Pollen les standards du rock se succèdent, des Stones au premier album des Pink Floyd ; les éternuements s’étalent sur trois pages ; les hommes baisent tout ce qui bouge, y compris des plantes vertes… Bref, Jeff Noon invente le flowerpunk. Certes, le récit, qui commence comme un roman noir extravagant pour nous plonger ensuite dans un véritable tourbillon d’images surréalistes, menace plusieurs fois de se perdre dans les limbes du n’importe quoi. Mais Jeff Noon déploie un tel talent narratif, une telle maîtrise des dialogues, que jamais la frontière du ridicule n’est franchie.
Néanmoins, quand Vurt et sa bande de junkies pathétiques émouvaient, et évoquaient non sans génie les conséquences de la possible convergence, dans un avenir proche, des drogues et des réalités virtuelles, Pollen se veut davantage ludique – lire : davantage superficiel. Noon s’amuse visiblement comme un fou à inventer un univers littéraire avec ses lois et sa logique propres, qui s’impose moins, ici, comme une allégorie ou une réflexion sur le Mal, que comme un pur exercice de style, brillant mais un peu vain. Ça manque donc un peu de rationalité et de profondeur, c’est un peu gratuit sur les bords, mais c’est du concentré d’imaginaire, c’est délirant, c’est destroy, c’est poétique, c’est psychédélique et complètement barré : c’est Pollen.
*
NymphoRmation (Nymphomation en version originale) opère une synthèse réussie entre la langue explosive et ludique de Pollen, et l’équilibre romanesque – à peine moins fou mais plus attachant – de Vurt.
JOUEZ POUR GAGNER
1999. c’est l’heure de l’AnnoDomino à Manchester. Partout vrombissent les publimouches (les blurbflies, en VO), qui assènent leurs slogans.
« C’est l’heure du domino !
L’heure du domino !
L’heure du dom, dom, dom, dom, domino ! »
 Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double… « C’est l’heure du domino ! L’heure du domino ! L’heure du dom, dom, dom, dom, domino ! » Bien qu’ils soient sérieusement accros, Daisy Love, Jaz et leurs compères de la Fractale Noire vont essayer de percer les secrets du jeu, qu’ils jugent dangereux, et de remonter à sa source… Leur quête mathémagique va les propulser au cœur de la nymphoRmation (un protocole d’accouplement des nombres, ou la sexualité appliquée à l’information...). La chance au jeu a-t-elle une origine génétique ? Jaz va-t-il se métamorphoser en Jaz-publimouche ? Qui se cache derrière M. Million ? Comment faire un bon poulet Dhansak ?
Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double… « C’est l’heure du domino ! L’heure du domino ! L’heure du dom, dom, dom, dom, domino ! » Bien qu’ils soient sérieusement accros, Daisy Love, Jaz et leurs compères de la Fractale Noire vont essayer de percer les secrets du jeu, qu’ils jugent dangereux, et de remonter à sa source… Leur quête mathémagique va les propulser au cœur de la nymphoRmation (un protocole d’accouplement des nombres, ou la sexualité appliquée à l’information...). La chance au jeu a-t-elle une origine génétique ? Jaz va-t-il se métamorphoser en Jaz-publimouche ? Qui se cache derrière M. Million ? Comment faire un bon poulet Dhansak ?
Vous le saurez en lisant NymphoRmation, roman de la guerre des pubs et du jeu divisé en sept manches, souvent interrompu par les slogans des publimouches comme par les règles du jeu (règle 3a : Le jeu est sacro-saint), qui s’attaque pour notre plaisir aux paradis artificiels médiatiques. Jeff Noon cède parfois à quelques facilités (la fin, un peu trop grandguignolesque) mais reste un incroyable littérateur (chaque chapitre commence par un survol de la ville, où s’entrechoquent et fusionnent les mots ; la 45ème manche est ainsi introduite : « Petit matin gris du Jungement dernier. Azimutée. Nonchester la moisie. Lèche tes n’ombres. Manche 45, ô tochtones aux 0ssements éloquents. Faites des bourgeons à la fêlévision. Regardez tout miel le généfric digitastiqué. » etc.) et nous propose une nouvelle galerie de personnages savoureux, qui en dépit du caractère hautement chaotique des événements, parviennent à nous émouvoir. C’est que, si son inventivité éclate à chaque page, NymphoRmation bénéficie d’une construction solide, et d’un art certain de la narration empruntant certains codes et son suspense au polar. C’est aussi parce qu’il nous parle du réel. Les mots se mélangent comme les populations, comme les quartiers, comme les technologies. Peaux brunes, noires, blanches. Pauvres, riches, classes moyennes. Homos, bis, hétéros. Filles, garçons, mouches. Curry, coriandre et morceaux d’information. NymphoRmation, c’est ici, et c’est maintenant.
*
 Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.
Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.
La preuve, dans Pixel Juice, il est question : du légendaire dixième magasin, d’un boisson addictive aux six parfums d’ABSOLU, de paroles qui suicident, de la « Métaphorazine » (ou comment s’envoyer du langage dans les veines), d’allergies alphabétiques, de macs en pagaille, de publimouches, de scaraboussoles, d’une « Cabine Fetish », du projet Alice de Chromosoft et de sa technologie Mirrors, de pubs qui tuent (d’ailleurs la mort devient la pub ultime), de clones-miroirs, d’un mode d’emploi incomplet pour un appareil douteux dont on se saura rien, de la joie d’être pixélisé dans un reportage TV, du système antivol Stigmatica, de la castration numérique, d’une charismachine, d’une chasse à on ne sait trop quoi, du dangereux système Muse, d’une promo exceptionnelle, et même de quelques plumes. Entre autres.
Et ça fonctionne. Jeff Noon excelle dans la forme courte, voire très courte, dans la fulgurance comme dans la forme romanesque. Certains fragments (comme chez Ballard, dans Fièvre guerrière notamment) sont même constitués de lexiques, de modes d’emplois, d’annonces publicitaires. Mais, si l’on peut juger les « dubs » et autres « remix » poétiques un peu légers – du moins dans leur traduction française –, et si les nouvelles plus conventionnelles dans leur forme (« Mini Mac ») sont généralement moins excitantes, c’est dans sa cohérence d’ensemble que Pixel Juice, aux influences multiples (Borges, Gibson, Carroll, Ballard, Burroughs, Cronenberg, Lee Scratch Perry…) impressionne vraiment. A priori, rien de commun entre, par exemple, le récit de « Mini Mac », qui nous décrit l’ascension et la chute d’un mac d’une dizaine d’années, et la promo spéciale pour le modèle Hyper Alice, ou le Dogga dub du DJ Robochien J-Loop… Et si chaque texte en appelle un autre, c’est toujours de façon imprévisible. Tout s’emboîte, mais si l’on oublie le prologue/épilogue, il n’y a ni début, ni fin, comme un Rubik’s Cube qui n’aurait pas de solution, mais aux combinaisons infinies – comme autant de visions, entre dystopie et conte de fée, de notre monde.
Son esthétique singulière, cette manière bien à lui (métaphorisée par la nymphoRmation), de « mixer » les mots et les idées, de les laisser s’accoupler en toute liberté, sied parfaitement à ses récits-miroirs : dans la vie, comme sur le dance-floor ou en littérature, rien ne vaut un bon mix. Vivement la traduction de l’expérimental Cobralingus…
 Je connais peu de postures aussi agaçantes que celle du cinéphile passéiste, aux yeux duquel toute œuvre réalisée par un cinéaste vivant n’est à voir que pour mieux la compisser. Je n’ai, il est vrai, visionné en salles qu’un très petit nombre de films cette année, mais non seulement ces rares élus ne m’ont pas déçu, mais encore, ils m’ont souvent enthousiasmé. Les frères Coen, monolithiques (No Country For Old Men), Arnaud Desplechin, toujours inventif (Un conte de Noël), Béla Tarr, élégiaque (L’Homme de Londres), Laurent Cantet, imprévisible (Entre les murs) et Matteo Garrone, impressionnant (Gomorra), m’ont encore prouvé la vitalité intacte d’un cinématographe du XXIe siècle cependant élevé à sa plus haute expression par deux films d’exception, Le Silence de Lorna de Luc et Jean-Pierre Dardenne, et Hunger (en photo ici) de Steve McQueen, certes pas exempt de défauts mais d’une si stupéfiante beauté que nous ne retiendrons qu’elle.
Je connais peu de postures aussi agaçantes que celle du cinéphile passéiste, aux yeux duquel toute œuvre réalisée par un cinéaste vivant n’est à voir que pour mieux la compisser. Je n’ai, il est vrai, visionné en salles qu’un très petit nombre de films cette année, mais non seulement ces rares élus ne m’ont pas déçu, mais encore, ils m’ont souvent enthousiasmé. Les frères Coen, monolithiques (No Country For Old Men), Arnaud Desplechin, toujours inventif (Un conte de Noël), Béla Tarr, élégiaque (L’Homme de Londres), Laurent Cantet, imprévisible (Entre les murs) et Matteo Garrone, impressionnant (Gomorra), m’ont encore prouvé la vitalité intacte d’un cinématographe du XXIe siècle cependant élevé à sa plus haute expression par deux films d’exception, Le Silence de Lorna de Luc et Jean-Pierre Dardenne, et Hunger (en photo ici) de Steve McQueen, certes pas exempt de défauts mais d’une si stupéfiante beauté que nous ne retiendrons qu’elle. Bien que guidés par ma seule intuition, mes errements dans le labyrinthe musical mondial n’ont pas été moins fructueux : l’électro dépressive de Blue Shif Emissions de Christ ; l’album éponyme, entre Tétris, punk et New Wave, de Crystal Castles ; les guitares et autres machines de Justin Broadrick (cf. photo ci-contre) et Jesu (Pale Sketches – dont j’ai pu glisser un extrait lors de mon passage dans l’émission d’Éric Vial sur Fréquence Protestante –, Why are we not perfect ?, et J2 avec l’ex-Swans Jarboe, dont le Tribal Limbo résonne encore dans mes neurones) ; Battles et leur single de la mort Atlas (l’album s’intitule Mirrored), détonnant mélange de riffs, de samples et d’Alvin et les Chipmunks (si, si) ; Person Pitch de Panda Bear et ses boucles psychédéliques qui vous font sourire connement ; Earth et son Omen’s and Portents I – The Driver (sur l’album The Bees Made Honey in the Lion’s Skull) d’une pureté étonnante, idéale (j’imagine) pour rouler dans le désert ; le dub hip hop noise de The Bug, alias Kevin Martin (London Zoo) ; le dernier Sigur Rós, plus festif mais toujours beau (Með suð í eyrum við spilum endalaust) et son Festival aux extases quasi-religieuses) ; la cosmic disco de Hans-Peter Lindstrøm (Where you go, I go too) ; l’électro-Krautrock mort-vivant de Zombie Zombie (A Land for Renegades) ; et l’ambient torturée de Portishead (Third, et sa corne finale qui me rappelle immanquablement les tripodes de War of the Worlds de Spielberg), ont tous habité mes innombrables voyages en métro ou en RER. Et les concerts de Sigur Rós (au Zénith) et de Killing Joke (au Trabendo) furent d’inoubliables moments de grâce et de furie. Et je ne passerai pas sous silence la prestation énergique des excellents Idem au Nouveau Casino (merci, sTeF) ; le concert, un peu trop lisse mais efficace, de Radiohead à Bercy, et la grandiose représentation de l’opéra de David Cronenberg et Howard Shore, The Fly au Théâtre du Châtelet, injustement désintégré par une critique qui n’y a visiblement rien entendu. Tandis que, après le spectacle, Sébastien et moi devisions tranquillement en compagnie de Philippe Curval et de sa charmante épouse Anne Tronche, un journaliste de Variety nous interrogea ; de notre mini-interview sur le trottoir, notre reporter a surtout retenu dans son article quelques mots de Philippe (« “Maybe the music's in danger of being monotonous, but the opera's a fascinating case of a director commenting on his earlier work,” said French writer Philippe Curval after the show »), non sans relever, quoique anonymement, l’enthousiasme des « Cronenberg fans » (autrement dit : Sébastien et moi). Belle moisson musicale, donc.
Bien que guidés par ma seule intuition, mes errements dans le labyrinthe musical mondial n’ont pas été moins fructueux : l’électro dépressive de Blue Shif Emissions de Christ ; l’album éponyme, entre Tétris, punk et New Wave, de Crystal Castles ; les guitares et autres machines de Justin Broadrick (cf. photo ci-contre) et Jesu (Pale Sketches – dont j’ai pu glisser un extrait lors de mon passage dans l’émission d’Éric Vial sur Fréquence Protestante –, Why are we not perfect ?, et J2 avec l’ex-Swans Jarboe, dont le Tribal Limbo résonne encore dans mes neurones) ; Battles et leur single de la mort Atlas (l’album s’intitule Mirrored), détonnant mélange de riffs, de samples et d’Alvin et les Chipmunks (si, si) ; Person Pitch de Panda Bear et ses boucles psychédéliques qui vous font sourire connement ; Earth et son Omen’s and Portents I – The Driver (sur l’album The Bees Made Honey in the Lion’s Skull) d’une pureté étonnante, idéale (j’imagine) pour rouler dans le désert ; le dub hip hop noise de The Bug, alias Kevin Martin (London Zoo) ; le dernier Sigur Rós, plus festif mais toujours beau (Með suð í eyrum við spilum endalaust) et son Festival aux extases quasi-religieuses) ; la cosmic disco de Hans-Peter Lindstrøm (Where you go, I go too) ; l’électro-Krautrock mort-vivant de Zombie Zombie (A Land for Renegades) ; et l’ambient torturée de Portishead (Third, et sa corne finale qui me rappelle immanquablement les tripodes de War of the Worlds de Spielberg), ont tous habité mes innombrables voyages en métro ou en RER. Et les concerts de Sigur Rós (au Zénith) et de Killing Joke (au Trabendo) furent d’inoubliables moments de grâce et de furie. Et je ne passerai pas sous silence la prestation énergique des excellents Idem au Nouveau Casino (merci, sTeF) ; le concert, un peu trop lisse mais efficace, de Radiohead à Bercy, et la grandiose représentation de l’opéra de David Cronenberg et Howard Shore, The Fly au Théâtre du Châtelet, injustement désintégré par une critique qui n’y a visiblement rien entendu. Tandis que, après le spectacle, Sébastien et moi devisions tranquillement en compagnie de Philippe Curval et de sa charmante épouse Anne Tronche, un journaliste de Variety nous interrogea ; de notre mini-interview sur le trottoir, notre reporter a surtout retenu dans son article quelques mots de Philippe (« “Maybe the music's in danger of being monotonous, but the opera's a fascinating case of a director commenting on his earlier work,” said French writer Philippe Curval after the show »), non sans relever, quoique anonymement, l’enthousiasme des « Cronenberg fans » (autrement dit : Sébastien et moi). Belle moisson musicale, donc.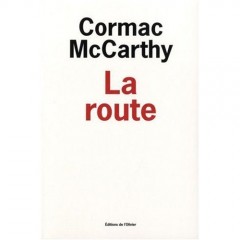 La situation est plus nettement critique si je me tourne vers ma bibliothèque : si l’on excepte, en science-fiction, les rééditions ou nouvelles traductions (Le Temps incertain et Soleil chaud poisson des profondeurs de Michel Jeury, Sauvagerie, La Forêt de cristal, Le Monde englouti et les Nouvelles complètes vol. 1 de J.G. Ballard), pas grand-chose en effet à se mettre sous la dent – mais je n’ai lu ni 2666, ni Contre-Jour, et pas plus les Volodine/Bassmann). Bastard Battle de Céline Minard, Pixel Juice et NymphoRmation de Jeff Noon, ont réussi à me surprendre (comme, dans une moindre mesure, Lothar Blues de Philippe Curval et Lacrimosa de Régis Jauffret), mais en définitive leurs jouissives étincelles ont été totalement éclipsées par une étoile autrement plus intense : La Route de Cormac McCarthy. Depuis près d’un an en effet, le père et l’enfant poursuivent leur errance crépusculaire sur les gris sentiers de mon cortex. L’émotion est intacte : leur feu brille, miraculeux, dans la nuit littéraire contemporaine, qu’heureusement éclairent aussi d’un lustre éternel les astres du passé : Dostoïevski (Carnets du sous-sol, Le Double, Les Frères Karamazov), Gogol (Nouvelles de Petersbourg), Melville (Moby Dick et sa quête concentrique de Dieu, relu dans la sublime traduction d’Armel Guerne) ou Nabokov, dont le Lolita irradie encore, tel un soleil noir, sur mon trente-deuxième hiver, ont tout emporté sur leur passage.
La situation est plus nettement critique si je me tourne vers ma bibliothèque : si l’on excepte, en science-fiction, les rééditions ou nouvelles traductions (Le Temps incertain et Soleil chaud poisson des profondeurs de Michel Jeury, Sauvagerie, La Forêt de cristal, Le Monde englouti et les Nouvelles complètes vol. 1 de J.G. Ballard), pas grand-chose en effet à se mettre sous la dent – mais je n’ai lu ni 2666, ni Contre-Jour, et pas plus les Volodine/Bassmann). Bastard Battle de Céline Minard, Pixel Juice et NymphoRmation de Jeff Noon, ont réussi à me surprendre (comme, dans une moindre mesure, Lothar Blues de Philippe Curval et Lacrimosa de Régis Jauffret), mais en définitive leurs jouissives étincelles ont été totalement éclipsées par une étoile autrement plus intense : La Route de Cormac McCarthy. Depuis près d’un an en effet, le père et l’enfant poursuivent leur errance crépusculaire sur les gris sentiers de mon cortex. L’émotion est intacte : leur feu brille, miraculeux, dans la nuit littéraire contemporaine, qu’heureusement éclairent aussi d’un lustre éternel les astres du passé : Dostoïevski (Carnets du sous-sol, Le Double, Les Frères Karamazov), Gogol (Nouvelles de Petersbourg), Melville (Moby Dick et sa quête concentrique de Dieu, relu dans la sublime traduction d’Armel Guerne) ou Nabokov, dont le Lolita irradie encore, tel un soleil noir, sur mon trente-deuxième hiver, ont tout emporté sur leur passage.

 Après les psychédélicieux
Après les psychédélicieux  Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles…
Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles… Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double…
Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double…  Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.
Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.