« La nuit, je revois la poussière noire obscurcissant les rues silencieuses, et sous ce linceul, des cadavres grimaçants ; ils se dressent devant moi, en haillons et à demi-dévorés par les chiens ; ils m’invectivent et deviennent peu à peu furieux, plus pâles et plus affreux, et se transforment enfin en affolantes contorsions d’humanité. Puis je m’éveille, glacé et bouleversé, dans les ténèbres de la nuit. Je vais à Londres ; je me mêle aux foules affairées de Fleet Street et du Strand, et ces gens semblent être des fantômes du passé, hantant les rues que j’ai vues silencieuses et désolées, allant et venant, ombres dans une ville morte, caricatures de vie dans un corps pétrifié. »
H.G. Wells, La Guerre des mondes.
« A l’appel de la vie le temps accourt,
prolongeant la seconde où l’on vole en éclats.
Comment l’effroi s’insinue en nous,
comment la peur s’exhale de nous.
Comme il est dur d’être mis en lambeaux. »
Harry Martinson, Aniara, une odyssée de l’espace.
Je ne crois pas, contrairement au riboulant Maurice G. Dantec qui, visiblement réjoui, s’est encore fendu sur le ring, en compagnie de Cyril Pahlavi, d’un
atrésique « papier » qu'il est permis de juger islamophobe, et vraisemblablement destiné à attirer l’attention de journalistes effarouchés – la méthode a fait ses preuves et nous apprenons, comme par hasard, la naissance imminente du site officiel de l’expatrié québécois, à quelques semaines de la parution de son nouveau roman… – et digne, en tout point, de figurer sur le
forum putride des « jeunes » de l’UMP, je ne crois pas, donc, que les attentats (vraisemblablement) islamistes perpétrés la semaine dernière à Londres constituent les quelconques prodromes d’une « guerre des mondes » au sens où seraient confrontés non seulement des antagonistes fondamentalement, définitivement différents, des
adversaires, des
ennemis – on perçoit sans peine où l’usage de ces deux derniers termes, pour peu que les saintes majuscules y soient décrétées, nous mène...
La similitude frappante entre les éprouvantes images du chaos londonien et l’extrait du roman de H.G. Wells cité plus haut – que l’autre Welles, Orson, adapta en mémorable canular-fiction radiophonique… – ne doit cependant pas nous égarer : si les envahisseurs martiens inventés par l’auteur anglais – dont la puissance de feu était autrement plus formidable, tout de même, que celle des zélotes (oh !) pouilleux d’Al Qaida –, si les tripodes monstrueux de Wells faisaient bloc, soldats inhumains unis – utilitarisme à la mode
alien… –, pour notre destruction totale, les terroristes ne sont, eux, que des clandestins minoritaires, des
êtres humains malgré tout, barbus, stupides et lâches assassins dissimulés dans la foule musulmane qui dans son immense majorité, condamne leurs abjections. Non, je ne crois pas que plane en Occident, cette « terreur islamiste » (lire cet intéressante
réaction de Marc Alpozzo) dont certains hâbleurs nous rebattent les oreilles à des fins sans doute propitiatoires, pas plus du moins que ne l’emporta au final la « terreur » communiste pendant la Guerre Froide, pas plus, encore, que ne pèse sur nous la moindre « terreur » virale. Les Israéliens peuvent être terrorisés, à juste titre. Les Palestiniens, également. Mais nous !... Ici existent seulement – ce qui devrait suffire cependant à exacerber notre vigilance – des menaces ponctuelles, et somme toute limitées, d’attentats nihilistes – hier anarchistes, là-bas indépendantistes, là encore islamistes.
Juan « Stalker » Asensio,
à son tour, martèle, confus et visionnaire : «
Reste une dernière voie, la seule qui affirmera, sinon notre victoire, en tous les cas notre honneur, moins que cela, un dernier soubresaut de notre honneur retrouvé, reconquis. Car ces morts-vivants, ces hommes (que seraient-ils donc, bon sang, sinon des hommes ?) prêts à mourir en chantant, outre le fait de démembrer quelques malchanceux Occidentaux obnubilés par la perfection de leur corps, parviendront peut-être mais j'en doute, à réveiller quelques-uns d'entre nous, les plus braves ou bien celles et ceux qui, eux aussi, ne craignent point la mort, pour aller défendre le territoire sacré du parc européen où gambadent et broutent en toute insouciance quelques millions de gras moutons. ». Et alors ? ai-je envie de demander, sarcastique… Et alors, en effet ? Une fois envisagé ce conflit entre d’une part, quelques milliers de tarés lobotomisés – une goutte d’eau viciée – et d’autre part, des centaines de millions d’occidentaux – le vieil Océan –, que devrions-nous faire ?... Déclarer la
guerre, comme l’insinue Dantec ? Mais CONTRE QUI diriger nos missiles, par tous les dieux ? Contre les Arabes, TOUS les Arabes ?... Contre les Musulmans, TOUS les Musulmans ?... Appeler la pucelle de Saint-Cloud pour les bouter hors de France ? Convoquer Philippe Auguste et les Plantagenêt ? Confondre Saladdin et Bin-Ladin ? Devrions-nous donc larguer nos bombes, anéantir les pays d’origine des terroristes, soumettre des hommes, des femmes, des enfants, au fer vengeur – et, peut-être, radioactif – de prétendus « croisés » non moins fanatiques que leurs agresseurs – l’histoire en témoigne
[1] – ? refaire, au nom de la « lutte antiterroriste », un Hiroshima d’Asie mineure ou d’Afrique du nord ? surpasser, au nom du confort occidental, le déluge infernal que les Alliés infligèrent à Dresde ? Devrions-nous vitrifier, pour plus de sûreté, la ceinture du croissant vert, rayer ses peuples impies de la carte ? C’est aux polices ! c’est aux services de renseignements ! de démanteler les réseaux terroristes, d’expulser ou, mieux, d’emprisonner les égorgeurs, équarrisseurs et plastiqueurs en tous genres – religieux, politiques, écologistes, etc. – qui mettent nos vies en danger ; pas aux machines de guerre. C’est aux gouvernements, aux parlements, aux exécutifs de freiner l’implantation en Europe d’un Islam qui, on le sait, distille dans ses mosquées les plus virulentes le poison extrémiste – de la freiner ou, à tout le moins, de la contrôler. En vérité ce genre d’anathème utilitariste qui ne dit pas son nom a pour seule conséquence – mais quel gâchis ! – la prolifération incontrôlée des pulsions xénophobes les plus viscérales, c’est-à-dire les plus primitives, des Occidentaux comme des émigrés (et non un hypothétique « sursaut » qui, selon ces mêmes prophétaillons de l’Occident, est de toute façon illusoire puisque celui-ci serait, toujours selon eux, déjà mort)... L’éréthique Dantec et ses épigones vaticinent, éructent, vocifèrent sans jamais cependant exaspérer le moindre imbécile – car les imbéciles, eux, frétillent de la queue ou ne lisent que la boue excrémentielle des tabloïds – sinon les béats thuriféraires d’un joyeux cosmopolitisme œcuménique. A première vue, j’aurais tendance à suivre le Stalker lorsqu’il écrit encore : «
Ils sont vivants et nous sommes morts, je mesure bien toute l'horreur de ce que je viens d'écrire. Oui, […]
car, aussi fanatisés qu'on les voudra, aussi incultes, intolérants, anti-féministes, homophobes déclarés, horriblement non-républicains et surtout, cela est parfaitement impardonnable, résolument ennemis de l'esprit tellement vertueux, internationaliste et humaniste du Baron de Coubertin, ils défendent encore une conception illuminée de la vie à coups de morts et de suicides et nous ne défendons rien […] » Rien de plus exact, comment le nier ? Et pourtant, le cerveau irrémissiblement ensemencé par les mèmes transhumanistes, je ne puis m’empêcher de deviner contre lui – contre nuit –, que ces fous d’Allah – que je soupçonne de ne jamais avoir lu le Coran, c’est-à-dire de n’être tout simplement pas Musulmans ! de n’être que nihilistes – sont, eux, déjà morts, empoisonnés jusqu’à l’os, par le venin religieux, le Mal – le « Nihilisme ». Et d’ailleurs lui-même, Stalker, n’évoquait-il pas plus haut, à leur encontre, l’état peu ragoûtant de « morts-vivants » ?... Non Juan, les terroristes n’ont pas « consommé leurs noces avec le nihilisme » : ils
sont, eux, les nihilistes les plus abjects, les plus basiques, les plus dangereux qui soient – les moins vivants, en dépit de leurs violentes trémulations. Bien vivants en revanche sont encore, et seront jusqu’à la fin dernière : Bernanos, Lautréamont, Burroughs, Céline, Dick, Bergman, Cronenberg, Tarkovski, Bach, Mozart, Arvo Pärt. Le néant est le royaume de ces zombies auxquels Juan consent vie, et je refuse de commettre la même erreur – je refuse tout net d’imposer par les armes, comme ils tentent de le faire, la Civilisation mienne au monde entier. Ce n’est qu’une intime conviction, mais quotidiennement renforcée – je ne crains pas les sarcasmes – par mes voisins d’immeuble, dans mon quartier populaire parisien : si l’on y parle peu Français, s’y côtoient cependant sans tension visible – sinon aux alentours de 23 heures 30, à la sortie tonitruante des troquets – blancs, Noirs africains, Arabes, Indiens, Chinois, Vietnamiens, Sud-américains, Turcs et autres étudiants hollandais… Et vous savez quoi ? Je ne suis nullement « terrorisé », pas plus que mes propriétaires, pourtant racistes bon teint…
Ah ! mais puisque vous en êtes à spéculer, à vous prendre pour les Cassandre de la Toile, pour des Bloy courroucés : qu’en pensent les auteurs de science-fiction et d’anticipation ? A priori, le temps de la naïveté lénifiante –
Jihad de Jean-Marc Ligny, qui décrivait un France fasciste où les Arabes étaient impitoyablement pourchassés – semble en tout cas bel et bien perdu – je ne m’en plaindrai pas –, même si Pierre Bordage, dans
L’Ange de l’abîme et
Les Chemins de Damas (deux pavés poussifs parus au Diable Vauvert, formant trilogie avec le non moins dispensable
Evangile du serpent) ose encore suggérer que la guerre qu’il a imaginée entre Orient et Occident aurait été initiée (et entretenue) par les Etats-Unis… L’angélisme multi-ethnique donc, à quelques exceptions près, a fait long feu.

L’Helvète Georges Panchard, lui, premier francophone à être publié dans la collection Ailleurs & Demain chez Laffont (dirigée par Gérard Klein) depuis Michel Jeury dans les années quatre-vingt, est plus réaliste.
Forteresse, son premier roman, situe son récit en 2039, une douzaine d’années après les guerres du Réveil entre l’Orient islamiste et l’Europe libérale. Tandis que cette dernière se débarrasse de ses ultimes ressortissants musulmans, les Etats-Unis sont devenus nation évangéliste, puritaine, obèse – quant au reste du monde, hormis les Yakuzas
hi-tech, nous n’en saurons quasiment rien. Pour Georges Panchard il ne fait pas de doute que l’Europe, manoeuvrée par des multinationales toutes puissantes dont les dirigeants – les vrais maîtres du monde – se terrent dans d’inexpugnables « forteresses » afin d’échapper aux spadassins des mafias et des concurrents, cette Europe-là – la nôtre, à moyen terme – ne saurait assimiler l’Islam djihadiste, pas plus d’ailleurs que le Christianisme, dont l’Amérique protestante, ployant sous son propre poids – où l’individu est nié dans son corps comme dans son esprit –, représente l’impasse la plus éloquente. Les ardents (lire : fanatiques) défenseurs de l’Occident
chrétien me font d’ailleurs penser aux myriades de planètes, dans
Des milliards de tapis de cheveux de l’Allemand Andreas Eschbach (L’Atalante), dont les habitants, isolés du reste de la galaxie, vénèrent encore l’Empereur-Dieu tout puissant alors que celui-ci est mort des années plus tôt, vaincu par les rebelles qui depuis lors sont au pouvoir…
Les auteurs les plus passionnants proposent ainsi une vision souvent très noire, mais jamais binaire de l’avenir de l’Occident – Christopher Priest, avec
Le Rat blanc (Presses de la cité), dans lequel l’Islam a conquis la planète, démontrait même que c’est le rejet xénophobe de l’étranger, et non son intégration, qui excite les frictions interethniques ou religieuses.

Ainsi le jeune Stéphane Beauverger, dans son excellent
Chromozone (éditions La Volte), autre thriller d’anticipation dans la veine de
Babylon babies de Dantec ou de
Rock Machine de Norman Spinrad, montre une Marseille post-apocalyptique divisée en territoires communautaires – « l’ordre » étant assuré par des milices privées. Parmi ces minorités dominantes se trouvent les Musulmans bien sûr, en position de force dans le sud de la France. Mais cet Islam, soucieux de survivre et de prospérer dans une société néodarwinienne où la puissance économique fait loi, est plutôt modéré – on utilise même un mutant, Khaleel, pour intercepter et analyser les flux d’informations « phéromoniques » (qui remplacent, dans le roman, les informations numériques totalement détruites par un virus militaire).
Mais si la plupart des écrivains refusent les oppositions binaires, c’est que de toute évidence la vraie menace, pour l’Occident, telle que désignée – n’en déplaise à Dantec –, par George Orwell dans son chef d’œuvre
1984 – qui érige les « arts » en tant que partage de connaissance (ou de « sensibilité » écrivit Lyotard), en l’occurrence le langage (l’écriture) en dernière défense de la métaphysique, en dernier rempart contre le Novlangue –, n’est évidemment pas ce monde Arabe aux abois, ultime refuge sans doute des fanatiques religieux – la Chrétienté, soit dit en passant, eût aussi son heure – sur une planète conquise par l’individualisme, mais bien plutôt celle, dénuée de portrait-robot, aux traits aussi banals que les vôtres, du nihilisme postmoderne.

Relisons Ballard et son
Millenium People – «
Pour la première fois dans l’histoire humaine, un ennui féroce régnait sur le monde, scandé par des actes de violence dénués de sens », ce qui, justement, en est «
exactement le sens ». – où «
[renverser] les gratte-ciel, réveillait des peurs assoupies depuis longtemps dans notre esprit. » Nous retrouvons l’idée, exprimée par Juan Asensio, qu’il faut espérer une réaction à ces banderilles ennemies… Mais pour Ballard la partie est finie – nous serions tous, eux, nous, déjà morts… Dans notre monde-parc à thème où « tout est transformé en spectacle », les uns font éclater leurs bombes, les autres font mine de s’indigner, et basta ! De
Millenium People j’écrivais récemment dans Galaxies (n°36) : « Le terrorisme n’est pas tant ici la marque d’un choc des civilisations que celle d’une guerre du sens, ce qui nous vaut d’ailleurs les plus belles pages du roman, où Ballard retrouve son art de la métaphore et sa scansion prophétique : “
Une bombe terroriste […]
produisait une violente déchirure dans le temps et l’espace, brisant la logique qui maintenait le monde en place.” Le monde moderne selon Ballard ressemble à une banlieue sans fin, à un centre commercial peuplé de morts-vivants, cadavre du 20e siècle que seule une secousse de l’ampleur du 11 septembre 2001 pourrait ranimer. C’est pourquoi les résidents de la Marina [d'où la fronde terroriste londonienne est partie], s’en prennent d’abord à des symboles — la Cinémathèque, la Tate Gallery (du « Walt Disney pour classes moyennes » !) — avant de leur préférer des cibles totalement gratuites. Ils cherchent à nous faire réintégrer le réel à coups de bombes incendiaires, sans se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes partie intégrante du spectacle ! Comme le narrateur de
Glamorama de Bret Easton Ellis (roman halluciné dans lequel des “people” s’improvisent poseurs de bombes…), Markham ne cesse de s’interroger sur son identité sociale, incapable de trouver un sens à ses actes. Et comme chez Ellis encore, ces derniers paraissent mis en scène, joués dans un décor factice : Londres prend ici des allures de cliché hollywoodien, signe que la bataille est déjà perdue. Pour les figurants de
Millenium People, la révolution n’est en définitive qu’une nouvelle lubie, à peine plus excitante que les autres. Même
Crash !, devenu fétiche socioculturel, y est parodié (par l’entremise de la femme de Markham, qui simule un handicap) et les soubresauts sexuels du héros — plus absent que jamais — ne sont rien de plus qu’un réflexe post-mortem. »

Relisons donc également Ellis qui dans son chef d’œuvre
Glamorama ne voit dans ces carnages mondains qu’un « truc des effets spéciaux », du « maquillage », des « accessoires » qui n’ont guère plus de sens que le sexe ou le cinéma – Victor Ward, arpentant les ruines sanglantes du Ritz qu’une bombe a littéralement soufflé, croit encore voir «
de temps en temps un mannequin en mousse figurant un cadavre. ». La cible d’Ellis, comme de Ballard – la fin de
Millenium People est désespérée – est évidemment la lèpre relativiste qui ronge, sans espoir de rémission, le Réel. Le danger, c’est de ne considérer ces massacres dramatiques – New York, Madrid et Londres, mais aussi Kigali ou Srebrenica (où furent tués, tout de même, huit mille
Musulmans…) – comme de simples informations – distractions – et non comme des événements réels et meurtriers. Si nous nous révélons incapables de tracer la limite, nous sommes effectivement perdus.
[1] L’auteur de
L’Antéchrist qui n’avait rien, lui, d’un « timoré » quant il s’agissait des valeurs de l’Occident, écrivait ces mots qui, aujourd'hui, seraient sans doute qualifiés par d'aucuns de « lénitifs » : «
Si l’islam méprise le christianisme, il a mille raisons pour cela ; l’islam a des hommes
pour condition première… […]
Le christianisme nous a frustrés de l’héritage de l’islam.
La merveilleuse civilisation maure de l’Espagne, plus voisine en somme de nos sens et de nos goûts que Rome et la Grèce, cette civilisation fut foulée
aux pieds (– je ne dis pas par quels pieds –), pourquoi ? puisqu’elle devait son origine à des instincts nobles, à des instincts virils, puisqu’elle disait oui à la vie, et encore avec les magnificences rares et raffinées de la vie mauresque !...[…]
Soyons donc impartiaux ! les croisades – de la haute piraterie, rien de plus ! » Je veux bien croire que les choses aient changé, mais des Musulmans de ma connaissance – certes pas très pratiquants, mais n’est-ce pas justement ceux-là qui m'importent ? – me prouvent souvent par lur intelligence, leur culture, leur ouverture, que le vie, en effet, n’est pas toujours du « côté » que l’on croit…




 Monsieur Pain propose une narration plus classique même s’il ne faut guère plus de quelques pages pour que la banale réalité objective se lézarde et soit parasitée par un univers absurde, inquiétant et fantomatique, presque kafkaïen, où les personnages croisés par Pain, ombres de la caverne, s’avèrent aussi fascinants qu’intangibles – au point qu’on les dirait sortis de L’invention de Morel de Bioy Casarès. L’action se déroule à Paris en 1938, alors que l’Espagne est secouée par la guerre civile. Pierre Pain, acupuncteur aux poumons brûlés et rompu à l’art du mesmérisme, tente de sauver le poète Vallejo, atteint d’un hoquet mystérieux et promis à une mort certaine. Contrairement à la médecine moderne, qui s’avoue impuissante à guérir le malade, Pain paraît sur le point de remédier à son mal mystérieux, presque par hasard, presque malgré lui, conscient de son origine non pas physiologique mais occulte – on devine ici l’opposition sous-jacente de la froide objectivité clinique et de l’hypersensibilité poétique. Pain – pain, en anglais, ne signifie rien d’autre que douleur ! –, pris au piège de ses circonvolutions mentales, semble alors s’immerger à son tour dans les méandres incertains d’un monde expressionniste et paranoïaque, projection schizophrénique de la profonde culpabilité qui le ronge. S’il se croit poursuivi par des Espagnols hostiles, victime d’un complot rien moins que démoniaque, il se perd aussi dans le dédale cauchemardesque de la Clinique Arago où est hospitalisé Vallejo, architecture non euclidienne à la mesure de son enfer psychologique.
Monsieur Pain propose une narration plus classique même s’il ne faut guère plus de quelques pages pour que la banale réalité objective se lézarde et soit parasitée par un univers absurde, inquiétant et fantomatique, presque kafkaïen, où les personnages croisés par Pain, ombres de la caverne, s’avèrent aussi fascinants qu’intangibles – au point qu’on les dirait sortis de L’invention de Morel de Bioy Casarès. L’action se déroule à Paris en 1938, alors que l’Espagne est secouée par la guerre civile. Pierre Pain, acupuncteur aux poumons brûlés et rompu à l’art du mesmérisme, tente de sauver le poète Vallejo, atteint d’un hoquet mystérieux et promis à une mort certaine. Contrairement à la médecine moderne, qui s’avoue impuissante à guérir le malade, Pain paraît sur le point de remédier à son mal mystérieux, presque par hasard, presque malgré lui, conscient de son origine non pas physiologique mais occulte – on devine ici l’opposition sous-jacente de la froide objectivité clinique et de l’hypersensibilité poétique. Pain – pain, en anglais, ne signifie rien d’autre que douleur ! –, pris au piège de ses circonvolutions mentales, semble alors s’immerger à son tour dans les méandres incertains d’un monde expressionniste et paranoïaque, projection schizophrénique de la profonde culpabilité qui le ronge. S’il se croit poursuivi par des Espagnols hostiles, victime d’un complot rien moins que démoniaque, il se perd aussi dans le dédale cauchemardesque de la Clinique Arago où est hospitalisé Vallejo, architecture non euclidienne à la mesure de son enfer psychologique.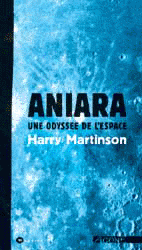

 L’Helvète Georges Panchard, lui, premier francophone à être publié dans la collection Ailleurs & Demain chez Laffont (dirigée par Gérard Klein) depuis Michel Jeury dans les années quatre-vingt, est plus réaliste. Forteresse, son premier roman, situe son récit en 2039, une douzaine d’années après les guerres du Réveil entre l’Orient islamiste et l’Europe libérale. Tandis que cette dernière se débarrasse de ses ultimes ressortissants musulmans, les Etats-Unis sont devenus nation évangéliste, puritaine, obèse – quant au reste du monde, hormis les Yakuzas hi-tech, nous n’en saurons quasiment rien. Pour Georges Panchard il ne fait pas de doute que l’Europe, manoeuvrée par des multinationales toutes puissantes dont les dirigeants – les vrais maîtres du monde – se terrent dans d’inexpugnables « forteresses » afin d’échapper aux spadassins des mafias et des concurrents, cette Europe-là – la nôtre, à moyen terme – ne saurait assimiler l’Islam djihadiste, pas plus d’ailleurs que le Christianisme, dont l’Amérique protestante, ployant sous son propre poids – où l’individu est nié dans son corps comme dans son esprit –, représente l’impasse la plus éloquente. Les ardents (lire : fanatiques) défenseurs de l’Occident chrétien me font d’ailleurs penser aux myriades de planètes, dans Des milliards de tapis de cheveux de l’Allemand Andreas Eschbach (L’Atalante), dont les habitants, isolés du reste de la galaxie, vénèrent encore l’Empereur-Dieu tout puissant alors que celui-ci est mort des années plus tôt, vaincu par les rebelles qui depuis lors sont au pouvoir…
L’Helvète Georges Panchard, lui, premier francophone à être publié dans la collection Ailleurs & Demain chez Laffont (dirigée par Gérard Klein) depuis Michel Jeury dans les années quatre-vingt, est plus réaliste. Forteresse, son premier roman, situe son récit en 2039, une douzaine d’années après les guerres du Réveil entre l’Orient islamiste et l’Europe libérale. Tandis que cette dernière se débarrasse de ses ultimes ressortissants musulmans, les Etats-Unis sont devenus nation évangéliste, puritaine, obèse – quant au reste du monde, hormis les Yakuzas hi-tech, nous n’en saurons quasiment rien. Pour Georges Panchard il ne fait pas de doute que l’Europe, manoeuvrée par des multinationales toutes puissantes dont les dirigeants – les vrais maîtres du monde – se terrent dans d’inexpugnables « forteresses » afin d’échapper aux spadassins des mafias et des concurrents, cette Europe-là – la nôtre, à moyen terme – ne saurait assimiler l’Islam djihadiste, pas plus d’ailleurs que le Christianisme, dont l’Amérique protestante, ployant sous son propre poids – où l’individu est nié dans son corps comme dans son esprit –, représente l’impasse la plus éloquente. Les ardents (lire : fanatiques) défenseurs de l’Occident chrétien me font d’ailleurs penser aux myriades de planètes, dans Des milliards de tapis de cheveux de l’Allemand Andreas Eschbach (L’Atalante), dont les habitants, isolés du reste de la galaxie, vénèrent encore l’Empereur-Dieu tout puissant alors que celui-ci est mort des années plus tôt, vaincu par les rebelles qui depuis lors sont au pouvoir… Ainsi le jeune Stéphane Beauverger, dans son excellent Chromozone (éditions La Volte), autre thriller d’anticipation dans la veine de Babylon babies de Dantec ou de Rock Machine de Norman Spinrad, montre une Marseille post-apocalyptique divisée en territoires communautaires – « l’ordre » étant assuré par des milices privées. Parmi ces minorités dominantes se trouvent les Musulmans bien sûr, en position de force dans le sud de la France. Mais cet Islam, soucieux de survivre et de prospérer dans une société néodarwinienne où la puissance économique fait loi, est plutôt modéré – on utilise même un mutant, Khaleel, pour intercepter et analyser les flux d’informations « phéromoniques » (qui remplacent, dans le roman, les informations numériques totalement détruites par un virus militaire).
Ainsi le jeune Stéphane Beauverger, dans son excellent Chromozone (éditions La Volte), autre thriller d’anticipation dans la veine de Babylon babies de Dantec ou de Rock Machine de Norman Spinrad, montre une Marseille post-apocalyptique divisée en territoires communautaires – « l’ordre » étant assuré par des milices privées. Parmi ces minorités dominantes se trouvent les Musulmans bien sûr, en position de force dans le sud de la France. Mais cet Islam, soucieux de survivre et de prospérer dans une société néodarwinienne où la puissance économique fait loi, est plutôt modéré – on utilise même un mutant, Khaleel, pour intercepter et analyser les flux d’informations « phéromoniques » (qui remplacent, dans le roman, les informations numériques totalement détruites par un virus militaire). Relisons Ballard et son Millenium People – « Pour la première fois dans l’histoire humaine, un ennui féroce régnait sur le monde, scandé par des actes de violence dénués de sens », ce qui, justement, en est « exactement le sens ». – où « [renverser] les gratte-ciel, réveillait des peurs assoupies depuis longtemps dans notre esprit. » Nous retrouvons l’idée, exprimée par Juan Asensio, qu’il faut espérer une réaction à ces banderilles ennemies… Mais pour Ballard la partie est finie – nous serions tous, eux, nous, déjà morts… Dans notre monde-parc à thème où « tout est transformé en spectacle », les uns font éclater leurs bombes, les autres font mine de s’indigner, et basta ! De Millenium People j’écrivais récemment dans Galaxies (n°36) : « Le terrorisme n’est pas tant ici la marque d’un choc des civilisations que celle d’une guerre du sens, ce qui nous vaut d’ailleurs les plus belles pages du roman, où Ballard retrouve son art de la métaphore et sa scansion prophétique : “Une bombe terroriste […] produisait une violente déchirure dans le temps et l’espace, brisant la logique qui maintenait le monde en place.” Le monde moderne selon Ballard ressemble à une banlieue sans fin, à un centre commercial peuplé de morts-vivants, cadavre du 20e siècle que seule une secousse de l’ampleur du 11 septembre 2001 pourrait ranimer. C’est pourquoi les résidents de la Marina [d'où la fronde terroriste londonienne est partie], s’en prennent d’abord à des symboles — la Cinémathèque, la Tate Gallery (du « Walt Disney pour classes moyennes » !) — avant de leur préférer des cibles totalement gratuites. Ils cherchent à nous faire réintégrer le réel à coups de bombes incendiaires, sans se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes partie intégrante du spectacle ! Comme le narrateur de Glamorama de Bret Easton Ellis (roman halluciné dans lequel des “people” s’improvisent poseurs de bombes…), Markham ne cesse de s’interroger sur son identité sociale, incapable de trouver un sens à ses actes. Et comme chez Ellis encore, ces derniers paraissent mis en scène, joués dans un décor factice : Londres prend ici des allures de cliché hollywoodien, signe que la bataille est déjà perdue. Pour les figurants de Millenium People, la révolution n’est en définitive qu’une nouvelle lubie, à peine plus excitante que les autres. Même Crash !, devenu fétiche socioculturel, y est parodié (par l’entremise de la femme de Markham, qui simule un handicap) et les soubresauts sexuels du héros — plus absent que jamais — ne sont rien de plus qu’un réflexe post-mortem. »
Relisons Ballard et son Millenium People – « Pour la première fois dans l’histoire humaine, un ennui féroce régnait sur le monde, scandé par des actes de violence dénués de sens », ce qui, justement, en est « exactement le sens ». – où « [renverser] les gratte-ciel, réveillait des peurs assoupies depuis longtemps dans notre esprit. » Nous retrouvons l’idée, exprimée par Juan Asensio, qu’il faut espérer une réaction à ces banderilles ennemies… Mais pour Ballard la partie est finie – nous serions tous, eux, nous, déjà morts… Dans notre monde-parc à thème où « tout est transformé en spectacle », les uns font éclater leurs bombes, les autres font mine de s’indigner, et basta ! De Millenium People j’écrivais récemment dans Galaxies (n°36) : « Le terrorisme n’est pas tant ici la marque d’un choc des civilisations que celle d’une guerre du sens, ce qui nous vaut d’ailleurs les plus belles pages du roman, où Ballard retrouve son art de la métaphore et sa scansion prophétique : “Une bombe terroriste […] produisait une violente déchirure dans le temps et l’espace, brisant la logique qui maintenait le monde en place.” Le monde moderne selon Ballard ressemble à une banlieue sans fin, à un centre commercial peuplé de morts-vivants, cadavre du 20e siècle que seule une secousse de l’ampleur du 11 septembre 2001 pourrait ranimer. C’est pourquoi les résidents de la Marina [d'où la fronde terroriste londonienne est partie], s’en prennent d’abord à des symboles — la Cinémathèque, la Tate Gallery (du « Walt Disney pour classes moyennes » !) — avant de leur préférer des cibles totalement gratuites. Ils cherchent à nous faire réintégrer le réel à coups de bombes incendiaires, sans se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes partie intégrante du spectacle ! Comme le narrateur de Glamorama de Bret Easton Ellis (roman halluciné dans lequel des “people” s’improvisent poseurs de bombes…), Markham ne cesse de s’interroger sur son identité sociale, incapable de trouver un sens à ses actes. Et comme chez Ellis encore, ces derniers paraissent mis en scène, joués dans un décor factice : Londres prend ici des allures de cliché hollywoodien, signe que la bataille est déjà perdue. Pour les figurants de Millenium People, la révolution n’est en définitive qu’une nouvelle lubie, à peine plus excitante que les autres. Même Crash !, devenu fétiche socioculturel, y est parodié (par l’entremise de la femme de Markham, qui simule un handicap) et les soubresauts sexuels du héros — plus absent que jamais — ne sont rien de plus qu’un réflexe post-mortem. » Relisons donc également Ellis qui dans son chef d’œuvre Glamorama ne voit dans ces carnages mondains qu’un « truc des effets spéciaux », du « maquillage », des « accessoires » qui n’ont guère plus de sens que le sexe ou le cinéma – Victor Ward, arpentant les ruines sanglantes du Ritz qu’une bombe a littéralement soufflé, croit encore voir « de temps en temps un mannequin en mousse figurant un cadavre. ». La cible d’Ellis, comme de Ballard – la fin de Millenium People est désespérée – est évidemment la lèpre relativiste qui ronge, sans espoir de rémission, le Réel. Le danger, c’est de ne considérer ces massacres dramatiques – New York, Madrid et Londres, mais aussi Kigali ou Srebrenica (où furent tués, tout de même, huit mille Musulmans…) – comme de simples informations – distractions – et non comme des événements réels et meurtriers. Si nous nous révélons incapables de tracer la limite, nous sommes effectivement perdus.
Relisons donc également Ellis qui dans son chef d’œuvre Glamorama ne voit dans ces carnages mondains qu’un « truc des effets spéciaux », du « maquillage », des « accessoires » qui n’ont guère plus de sens que le sexe ou le cinéma – Victor Ward, arpentant les ruines sanglantes du Ritz qu’une bombe a littéralement soufflé, croit encore voir « de temps en temps un mannequin en mousse figurant un cadavre. ». La cible d’Ellis, comme de Ballard – la fin de Millenium People est désespérée – est évidemment la lèpre relativiste qui ronge, sans espoir de rémission, le Réel. Le danger, c’est de ne considérer ces massacres dramatiques – New York, Madrid et Londres, mais aussi Kigali ou Srebrenica (où furent tués, tout de même, huit mille Musulmans…) – comme de simples informations – distractions – et non comme des événements réels et meurtriers. Si nous nous révélons incapables de tracer la limite, nous sommes effectivement perdus.
 Un an avant Elephant (palme d’or à Cannes en 2003) et deux ans avant Last Days, le cinéaste américain Gus Van Sant réalisait Gerry, sidérante expérience sensorielle et contemplative sans équivalent aux Etats-Unis, sans conteste l’un des films contemporains les plus fascinants, au même titre, par exemple, que Les Harmonies Werckmeister du Hongrois Béla Tarr – d’ailleurs remercié au générique. Faisant table rase des systèmes narratifs classiques, en vingt-six jours de tournage et une incroyable économie de moyens (seulement deux acteurs et une poignée de figurants), Gus Van Sant nous engage dans un puissant trip mystique, aride et élégiaque exploration de la Vallée de la Mort en compagnie de deux jeunes « angelinos » (Matt Damon et Casey Affleck) à l’allure décontractée – mais complètement perdus. Quelque part entre L’Avventura et 2001, Odyssée de l’espace – sans oublier Beckett –, Gerry est également une sorte de remake symbolique et neurasthénique de Stalker – les protagonistes s’enfoncent dans une Zone métaphysique où les attendent d’indicibles épreuves – et de Solaris – le désert, à l’aspect lunaire, fait surgir ses mirages, à l’instar de la mystérieuse planète du film de Tarkovski.
Un an avant Elephant (palme d’or à Cannes en 2003) et deux ans avant Last Days, le cinéaste américain Gus Van Sant réalisait Gerry, sidérante expérience sensorielle et contemplative sans équivalent aux Etats-Unis, sans conteste l’un des films contemporains les plus fascinants, au même titre, par exemple, que Les Harmonies Werckmeister du Hongrois Béla Tarr – d’ailleurs remercié au générique. Faisant table rase des systèmes narratifs classiques, en vingt-six jours de tournage et une incroyable économie de moyens (seulement deux acteurs et une poignée de figurants), Gus Van Sant nous engage dans un puissant trip mystique, aride et élégiaque exploration de la Vallée de la Mort en compagnie de deux jeunes « angelinos » (Matt Damon et Casey Affleck) à l’allure décontractée – mais complètement perdus. Quelque part entre L’Avventura et 2001, Odyssée de l’espace – sans oublier Beckett –, Gerry est également une sorte de remake symbolique et neurasthénique de Stalker – les protagonistes s’enfoncent dans une Zone métaphysique où les attendent d’indicibles épreuves – et de Solaris – le désert, à l’aspect lunaire, fait surgir ses mirages, à l’instar de la mystérieuse planète du film de Tarkovski. Dès lors, le film n’est qu’une tentative d’épuisement des corps – saluons l’excellence des deux acteurs devenus « modèles » de Gus Van Sant, présences physiques, peaux, visages, plutôt que comédiens –, de la narration, et du plan, en même temps qu’une lutte frontale entre l’homme et la nature, entre l’individu, même dédoublé comme ici, et l’étendue pierreuse – entre la finitude des corps (aux textures presque palpables) et l’infinitude minérale. Les personnages, confrontés à eux-mêmes et au monde, sont captifs du plan et de sa durée, étirée mais finie, impuissants, incapables de sortir du labyrinthe. Le cinémascope, cache-misère de trop de réalisateurs sans talent, est exploité à bon escient : il n’est pas rare de voir les personnages chacun d’un côté de l’écran, séparés en réalité de plusieurs dizaines de mètres ou, au contraire, extrêmement proches, comme dans ce gros plan de quatre minutes trente sur leurs visages de profils, rythmé par le crissement hypnotique de leurs pas cadencés. Si Gerry & Gerry manquent de prudence et de jugeote, le spectateur, astreint à une certaine abstraction spatiale – nous passons par exemple, et sans repères géographiques ou temporels, d’à-pics rocailleux à de plates étendues vierges… –, n’est pas moins désorienté qu’eux : quelle est donc cette forme sombre que nous apercevons, par endroits, au beau milieu des élévations blanchâtres ou des étendues désertiques ? Est-ce le réalisateur ?... un mirage ?... ah ! mais le désert, selon Saint Matthieu, n’est-il pas plutôt peuplé de démons ?...
Dès lors, le film n’est qu’une tentative d’épuisement des corps – saluons l’excellence des deux acteurs devenus « modèles » de Gus Van Sant, présences physiques, peaux, visages, plutôt que comédiens –, de la narration, et du plan, en même temps qu’une lutte frontale entre l’homme et la nature, entre l’individu, même dédoublé comme ici, et l’étendue pierreuse – entre la finitude des corps (aux textures presque palpables) et l’infinitude minérale. Les personnages, confrontés à eux-mêmes et au monde, sont captifs du plan et de sa durée, étirée mais finie, impuissants, incapables de sortir du labyrinthe. Le cinémascope, cache-misère de trop de réalisateurs sans talent, est exploité à bon escient : il n’est pas rare de voir les personnages chacun d’un côté de l’écran, séparés en réalité de plusieurs dizaines de mètres ou, au contraire, extrêmement proches, comme dans ce gros plan de quatre minutes trente sur leurs visages de profils, rythmé par le crissement hypnotique de leurs pas cadencés. Si Gerry & Gerry manquent de prudence et de jugeote, le spectateur, astreint à une certaine abstraction spatiale – nous passons par exemple, et sans repères géographiques ou temporels, d’à-pics rocailleux à de plates étendues vierges… –, n’est pas moins désorienté qu’eux : quelle est donc cette forme sombre que nous apercevons, par endroits, au beau milieu des élévations blanchâtres ou des étendues désertiques ? Est-ce le réalisateur ?... un mirage ?... ah ! mais le désert, selon Saint Matthieu, n’est-il pas plutôt peuplé de démons ?... Eminemment métaphysique, Gerry (le second titre d’Arvo Pärt utilisé s’intitule Spiegel im Spiegel, soit « miroir dans le miroir »…) pourrait donc n’être in fine que la quête initiatique – on sait l’importance de la marche pour de nombreux penseurs –, existentielle et spirituelle d’un jeune homme confronté au silence de Dieu, l’odyssée mythologique dont le désert serait le décor symbolique plutôt qu’une authentique terre inhospitalière, le récit de passage à l’âge adulte, de l’abandon de l’enfance et, peut-être, des dernières tentations homosexuelles ou homo-érotiques (l’étreinte finale) du sujet : tel Caïn tuant Abel, Gerry/Damon évince l’angélique Gerry/Affleck qui achève alors son destin christique – l’étoile de son T-shirt serait-elle aussi celle de Bethléem ? –... Le désert, espace indéfini où Dieu règne en maître absolu (voir ces plans de ciels, de nuages au mouvement accéléré, qu’on rencontrera également dans Elephant), n’est-il pas le lieu symbolique de la quête de l’Essence, de la Terre promise – c’est-à-dire, de la prise de conscience par l’être de sa propre finitude, comme chez Buzzatti – ? Dans une séquence au burlesque ascétique, juché sur un gros rocher tel Simon du désert, Gerry/Affleck surplombe Gerry/Damon de plusieurs mètres (l’ange, spirituel, tenté par le démon, matériel ?), ce qui s’avère, à évaluer la hauteur du rocher, totalement irrationnel – s’il ne peut s’y trouver, c’est peut-être tout simplement qu’il ne s’y trouve pas : le plan d’ensemble, très long et seulement interrompu par une contre-plongée sur Gerry/Affleck (caméra subjective Gerry/Damon, donc), est construit comme le niveau d’un jeu de plateforme pour Playstation (cf. Prince of Persia par exemple) : encore une fois, Gerry/Affleck n’est que pure virtualité – les observateurs attentifs auront d’ailleurs reconnu, dans le jeu de « shoot’em up » auquel s’adonnent les jeunes tueurs d’Elephant, l’avatar numérique de Casey Affleck, avec la même étoile jaune…
Eminemment métaphysique, Gerry (le second titre d’Arvo Pärt utilisé s’intitule Spiegel im Spiegel, soit « miroir dans le miroir »…) pourrait donc n’être in fine que la quête initiatique – on sait l’importance de la marche pour de nombreux penseurs –, existentielle et spirituelle d’un jeune homme confronté au silence de Dieu, l’odyssée mythologique dont le désert serait le décor symbolique plutôt qu’une authentique terre inhospitalière, le récit de passage à l’âge adulte, de l’abandon de l’enfance et, peut-être, des dernières tentations homosexuelles ou homo-érotiques (l’étreinte finale) du sujet : tel Caïn tuant Abel, Gerry/Damon évince l’angélique Gerry/Affleck qui achève alors son destin christique – l’étoile de son T-shirt serait-elle aussi celle de Bethléem ? –... Le désert, espace indéfini où Dieu règne en maître absolu (voir ces plans de ciels, de nuages au mouvement accéléré, qu’on rencontrera également dans Elephant), n’est-il pas le lieu symbolique de la quête de l’Essence, de la Terre promise – c’est-à-dire, de la prise de conscience par l’être de sa propre finitude, comme chez Buzzatti – ? Dans une séquence au burlesque ascétique, juché sur un gros rocher tel Simon du désert, Gerry/Affleck surplombe Gerry/Damon de plusieurs mètres (l’ange, spirituel, tenté par le démon, matériel ?), ce qui s’avère, à évaluer la hauteur du rocher, totalement irrationnel – s’il ne peut s’y trouver, c’est peut-être tout simplement qu’il ne s’y trouve pas : le plan d’ensemble, très long et seulement interrompu par une contre-plongée sur Gerry/Affleck (caméra subjective Gerry/Damon, donc), est construit comme le niveau d’un jeu de plateforme pour Playstation (cf. Prince of Persia par exemple) : encore une fois, Gerry/Affleck n’est que pure virtualité – les observateurs attentifs auront d’ailleurs reconnu, dans le jeu de « shoot’em up » auquel s’adonnent les jeunes tueurs d’Elephant, l’avatar numérique de Casey Affleck, avec la même étoile jaune…