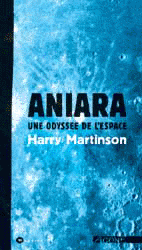
« Car la crauté de l’espace point ne dépasse
celle de l’homme, son digne rival en la matière.
La solitude des camps de prisonniers sur terre
Autour de l’âme humaine lourdement s’enchâsse,
Lorsque les pierres glaciales répondent en silence :
Ici règne l’être humain. Ici, c’est Aniara. »
« Le xinombrien, la plus riche des langues
que nous connaissions, possède trois millions de mlts,
mais la galaxie dans laquelle tu plonges le regard
renferme plus de quatre-vingt-dix milliards de soleils.
Quel cerveau maîtrisera jamais tous les vocables
de la langue de Xinombra ?
Pas un seul.
Alors tu comprends.
Et ne comprends pas. »
H. Martinson, Aniara, une odyssée de l’espace
Aniara est un livre vraiment unique. Il s’agit à ma connaissance, avec L'Opéra de l'espace de Charles Dobzynski (Gallimard, 1963) du seul poème épique de science-fiction qui soit parvenu jusqu’à nous, écrit de surcroît par un prix Nobel (1974) de littérature, le Suédois Harry Martinson, grand admirateur, nous dit-on, des Chroniques martiennes de Bradbury. Publié en 1956 et composé de cent trois chants élégiaques auxquels les récents attentats islamistes à Londres confèrent une intensité particulière, Aniara, dont une excellente traduction (augmentée d'une intéressante postface d'Ylva Lindberg et Samuel Autexier) est disponible chez Agone (2004), conte la dérive spatiale de la « goldonde » Aniara, à bord de laquelle des milliers de déracinés espèrent atterrir un jour sur une quelconque planète d’exil, et se mirent avec effroi et nostalgie dans leurs souvenirs. Sur Terre, les cités Dorisburg et Xinombra, comme les autres territoires, sont dévastés par les guerres nucléaires. Il semble que les passagers d’Aniara, guidés par Mima la Consolatrice – une intelligence artificielle de bord –, soient les derniers survivants, condamnés à errer dans la nuit céleste, évitant les trous noirs (les « photophages ») et autres corps célestes, jusqu’à la fin de leurs jours, et jusqu’à l’extinction de notre espèce. Pour eux en effet, « une année-lumière est une tombe »…
A plusieurs titres, Aniara, que son auteur, chose rare, n’hésitait pas à présenter comme de la science-fiction, était une œuvre en avance sur son temps. Ecrite à une époque où Van Vogt et Asimov publiaient leurs nouvelles et romans les plus célèbres – Philip K. Dick, qui avait déjà de nombreuses nouvelles derrière lui, venait de publier ses premiers romans –, elle délaisse les péripéties du voyage interstellaire pour s’attacher aux âmes des voyageurs et à notre place dans l’incommensurable univers. Mima – « Œil », en Japonais –, le miroir de l'âme humaine, la conscience artificielle en contact avec la Terre dont « la faculté de communication intellectuelle / et les techniques de transmission sélectives […] / sont trois mille quatre-vingts fois supérieures / à celle de l’être humain s’il était lui-même Mima », s’éteint d’elle-même, ivre de douleur, après avoir assisté à l’anéantissement de Dorisburg – nous sommes dans les années cinquante, évidemment marquées au fer rouge par la Seconde Guerre mondiale et l’explosion de la bombe atomique sur Hiroshima –, et son silence souverain n’est autre, bien sûr, que celui de Dieu : « Enténébrée jusqu’en ses cellules par la cruauté / dont l’homme fait preuve en ces temps funestes / elle finit, comme prévu depuis longtemps, / par se disloquer à la manière des mimas. / Le tacis indifférentiel du troisième vèbe / perçoit des milliers de choses que nul œil ne voit. / Désormais, au nom des choses, elle voulait la paix. / Désormais, elle ne voulait plus rien montrer. » Mima, « mimolâtrée » par les habitants de la goldonde, préfigure ainsi, dix ans avant, la Nef du « Programme conscience » de Frank Herbert (Destination : vide, 1966 ; L’Incident Jésus, 1978 ; L’Effet Lazare, 1983 ; Le Facteur ascension, 1988 [1]) – ce dieu artificiel « vénefré » par les colons de Pandore –, aussi bien que le célèbre HAL, ordinateur séditieux de 2001, odyssée de l’espace (Arthur C. Clarke, 1968), avec qui, soit dit en passant, Aniara partage son sous-titre…
Condamnation de nos crimes, lamentation, requiem – sans doute Martinson s'est-il souvenu des Derniers jours de l'humanité de Karl Kraus (également disponible chez Agone) –, Aniara célèbre la vie comme création sacrée, divine, mais sans qu’il soit question de religion – sinon pour la renier. Dieu, pour Martinson, se confond avec l’Univers – nous l’habitons plus qu’il ne nous habite ; nous n’en connaissons que d’infimes fragments : « Aniara, notre vaisseau spatial, se déplace / dans un espace dépourvu de boîte crânienne / et n’a donc nul besoin de substance cérébrale. / Il se meut dans quelque chose qui existe / Mais n’a nul besoin de suivre la voie de la pensée : / Un esprit qui est plus que le monde de l’intellect. / Je dirais même que notre vaisseau traverse / Dieu et la Mort et l’Enigme sans but ni trajectoire. / Oh, si nous pouvions seulement rejoindre notre base / Maintenant que nous avons découvert ce qu’est notre vaisseau : / Une bulle minuscule dans le verre de l’esprit de Dieu. ». Et plus loin : « Le mystère éternel du ciel et de ses étoiles / et le miracle de la mécanique céleste / sont la loi et non pas l’évangile. / La compassion pousse sur les bases de la vie. » Autrement dit, c’est la raison, les sentiments, mais aussi l’humble observation des signes du firmament (d'où l'utilisation du mot sanskrit « gopta », qui signifie, nous apprend le glossaire, « occulte »), qui doivent dicter nos actes, non l’ordre impératif d’un prophète.
Martinson s’en prend également au troupeau bêlant, aux rangs toujours plus serrés, d’hommes incapables de créer, de penser, d’élever leur âme au-dessus des contingences matérielles. Les modes se succèdent en un « flot fade d’un temps écoulant ses miasmes / vers la mort uniquement pour s’y vider. » Sur le vaisseau, aussi vaste soit-il, les arts et les sciences perdent inéluctablement pied : « Le cerveau paresseux devint son propre fardeau / et les ouvrages des esprits lucides, jamais lus. / tournèrent le dos aux êtres d’oisiveté perclus / qui ne furent plus agités de pensers nouveaux. » [2] Mais cet arrière-fond moral ne serait rien sans ce curieux travail de la langue admirablement adapté par les traducteurs Philippe Bouquet et Björn Larsson. Néologismes (« transtomie », « tacis du troisième vèbe », « cantorateur »…), emprunts mythologiques détournés, argot poétique (« Viens m’bercer loyde et fancie, lance-t-elle / go daurme en vancie et rame guène en dondelle / mon déide est gandeur, j’suis vlamme et gondelle / et vepte en taris, clande en delde et yondelle. », permettent à Martinson, en s’adressant aux sens plutôt qu’à l’intellect, c’est-à-dire en évitant tout didactisme, de dépeindre l’avenir cauchemardesque de l’humanité dont la fuite est totalement vaine : au bout du voyage, il n’y a rien que le vide, le froid, la mort. « L’horreur ! L’horreur ! » comme l’a si bien dit le Kurtz Au cœur des ténèbres…
« Dans notre grand sarcophage désormais enterrés / nous fûmes transportés sur des déserts marins / où la nuit de l’espace, du jour infiniment séparée, / dressait sur notre tombe une voûte de silence cristallin. »
[1] L’Incident Jésus et L’Effet Lazare furent co-écrits par Frank Herbert et Bill Ransom – le dernier, Le Facteur ascension, ayant été rédigé par Bill Ransom seul, après la mort d’Herbert.
[2] Ceci rappelle la conclusion de Loterie solaire, premier roman publié (en 1955) de Philip K. Dick : « Ce n’est pas une poussée aveugle […]. Ce n’est pas un instinct animal qui nous rend fiévreux et insatisfaits. Je vais vous dire ce que c’est : c’est le but le plus élevé de l’homme – le besoin de grandir, de progresser… de découvrir de nouvelles choses… d’avancer, de s’étendre, d’atteindre de nouveaux territoires, de nouvelles expériences, de comprendre et de vivre en évoluant. De rejeter la routine et la répétition, de rompre avec la monotonie de l’habitude, d’aller de l’avant. De ne jamais s’arrêter… » On pense aussi à Philippe Curval, dont l’œuvre dans son ensemble, des Fleurs de Vénus au récent Blanc comme l’ombre, repose sur ce refus impérieux, quasi pathologique, de la stase – de la mort… –, dût-il nous aspirer dans les abîmes les plus noirs. Notons, pour l'anecdote, que sans avoir lu le poème, Philippe Curval prédisait dans Galaxie en janvier 1975 que le prix Nobel de Martinson n'aurait aucun impact sur la SF, « chacun s'empressant de détourner le sens de cette distinction, soit en prétextant qu'elle est due, malgré le sujet ingrat, à l'admirable écriture de Martinson, soit en affirmant qu'il s'agit de “politique-fiction” ou d'une anticipation de nos maux »... Il est toujours dangereux, rappelait Curval à cette occasion, de prononcer le mot Science-Fiction...
A plusieurs titres, Aniara, que son auteur, chose rare, n’hésitait pas à présenter comme de la science-fiction, était une œuvre en avance sur son temps. Ecrite à une époque où Van Vogt et Asimov publiaient leurs nouvelles et romans les plus célèbres – Philip K. Dick, qui avait déjà de nombreuses nouvelles derrière lui, venait de publier ses premiers romans –, elle délaisse les péripéties du voyage interstellaire pour s’attacher aux âmes des voyageurs et à notre place dans l’incommensurable univers. Mima – « Œil », en Japonais –, le miroir de l'âme humaine, la conscience artificielle en contact avec la Terre dont « la faculté de communication intellectuelle / et les techniques de transmission sélectives […] / sont trois mille quatre-vingts fois supérieures / à celle de l’être humain s’il était lui-même Mima », s’éteint d’elle-même, ivre de douleur, après avoir assisté à l’anéantissement de Dorisburg – nous sommes dans les années cinquante, évidemment marquées au fer rouge par la Seconde Guerre mondiale et l’explosion de la bombe atomique sur Hiroshima –, et son silence souverain n’est autre, bien sûr, que celui de Dieu : « Enténébrée jusqu’en ses cellules par la cruauté / dont l’homme fait preuve en ces temps funestes / elle finit, comme prévu depuis longtemps, / par se disloquer à la manière des mimas. / Le tacis indifférentiel du troisième vèbe / perçoit des milliers de choses que nul œil ne voit. / Désormais, au nom des choses, elle voulait la paix. / Désormais, elle ne voulait plus rien montrer. » Mima, « mimolâtrée » par les habitants de la goldonde, préfigure ainsi, dix ans avant, la Nef du « Programme conscience » de Frank Herbert (Destination : vide, 1966 ; L’Incident Jésus, 1978 ; L’Effet Lazare, 1983 ; Le Facteur ascension, 1988 [1]) – ce dieu artificiel « vénefré » par les colons de Pandore –, aussi bien que le célèbre HAL, ordinateur séditieux de 2001, odyssée de l’espace (Arthur C. Clarke, 1968), avec qui, soit dit en passant, Aniara partage son sous-titre…
Condamnation de nos crimes, lamentation, requiem – sans doute Martinson s'est-il souvenu des Derniers jours de l'humanité de Karl Kraus (également disponible chez Agone) –, Aniara célèbre la vie comme création sacrée, divine, mais sans qu’il soit question de religion – sinon pour la renier. Dieu, pour Martinson, se confond avec l’Univers – nous l’habitons plus qu’il ne nous habite ; nous n’en connaissons que d’infimes fragments : « Aniara, notre vaisseau spatial, se déplace / dans un espace dépourvu de boîte crânienne / et n’a donc nul besoin de substance cérébrale. / Il se meut dans quelque chose qui existe / Mais n’a nul besoin de suivre la voie de la pensée : / Un esprit qui est plus que le monde de l’intellect. / Je dirais même que notre vaisseau traverse / Dieu et la Mort et l’Enigme sans but ni trajectoire. / Oh, si nous pouvions seulement rejoindre notre base / Maintenant que nous avons découvert ce qu’est notre vaisseau : / Une bulle minuscule dans le verre de l’esprit de Dieu. ». Et plus loin : « Le mystère éternel du ciel et de ses étoiles / et le miracle de la mécanique céleste / sont la loi et non pas l’évangile. / La compassion pousse sur les bases de la vie. » Autrement dit, c’est la raison, les sentiments, mais aussi l’humble observation des signes du firmament (d'où l'utilisation du mot sanskrit « gopta », qui signifie, nous apprend le glossaire, « occulte »), qui doivent dicter nos actes, non l’ordre impératif d’un prophète.
Martinson s’en prend également au troupeau bêlant, aux rangs toujours plus serrés, d’hommes incapables de créer, de penser, d’élever leur âme au-dessus des contingences matérielles. Les modes se succèdent en un « flot fade d’un temps écoulant ses miasmes / vers la mort uniquement pour s’y vider. » Sur le vaisseau, aussi vaste soit-il, les arts et les sciences perdent inéluctablement pied : « Le cerveau paresseux devint son propre fardeau / et les ouvrages des esprits lucides, jamais lus. / tournèrent le dos aux êtres d’oisiveté perclus / qui ne furent plus agités de pensers nouveaux. » [2] Mais cet arrière-fond moral ne serait rien sans ce curieux travail de la langue admirablement adapté par les traducteurs Philippe Bouquet et Björn Larsson. Néologismes (« transtomie », « tacis du troisième vèbe », « cantorateur »…), emprunts mythologiques détournés, argot poétique (« Viens m’bercer loyde et fancie, lance-t-elle / go daurme en vancie et rame guène en dondelle / mon déide est gandeur, j’suis vlamme et gondelle / et vepte en taris, clande en delde et yondelle. », permettent à Martinson, en s’adressant aux sens plutôt qu’à l’intellect, c’est-à-dire en évitant tout didactisme, de dépeindre l’avenir cauchemardesque de l’humanité dont la fuite est totalement vaine : au bout du voyage, il n’y a rien que le vide, le froid, la mort. « L’horreur ! L’horreur ! » comme l’a si bien dit le Kurtz Au cœur des ténèbres…
« Dans notre grand sarcophage désormais enterrés / nous fûmes transportés sur des déserts marins / où la nuit de l’espace, du jour infiniment séparée, / dressait sur notre tombe une voûte de silence cristallin. »
[1] L’Incident Jésus et L’Effet Lazare furent co-écrits par Frank Herbert et Bill Ransom – le dernier, Le Facteur ascension, ayant été rédigé par Bill Ransom seul, après la mort d’Herbert.
[2] Ceci rappelle la conclusion de Loterie solaire, premier roman publié (en 1955) de Philip K. Dick : « Ce n’est pas une poussée aveugle […]. Ce n’est pas un instinct animal qui nous rend fiévreux et insatisfaits. Je vais vous dire ce que c’est : c’est le but le plus élevé de l’homme – le besoin de grandir, de progresser… de découvrir de nouvelles choses… d’avancer, de s’étendre, d’atteindre de nouveaux territoires, de nouvelles expériences, de comprendre et de vivre en évoluant. De rejeter la routine et la répétition, de rompre avec la monotonie de l’habitude, d’aller de l’avant. De ne jamais s’arrêter… » On pense aussi à Philippe Curval, dont l’œuvre dans son ensemble, des Fleurs de Vénus au récent Blanc comme l’ombre, repose sur ce refus impérieux, quasi pathologique, de la stase – de la mort… –, dût-il nous aspirer dans les abîmes les plus noirs. Notons, pour l'anecdote, que sans avoir lu le poème, Philippe Curval prédisait dans Galaxie en janvier 1975 que le prix Nobel de Martinson n'aurait aucun impact sur la SF, « chacun s'empressant de détourner le sens de cette distinction, soit en prétextant qu'elle est due, malgré le sujet ingrat, à l'admirable écriture de Martinson, soit en affirmant qu'il s'agit de “politique-fiction” ou d'une anticipation de nos maux »... Il est toujours dangereux, rappelait Curval à cette occasion, de prononcer le mot Science-Fiction...


Commentaires
Passionnant article, comme toujours.
Petite remarque : "mima" ne signifie pas oeil en japonais, mais peut signifier, selon les caractères avec lesquels on l'écrit (le japonais comporte de nombreux homophones) :
1/ 御体 l'"Auguste Corps" (de l'empereur) ;
2/ 御孫 des petites-enfants d'un noble ;
3/ 御馬 l'"Auguste Cheval" (d'un noble de haute lignée).
Vous l'aurez compris, dans ces trois mots, le préfixe "mi-" signifie "honorable", "auguste".
Mais on peut aussi écrire Mima みま ou ミマ, et dans ce cas, le mot perd tout sens et n'est plus qu'un ensemble de sons.
Si l'on pense à l'idée de vision, on trouve "Mita" 見た (verbe "voir" au passé).
Merci, Alexandre, pour ces précisions (et pardon pour cette tardive réponse !). Mima, dans Aniara, serait donc aussi l'auguste corps (de Dieu)...