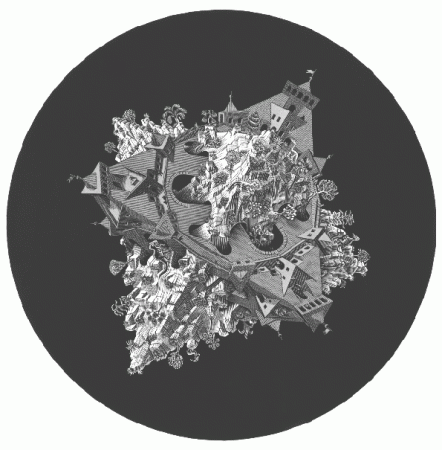
« Je sais qu’on m’accuse d’orgueil, peut-être de misanthropie, peut-être de démence. Ces accusations (que je punirai le moment venu) sont ridicules. Il est exact que je ne sors pas de ma maison ; mais il est non moins exact que les portes de celle-ci, dont le nombre est infini, sont ouvertes jour et nuit aux hommes et aussi aux bêtes. Entre qui veut. »
Jorge Luis Borges, La Demeure d’Astérius.
« Le diamètre de l’Aleph devait être de deux ou trois centimètres, mais l’espace cosmique était là, sans diminution de volume. Chaque chose (la glace du miroir par exemple) équivalait à une infinité de choses, parce que je la voyais clairement de tous les points de l’univers. »
Jorge Luis Borges, L’Aleph.
 Roman labyrinthique [1], borgésien en diable – on pense aussi à Edgar Poe et, bien sûr, au Feu pâle de Nabokov –, La maison des feuilles [2] est le fruit de douze ans de travail… J’en vois qui se gaussent, mais à le lire, on comprend combien ces douze années [3] ont été nécessaires : La maison des feuilles tient en effet autant de l’ouvrage universitaire que du roman, tant les références citées, réelles ou inventées, sont nombreuses [4]. D’emblée, Danielewski brouille les pistes : les auteurs crédités en page de titre ne sont autres que Zampano [5] – à qui nous devons l’exégèse du Navidson Record, vrai-faux film documentaire sur une (fausse ?) maison, infiniment plus vaste à l’intérieur qu’à l’extérieur (lire la note 22) – et Johnny Errand (référence souterraine au Billy Pèlerin de Kurt Vonnegut ?), commentateur de cette exégèse et auteur de logorrhéiques notes de bas de page (qui font aussi office de journal intime), sans oublier le (vrai) traducteur, Claro [6]. De fait, La maison des feuilles est bien un roman, mais présenté sous la forme d’une thèse aussi ardue que démente, où la mise en page hallucinante (typographies variées, pages blanches ou, au contraire, couvertes de minuscules caractères, reproductions de photographies, textes barrant obliquement les pages ou se chevauchant, écheveau inextricable de notes diverses, etc.) reflète les états d’âme des auteurs-personnages. La maison en elle-même, d’apparence banale, défie pourtant l’imagination : ses nouveaux locataires, Will Navidson, photographe lauréat du prix Pulitzer, sa femme Karen et leurs deux enfants Chad et Daisy, découvrent un matin une nouvelle porte donnant sur un couloir d’abord réduit mais qui prend par la suite d’inquiétantes proportions. Lorsque ce corridor paraît s’étendre à l’infini, silencieux [7] et ténébreux, Navidson décide de l’explorer, armé de caméras Hi8 et d’un appareil photo. Le texte de Zampano s’attache ainsi à analyser les différents films tournés par Navidson et par des hommes de terrain venus en renfort, films qui rendent compte de l’immensité vertigineuse de la maison. Zampano sonde les pistes comme Navidson a exploré la maison, se perdant dans les méandres de ses innombrables implications scientifiques, philosophiques, artistiques et psychologiques. Cette maison existe-t-elle – dans la diégèse du roman s’entend – ? Même cela est sujet à caution, puisque si Zampano prétend que le Navidson Record fut effectivement distribué par Miramax [9], le dépositaire de ses notes, Johnny Errand – schizophrène paranoïaque patenté –, nous indique en revanche qu’on ne retrouve nulle trace d’un tel document – et encore moins d’une telle maison –, sinon dans un mystérieux ouvrage intitulé… La maison des feuilles !
Roman labyrinthique [1], borgésien en diable – on pense aussi à Edgar Poe et, bien sûr, au Feu pâle de Nabokov –, La maison des feuilles [2] est le fruit de douze ans de travail… J’en vois qui se gaussent, mais à le lire, on comprend combien ces douze années [3] ont été nécessaires : La maison des feuilles tient en effet autant de l’ouvrage universitaire que du roman, tant les références citées, réelles ou inventées, sont nombreuses [4]. D’emblée, Danielewski brouille les pistes : les auteurs crédités en page de titre ne sont autres que Zampano [5] – à qui nous devons l’exégèse du Navidson Record, vrai-faux film documentaire sur une (fausse ?) maison, infiniment plus vaste à l’intérieur qu’à l’extérieur (lire la note 22) – et Johnny Errand (référence souterraine au Billy Pèlerin de Kurt Vonnegut ?), commentateur de cette exégèse et auteur de logorrhéiques notes de bas de page (qui font aussi office de journal intime), sans oublier le (vrai) traducteur, Claro [6]. De fait, La maison des feuilles est bien un roman, mais présenté sous la forme d’une thèse aussi ardue que démente, où la mise en page hallucinante (typographies variées, pages blanches ou, au contraire, couvertes de minuscules caractères, reproductions de photographies, textes barrant obliquement les pages ou se chevauchant, écheveau inextricable de notes diverses, etc.) reflète les états d’âme des auteurs-personnages. La maison en elle-même, d’apparence banale, défie pourtant l’imagination : ses nouveaux locataires, Will Navidson, photographe lauréat du prix Pulitzer, sa femme Karen et leurs deux enfants Chad et Daisy, découvrent un matin une nouvelle porte donnant sur un couloir d’abord réduit mais qui prend par la suite d’inquiétantes proportions. Lorsque ce corridor paraît s’étendre à l’infini, silencieux [7] et ténébreux, Navidson décide de l’explorer, armé de caméras Hi8 et d’un appareil photo. Le texte de Zampano s’attache ainsi à analyser les différents films tournés par Navidson et par des hommes de terrain venus en renfort, films qui rendent compte de l’immensité vertigineuse de la maison. Zampano sonde les pistes comme Navidson a exploré la maison, se perdant dans les méandres de ses innombrables implications scientifiques, philosophiques, artistiques et psychologiques. Cette maison existe-t-elle – dans la diégèse du roman s’entend – ? Même cela est sujet à caution, puisque si Zampano prétend que le Navidson Record fut effectivement distribué par Miramax [9], le dépositaire de ses notes, Johnny Errand – schizophrène paranoïaque patenté –, nous indique en revanche qu’on ne retrouve nulle trace d’un tel document – et encore moins d’une telle maison –, sinon dans un mystérieux ouvrage intitulé… La maison des feuilles !Danielewski n’est certes pas le premier à mettre son propre livre en abyme (Feu pâle, en 1961, nous donnait à lire non seulement le poème autobiographique d'un certain John Shade, mais aussi les commentaires du poème par Kinbote, et enfin les notes du commentaire) mais nul, sans doute, ne l’avait fait avec autant de zèle. La maison des feuilles, au premier degré, rappelle évidemment les romans de Philip K. Dick – Ubik, Le Maître du haut-château, Substance Mort… – ou les nouvelles de H.P. Lovecraft (La Maison de la sorcière). Moins viscéralement schizo et parano que le premier, moins effrayant que le second, il est en revanche plus « cérébral » et, surtout, plus fondamentalement labyrinthique. Savant mélange de Twin Peaks [10], The Blair Witch Project [11], The Kingdom [12] et de géométrie non-euclidienne lovecraftienne, [13] La maison des feuilles relève de l’horreur gothique classique comme de l’approche post-moderne des concepts de réalité, de perception et d’infosphère. Son foisonnement démentiel, qu’on peut juger rebutant, n’est jamais gratuit [14] : le roman représente au contraire fort pertinemment le gouffre ontologique qui menace d’engloutir notre société technologique du 21e siècle saturée d’information, de même que l’héritage artistique, fondu en une sorte de métacouche de pâte à modeler grisâtre, ensevelit peu à peu une création contemporaine orpheline de sens. De ce point de vue, La maison des feuilles est sans doute la plus extraordinaire métaphore littéraire du paradoxe de l’humanité technologique, poussière insignifiante à l’échelle cosmique, mais à son tour capable de créer de véritables univers aussi vastes que celui qui la contient – ou d’accoucher malgré elle d’une intelligence totalement inhumaine – : l’infiniment petit englobant l’infiniment grand…
Comparer Danielewski à James Joyce est alors injuste : si Danielewski ne possède pas le génie de l’auteur de Ulysses et de Finnegan’s wake, il offre néanmoins avec La maison des feuilles une œuvre hors normes, définitivement plus riche que ce qu’elle donne à voir, à l’image de la maison elle-même. Son influence excède en effet largement le cadre du livre-objet pour atteindre à une sorte d’épiphanie, fenêtre étroite – plus de 700 pages tout de même ! – ouverte sur des abîmes de références, de concepts, d’histoires ; ouverte, en somme, sur l’infini – sur le divin. Bien sûr, à n’évoquer que son apparente complexité – c'est une bibliothèque de Babel à lui seul –, on en oublierait presque qu’il s’agit avant tout d’une œuvre littéraire – le terme de « roman », trop formaté, trop assujetti à ses formes canoniques, paraît ici inadapté –, or La maison des feuilles, sous ses atours d’essai plus ou moins ésotérique, procure à son lecteur une expérience formelle indéniable : les aventures de Navidson dans la maison, vécues au travers des descriptions et analyses de Zampano, sont en elles-mêmes passionnantes, mais le journal intime de Johnny Errand, dissimulé dans de longues notes de bas de pages, est quant à lui pleinement dramatique, quelque part entre une littérature typiquement anglo-saxonne, disons dans la lignée de William Burroughs [15] et de Chuck Palahniuk (dont il faut relire Fight club, Monstres invisibles et Berceuse, tous disponibles dans la Noire de Gallimard), et les récits déstructurés d’un Fabrice Colin [16] – ou ceux, dont il me faudra aussi parler un jour, d’Antoine Volodine, auteur de textes aussi inclassables que Biographie comparée de Jorian Murgrave (Denoël) ou Lisbonne, dernière marge (Minuit). Les lettres de la mère de Johnny adressées à ce dernier, reproduites en annexe – et publiées indépendamment du roman, toujours chez Denoël & D’ailleurs, sous le titre Les Lettres de Pelafina –, éclairent le récit et forment en elles-mêmes un récit épistolaire autonome [17]. Peu à peu le lecteur – aidé en cela par les nombreux documents annexes – accompagne Errand dans son enfer labyrinthique, et assiste à sa tragédie, inextricablement liée – ici réside sans doute le génie de Danielewski – à l’histoire de La maison des feuilles elle-même [18]. Comme chez Volodine tous ces niveaux de lecture (Zampano, Errand, Claro, Danielewski…) s’enchevêtrent, s’écartèlent, s’enchâssent ad nauseam, tissant une trame fascinante, propre à susciter cauchemars étranges (le roman fait vraiment peur) et maux de tête lancinants. La maison des feuilles force le lecteur à s’emparer du livre, à se l’approprier, à le réécrire selon sa propre vision du labyrinthe ; il existe autant de façons d’explorer la maison qu’il existe de lecteurs, mais toutes mènent, au final, à la même terrifiante constatation : Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici [19]. Et si, en tant que thriller gothique ou fantastique, La maison des feuilles peut décevoir – trop expérimental, trop métaphysique –, celle-ci se révèle extrêmement stimulante, vertigineuse, comme une extension moderne et incontrôlée de « La Demeure d’Astérion » de Jorge Luis Borges (in L’Aleph, Gallimard, « L’imaginaire », 1967), écrivain dont l’ombre plane sur chaque page – comme chez Borges, l’angoisse de Thésée, désorienté et cible d’un Mal qui peut surgir de n’importe où, est palpable, d’autant qu’elle nous renvoie à nos pratiques d’hommes modernes à l’hypertextualité psychotique et débilitante dont la blogosphère est un exemple éloquent : ne sommes-nous pas en train de dissoudre nos âmes, progressivement, de lien en lien ?
Surtout, que la densité et parfois l’aridité du texte ne vous arrêtent pas[20] ; persévérez : vous verrez alors combien la maison vous hantera longtemps [21], et combien l’expérience vous aura transporté dans un ailleurs qui pourrait bien n’être, en définitive, que l’abîme de votre propre esprit. Mais attention : l’exploration de La maison des feuilles ne laisse jamais indemne : il vous sera désormais impossible de lire un roman comme vous le faisiez auparavant ; vous vous surprendrez à y chercher des phrases codées, à y traquer le Logos, à discerner son inframonde et, levant les yeux vers ce que vous croyiez être le monde réel, vous vous attendrez à voir surgir dans votre maison – ou votre appartement – de nouvelles pièces, de nouveaux couloirs, menant vers nulle part [24], vers Dieu ou vers le Mal absolu, baignés dans un silence de mort seulement troublé par un grondement chtonien auquel il vous suffira de penser pour sombrer – du moins faut-il le souhaiter... – dans un état proche de la catalepsie…
[1] Si d’aucuns ont évoqué – un brin abusivement – l’œuvre de James Joyce, pour son caractère résolument expérimental, on peut aussi aller voir du côté du nouveau roman, de l’Oulipo ou de la nouvelle vague anglaise (*) pour la recherche d’une adéquation totale entre signifiant et signifié.
(*) Notons que Danielewski doit beaucoup, entre autres, à James G. Ballard. Dans son chef d’oeuvrissime recueil Fièvre guerrière (Stock, 1992), nous trouvons, pêle-mêle :
- une nouvelle en forme d’index ;
- une autre, Note pour une déconstruction mentale, qui se compose d’une phrase et de longues notes de bas de pages ;
- une troisième, Univers en expansion, dans laquelle un homme perçoit sa maison comme un espace de plus en plus vaste ;
- une quatrième, Rapport sur une station spatiale non identifiée, où ladite station s’étend à mesure qu’elle est explorée, en sorte qu’elle finit par se confondre avec l’Univers...
Difficile de croire à une coïncidence… Il est alors permis de regretter que parmi son armée de références et autres citations (Pound, Duras, Derrida, Milton, etc., et même Heidegger en Allemand ! ainsi, d’ailleurs, que de nombreux autres extraits en langue originale…), Mark Z. Danielewski ait « oublié » le grand James G. Ballard [23]…
[2] La couleur du mot maison n’est pas fortuite ; elle trouve son explication à la faveur d’une citation d’origine inconnue. De plus, tout ce qui a trait au
[3] Voilà qui relativise les longues heures, les nuits blanches, les faces de zombies, qu’exige la lecture de La maison des feuilles…
[4] Saluons l’initiative de l’auteur qui a eu la bonté d’insérer un index à multiples entrées dans son ouvrage (cf note ci-dessus à propos de James Ballard).
[5] Mark « Z. » Danielewski : « Z » pour Zampano ?...
[6] Claro est également traducteur de John Flint, Thomas Pynchon, William T. Vollmann, John Barth, etc., directeur de la collection « Lot 49 » au Cherche Midi, et lui-même auteur de plusieurs romans, dont le récent et excellent Bunker anatomie (Verticales, « minimales », 2004), sur lequel je reviendrai sans doute.
[7] A l’exception d’un grognement, ou grondement, selon les témoignages. Bête,
[8] Hi8 : caméras vidéo professionnelles.
[9] Miramax : célèbre entreprise de production cinématographique dite « indépendante » (*)
(*) Indépendante ? Ah ah !
[10] Twin Peaks (David Lynch, 1989-1992) : série sophistiquée et post-moderne emblématique du style de son créateur, et assez proche, de par sa complexité et de par son inquiétante étrangeté, de La maison des feuilles. Varie du sublime au n’importe quoi.
[11] Le projet Blair Witch (Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, USA, 1999) : le film joue, comme le roman, sur la prétendue réalité des images.
[12] The Kingdom / L’hôpital et ses fantômes (Lars von Trier, Danemark, 1994-1997) : série comique, horrifique et danoise mettant en scène un hôpital hanté, lieu d’événements inexplicables, dont les couloirs et les sous-sols n’ont vraiment rien de rassurant…
[13] Lovecraft était effectivement féru d’angles bizarres et autres anomalies géométriques. Mais on ne saurait assimiler le récit de Danielewski/Zampano/Errand à du fantastique lovecraftien : La maison des feuilles, qui doit beaucoup à l’Aleph borgésien, serait plutôt le roman phénoménologique par excellence…
[14] 29€ pour être précis.
[15] Les pathétiques divagations de Johnny Errand ne sont pas sans évoquer les récits autobiographiques de Burroughs, comme Le Festin nu (Gallimard, L’imaginaire n°138, 1984) ou Junky (10-18, 1988).
[16] Fabrice Colin dont on connaît le goût des jeux formels et spéculaires : lire le formidable Or not to be (L’Atalante, 2002), et le non moins impressionnant Sayonara baby (L’Atalante, 2004), dont il sera bientôt question sur ce blog.
[17] Ceci me fait penser à un autre chef d’œuvre, Camp de concentration de Thomas Disch (Laffont Ailleurs & Demain Classiques, 1978), jamais réédité depuis 20 ans – un scandale – dans lequel le narrateur, dans son journal, inclut une nouvelle parfaitement autonome et néanmoins étroitement liée au reste du roman. Camp de concentration, écrit en 1968 et marqué par la guerre du Vietnam, narre les déboires d’un poète objecteur de conscience emprisonné puis transféré dans un centre d’expérimentation scientifique. Les « pensionnaires » sont drogués à la pallidine, drogue puissante qui décuple les capacités intellectuelles et créatives mais qui a l’accessoire inconvénient de tuer le patient en quelques mois seulement, non sans leur avoir fait tutoyer le génie absolu, c’est-à-dire ces contrées de l’esprit où la folie menace – on pense encore à William Burroughs pour certains passages torturés à souhait : du grand art.
[18] L’histoire de Navidson bien sûr, mais aussi celle du livre de Zampano… à moins qu’il ne s’agisse de celui de Danielewski ? Allez savoir !
[19] Dante, L’enfer, chant III, vers 7-9, cité page 4 de La maison des feuilles.
[20] Cette phrase sibylline figure en exergue : Ceci n’est pas pour vous. Vous voilà avertis.
[21] Danielewski retourne ainsi les conventions comme des gants. La maison n’est plus hantée : c’est elle, au contraire, qui hante le visiteur et, par extension, le lecteur. Le projet de La maison des feuilles est contenu tout entier dans cette idée toute borgésienne : la maison, en définitive, n’est que la projection architecturale de votre cerveau dérangé. En cela surtout Danielewski parvient à faire oublier les troublantes similitudes observées plus haut entre sa maison des feuilles et les nouvelles de James Ballard (cf astérisque de la note « 1 »), sans parler, évidemment, des textes de Borges, figure tutélaire écrasante.
[23] L’un de mes lecteurs me signale néanmoins que l’un des auteurs fictifs de Danielewski se serait perdu quelque part entre les pages 400 et 430… Un lien gratuit pour qui trouvera sa trace. Tiens, étrange : il semblerait que la note 22 ait elle aussi disparu…
[24] Je dois ici avouer combien m’étreint l’angoisse de la folie. Celle du héros, dont la mise en page et la construction du récit rendent admirablement compte, m’a donc atteint au plus profond de ma peur…




 « Toutes les humiliations qu’il avait subies pouvaient être balayées par cet acte très simple d’annihilation : le MEURTRE ! » Ces mots prononcés en prologue (issus du livre) justifient les actes de Peter Neal, le meurtre s’y annonce d’emblée comme une cérémonie de libération. Or Tenebrae, le titre du film, est le nom d’un office liturgique particulier, au cours duquel les bougies de l’autel sont éteintes une à une, plongeant peu à peu l’église dans la pénombre, jusqu’à l’obscurité qui évoque les ténèbres spirituelles de la trahison (par
« Toutes les humiliations qu’il avait subies pouvaient être balayées par cet acte très simple d’annihilation : le MEURTRE ! » Ces mots prononcés en prologue (issus du livre) justifient les actes de Peter Neal, le meurtre s’y annonce d’emblée comme une cérémonie de libération. Or Tenebrae, le titre du film, est le nom d’un office liturgique particulier, au cours duquel les bougies de l’autel sont éteintes une à une, plongeant peu à peu l’église dans la pénombre, jusqu’à l’obscurité qui évoque les ténèbres spirituelles de la trahison (par 


 Le spectre tutélaire du Voyeur / Peeping Tom [Grande-Bretagne, 1959] de Michael Powell, plane sur l’ensemble du film : la caméra de Mark / Karl-Heinz Böhm est en effet diégétiquement à la fois sexe (le pied-épée, dressé en direction des jeunes femmes, simule l’érection) et arme (le pied-épée transperce ses victimes tandis que la caméra filme leur agonie), Peeping Tom déployant son dispositif de mise en abyme du processus filmique – le cinéma comme voyeurisme, comme nous le verrons – voire de la cinéphilie – manifestation particulière des névroses et perversions freudiennes. La caméra d’Argento est un phallus protéiforme capable de suivre le trajet d’un comprimé dans le tube digestif d’un personnage (Le Syndrôme de Stendhal), de s’infiltrer dans un canal vasculaire pour nous montrer les « pulsations » ( ? ) symboliques d’un cerveau malade (Opera), de s’introduire avec obscénité dans la large bouche d’une cantatrice (Le Fantôme de l’Opéra) et ainsi obtenir un gros plan évoquant un sexe féminin béant (avec la glotte en guise de clitoris disproportionné ; a-t-on jamais vu image plus crue, comme une pénétration en caméra subjective-pénis ?...), ou encore de zigzaguer (grâce à l’emploi d’une autre caméra spéciale, la « Snorkel », qui fonctionne sur le principe de l’endoscopie) entre de petits objets dans une séquence très abstraite de Profondo rosso. La caméra se fait également arme lorsqu’elle déchire les chairs : ainsi dans Suspiria une force démoniaque, comme activée par la caméra – zooms rehaussés par une bande-son incantatoire –, prend possession du chien d’un aveugle et le pousse à égorger son maître (Miss Tanner est sans doute l’instigatrice de ce forfait, mais la caméra, élément pourtant extradiégétique, semble être sa seule arme). C’est encore la caméra qui étrangle Gianni dans Ténèbres, autant que la corde : avant de mourir le jeune homme plonge son regard dans l’objectif, comme pour connaître, avant de pousser son dernier souffle, l’identité de son assassin. Nous avons déjà évoqué le plan qui annonçait ce meurtre, montrant Anne dans sa voiture ; un autre, plus éloquent encore, augure ironiquement de la suite : sur le point de se rendre à l’aéroport, encore sur le palier, Neal se retourne dans l’embrasure de la porte et fixe la caméra comme si, profitant de l’absence de sa secrétaire, il pouvait enfin se saisir de son arme, comme un chasseur son fusil. Nous avons également évoqué, plus haut, un autre plan : Anne, quittant le même appartement, ferme la porte ; la caméra s’attarde dans la pénombre de la pièce déserte, la musique que l’on identifie rapidement comme celle qui accompagne les séquences de meurtre commence, l’image panoramique pour s’arrêter sur une lame scintillante, à l’origine indéterminée : le regard-caméra de Peter Neal confirmera que cette lame n’est autre que celle de l’appareil de prise de vue, réminiscence du Voyeur.
Le spectre tutélaire du Voyeur / Peeping Tom [Grande-Bretagne, 1959] de Michael Powell, plane sur l’ensemble du film : la caméra de Mark / Karl-Heinz Böhm est en effet diégétiquement à la fois sexe (le pied-épée, dressé en direction des jeunes femmes, simule l’érection) et arme (le pied-épée transperce ses victimes tandis que la caméra filme leur agonie), Peeping Tom déployant son dispositif de mise en abyme du processus filmique – le cinéma comme voyeurisme, comme nous le verrons – voire de la cinéphilie – manifestation particulière des névroses et perversions freudiennes. La caméra d’Argento est un phallus protéiforme capable de suivre le trajet d’un comprimé dans le tube digestif d’un personnage (Le Syndrôme de Stendhal), de s’infiltrer dans un canal vasculaire pour nous montrer les « pulsations » ( ? ) symboliques d’un cerveau malade (Opera), de s’introduire avec obscénité dans la large bouche d’une cantatrice (Le Fantôme de l’Opéra) et ainsi obtenir un gros plan évoquant un sexe féminin béant (avec la glotte en guise de clitoris disproportionné ; a-t-on jamais vu image plus crue, comme une pénétration en caméra subjective-pénis ?...), ou encore de zigzaguer (grâce à l’emploi d’une autre caméra spéciale, la « Snorkel », qui fonctionne sur le principe de l’endoscopie) entre de petits objets dans une séquence très abstraite de Profondo rosso. La caméra se fait également arme lorsqu’elle déchire les chairs : ainsi dans Suspiria une force démoniaque, comme activée par la caméra – zooms rehaussés par une bande-son incantatoire –, prend possession du chien d’un aveugle et le pousse à égorger son maître (Miss Tanner est sans doute l’instigatrice de ce forfait, mais la caméra, élément pourtant extradiégétique, semble être sa seule arme). C’est encore la caméra qui étrangle Gianni dans Ténèbres, autant que la corde : avant de mourir le jeune homme plonge son regard dans l’objectif, comme pour connaître, avant de pousser son dernier souffle, l’identité de son assassin. Nous avons déjà évoqué le plan qui annonçait ce meurtre, montrant Anne dans sa voiture ; un autre, plus éloquent encore, augure ironiquement de la suite : sur le point de se rendre à l’aéroport, encore sur le palier, Neal se retourne dans l’embrasure de la porte et fixe la caméra comme si, profitant de l’absence de sa secrétaire, il pouvait enfin se saisir de son arme, comme un chasseur son fusil. Nous avons également évoqué, plus haut, un autre plan : Anne, quittant le même appartement, ferme la porte ; la caméra s’attarde dans la pénombre de la pièce déserte, la musique que l’on identifie rapidement comme celle qui accompagne les séquences de meurtre commence, l’image panoramique pour s’arrêter sur une lame scintillante, à l’origine indéterminée : le regard-caméra de Peter Neal confirmera que cette lame n’est autre que celle de l’appareil de prise de vue, réminiscence du Voyeur. 