
« En cette nuit de Noël, les diables verts accrochèrent quatre cents vieilles femmes à leur sinistre tableau de chasse. Dans les semaines qui suivirent, deux mille six cents « terroristes » furent déportées vers ces camps du Laogai d’où l’on ne revenait pas. Le 1er mars, matées, les survivantes avaient repris le travail.
– C’était le prix à payer pour la modernisation du pays, avait expliqué Xuan […]. Dans une économie concurrentielle, c’est ça ou disparaître… Nous sommes en guerre, Jonathan, et à la guerre, certains sont parfois sacrifiés pour que le plus grand nombre vive. Cette nécessité, confusément, le plus grand nombre la reconnaît et l’accepte, et c’est pourquoi, lorsque certaines personnes périssent, le plus grand nombre se tait. D’ailleurs, tu verras, avant l’été plus personne ne se souviendra de ces folles. »
Jean-Michel Truong, Eternity Express
 L’occident croule sous ses anciens. L’Europe, déjà ébranlée par les Krachs boursiers de la netéconomie et de l’Eternity rush (boom économique autour d’une illusoire immortalité), ne peut plus faire face à ce déferlement démographique sans précédent, à ces papyboomers devenus trop encombrants, tels des déchets nucléaires partout indésirables. Acculée, l’Union, charnier vivant, n’a d’autre choix que de sous-traiter leur prise en charge : c’est l’avènement des lois dites de « décentralisation du troisième âge ». Concrètement, les vieillards sont envoyés en Chine, délocalisés pourrait-on dire, où ils finiront leurs jours - croient-ils - dans des villages idylliques bénéficiant de tout le confort permis par la science. Jonathan, médecin désabusé, fait partie du premier convoi en direction de Clifford Estate, l’un de ces paradis enclavés. A bord du transsibérien, entre l’Alsace et le désert de Gobi, des liens se nouent et se défont entre les voyageurs, mettant au jour la vacuité de leurs semblables, leur médiocrité – à tous autant qu’ils sont –, tandis que Jonathan a tout loisir de se plonger dans ses troubles souvenirs. Peu à peu, à la manière d’un puzzle, les pièces s’assemblent et l’image qu’on entraperçoit est celle, ô combien atroce, de la société que nous construisons aveuglément. Nous : c’est-à-dire vous, c’est-à-dire moi.
L’occident croule sous ses anciens. L’Europe, déjà ébranlée par les Krachs boursiers de la netéconomie et de l’Eternity rush (boom économique autour d’une illusoire immortalité), ne peut plus faire face à ce déferlement démographique sans précédent, à ces papyboomers devenus trop encombrants, tels des déchets nucléaires partout indésirables. Acculée, l’Union, charnier vivant, n’a d’autre choix que de sous-traiter leur prise en charge : c’est l’avènement des lois dites de « décentralisation du troisième âge ». Concrètement, les vieillards sont envoyés en Chine, délocalisés pourrait-on dire, où ils finiront leurs jours - croient-ils - dans des villages idylliques bénéficiant de tout le confort permis par la science. Jonathan, médecin désabusé, fait partie du premier convoi en direction de Clifford Estate, l’un de ces paradis enclavés. A bord du transsibérien, entre l’Alsace et le désert de Gobi, des liens se nouent et se défont entre les voyageurs, mettant au jour la vacuité de leurs semblables, leur médiocrité – à tous autant qu’ils sont –, tandis que Jonathan a tout loisir de se plonger dans ses troubles souvenirs. Peu à peu, à la manière d’un puzzle, les pièces s’assemblent et l’image qu’on entraperçoit est celle, ô combien atroce, de la société que nous construisons aveuglément. Nous : c’est-à-dire vous, c’est-à-dire moi.
Après le clonage dans Reproduction interdite, après l’intelligence artificielle dans Le successeur de pierre – deux livres sur lesquels je reviendrai sans doute – et Totalement inhumaine, Jean-Michel Truong s’attaque donc au vieillissement de la population. Ses textes, on le comprend vite, participent tous d’une même réflexion philosophique sans pour autant ressasser les mêmes obsessions ; son Œuvre, essai et romans confondus, d’une rare cohérence, compose une pensée en mouvement dont la pierre angulaire demeure ce malaise dans la civilisation, ce sentiment d’horreur que lui inspire notre histoire, cet avenir proche qu’il pressent désastreux ; ces démons qu’on appelle des « hommes ».
Reproduction interdite et Le successeur de pierre montraient comment la société, impersonnelle, finit toujours par assimiler des pratiques qu’elle a d’abord réprouvées. De fait, Jean-Michel Truong revient brièvement dans Eternity Express sur l’inanité de la distinction opérée actuellement entre clonage thérapeutique et clonage reproductif : accepter le premier, avance-t-il, c’est accepter que tôt ou tard, le second s’imposera naturellement. Et le pire, voyez-vous, le pire, c’est que j’entrevois – mais je n’ose y croire – qu’il a raison, que la promesse d’une vie prolongée par transfusions sanguines et transplantation d’organes à partir de clones, que les enjeux financiers vertigineux, écarteront nos objections éthiques, morales, philosophiques, du revers de la main. Je persiste à croire, comme je l’écrivais dans mon manifeste Des choses et des fantômes, que dans certaines sociétés, dont les nôtres, occidentales, l’image même du clone, même diminué génétiquement, empêchera toute exploitation industrielle légale. Hélas ! Lire la prose de Jean-Michel Truong guérit de toute naïveté. Dans son livre, l’euthanasie légale ne serait à son tour que le premier pas – le plus important – vers une politique de régulation de la population par le contrôle des naissances, mais aussi, vous l’aurez deviné, par le contrôle des décès ! Dans Le successeur de pierre déjà, où l’humanité des nantis ne subsiste plus qu’isolément, sous la protection hautement technologique de cocons artificiels dont les éléments vitaux sont à la merci du règne informatique, la mort était littéralement programmée selon certains paramètres sociaux bien précis. Impensable ? Erreur ! Aujourd’hui l’euthanasie est acceptée par plusieurs pays – l’utilitarisme, la réification générale, guettent. De réformes – notez combien les néolibéraux raffolent de ce terme – en réajustements, la décision finale glissera progressivement du cercle proche des malades, comme nous l’admettons chaque jour davantage en France – moi-même, en écrivant ces lignes, je me rends compte (j’en ai la nausée) que je n’y suis pas viscéralement opposé : je suis un monstre ! –, à une hiérarchie de plus en plus éloignée. En d’autres termes, demain, ou après-demain, la décision de débrancher les fils qui maintiennent votre parent en vie, échoira à un fonctionnaire ou, pire, à un directeur commercial en blouse blanche. La démonstration est certes contestable, mais elle fait indubitablement peur, très peur en vérité, car ce que prédit l’auteur, Cassandre averti des biotechnologies, n’est rien moins que l’extermination planifiée des vieillards occidentaux qui représentent une charge financière trop lourde pour leurs descendants… Son Eternity Express, autant vous prévenir, est un sinistre convoi de la mort, et Clifford Estate, cet Eden en terre de Chine promis à nos ancêtres par les brochures publicitaires, est un camp de concentration à visage humain. Il existe bien une solution au problème des retraites ou du financement du soutien aux personnes invalides, tenez-vous le pour dit : la solution FINALE !
Pour parvenir à ses fins, Truong développe une passionnante dialectique par le biais des dialogues effrayants entre Xuan et Jonathan. Xuan, alias Monsieur Ho (Monsieur Ho, soit dit en passant, était aussi le surnom du communiste vietnamien Ho Chi Minh…), fait figure d’épouvantail : parrain tout-puissant, nietzschéen de la pire espèce, il prône « l’amour du plus lointain » professé par Zarathoustra – celui-là même que je chéris au même titre que l’amour du prochain – c’est-à-dire, selon Xuan, la raison du plus grand nombre – une pensée anti-humaniste, utilitariste, inhumaine –, la pérennité coûte que coûte, à n’importe quel prix. Jonathan, en bon humaniste occidental, paraît horrifié par le cynisme pragmatique de son ami, mais s’avère beaucoup plus complexe que Xuan : comme le juge-enquêteur de Reproduction interdite, Jonathan véhicule à l’insu du lecteur toute la problématique du livre. Extrêmement ambigu, il est encore une fois cet individu lambda – quel que soit son statut social (nous sommes tous égaux devant la Mort) – dont les convictions éthiques et morales, parce qu’elles ne reposent sur aucune réflexion en profondeur, parce qu’elles relèvent surtout du prêt-à-penser et de la doxa intellectuelle, finissent par être balayées par un système anthropophage – et, lui, froidement mathématique. Cette dialectique est si prépondérante – au détriment du Verbe, nous allons le voir – qu’elle évoque le Gorgias de Platon plus que les dystopies d’Huxley (et ne parlons pas d’Orwell !) – même si le résultat, je suppose, est similaire. C’est d’ailleurs bien cette philosophie en action – Truong n’aime rien tant que « philosopher à coups de marteau » – qui rend Eternity Express à la fois si facinantt et si décevant. Fascinant, parce qu’il repousse une nouvelle fois les limites de nos certitudes, parce qu’au-delà de ses carences littéraires – dont l’auteur se contrefiche –, il sème un immarcescible doute dans nos esprits pétris de stupides certitudes. Et décevant, parce qu’après la maestria de Totalement inhumaine, essai redoutable, j’attendais un véritable roman, une œuvre qui constituât en elle-même une réponse plutôt qu’une simple réaction, or la trame d’Eternity Express, cet ultime voyage, à bord du transsibérien, de quatre cents insupportables vieillards pleins d’espoir, sert avant tout de prétexte à sa dramatique démonstration. Les péripéties dont le train est le théâtre cinétique sont relativement anodines et masquent délibérément l’enjeu réel du périple, tout en égrenant périodiquement quelques informations capitales sur le narrateur, seul dépositaire de l’abjecte vérité.
Eternity Express se lit d’une traite, comme un roman de gare – en partance pour l’Enfer –, mais hormis dans sa dernière partie – excellente –, seuls quelques passages marquent vraiment les esprits. Il est regrettable que Jean-Michel Truong, dont j’admire l’acuité de vision, n’ait pas encore tout à fait réussi, au travers d’un évident travail d’épure stylistique, à atteindre une plénitude formelle à la hauteur de ses ambitions. Son style n’est pas en cause, fluide, efficace, mais le roman aurait pu se passer sans dommage, j’en suis convaincu, de quelques excès pamphlétaires et didactiques qui ont le double inconvénient de briser l’élégance de l’ensemble et d’interdire tout sentiment d’empathie envers les passagers (ce qui constitue la force, au contraire, de Chromozone, 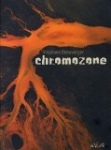 un formidable roman de science-fiction publié aux éditions de la Volte, sur lequel je reviendrai prochainement). A trop vouloir aller à l’essentiel, l’auteur en a oublié d’écrire un vrai roman… Souvent, il s’égare dans des dialogues redondants et trop explicatifs qui nuisent au rythme du récit. Peut-être a-t-il souhaité éviter des polémiques similaires à celles suscitées par ses précédents ouvrages, réaffirmer haut et fort que s’il renie l’humanisme des lumières – une évidence –, s’il croit que notre espèce est fondamentalement mauvaise (une offense, écrit Stéphane Beauverger, l’auteur de Chromozone), il n’en reste pas moins profondément révolté par les exactions commises au nom du politiquement correct. Ceci expliquerait sans doute pourquoi Xuan, sorte d’incarnation du Mal, est dépourvu de cette épaisseur qui nimbait le Nitchy du Successeur d’un insaisissable voile de sentiments contraires. Le discours cynique de Xuan fascine au plus haut point – comment ne le serais-je point, fasciné, moi qui suis tout aussi nietzschéen que son démon chinois ? – mais Truong le définit explicitement comme le Diable en personne ; le Diable, c’est-à-dire l’Homme dans toute son ambiguïté fondamentale, archétype monolithique en qui est concentrée toute la logique socio-économique actuelle et, selon toute vraisemblance, à venir. La facilité avec laquelle Truong – qui maîtrise à la perfection les arcanes du cynisme absolu – parvient à se glisser dans la peau de ce type de personnages est par ailleurs assez troublante : sa connaissance et sa pratique de la philosophie n’y sont sans doute pas étrangères, et son Xuan rappelle le Vautrin de Balzac, à la fois ennemi et tentateur.
un formidable roman de science-fiction publié aux éditions de la Volte, sur lequel je reviendrai prochainement). A trop vouloir aller à l’essentiel, l’auteur en a oublié d’écrire un vrai roman… Souvent, il s’égare dans des dialogues redondants et trop explicatifs qui nuisent au rythme du récit. Peut-être a-t-il souhaité éviter des polémiques similaires à celles suscitées par ses précédents ouvrages, réaffirmer haut et fort que s’il renie l’humanisme des lumières – une évidence –, s’il croit que notre espèce est fondamentalement mauvaise (une offense, écrit Stéphane Beauverger, l’auteur de Chromozone), il n’en reste pas moins profondément révolté par les exactions commises au nom du politiquement correct. Ceci expliquerait sans doute pourquoi Xuan, sorte d’incarnation du Mal, est dépourvu de cette épaisseur qui nimbait le Nitchy du Successeur d’un insaisissable voile de sentiments contraires. Le discours cynique de Xuan fascine au plus haut point – comment ne le serais-je point, fasciné, moi qui suis tout aussi nietzschéen que son démon chinois ? – mais Truong le définit explicitement comme le Diable en personne ; le Diable, c’est-à-dire l’Homme dans toute son ambiguïté fondamentale, archétype monolithique en qui est concentrée toute la logique socio-économique actuelle et, selon toute vraisemblance, à venir. La facilité avec laquelle Truong – qui maîtrise à la perfection les arcanes du cynisme absolu – parvient à se glisser dans la peau de ce type de personnages est par ailleurs assez troublante : sa connaissance et sa pratique de la philosophie n’y sont sans doute pas étrangères, et son Xuan rappelle le Vautrin de Balzac, à la fois ennemi et tentateur.
Jonathan en revanche, dont l’auteur ne dévoile le passé douteux que par bribes éparses, se révèle autrement plus retors. C’est sur lui que se cristallisent les véritables enjeux. Si le personnage de Reproduction interdite prenait peu à peu conscience du caractère pusillanime de son comportement avant de faire preuve d’un courage salutaire, Jonathan effectue le trajet inverse, et bien que son rôle – qu’on devine important – dans la tragédie révélée demeure longtemps obscur pour le lecteur, il se laisse manifestement porter par les événements, en observateur clinique ; si son ambition, sa vénalité et sa volonté de puissance affleurent parfois, Jonathan cache bien son jeu. Surtout, son itinéraire idéologique épouse parfaitement celui de la société occidentale tel que décrit par Truong. Les révélations finales, dont la brutalité laisse pantois, ne sont pourtant guère surprenantes au regard de l’habitus de Jonathan et de ses pairs, dont toutes les actions peuvent se résoudre en définitive à de simples calculs mathématiques. Jonathan, simplement, est un faible. Personnage presque ballardien, Jonathan ressemble comme deux gouttes d’eau au Charles Prentice de La Face cachée du soleil ou au Paul Sinclair de Super Cannes, romans dont la parenté avec Eternity Express est plus profonde puisque dans les trois cas, le séjour paradisiaque attendu – une station balnéaire, un complexe scientifico-financier, un village de retraite – se mue en cauchemar climatisé sous la main d’un démiurge visionnaire.  Le journaliste de La Face cachée du soleil est poussé, comme Jonathan, à commettre l’irréparable sous l’influence d’un illuminé. J.G. Ballard et Jean-Michel Truong partagent une même vision du monde où le libre arbitre des individus ne suffit pas à assurer leur liberté – un monde où les seules armes dont disposent ceux qu’il faut bien se résoudre à nommer les résistants sont la réflexion individuelle (la méditation ?) et une rigueur éthique exemplaire. Mais chez Ballard cet aspect est escamoté, assimilé par le récit lui-même jusqu’à en devenir extrêmement ambigu et apolitique – en bref, une véritable œuvre littéraire –, comme dans son dernier roman Millenium People, tandis que chez Truong le discours, souverain, ne s’embarrasse pas de détours : le Verbe est privé de sa majuscule, sacrifié sur l’autel du signifié, du sens. Truong ne nourrit pas la littérature, il propage des mèmes antiviraux. Pour autant, Eternity express n’est pas qu’un vulgaire pamphlet : Truong n’y défend pas les opprimés, il ne s’attaque à personne en particulier, il n’est même pas vindicatif : il étudie les rouages d’un système et nous confie froidement ses conclusions. Et croyez-moi – si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous êtes désormais convaincus –, celles-ci ne sont pas des plus réjouissantes...
Le journaliste de La Face cachée du soleil est poussé, comme Jonathan, à commettre l’irréparable sous l’influence d’un illuminé. J.G. Ballard et Jean-Michel Truong partagent une même vision du monde où le libre arbitre des individus ne suffit pas à assurer leur liberté – un monde où les seules armes dont disposent ceux qu’il faut bien se résoudre à nommer les résistants sont la réflexion individuelle (la méditation ?) et une rigueur éthique exemplaire. Mais chez Ballard cet aspect est escamoté, assimilé par le récit lui-même jusqu’à en devenir extrêmement ambigu et apolitique – en bref, une véritable œuvre littéraire –, comme dans son dernier roman Millenium People, tandis que chez Truong le discours, souverain, ne s’embarrasse pas de détours : le Verbe est privé de sa majuscule, sacrifié sur l’autel du signifié, du sens. Truong ne nourrit pas la littérature, il propage des mèmes antiviraux. Pour autant, Eternity express n’est pas qu’un vulgaire pamphlet : Truong n’y défend pas les opprimés, il ne s’attaque à personne en particulier, il n’est même pas vindicatif : il étudie les rouages d’un système et nous confie froidement ses conclusions. Et croyez-moi – si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous êtes désormais convaincus –, celles-ci ne sont pas des plus réjouissantes...
Comme Reproduction interdite, Eternity Express est aussi une variation autour de l’holocauste. L’éternité du titre, délicieusement ironique, est bien sûr celle à laquelle aspirent les passagers refusant l’échéance inéluctable de la mort ; elle est surtout celle, moins romantique, qu’ils acquièrent au terminus, au cœur des gigantesques fours crématoires de Global Waste basés à Clifford Estate ! Truong a cependant eu l’intelligence de faire coïncider son récit avec le parcours du train : les seules connaissances de ce qui attend les compagnons de Jonathan – aussi antipathiques soient-ils – et du rôle abject de Jonathan se suffisent à elles-mêmes. Le propos de l’auteur, d’une rigueur exemplaire, se situe au-delà de toute description : les faits, rien que les faits, comme dans Reproduction interdite encore – qui reste son meilleur roman à ce jour –, ou comme dans un livre d’histoire. A mille lieues des ridicules gesticulations du grand cirque médiatique, Jean-Michel Truong clos son récit avec rage et pudeur, et non sans désespoir. Le souvenir rémanent de Jonathan, ce Mengele ordinaire – vous ?... moi ?...), m’a longtemps hanté, sans doute parce que ce que suggère l’auteur a trop d’accents de vérité pour être négligé, et parce que le dénouement, témoignant de son grand talent, et rompant avec le didactisme souvent artificiel des deux premiers tiers, renoue avec la fiction en tant que telle – avec la littérature – sans pour autant délaisser ses ambitions discursives. Au temps pour ma critique de forme, quasi inopérante.
La faille d’Eternity Express, toutefois, réside peut-être dans son extrême pessimisme – Truong ne ménage aucune échappatoire. Aucun personnage, aucun individu de notre race maudite ne trouvant grâce à ses yeux – sinon un couple d’antiquaires un peu terne et les ouvrières de Shuang-Feng massacrées avant les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, mais seulement, pour ces dernières, sous la forme d’un groupe anonyme et emblématique –, la légitimation du propos devient alors problématique : pour critiquer la politique fasciste (communiste ?) de Xuan et de l’Union (la primauté du collectif sur l’individuel), Truong raisonne lui aussi à un niveau collectif, empêchant le roman d’atteindre complètement son but, le rendant aussi froid en définitive que ses personnages : à quoi sert de crier au feu, je vous le demande, quand l’on est déjà à moitié carbonisé ?... Nul doute que certains interpréteront ce parti pris discutable comme un aveu, celui d’une pensée anti-humaniste qui ne dit pas son nom, comme ce fut le cas avec Totalement inhumaine. Ils feront remarquer qu’Eternity Express peut dès lors se lire comme une nouvelle justification du Successeur, comme une énième démonstration de l’échec définitif d’une humanité depuis longtemps suicidée. Mais a contrario, on pourrait rétorquer que ce que Truong signifie par cette noirceur absolue, ce qu’il sous-entend, c’est justement que nos combats, notre empathie, ne doivent pas être soumis à des critères quelconques – je ne suis pas un code statistique, ai-je envie de hurler –, mais que toute l’humanité, aussi détestable soit-elle, mérite notre considération. La manière éminemment réfléchie dont Truong a traité son sujet, ce refus héroïque des concessions, cette emprise de la rigueur intellectuelle sur le pathos, prouvent définitivement que sa vision prophétique d’une intelligence « totalement inhumaine » était bien le fruit d’une analyse qui ne doit rien à la provocation. Le remarquable travail d’épure effectué par l’auteur n’a rien de fortuit : débarrassée des affèteries littéraires, sa nouvelle prose du transsibérien approche une certaine vérité transcendante qui me pétrifie d’effroi. Je regarde mon fils, et je tremble, parce que je ne veux pas d’un univers sans hommes. Je ne veux pas – suprême égoïsme – d’un univers sans moi et mes semblables.
Il semble, au final, que la force d’évocation d’Eternity Express excède ses contradictions. Au cynisme post-moderne, Truong oppose un cynisme antique, celui encouragé par Peter Sloterdijk et qui consiste en ce retournement ironique à l’œuvre dans le roman, de l’ordre de la guérilla intellectuelle ; ce qui fait son prix en définitive, c’est bien cet hyperréalisme halluciné, cette rectitude, cette rage réprimée ; ce doute glacial et poisseux qui nous étreint au fil de la lecture et qui ne nous lâche plus jusqu’à l’apocalypse finale.
Et le doute, toujours. Sommes-nous tous damnés ? « Ça n’est pas encore fini », préféré-je répondre, comme le Valushka des Harmonies Werckmeister, le chef d’œuvre de Béla Tarr.

Jean-Michel Truong, Eternity Express (Albin Michel, 2003), 299 pages.
-
-
Et Expecto - 2 - Vae Victis

Hugo Klossowski : de simples mots, couchés sur le papier ou sur l’écran dix-sept pouces d’un dieu schizophrène équipé d’Internet à haut débit – pixels lumineux trouant les ténèbres d’un blog céleste.
L’excroissance : un fantasme psychopathologique – une fiction.
Vous me croyez fou… Vous vous dites : à quoi bon théoriser ainsi…
Brundle-Fly n’était né pour devenir mouche ; rien en revanche ne me caractérise a priori sinon l’attente, sinon l’incertitude : je suis Hugo-Ténèbres, comme la nuit qui recouvre de son voile obscur cette ogive de chair surgie du néant, clitoris érectile niché, sournois, sous mon bras gauche.
Hugo-Ténèbres, l’homme-paragraphe, n’est pas sans savoir qu’une mutation sauvage peut se révéler fulgurante.
Hugo-Ténèbres, l’homme-paragraphe, n’est pas sans savoir qu’une mutation sauvage peut se révéler désastreuse.
Fatale.
J’ai appris depuis longtemps à m’accommoder de mes crises hypocondriaques. Je crois qu’elles sont principalement dues à ma nature angoissée. A défaut de les vaincre – ce qui paraît, hélas, définitivement exclu –, je ruse et les accepte comme un mal acide mais inoffensif. Je m’adapte. Combien de fois me suis-je cru sur le point de passer l’arme à gauche, sur la seule foi d’un membre vaguement engourdi ou d’un furtif élancement dans l’épaule ? Combien de (cancers). Combien de (sidas). Savez-vous ce que c’est, que de se recroqueviller au fond de son lit, en tremblant, en chialant comme une petite fille effrayée par un cauchemar atroce, attendant que la mort, cette chienne, vous emporte ?
L’important, si l’on veut éviter une crise, est alors de ne pas prêter attention aux signaux d’alarme biologiques qui se déclenchent à la moindre occasion, ou plutôt de les dévier. Il suffit d’un rien – une toux soudaine, une douleur fugace – : le nerf sollicité transmet un ordre au cerveau. Action quasi instantanée, imparable. La solution consiste à intercepter la réaction du cerveau à ce stimulus. Il faut alors être capable de dévier l’information vers un canal secondaire, d’opérer en un temps quasiment nul une dérivation automatique. Si l’opération réussit, l’information est expulsée de la zone critique avant terme. Reste à savoir dans quel secteur obscur du cerveau cette propagande nerveuse est stockée… Je crains le jour où la bonde cèdera…
Mais soyez rassurés. A force d’entraînement, je suis passé maître dans cet art insoupçonné de l’espionnage synaptique. Il me suffit de fixer mon attention sur un fantasme : l’interception prend la forme d’un corps féminin sur les courbes duquel l’information dangereuse, décontenancée, ne peut que rebondir. Il ne s’agit pas de n’importe quel corps cependant : ni d’un corps anonyme ni du corps d’une femme aimée, mais bien de la quintessence de la Femme ultime telle que la conçoit mon inconscient – pour ce que j’en sais. Deux seins lourds, gonflés de lait. Un ventre rond, outrageusement fécond. Des hanches larges, des fesses généreuses, des cuisses puissantes. Confrontée à cet archétype femelle, l’information empoisonnée n’a d’autre choix que de s'écouler, vaincue, vers un canal d’évacuation. Et l’indicible angoisse causée par la réception du premier message disparaît dans les limbes de la matière grise.
Mon organisme demeure en perpétuel état d’alerte, Cerveau-Monde contre Corps-Dévorant, guérilla intérieure aussi inextricable que le conflit israélo-palestinien, mais cette petite ogive de chair sous mon bras gauche (le membre le plus proche du cœur, est-ce un hasard ?), n’est pas le fruit, même pourri, d’une imagination trop fertile. Je l’ai palpée pendant près d’une heure dans mon lit, à mon réveil, n’osant respirer qu’avec d’infinies précautions, de peur qu’elle ne se mette à suppurer, à s’étendre, à se propager, à m'engloutir.
Un mot m’est d’abord venu à l’esprit, ce mot infect que mon inconscient pourtant bien rôdé s’était efforcé de taire par tous les moyens. Une fois prononcé, même mentalement, mot et concept avaient fusionné : ils se sont mis à proliférer dans mon esprit, à progresser pas à pas, neurone par neurone jusqu’à saturation, contamination synaptique, parfaite métaphore du concept ainsi assimilé. Ce mot ?
(Cancer).
Permettez-moi de le chuchoter seulement – l’entendre m’est un supplice – ou, comme ici, d'y apposer de salvatrices parenthèses.
Etait-ce une tumeur maligne ? Ma vigilance mécanique avait-elle été trahie par l’absence de douleur ?
Curieusement, cette effroyable évocation, cette maladie dont le nom même vous ronge frénétiquement, a disparu aussi rapidement qu’elle était apparue. Une main posée en coupe sur mon bas-ventre, les doigts de l’autre frôlant le bouton de peau sous mon bras gauche, je me surpris même, dans cette même chambre, à songer au cancer avec sérénité, à lui ôter ses parenthèses, comme si l’évocation de ma peur la plus viscérale était enfin neutralisée – et non exacerbée – par ma nouvelle configuration physiologique. Je pouvais même en prononcer le nom à haute voix, sans frémir, à l’abri des habituelles sueurs froides. J’étais confusément convaincu que si je restais immobile sous mes draps moites, respirant à dose homéopathique, l’excroissance me protègerait des ennemis extérieurs.
Absurde ! Me protéger de quoi au juste ? Des bombes ? Des rats ? De la racaille ?
Pourtant, la caresser du bout des doigts, l’effleurer de la pulpe de l’index me rassurait indéniablement, d’autant qu’il me semblait – mais je ne puis en jurer – qu’elle réagissait imperceptiblement, qu’elle se tendait telle un téton, un clitoris ou un pénis. Si l’éventualité d’un troisième téton ne m’enthousiasmait pas outre mesure, celle de posséder un clitoris, au contraire, comblait mes appétits hermaphrodites ; mais l’idée d’avoir une deuxième bite a fini par l’emporter haut la main…
Après une heure de tergiversations, de fantasmes et de délires enfiévrés, à me demander si je n’étais pas tout simplement en train de rêver, si je n’allais pas me changer soudain en cafard, pourquoi pas, comme dans La Métamorphose, ou bien en poulpe ou en méduse, sait-on jamais, avant de me réveiller, alors, dans des draps trempés de sueur, je me suis finalement redressé sur les coudes avec précaution puis, constatant que conformément à mon intuition, rien ne se passait, et que je conservais par ailleurs toute ma raison claire, nette, froide, je me suis simplement levé, comme si de rien n’était.
Et la chose, elle, était toujours là.
Ce matin, j’ai connu le désespoir.
Ce matin, je suis devenu un autre.
Ce matin, je me suis douché.
Vous vous dites : à quoi bon…
La petite gangue attend toujours son heure sous mon aisselle tandis que le métro se fait attendre ; anomalie tapie dans un buisson ardent de poils humides et soyeux, écriture dermique invisible aux yeux du monde sous mes vêtements.
Stigmate du troisième type.
Révélation mystique.
Illumination religieuse.
Mon corps est un objet narcissique d’auto-adoration, dieu de lui-même et uniquement de lui-même. Les faits sont là : l’ogive clitoridienne existe sans le moindre doute possible. Il me suffit de glisser une main à la naissance de mon bras pour le vérifier. Seulement, dans l’univers solipsiste qui se dessine, où créateur et créature se confondent en un anneau de Möbius temporel, je ne suis pas tout à fait certain de ne pas l’avoir créée ex nihilo. Pas tout à fait…
Les néons de la station ont ravivé l’ombre de Philip K. Dick. Perception du réel. Manipulation mentale. A présent, l’ombre paranoïaque me suit pas à pas, sans qu’il soit possible de déterminer qui, de moi ou d’elle, initie le mouvement. Je songe à la chaise de Wittgenstein : si je ferme les yeux, existé-je encore ?
J’entrouvre ma serviette et en extrais un lecteur MP3 en plastique vert émeraude que j’enfourne dans une large poche de mon manteau de cuir. Je démêle rapidement les fils entortillés des écouteurs ergonomiques et les introduis dans le creux de mes oreilles. Gestes bien rôdés, aisance de l’habitude. Ma main plonge dans la poche et atteint sa cible sans hésitation. Play. Le lecteur démarre au quart de tour et après un léger bip sonore, les premières notes des guitare mélancoliques et aériennes de Gospeed You Black Emperor percutent mes tympans avant d’être codées puis décodées, d’impulsions nerveuses en émotions esthétiques, passées au tamis de ma topographie neuronale en mouvement perpétuel.
Yanqui XO, l’album le plus brut, le plus dépouillé du groupe, a investi mon lecteur MP3 tel un bernard-l’hermite depuis la fin de l’été, et rien ni personne ne semble en mesure de l’en déloger. Aucune voix, aucun sample, aucun ajout électronique – Godspeed côtoie cependant, dans mes fichiers, l’électro reptilienne, organique, d’Amon Tobin – ne vient souiller la pureté des instruments, c’est un Requiem de notre temps, de la musique d’après l’Apocalypse, de la musique d’inframonde, stase temporelle, épiphanie sensorielle.
Je ne regrette pas d’être né, le temps d’un mouvement, le temps d’un disque.
La fin, la chienne, peuvent attendre.
Un homme, manteau de cuir anthracite : moi.
Un accord.
Je suis vivant, et putain, vous êtes morts ! -
Sayonara baby de Fabrice Colin – principes essentiels de l’abandon de la vie
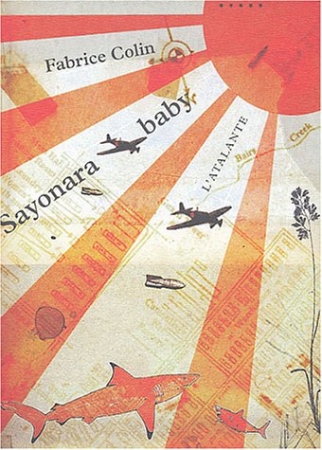
« L'invasion. Il sent, il voit l'armée japonaise se lever comme une vague, prête à l'assaut final, il voit les dieux et les fantômes, les morts, les assoiffés, les garçons solaires, torse nu, bariolés, décidés à se fondre dans la sainte et oublieuse Amérique, à s'introduire en elle, ignorant ses plaintes, ignorant sa force et ce qui arrivera ensuite. Il sait qu'ils vont venir : une attaque sans commune mesure avec celles qui l'ont précédée. La dernière de toutes. »
F. Colin, Sayonara baby.
Je ne sais pas qui c’est
Comme au théâtre, trois coups annoncent le roman. D’abord, une citation ésotérique de Giacometti (« Et puis ? Et puis ? Tout sombre, tout vit, tout bouge, tout revient, rien n’est passé, rien n’arrivera, le tournant… » ; l’annonce de la première partie ensuite, intitulée « interzone », tribut évident à William S. Burroughs ; et enfin, en guise de troisième et dernier coup, ces mots : « je ne sais pas qui c’est », jetés sur le papier comme par mégarde, sans majuscule, sans ponctuation, sans explication, qui donnent l’impression d’être chuchotés d’une voix blanche, écho lointain de L’année dernière à Marienbad, ou crachotés par un interphone, comme le célèbre « Dick Laurent is dead » de Lost Highway. La bande originale de ce film – l’histoire déstructurée d’un personnage projeté du jour au lendemain dans une autre réalité, un autre corps, une autre personnalité – est explicitement citée avec des extraits des paroles d’Apple of Sodom de Marilyn Manson, musicien qui a fait de l’ambiguïté son fonds de commerce – d’autres références à Lost Highway parsèment le roman, comme cette « Image d’une limousine sans conducteur lancée à toute allure vers les montagnes, pas de frein, pas de volant, seulement la vitesse » [1], qui n’est pas sans rappeler une séquence du film particulièrement marquante. Sayonara baby évoque à plusieurs titres le cinéma de David Lynch : dans ces films ou livres-puzzles, le sens ne surgit qu’une fois les pièces assemblées – encore que même achevé, le roman conserve une grande part de mystère. « Pas de souvenirs, des éclats de mémoire » [2] : le roman, en cela assez proche par sa démarche de certains artistes contemporains – Kandinsky par exemple, ou bien les surréalistes, au premier rang desquels Ernst et Dali –, articule des éclats de mémoire dont on ne saurait décider s’ils sont fantasmes ou réalité, et qu’on serait bien en peine de ré-agencer de manière logique. Le Verbe halluciné de Fabrice Colin entrelace différentes strates de réalités dont aucune ne peut prétendre au titre de réalité objective – et pour cause : comme nous le verrons plus loin, la fiction, chez Colin, se revendique énergiquement comme telle… Dès lors le problème n’est plus de rétablir une hypothétique hiérarchie entre ces niveaux de réalités – puisque tous sont fictifs – mais de trouver un sens à leur entrelacement ; en d’autres termes, la clé est ici davantage plastique que sémantique. Avant même les premières lignes, nous sommes donc avertis : Sayonara baby n’est pas un roman comme les autres. Il arbore d’emblée ses influences avouées – le surréalisme, Burroughs, Lynch – et son thème manifeste – la quête identitaire.
« je ne sais pas qui c’est »… Qui s’interroge ainsi ? Nous verrons qu’il ne s’agit pas seulement du héros, amnésique et schizophrène, version pop et borgésienne du Vitus Saint-Ange de Or not to be (dont je reparlerai peut-être un jour) : l’écriture elle-même, la fiction, se prennent en effet pour objet, s’intéressant surtout à leurs rapports avec leur culture de référence et leurs figures tutélaires ; à travers elles, c’est le rêve d’Amérique de Fabrice Colin qui nous est donné à voir.
le temps désarticulé
L’auteur ancre son récit dans un univers fabulateur déjà filtré par la fiction, autrement dit ne vous attendez pas à une peinture réaliste de l’Amérique d’aujourd’hui ou d’hier, ou à la radiographie d’une période historique donnée. Colin ne cherche pas tant à capter une quelconque réalité « objective », dont il sait qu’elle n’existe pas en tant que telle – ou du moins, qu’elle ne peut pas être réduite à quelques millions de caractères par le truchement de son cerveau humain et de son logiciel de traitement de texte –, qu’à nous restituer un corpus mutant et non fini de mythes, d’images et de figures dont la fonction essentielle, paradoxalement, est de révéler une autre réalité, subjective, hallucinée, protéiforme et surtout immanente – l’Amérique, cette entité abstraite et autophage. C’est en toute logique que l’auteur, très conscient de son art, s’éloigne de toute tentation naturaliste. S’il ne conçoit ses récits que comme des songes entièrement maîtrisés, c’est qu’il sait tirer parti de leur géométrie variable. Fabrice Colin, en digne héritier de Dick et de Borges, dessine ainsi la carte à « n » dimensions de ce territoire imaginaire, géographie fantasmatique de ses concrétions mentales, née de sa vision personnelle des Etats-Unis – et, dans une moindre mesure, du Japon. Le titre, Sayonara baby, paraît dès lors très approprié : il reprend une réplique culte de Terminator (« Hasta la vista, baby ») qui, dans sa version espagnole, est devenue pour des raisons évidentes d’impact lexical : « Sayonara, baby ». A l’image de ce choc – presque un contresens – Fabrice Colin s’est plu à échafauder une histoire complexe, vaguement uchronique, opposant Japon et Etats-Unis de même que Dreamericana, son roman précédent, opposait Gardiens et Voyageurs, c’est-à-dire d’une façon occulte et surréaliste [3].
Comme Le grand sommeil de Chandler [4], Sayonara baby présente de nombreuses zones d’ombres, et sa construction aux allures de casse-tête – à prendre ici au sens littéral, comme en témoignent ces bandages autour du crâne du samouraï – en fait une œuvre esthétique plutôt que narrative, où le sens est à chercher dans l’agencement, dans les combinaisons, non dans un contenu manifeste trop nébuleux. Sayonara baby imite en cela les structures du rêve telles que nous les imaginons depuis Freud. Jamais le rêve, qui tient une place centrale dans l’Œuvre de Colin, n’a pourtant été aussi décisif. Le caractère excessif, transgressif, des scènes de sexe, inhabituelles chez Colin – elles font ici songer à de mauvais romans de gare –, désigne ces dernières comme de purs fantasmes stéréotypés, comme des séquences que le personnage subit malgré lui, mû par une volonté supérieure. La littérature de Fabrice Colin ébranle les fondements de notre rassurante perception cognitive du monde. Comme d’autres avant lui, de Borges à Philip K. Dick, Colin subvertit nos systèmes de reconnaissance et d’intellection. Dans Sayonara baby, causalité et postulats réalistes n’ont plus cours. Autrement dit, pour entrer pleinement dans le roman, le lecteur doit se défaire de ses habitudes.
Le rêve est à entendre ici également selon son autre acception, c'est-à-dire comme fantasme proprement dit – on peut parler de l’American dream de Colin, de même qu’Ada ou l’ardeur était celui de Vladimir Nabokov. Colin ne cache pas que Ada était d’ailleurs (avec Feu pâle) l’ombre tutélaire de Dreamericana. Sayonara baby est pourtant, peut-être plus encore que Dreamericana, littéralement hanté par le chef d’œuvre de Nabokov, auquel il a emprunté amours incestueux, jeux linguistiques, temporalité chaotique et atmosphère éthérée. De Nabokov, Colin a également retenu cette idée selon laquelle le passé est un « emmagasinage de Temps » : qu’une bombe vienne à y tomber, et le Temps se retrouve explosé, désarticulé. Mais bien sûr, Colin n’est pas Nabokov. Son style, très éloigné de la prose élégante de l’auteur d’Ada, emprunte davantage au roman noir et à la littérature anglo-saxonne de la fin du 20ème siècle. Là encore, il ne s’agit ni d’une pose, ni d’opportunisme : cet héritage fait partie intégrante de Sayonara baby, jusque dans ses articulations les plus secrètes.
Onirisme, donc. Il s’en faut de beaucoup que Sayonara baby soit aussi radical que les expérimentations formelles du Festin nu de Burroughs ou de La Foire aux atrocités de Ballard. Pour autant, il n’en est pas moins conceptuel. Les tableaux surréalistes du roman, évoquant aussi bien les pulps et autres comics que les grands auteurs américains – et liés par la logique interne du rêve –, ne renseignent pas tant sur la résolution de l’énigme (« je ne sais pas qui c’est ») – que sur le projet souterrain du livre, la peinture abstraite d’une Amérique virtuelle [5] et suicidaire réduite dans les dernières pages à quelques mots clés : « Requins blancs. Femmes violées. Mines antipersonnel. », dérisoire géométrie d’un décor factice qui n’a plus d’envers – ou plus d’endroit, ce qui revient au même.
Aleph
La visée essentielle de la littérature de Fabrice Colin n’est en effet rien moins qu’ontologique. Cet architecte dément, véritable Escher littéraire, s’intéresse aux espaces intérieurs (innerspace), forcément tourmentés – les seuls qui soient vraiment, en vérité… –, plutôt qu’aux espaces extérieurs. Chaque œuvre, depuis Or not to be, investit le champ psychique d’un personnage, créant avec lui un univers propre, surréaliste. Mais tandis que Or not to be était hanté par William Shakespeare et Dreamericana par Stanley Kubrick, Sayonara baby ne présente aucune prise similaire à laquelle se raccrocher : nous l’avons vu, son objet d’élection est un fantasme aux contours multiples, cette culture américaine baroque, sans figure suffisamment charismatique pour se distinguer des autres – juste un théâtre et ses ombres, comme ce Manzanar War Relocation Center, installation artistique (authentique) qui fige dans l’espace et dans le temps le désastre de Pearl Harbour. Les « principes essentiels d’abandon de vie » du sous-titre équivalent en fait à une assimilation de la mort. Schizophrènes au dernier degré, incapables de réordonner leur mémoire déstructurée [6], les personnages sont des semi-morts, tel Johnny Depp dans Dead Man de Jim Jarmusch, captifs impuissants d’une représentation éclatée de la réalité (l’épilogue s’intitule m.o.r., cela ne s’invente pas !) : ils demeurent tributaires, en somme, de la plume mortifère d’un auteur facétieux. La longueur inhabituelle des tirets dans la seconde partie, judicieusement empruntée au Tristram Shandy de Laurence Sterne, n’est d’ailleurs pas sans évoquer le trait d’un électro-encéphalogramme plat – il était même logique que le livre se terminât sur l’un d’entre eux alors que le samouraï, dans ce qui n’est sans doute que l’hallucination onirique d’un attentat-suicide, finit par s’effacer de la fiction en un Seppuku rageur et dérisoire [7]. Les tirets en question, dont la fonction signifiante excède la simple ponctuance, sont la manifestation graphique de l’interzone, l’immixtion, dans la typographie même, de cette idée de mort et de disparition – une autre manière, en somme, de garder sa fiction à distance du réel. La réalité, pour Fabrice Colin, est une notion éminemment stochastique, il ne servirait à rien d’en trier les différentes strates, toutes étant considérées comme fictives. On peut alors considérer ce personnage conceptuel (selon la terminologie deleuzienne) qu’est le samouraï comme la métaphore des Etats-Unis ensevelis sous leur propre virtualité. La référence à Jean Baudrillard, que Colin cite dans la dernière partie, n’est pas innocente : on se souvient de son interprétation symbolique des attentats du 11 septembre 2001 [8], sans oublier ses articles réunis dans Simulacres et simulation [9] où Baudrillard s’interrogeait sur les rapports entre nihilisme, technologie et production (ou destruction) de sens. Or l’Amérique de Sayonara baby, nous l’avons vu, prend des allures de carton-pâte ; c’est un simulacre, un décor sans endroit, c’est-à-dire sans objet de référence. L’Amérique de Sayonara baby n’existe que sous forme fragmentaire, kaléidoscope de réminiscences cinématographiques, de personnages de fiction, d’événements historiques déformés par l’inconscient collectif. Colin suggère que sous le vernis se cache une autre couche de vernis, et ainsi de suite, ad vitam aeternam.
Vous l’avez compris, Sayonara baby est une formidable machine métafictionnelle. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner cette tirade du docteur Lazare, sorte de personnage à la Dr Benway (Le Festin nu) et qui se présente comme « écrivain repenti, assassin et chamane » : « Le travail du romancier […] consiste à fixer sur papier une matière toujours en mouvement. Certains donnent à cette matière le nom galvaudé de réalité. Une denrée rare par les temps qui courent, un truc à piéger sur pellicule, éventuellement, mais pas plus. » [10]. Kenso/Kenneth, notre samouraï anonyme, n’est qu’une virtualité née de quatre personnes – dont rien ne permet de vérifier l’existence diégétique réelle –, de deux viols et de deux réalités distincts. Un pur personnage de fiction dans un univers fictif qui ne peut en aucun cas prétendre au statut de réalité.
La métafiction s’appuie ici, comme souvent, sur un personnage schizophrène, dont la perte de prise sur le Réel est avant tout un formidable moteur de fiction que Colin utilise fréquemment. Or les Etats-Unis, riches en schizophrènes littéraires, constituent le terrain idéal pour la mise en abyme : Dick, Ballard, Palahniuk, Ellis et d’autres sont déjà passés par là : Fabrice Colin, suivant la logique interne de Sayonara baby, n’avait alors d’autre choix que d’assimiler leurs schizophrènes de fiction – je dis bien assimiler, non recycler… – : tous, de Patrick Bateman à Victor Ward, en passant par Tyler Durden et Bob Arctor [11], suivent le samouraï comme des ombres spectrales, tapis entre les lignes – peut-être sous forme de messages navajos… Si le héros de Sayonara baby est incapable de se stabiliser sous une identité ou une autre, c’est justement parce qu’il est multiple, indéfini. Chacune des trois parties du roman adopte un point de vue particulier : dans la première, nous suivons le samouraï à distance, le « il » est de rigueur ; la deuxième partie épouse son point de vue, le samouraï devient le narrateur ; la courte dernière partie renverse la situation et tutoie Anami – et le lecteur par la même occasion – comme si celui-ci était littéralement exclu du roman, éjecté de la fiction pour être projeté dans le Réel. Les bandages du samouraï – qui rappellent de nombreux personnages : on pense aux momies, à L’homme invisible de Wells, ou encore aux Passagers de la nuit, le film noir de Delmer Daves (1947) – en font un homme sans visage, sans passé ; à moins qu’il ne soit l’homme aux mille visages, qui se superposent, s’annulent, se fondent les uns aux autres, comme un procédé cinématographique. Que l’on opte pour l’une ou l’autre hypothèse, le résultat est identique : n’est-ce pas précisément tout l’enjeu du roman, que de montrer combien l’Amérique est fondamentalement, structurellement, schizophrène ?
Les bandages du samouraï – qui rappellent de nombreux personnages : on pense aux momies, à L’homme invisible de Wells, ou encore aux Passagers de la nuit, le film noir de Delmer Daves (1947) – en font un homme sans visage, sans passé ; à moins qu’il ne soit l’homme aux mille visages, qui se superposent, s’annulent, se fondent les uns aux autres, comme un procédé cinématographique. Que l’on opte pour l’une ou l’autre hypothèse, le résultat est identique : n’est-ce pas précisément tout l’enjeu du roman, que de montrer combien l’Amérique est fondamentalement, structurellement, schizophrène ?
bibliothèque de babel
Ce dédoublement de l’identité individuelle de son personnage rappelle les procédés borgésiens. Comme son illustre aîné, Fabrice Colin choisit délibérément d’abolir l’intégrité (inévitablement factice) de son personnage pour mieux en signifier le caractère irréductible, infiniment complexe. Cette démarche trahit une conception phénoménologique de l’univers et de ses mécanismes. En refusant de considérer l’individu comme une entité métaphysique ou au contraire comme un simple phénomène causal dénué de véritable libre-arbitre, Fabrice Colin prend acte de ce paradoxe fondamental exprimé jadis par Maurice Merleau-Ponty : « Le monde est déjà constitué, mais aussi jamais complètement constitué. Sous le premier rapport, nous sommes sollicités, sous le second, nous sommes ouverts à une infinité de possibles. Mais cette analyse est encore abstraite, car nous existons sous les deux rapports à la fois. Il n’y a donc jamais déterminisme et jamais choix absolu, jamais je ne suis chose et jamais conscience nue. […] Il y a, comme dit Husserl, un « champ de liberté » et une « liberté conditionnée », non qu’elle soit absolue dans les limites de ce champ et nulle au dehors, - comme le champ perceptif, celui-ci est sans limites linéaires, – mais parce que j’ai des possibilités prochaines et des possibilités lointaines. » [12]. C’est cette confusion inextricable du monde que reproduit Sayonara baby à son échelle quantique – pas même une virgule dans le grand Livre de l’univers.
L’écriture, cet acte de création quasi religieux – dans le sens où l’homme a créé Dieu, plutôt que l’inverse –, occupe naturellement une place centrale dans le roman. De mystérieux messages calligraphiés s’inscrivent à l’encre noire sur la peau d’Anami. Plus tard, d’autres signes, rédigés dans le même langage codé, apparaîtront comme par enchantement dans les pages d’un exemplaire du Hagakure, le livre secret des samouraïs. A travers ces prodiges – on pense encore à William S. Burroughs, pour qui « le langage est un virus » –, c’est bien sûr le Fabrice Colin démiurge qui intervient, comme pour aider Anami dans sa quête identitaire, comme pour lui souffler : tu es un personnage de fiction… Le samouraï ne se croit-il pas entravé par de mystérieux câbles invisibles ? Ces câbles, on peut le supposer, mènent tout droit à Fabrice Colin lui-même, marionnettiste de l’ombre, mais même l’auteur ignore la vérité, même le marionnettiste ne peut accéder à la véritable démiurgie ainsi que le suggérait Francis Berthelot dans La Ville au fond de l’œil – cela contredirait le sens de son travail puisque le démiurge défie l’infini et prétend en maîtriser tous les mécanismes. Ainsi Anami finit-il paradoxalement par se débarrasser de son « câblage » en lui donnant corps, en le ramenant à sa propre réalité fictive. Plus tard, nous apprendrons que le langage-virus contracté par le samouraï est une transcription occidentale du navajo, utilisée par l’armée américaine pour transmettre des messages inviolables. [13] Que Fabrice Colin croie au pouvoir créateur du langage au sein de sa fiction ne signifie pas qu’il l’assimile au monde lui-même, bien au contraire : c’est justement par cet évitement du réalisme mimétique qu’il réaffirme l’inintelligible toute puissance de l’univers. Ses fictions se reconnaissent comme telles, pourvoyeuses de (men)songes. C’est donc en admettant leur valeur d’artifice, en considérant comme Bernanos que le langage « est le miroir de l’être », que Fabrice Colin approche au plus près de ce monde réel qui dépasse de beaucoup l’entendement humain – Borges a d’ailleurs métaphorisé la question avec sa fameuse Bibliothèque de Babel, bibliothèque imaginaire constituée de toutes les combinaisons possibles des lettres de l’alphabet. L’humilité de la démarche est trop rare pour ne pas la saluer ; l’acharnement à citer ses influences, ses sources, ses références, dont Colin se rend coupable, participe aussi de cette idée selon laquelle l’écriture, y compris la sienne, recèle une généalogie dont une partie doit rester visible [14].
nova express
L’intrigue de Sayonara baby, pourtant foisonnante, pourrait presque se résumer à ces quelques traits déjà évoqués : « requins blancs. femmes violées. mines antipersonnel » où sont réunies histoire et culture américaines. Les requins sont une allusion directe aux soldats dévorés sous les yeux de leurs compagnons de guerre, dans le pacifique, et une référence implicite aux Dents de la mer de Steven Spielberg. Les femmes violées sont japonaises, vietnamiennes, américaines, elles sont le symbole des traumatismes causés par la guerre aux êtres humains. Les mines antipersonnel sont celui de la paranoïa américaine, la mort, la guerre matérialisées. La Guerre, justement, fait rage. Entre le Japon et les Etats-Unis. Quand ? Nous sommes en 1941, à la veille de Pearl Harbour. Ou alors en 1967, en pleine guerre du Vietnam. Anami, métis américano-japonais – mais en est-on bien sûr, a-t-on vérifié sous ses bandages ? – qui se prétend samouraï, est aux mains de l’armée Américaine en Californie, au pied de la Sierra Nevada. 1941 ou 1967, peu importe en définitive puisqu’il s’agit d’un monde uchronique : quand l’officier Füller dégaine son téléphone cellulaire pour communiquer avec ses supérieurs, le lecteur est aussi désorienté que le jeune samouraï. Impossible, dès lors, de ne pas penser à Philip K. Dick, en particulier à Ubik et au Maître du haut-château. Comme dans Ubik, la réalité conventionnelle est peu à peu subvertie, une époque se substituant à une autre – et les morts parlent. Et comme dans Le maître du haut-château, la Seconde Guerre Mondiale crée une faille dans l’appréhension du réel et de l’Histoire – dans le chef d’œuvre de Dick du reste, le territoire américain est effectivement devenu japonais (en un sens, Colin radicalise la réflexion dickienne : là se situe peut-être sa limite : en brouillant à outrance les perceptions de la réalité du personnage, Colin maintient le lecteur à distance… C’était d’ailleurs programmé, comme l’indique le sous-titre : c’est au roman lui-même que Colin applique ses « principes d’abandon de la vie ».
Anami, le samouraï, change fréquemment de patronyme au cours du récit, sans crier gare. Il se fait appeler tantôt Onishi, tantôt Umezu, ou encore Yoshigiro. Des noms de généraux japonais pendant le Seconde Guerre Mondiale. Des identités d’emprunt sans doute, mais pour quoi faire ? Est-il un espion, et à la solde de qui ? Le cobaye d’une expérience interdite ? Nous avons vu que c’est justement dans l’absence de réponse satisfaisante que réside la solution. Sur son écran de télévision, les programmes habituels laissent place à des images d’archive de soldats japonais de la Seconde Guerre – des hallucinations, vraisemblablement. Par ailleurs, son activité onirique inquiète beaucoup l’armée américaine, convaincue – mesures scientifiques à l’appui – que les raids japonais coïncident systématiquement avec ses crises. L’évocation d’un tel pouvoir – le samouraï pourrait altérer le réel par les rêves – rappelle évidemment L’autre côté du rêve d’Ursula Le Guin, Le rêveur illimité de James Ballard, ou encore Le dormeur s’éveillera-t-il, de Philippe Curval – parmi d’autres [15]. Anami, d'une certaine manière, évolue dans les Etats-Unis imaginaires de Fabrice Colin comme Jack Hamilton était balloté, dans L'Œil dans le ciel de Philip K. Dick (1957), dans le monde réel imaginé par ses compagnons accidentés du Bévatron.
Entre temps, le samouraï est devenu Kenso (ou Kenneth) Badway – littéralement : fausse route. L’impuissance du samouraï est donc inscrite, sinon sur son corps, du moins dans son nom. Il lui faudra donc en trouver un plus ouvert, salutaire : ce sera Kenso Awake (littéralement : « éveillé »). Avec cette nouvelle peau, le dormeur est enfin éveillé – mais voué à disparaître, car sa cohésion n’était assurée que par cet équilibre paradoxal dans le temps désarticulé du rêve. A l’instant où le samouraï est entré en interférence avec le monde réel – celui de l’auteur –, il est condamné à disparaître.
conte de la folie ordinaire
Dans cette deuxième partie – intitulée kamikaze, ce qui n’étonnera personne –, Colin s’attarde un peu plus sur cette Amérique profonde telle qu’il a pu l’imaginer à travers ses lectures ou certains films. Il y a ce père alcoolique qui n’est peut-être pas son vrai père ; cette sœur top-model dont il est amoureux et avec qui il entretient une relation incestueuse ; le base-ball ; les Cadillac ; la bière ; les groupuscules klanistes ; la guerre du Vietnam ; le racisme ordinaire. Il y a aussi ce fast-food, où travaille sa petite amie Stella ; et le patron du fast-food, McNamara (toute ressemblance avec un certain secrétaire de la Défense états-unienne pendant la Seconde Guerre Mondiale n’est pas fortuite). Peu à peu, cette image des Etats-Unis – celle-là même que nous projettent les films de Larry Clark (Ken Park) ou d’Harmony Korine (Gummo), celle-là encore que l’on a pu lire chez John Fante, Charles Bukowski ou William Faulkner – se délite à son tour, rattrapée par les obsessions hallucinées du samouraï. Le véritable Robert MacNamara était, si je ne m’abuse, l’inventeur du concept de « Fog of War » (brume de guerre). The Fog of War, c’est le flou qui entoure tout conflit armé – en d’autres termes, la guerre est inévitable puisqu’elle est trop complexe pour que les hommes puissent en discerner les tenants et les aboutissants. On trouve dans Sayonara baby un écho à cette théorie confuse dans les imprécations du clochard de Monterey [16], tirées de Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo. Pourtant, selon la logique du roman, il n’est pas interdit d’imaginer que c’est justement la paranoïa américaine à l’encontre des aliens, cette réaction ultraviolente au terrorisme, qui créent littéralement cette réalité de guerre. Le samouraï et les concrétions nées de son esprit seraient ainsi la métaphore du paradoxe étasunien. L’Amérique d’après 11 septembre, gangrenée par la peur et la haine de l’extérieur, empêtrée dans ses propres mythes (en tête, celui du bon père de famille qui défend les siens fusil au poing) ne sème-t-elle pas elle-même les racines du mal qui la ronge ? Colin, plutôt qu’en bombardier, préfère toutefois agir en sniper. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas dans Sayonara baby d’arguments de destruction massive à la Michael Moore. A nous de discerner, parmi les décombres qu’il nous donne à entrevoir, le véritable visage des Etats-Unis. A cet égard, la démarche de Fabrice Colin est à l’exact opposé de celle d’un Roland C. Wagner par exemple [17] : tandis que l’auteur de La Saison de la sorcière cherche à stigmatiser par la caricature les outrances et les contradictions de l’Amérique de George W. Bush, Colin la déconstruit au point de la rendre méconnaissable ; les conditions sont alors remplies pour tenter d’en dégager une vérité sous-jacente. La tâche n’est pas facile, j’en conviens. Alors que la plupart des écrivains (tous genres confondus) se contentent de réactualiser les mythes fondateurs de nos cultures occidentales, Fabrice Colin s’intéresse plutôt à leur éclatement et s’infiltre dans les brèches ouvertes dans l’inconscient collectif. Ici, ces mythes séculaires sont tombés en poussière, remplacés par un kaléidoscope d’archétypes souvent tirés de la contre-culture – ou de leur double, fantasmé par l’auteur – qui, relayé par un récit fragmenté, s’attaque en premier lieu à la représentation totalitaire et mensongère de la réalité. [18] Sayonara baby s’apparente ainsi clairement à la littérature paranoïaque américaine, du Festin nu à Glamorama. La forme, ici empruntée au roman populaire, aux surréalistes et à Burroughs, est évidemment indissociable de ce matériau évoqué plus haut, cette Amérique fantasmée, à la carte ébauchée avec la seule aide de la littérature, du cinéma et de la musique états-uniens. Elle devient alors un but en soi. Elle se « métafictionne ».
Arigato, mister Colin.
Fabrice Colin, Sayonara baby (L'Atalante, 2004).
[1]
p.197
[2] p.18
[3] Sayonara baby, c’est encore le titre de plusieurs chansons, dont l’une, celle du groupe Toy-Box, mérite quelque attention. Ses paroles (Sayonara baby / This could be the end / But I’m not worried baby / Cause we will meet again) résonnent en effet de manière troublante avec l’issue du récit…
[4] Chandler lui-même fut en effet incapable de renseigner Howard Hawks, qui travaillait alors sur l’adaptation du Grand sommeil au cinéma, sur l’identité de l’auteur de l’un des meurtres.
[5] L’écrivain Pierre Senges a même écrit un roman sur le sujet : dans La réfutation majeure (Verticales, 2004), l’existence du Nouveau Monde est littéralement mise en doute…
[6] Le samouraï rappelle par bien des aspects le Victor Ward de Glamorama (Bret Easton Ellis), mannequin shooté et schizophrène pour qui la déréalisation du réel prend la forme d’un film imaginaire dont il se croit la vedette.
[7] « Tu pratiques l’esthétique de la disparition », est-il écrit à propos du samouraï à la toute dernière page du roman.
[8] Interprétation que l’on pourrait résumer ainsi : les Etats-Unis, coupables d’hégémonie et d’acculturation violente, seraient les premiers responsables du terrorisme qui les frappe, et ce indépendamment de l’origine des terroristes. Selon Jean Baudrillard, l’Islam n’est que le représentant ponctuel d’une réaction générale à cette hégémonie. Symboliquement, les tours du World Trade Center auraient ainsi ployé sous leur propre « excès de réalité ».
[9] J. Baudrillard, Simulacres et simulation, éd. Galilée, 1981.
[10] p.38.
[11] Personnages, dans l’ordre, de American Psycho (B.E. Ellis), Glamorama (B.E. Ellis), Fight Club (Palahniuk) et Substance Mort (Philip K. Dick).
[12] M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Gallimard, Tel, 1976) pp. 517-518.
[13] Les rares élus qui parlent et écrivent couramment le navajo, comme moi, auront la joie de reconnaître la version codée de l’hymne des Marines…
[14] L’idée n’est pas nouvelle : pensez au cut-up de William Burroughs ou aux techniques de vampirisme littéraire de Lautréamont dans ses Chants de Maldoror.
[15] Sans oublier Peter Pan, Alice au pays des merveilles ou Le Magicien d’Oz.
[16] Monterey, dont Charles Bukowski écrivait, dans un poème de L’amour est un chien de l’enfer : « une grue ne peut s’offrir / un cul / ou / se pendre à Monterey / sur le coup de minuit » : visiblement, certains lieux sont voués à susciter rêveries et poésie…
[17] R. C. Wagner, La saison de la sorcière (J’ai lu « Millénaires », 2003).
[18] Où l’on ne peut qu’apprécier la clairvoyance d’Andy Warhol avec ses portrait en sérigraphie, et de Marcel Duchamp avec ses ready-made, qui avaient très tôt compris que l’ère de la (re)production industrielle préludait à une transformation radicale de la représentation.
-
Konichiwa, baby

« – Comprendre n’est en aucun cas le but de ta présence en ces murs, dit l’homme au masque. Tu es ici pour agir. A toi de savoir comment.
– Suis-je réellement ici ? demande le samouraï. Dans cette maison ?
– A ta place, j’abandonnerais au plus vite ce genre de considérations stériles. Tes aspirations se précisent. Dis-toi que c’est pour ça que tu existes : ce lieu est le tien. »
F. Colin, Sayonara baby
 Sayonara baby, le dernier roman solo de Fabrice Colin édité par L’Atalante, a gagné au mois de juin 2004 les rayons des librairies dans une indifférence quasi générale. Pourquoi un tel silence, que n’explique tout de même pas la parcimonie euphémique avec laquelle l’éditeur distribue ses services de presse ? J’avoue trouver singulièrement affligeant le manque de discernement d’une critique généraliste trop souvent à côté de ses pompes, myope au dernier degré, incapable au même titre que son public de repérer d’authentiques écrivains, pour peu qu’ils ne soient pas publiés dans les collections générales de Gallimard, Grasset, Actes Sud, Flammarion et tutti quanti. Ah ! quand il s’agit d’encenser les productions égotistes d’une Christine Ego – pardon : Angot –, ou la dernière petite merdouille d’un bellâtre mondain, les journalistes dits « littéraires » remuent la queue en cadence... Mais qu’une Voix s’élève, trop véhémente, trop expérimentale ou même simplement dévouée au verbe – c’est-à-dire à la littérature –, et la meute décampe en jappant, la queue entre les jambes. Voyez Pogrom d’Eric Bénier-Bürckel, conchié par les mollassons du Monde, de Lire ou du Nouvel Observateur : hormis Joseph Vébret et quelques autres, rares sont les commentateurs à s’être opposés au lynchage et à avoir émis l’idée saugrenue que peut-être, Bénier-Bürckel était un écrivain… Dans le cas de Fabrice Colin, seulement connu des habitués des collections de fantasy, la farce touche au sublime : trois mois après la publication de Sayonara baby, certaines librairies parmi les plus grandes de la capitale ne le proposaient ni en rayon, ni en stock : un comble pour une « nouveauté », a fortiori pour un roman de cette valeur.
Sayonara baby, le dernier roman solo de Fabrice Colin édité par L’Atalante, a gagné au mois de juin 2004 les rayons des librairies dans une indifférence quasi générale. Pourquoi un tel silence, que n’explique tout de même pas la parcimonie euphémique avec laquelle l’éditeur distribue ses services de presse ? J’avoue trouver singulièrement affligeant le manque de discernement d’une critique généraliste trop souvent à côté de ses pompes, myope au dernier degré, incapable au même titre que son public de repérer d’authentiques écrivains, pour peu qu’ils ne soient pas publiés dans les collections générales de Gallimard, Grasset, Actes Sud, Flammarion et tutti quanti. Ah ! quand il s’agit d’encenser les productions égotistes d’une Christine Ego – pardon : Angot –, ou la dernière petite merdouille d’un bellâtre mondain, les journalistes dits « littéraires » remuent la queue en cadence... Mais qu’une Voix s’élève, trop véhémente, trop expérimentale ou même simplement dévouée au verbe – c’est-à-dire à la littérature –, et la meute décampe en jappant, la queue entre les jambes. Voyez Pogrom d’Eric Bénier-Bürckel, conchié par les mollassons du Monde, de Lire ou du Nouvel Observateur : hormis Joseph Vébret et quelques autres, rares sont les commentateurs à s’être opposés au lynchage et à avoir émis l’idée saugrenue que peut-être, Bénier-Bürckel était un écrivain… Dans le cas de Fabrice Colin, seulement connu des habitués des collections de fantasy, la farce touche au sublime : trois mois après la publication de Sayonara baby, certaines librairies parmi les plus grandes de la capitale ne le proposaient ni en rayon, ni en stock : un comble pour une « nouveauté », a fortiori pour un roman de cette valeur.
Certes, prétendre qu’une œuvre est plus importante qu’une autre, plus nécessaire, plus essentielle, est aujourd’hui fort mal considéré (après tout, pourquoi Colin plutôt qu’Angot ou Marc Lévy ou encore, pourquoi pas, Juliette Benzoni ? Pourquoi Joyce plutôt que Tom Clancy ? Pourquoi Bloy plutôt que Romain Sardou ?) – et encore ne s’agit-il, de mon point de vue, que d’apporter une infime contribution à la reconnaissance des Maîtres, et non de m’adonner à de stériles comparaisons. Il n’est cependant pas interdit de s’interroger : la critique, battue en brèche par les assauts répétés des relativistes de tous poils – je les abhorre, ces empoisonneurs –, ébranlée par les opérations marketing d’éditeurs plénipotentiaires ou velléitaires, relève-t-elle encore d’une authentique démarche intellectuelle ou n’est elle plus qu’un vulgaire processus économique, un rouage comme un autre, une conséquence déterministe ? Pourtant s’il est une époque où la critique devrait jouer un rôle éminent, n’est-ce pas la nôtre ? La masse gélatineuse, chaque année plus grasse, de « romans » qui sont jetés en pâture aux Français réclame en effet que la Critique – permettez-moi d’y apposer dorénavant une impérieuse majuscule – assume pleinement ses responsabilités (bien que certains, je pense aux histrions du Masque et la plume – l’émission de France Inter qui donne envie, tous les dimanches soir, de rouer son poste radio de violents coups de pieds – ne méritent sans doute pas cette majuscule… Qu’on en juge : ces nains, il y a déjà un certain temps, ont tout de même réussi – entre autres –, à se répandre durant de longues, très longues minutes en vaines tergiversations autour du dernier Jean-Christophe Grangé – qui, avec ses fac-similés de thrillers anglo-saxons, n’en avait pas vraiment besoin… – et à affirmer le plus tranquillement du monde, par l’inénarrable bouche d’Arnaud Viviant, que le polar était, je résume, une paralittérature tout juste bonne à passer le temps sur la plage, comme si ce simple terme, « polar », suffisait à recouvrir de sa familiarité putassière aussi bien les pires romans de gare et les monuments de James Ellroy… Et si j’en crois Philippe Curval, ce même Viviant n’eût de cesse, lors d’une autre session, de qualifier Millenium People, le dernier James G. Ballard – sur lequel je reviendrai un jour –, de « fiction spéculative », par opposition, évidemment, à la science-fiction…).
Or, quand paraît une œuvre que l’ambition, rare, et la valeur formelle, indéniable, propulsent en orbite à dix mille pieds au-dessus de l’écrasante majorité de ses contemporains, la Critique a presque le devoir d’en rendre compte. Loin de moi l’idée, chers amis, d’imposer la lecture de Sayonara baby à la Critique ou à vous-même. Le critique n’est pas un surhomme, ses capacités de lecture sont limitées – le livre, en outre, n’est pas sans défaut, et mon propos n’est pas de brandir inconsidérément l’étendard du génie ou de hurler prématurément au chef d’œuvre, encore moins de prétendre dénicher le nouveau Dick ou le nouveau Céline, ces tartes à la crème journalistiques. Mais l’injustice serait flagrante si d’aventure Sayonara baby n’était déjà enterré, repéré seulement par une poignée de revues ou de sites spécialisés – quand ceux-ci ne se gaussent pas d’une œuvre qu’ils peinent à comprendre –, tandis que d’autres, moins méritants, au style médiocre ou au propos indigent, monopoliseront les tribunes et l’argent du consommateur – sans doute avez-vous, vous aussi, repéré quelque livre « important » et oublié des médias ; Sayonara baby, j’en suis conscient, n’en est qu’un exemple parmi d’autres, qui me paraît néanmoins édifiant.
Permettez-moi, je vous prie, de prolonger encore un instant ces quelques libres réflexions sur la Critique démissionnaire : s’il y a une chose dont je sois sûr, c’est qu’il y a aujourd’hui nombre d’écrivains et d’éditeurs passionnants pour qui le nombril n’est rien d’autre qu’un petit renfoncement dans l’abdomen – ou alors, qui ouvre sur des abîmes métaphysiques – et pour qui la littérature, l’art de dire l’indicible, est d’abord une réinvention du monde. Certains intellectuels, parfois écrivains eux-mêmes, sont en effet convaincus – dans un élan de foi qui confine au fanatisme – que le roman est mort, la littérature assassinée (et, incidemment, disséquée), ce qui sous-entend, chers amis, que ces prophètes autoproclamés de l’Apocalypse littéraire, ces Chevaliers du Verbe, seraient les sauveurs par qui la Révolution surviendra ; ils sont les héros qui ébranleront nos certitudes… Les animateurs émérites de la revue Ligne de Risque (François Meyronnis, Yannick Haenel), porte-parole forcenés de ce dandysme très « Saint-Germain-des-prés », confondent cependant littérature et rentrée littéraire ; pour eux, tous les jeunes auteurs plagient Bret Easton Ellis et Michel Houellebecq, et sans aucun talent. Il est vrai qu’on ne compte plus les récits nihilistes dont l’absence de style est censée révéler la vacuité de nos sociétés mercantiles, mais sachons distinguer entre ces fades resucées et des œuvres extraordinaires comme Un prof bien sous tout rapport d’Eric Bénier-Bürckel, qui dépasse de très loin, les vaines prétentions logocratiques de nos super héros (j’admire le travail rythmique et mélodique de Yannick Haenel dans Evoluer parmi les avalanches, mais l’auteur tombe de toute évidence dans les travers qu’il dénonce : son style est tout simplement magnifique, mais il n’a hélas rien à dire…) ; ils écartent arbitrairement, sans doute par a priori (ce qui ne laisse pas d’étonner de la part d’écrivains suivis jadis par Maurice G. Dantec et Medhi Belhaj-Kacem, et soutenus par Philippe Sollers), d’autres créateurs dont ces considérations théoriques sur la mort du roman sont le cadet des soucis parce qu’eux dans ses veines font couler leur sang. Je pense, vous l’aurez deviné, à Fabrice Colin qui, à mille lieues des goncourables et autres règlements de compte délatoires des autofictionneurs, a en effet assimilé l’œuvre d’Ellis – comme celles de Nabokov, de John Fante ou de William Burroughs –, en prenant toutefois toujours garde de ne pas tomber dans les travers de la pâle copie : Colin s’invente un style propre, libre et modeste, entièrement dévoué à son art. Sans se préoccuper du prétendu cadavre du roman, peu enclin à endosser le titre suprême de « grand conteur », Fabrice Colin érige une Œuvre authentique et cohérente.
Je doute fort, hélas, que Sayonara baby soit pleinement apprécié par les partisans toujours plus nombreux de la littérature prophylactique, du roman opiacé qui, vous faisant ressembler à Dorian Gray, accélère votre vieillissement, autrement dit du roman de pure distraction qui ne doit surtout pas souffrir le moindre effort intellectuel. Ces aficionados du « talent de conteur » – cette plaie qui pourrit l’esprit critique du petit monde de la SF – oublient cependant l’essentiel, à savoir qu’il s’agit avant tout de littérature, c’est-à-dire d’un travail sur le langage, d’une re-création du monde à échelle microscopique, et n’étayent que rarement leurs propos par une étude de forme. On en vient alors à promouvoir des œuvres parfois très mineures, pour ne pas écrire médiocres, quand il ne s’agit pas des pires torchons, dont le seul mérite est, je cite, de « raconter une histoire ». Aucun chef d’œuvre, faut-il le rappeler, n’est pourtant réductible à son intrigue, hors de toute mise en forme ! Cette propension de la Critique à réduire un auteur à son « talent de conteur » procède surtout, après réflexion, d’une fâcheuse tendance à ressasser des lieux communs, à coasser bêtement des phrases toutes faites et des formules à l’emporte-pièce qui pourraient indifféremment qualifier n’importe quel roman – afin d’éviter tout malentendu, je précise que je me suis moi-même souvent fourvoyé dans cette impasse critique. Méfions-nous aussi des chroniqueurs à la dithyrambe facile, qui ponctuent invariablement leurs articles d’un point d’exclamation final (« à lire absolument ! » ; « un grand plaisir de lecture ! » ; « un vrai bonheur ! » ; « à lire et à relire ! »…), en qui je ne vois en réalité que les bras chétivement armés de l’abominable Relativisme : souvent, seul le résumé distingue un livre d’un autre, tant la partie critique, réutilisable à loisir, se réduit à une série de grossiers stéréotypes (« une intrigue bien ficelée »), quand elle n’est pas tout simplement absente.
Un roman aussi atypique que Sayonara baby risque en tout cas d’en dérouter plus d’un. Et pourtant, l’auteur de Or not to be s’y entend comme personne pour construire un récit et susciter l’intérêt des plus versatiles. Hélas, bonnes gens, la partie est perdue d’avance : dans Sayonara baby, Fabrice Colin ne dénonce aucune injustice ; ses personnages ne sont ni des monstres de cynisme, ni des humanistes christiques ; il ne délivre aucun message, il n’est pas suffisamment anti-Bush pour les gauchistes, il n’est pas altermondialiste, il ne prétend pas vous éclairer sur le sens de la vie ou rédimer un Verbe agonisant ; il n’entend pas non plus vous divertir sans contrepartie. Bref, aucune chance de défrayer la chronique ou de faire bander le rebelle mondain. Colin, pour qui « Littérature » n’est pas un vain mot, n’écrit pas pour les masses, ou pour une élite (que Borges, dans sa labyrinthique sagesse, qualifiait d’« abstractions, chères au démagogue »), mais pour lui-même, pour la littérature et, sans doute, pour ses amis (et peut-être aussi pour les idiots). Je doute, pour couronner le tout, que ma critique désastreusement longue – déjà publiée ailleurs, et dont je vais vous proposer une version révisée dans quelques jours –, ainsi d’ailleurs que ce billet aux dimensions non moins rédhibitoires, lui soient d’une aide quelconque… -
Au coeur de Ténèbres - 12 - Intermezzo

La construction de Ténèbres semble totalement asservie à son objectif cathartique, rendu possible, nous le verrons, aussi étonnant que cela puisse paraître, par un invisible dialogue entre le film et son spectateur, authentique – et dialectique – rapport intime qui s’apparente en de nombreux points à la rencontre sexuelle – et au meurtre. Les noces d’Eros et de Thanatos ont engendré ici un Big Bang psychosexuel qui se serait étendu indéfiniment, révélant un monde similaire au nôtre mais où chaque objet, chaque individu, dissimuleraient une menace latente. Ténèbres est un coït filmique monstrueux qui se repaît de notre jouissance nécrophage de la peur, qui « s’articule ici comme la montée d’un désir, l’assouvissement d’une force vitale » [47]. Appliquée au film dans son ensemble, notre chaîne « phallus-couteau-caméra » devient « coït-meurtre-film » : la relation entre sexe et meurtre est ici très complexe, ni tout à fait métaphorique, ni tout à fait métonymique – le sexe n’est en effet pas explicitement représenté par le meurtre, ni par convention culturelle (l’équivalence ne va pas d’elle même) ni par rapprochement contigu : il s’agit plutôt d’une surdétermination de tous les instants. De la même manière que chaque meurtre est mis en scène comme un acte sexuel – rythme du montage, utilisation du gros plan… –, le film joue délibérément avec l’excitation d’un spectateur qui ne demande, il faut bien l’avouer, qu’à assouvir ses fantasmes par procuration – jouir d’une peur coupable mais socialement acceptée [48]. Tuer dans Ténèbres, pour les personnages, c’est se libérer de ses angoisses, d’un inconscient trop proliférant ; tuer dans Ténèbres c’est aussi libérer le spectateur des siennes propres : tout l’enjeu du film est de provoquer l’abréaction de nos pulsions de mort, c’est-à-dire de susciter des désirs morbides, violents, immoraux, avant de les représenter, de nous renvoyer l’image de nos perversions.
Dario Argento procède en deux phases bien distinctes. Le film commence d’abord piano, l’intrigue préliminaire paraît classique, familière, rassurante, le scénario plutôt convenu : un sadique assassine de jolies jeunes femmes et un écrivain, fort de son imagination, s’improvise détective. Mis en confiance, le spectateur croit assister à un thriller archétypal aux dialogues ponctués de références littéraires (Arthur Conan Doyle, Mickey Spillane, Agatha Christie, etc.) quand les premières fissures apparaissent avec la brutale insertion du premier flash-back, dont la subversion narrative et esthétique détruit le confort initial. La mise en scène devient dès lors plus nerveuse : les deuxième et troisième meurtres (Tilda et son amie) sont magistralement, sensuellement, esthétiquement filmés – la violence, pour être brutale, n’en est cependant pas moins contenue, encore raisonnable.
Le meurtre de Cristiano Berti à la hache, qui survient vingt minutes après le précédent, marque un indéniable changement de ton : Peter Neal, héros jusqu’alors plutôt charismatique, devient alors coupable : le spectateur, qui n’est pas encore dans la confidence, perd ses repères, aspiré dans un monde paranoïaque d’insaisissables ténèbres. Les meurtres deviennent plus violents, plus explicitement sexuels, plus nombreux aussi : la barbarie paroxystique de la dernière séquence ne s’achève qu’avec le film lui-même – les hurlements d’Anne (la seule survivante) devant l’écrivain agonisant, embroché par la sculpture, se poursuivent d’ailleurs encore après le fondu au noir final.
Avec le changement de régime progressif, puis brutal, du rythme des meurtres de Ténèbres – d’Agatha Christie au gore –, se profile la montée d’excitation du spectateur, qui attend chaque meurtre avec toujours plus d’impatience. L’identité de la victime lui importe plus encore que celle du tueur : nous ne regardons pas Ténèbres pour suivre une banale enquête policière mais pour être les témoins volontaires – les voyeurs – d’actes atroces. Le rythme et la relative sagesse (malgré leur indéniable beauté artistique) des meurtres de la première moitié du film provoque une frustration qui participe à l’explosion de la jouissance finale : le spectateur se vautre dans le sang et les cris, participant au massacre avec un plaisir non simulé et, pour ma part, sans retenue. En quinze minutes le spectateur-voyeur a assisté complaisamment à cinq violents assassinats, s’est repu de geysers de sang (le bras tranché de Jane McKerrow) et a délicieusement subi deux coups de théâtre (la révélation de la culpabilité de Peter Neal et le faux suicide). De tous les protagonistes importants du film, Anne est la seule survivante. Le spectateur sort de ce déchaînement de violence éprouvé, libéré de ses fantasmes de mort, de ses pulsions de violence. Ténèbres s’achève par une jouissance violente et impensable, à coups de hache, de sang en cascade et de hurlements continus.
C’est qu’en vérité le désir, sous toutes ses formes, est la sève du film. C’est à lui que nous allons à présent nous intéresser.
[47] J.-P. Putters, « Dario Argento ou le regard sur l’indicible » in Mad Movies n°24, septembre 1982.
[48] En réécrivant cela, je ne puis m’empêcher de penser à ces lignes, extraites des Fables de l’Humpur (J’ai lu « Fantasy », 2005, p.433) du naïf mais sympathique Pierre Bordage : « Mais la recherche de la peur n’est-elle pas qu’une préparation à la dissolution – pardon, la disparition – finale ? »...

