
« L’artiste a le devoir d’être calme. Il n’a pas le droit de projeter toutes ses émotions ou tout ce qui l’intéresse vers le public. Son émotion pour un sujet doit se métamorphoser dans le calme olympien de la forme. Alors seulement pourra-t-il révéler ce qui l’émeut en vérité. »
A. Tarkovski, Le Temps scellé
« Un seul mystère des personnes et des objets. »
R. Bresson, Notes sur le cinématographe
Avec Un couple parfait de Nobuhiro Suwa et Saraband d’Ingmar Bergman, Le Soleil, nouveau poème cinématographique d’Alexandre Sokourov, est au moins le troisième grand film de ces deux dernières années, tourné non plus en 35mm mais en vidéo haute définition. Je ne me lancerai pas ici dans une interprétation hasardeuse de cette révolution numérique du septième art. Postulons cependant qu’à rebours d’un certain cinéma contaminé par l’esthétique télévisuelle – sans parler du financement des productions nationales par les chaînes TV –, cette technologie numérique haute définition, utilisée à des fins artistiques, permet d'abolir un peu plus la distance qui sépare l’image du Réel (ce qui, j'y viendrai, n'est pas sans poser quelque problème dans Le Soleil), et paradoxalement, de redéfinir la spécificité cinématographique (lire l’intéressante table ronde des Cahiers du cinéma n° 610[1]). Il y a un autre point commun, soit dit en passant, entre Saraband et Le Soleil : tous deux peuplés de démons (un père incestueux, un empereur irresponsable), les œuvres de Bergman et de Sokourov utilisent la même sarabande, tirée de la Suite N°5 en C mineur pour violoncelle[2] (CW1011) de J.-S. Bach. Ainsi est-ce sur ces notes que Hirohito (incarné par Issei Ogata), dans Le Soleil, esquisse quelques pas de danse, troublant écho au Dictateur de Charlie Chaplin. Le Soleil nous montre l’Empereur Shôwa, connu sous le nom de Hirohito, préparer la reddition du Japon après Hiroshima, et l’abandon de son statut divin. Je vous livre ici quelques réflexions éparses que m’ont inspiré le film de Sokourov et deux ou trois commentaires lus ici ou là.
Sur son blog, « le Uhlan », qui compare Le Soleil à Ludwig ou le crépuscule des dieux, écrit à juste titre que « Sokourov a mis moins longtemps [que Visconti] à trouver sa manière », or il me semble qu’il s’agit précisément de la limite du cinéaste depuis quelques années – ses choix artistiques deviennent des marques de fabrique : Sokourov fait du Sokourov. Je n'ai pas vu Taurus, qu’aucun distributeur français n’a encore jugé bon de montrer au public français, mais depuis Mère et fils en 1997 – une vraie splendeur plastique, qui tirait le cinéma vers la peinture –, les films de Sokourov sont à la fois extrêmement raffinés, étranges, « oeuvres d'art » de premier ordre, et un peu hermétiques, usant souvent des mêmes artifices – brume, bande-son en arrière-plan, dominante monochrome –, comme des réminiscences indéfiniment répétées de séquences inoubliables de Stalker ou du Miroir d’Andrei Tarkovski. Autrement dit, il s'en faut de peu pour que Père, fils, L'Arche russe, Moloch et Le Soleil (nous oublions volontairement les films antérieurs du cinéaste, comme Le Jour de l’éclipse, œuvres de virtuose mais d’une « manière » très différente) nous plongent dans une torpeur que rien, ou presque, ne sépare de l'ennui. Mère et fils au contraire, rare équivalent cinématographique d’une toile de maître, nous transportait dans un univers esthétique et sensoriel, radicalement différent[3] ; et Pages cachées, une étrange adaptation de Crime et châtiment, possédait un souffle poétique qu'on devinait hérité de Tarkovski (ce dernier citait d’ailleurs Sokourov, dans Le Temps scellé, parmi les rares génies du cinéma, avec Bresson, Mizoguchi, Vigo, Buñuel et Satyajit Ray). Chez Sokourov toutefois, comme chez Antonioni, cet « ennui », qui n’est jamais que l’expression d’un jugement qui pourrait tout autant, pour citer Tarkovksi, être celui d’un « aveugle-né à qui on décrirait un arc-en-ciel »[4], cet ennui, donc, est fécond, et ne saurait faire office d’argument critique. L’intérêt du Soleil est à chercher, moins dans la « manière » d’un auteur, que dans l’expression formelle réussie d’idées et d’émotions infiniment plus complexes que les « intentions » conscientes (supposées) de cet auteur.
 En outre Le Soleil, même s’il décrit lui aussi le « crépuscule d’un dieu », ne saurait être comparé de trop près au Ludwig de Visconti : la folie – le monde intérieur – de Louis II de Bavière, était sans cesse confronté – si mes souvenirs (assez anciens) du film sont bons – aux événements extérieurs dont nous percevions au moins la rumeur. Chez Sokourov, ce contexte est non seulement réduit à la ruine totale du Japon, comme si rien d'autre n'existait – ainsi que nous le montre l'extraordinaire séquence de bombardement onirique, où bombes et B-52 prennent la forme d’inquiétants poissons volants –, mais encore enveloppé d’un brouillard persistant. Plus que Ludwig, Le Soleil exige du spectateur, pour être seulement compris, quelque connaissance au moins superficielle de la réalité historique et du personnage. Même le spectateur le plus inculte ressentait le tragique de la situation de Louis II. À la vision du Soleil en revanche, le même spectateur se forgerait de Hirohito une image certes confusément ambiguë, mais essentiellement positive… Un minimum de culture générale, altère donc profondément la vision du film. Ainsi n'ai-je pu m'empêcher de penser, voyant cet attachant Hirohito s'extasier devant un crabe aux pattes atrophiées extrait du formol, ou se passionner pour la biologie, aux expériences atroces commises par la tristement célèbre unité 731 en Mandchourie[5], restées impunies précisément grâce à l’immunité que lui conférait le pacte conclu avec le général MacArthur... D'autre part, formellement, les deux films n’ont que peu de points communs. Ludwig bénéficiait des techniques classiques du cinématographe admirablement maîtrisées par un Visconti au sommet de son art – costumes, décors, éclairages, maquillages ; tout tendait vers une forme assez théâtrale, shakespearienne, du cinéma. Sokourov en revanche, en ayant recours à la grisaille enveloppante de la vidéo, et en dépit d'une indéniable préoccupation plastique, est à la recherche d'une captation au plus près du Réel (remarquez combien ses derniers films de fiction sont proches, plastiquement, de ses essais documentaires ou poétiques, comme Une vie humble, magnifique élégie d’une vieille veuve japonaise, ou Confession, long poème dédié à la marine russe), fort éloignée de la méthode viscontienne.
En outre Le Soleil, même s’il décrit lui aussi le « crépuscule d’un dieu », ne saurait être comparé de trop près au Ludwig de Visconti : la folie – le monde intérieur – de Louis II de Bavière, était sans cesse confronté – si mes souvenirs (assez anciens) du film sont bons – aux événements extérieurs dont nous percevions au moins la rumeur. Chez Sokourov, ce contexte est non seulement réduit à la ruine totale du Japon, comme si rien d'autre n'existait – ainsi que nous le montre l'extraordinaire séquence de bombardement onirique, où bombes et B-52 prennent la forme d’inquiétants poissons volants –, mais encore enveloppé d’un brouillard persistant. Plus que Ludwig, Le Soleil exige du spectateur, pour être seulement compris, quelque connaissance au moins superficielle de la réalité historique et du personnage. Même le spectateur le plus inculte ressentait le tragique de la situation de Louis II. À la vision du Soleil en revanche, le même spectateur se forgerait de Hirohito une image certes confusément ambiguë, mais essentiellement positive… Un minimum de culture générale, altère donc profondément la vision du film. Ainsi n'ai-je pu m'empêcher de penser, voyant cet attachant Hirohito s'extasier devant un crabe aux pattes atrophiées extrait du formol, ou se passionner pour la biologie, aux expériences atroces commises par la tristement célèbre unité 731 en Mandchourie[5], restées impunies précisément grâce à l’immunité que lui conférait le pacte conclu avec le général MacArthur... D'autre part, formellement, les deux films n’ont que peu de points communs. Ludwig bénéficiait des techniques classiques du cinématographe admirablement maîtrisées par un Visconti au sommet de son art – costumes, décors, éclairages, maquillages ; tout tendait vers une forme assez théâtrale, shakespearienne, du cinéma. Sokourov en revanche, en ayant recours à la grisaille enveloppante de la vidéo, et en dépit d'une indéniable préoccupation plastique, est à la recherche d'une captation au plus près du Réel (remarquez combien ses derniers films de fiction sont proches, plastiquement, de ses essais documentaires ou poétiques, comme Une vie humble, magnifique élégie d’une vieille veuve japonaise, ou Confession, long poème dédié à la marine russe), fort éloignée de la méthode viscontienne.
Or, une telle figure historique, dont nous connaissons des photographies et au moins les grandes lignes biographiques, échappe forcément à cette traque en haute définition. Et sans doute la séquence des photographes américains, moqueurs et irrespectueux – Hirohito, affublé d’un costume de charlot, prend la pose devant les rosiers du jardin du palais –, est-elle destinée à nous maintenir à distance de cette réalité historique. A première vue cependant, la vidéo haute définition paraît inappropriée pour filmer la solitude de l’Empereur japonais en 1945. Si la technologie numérique enregistre idéalement l’engloutissement du couple moderne dans l’indistinction des contingences quotidiennes (lire mon analyse de Un couple parfait, le chef d’œuvre de Nobuhiro Suwa, dans le premier numéro à paraître de La Revue du cinéma), elle confère en effet au sujet historique une virtualité très télévisuelle, renforcée par d’étranges fondus enchaînés, extrêmement brefs – en fait, tellement imperceptibles qu’à ma connaissance, nul ne les a encore mentionnés –, au début du film.
 Le dictateur nippon, sous l’œil réactionnaire de Sokourov, est décrit comme un idiot dostoïevskien, poète – il compose des haïkus – sinon pacifiste, du moins opposé à l’orgueil national qu’il rend d’ailleurs coupable de la débâcle, et infantile. Devant ses serviteurs et généraux médusés, Hirohito, à un discours intransigeant, préfère la métaphore de la capitulation : « Parfois le poisson-chat se cache dans les profondeurs, parfois le papillon ferme ses ailes… ». Face à l’inéluctable, l’Empereur pressent la nécessité de se défaire de sa « divinité » : il renonce volontairement à être le descendant du Soleil – il s’éclipse. Loin de l’exercice hagiographique, et cependant guère plus critique, Le Soleil s’attache à l’extinction d’un Dieu qui, littéralement, n’appartient pas à notre monde (de même que L’Arche russe, fameux film tourné lui aussi en vidéo, et en un seul plan magistral, interrogeait l’identité russe, Le Soleil s’intéresse à l’âme nippone). D’où, en dernière analyse, la pertinence de la vidéo, qui transporte le personnage, admirateur de Chaplin et de stars hollywoodiennes, dans un espace filmique totalement étranger et anachronique – hanter le présent numérique, tel est le projet de Sokourov. Comparés à Hirohito/Issei Ogata les autres personnages, à commencer par MacArthur et ses GI’s, semblent tous caricaturaux : l’Empereur ne se meut pas dans la même réalité. Ainsi ce dernier ouvre-t-il sans cesse la bouche en silence, agité d’un tic nerveux, comme un poisson, ou comme si son univers intérieur excédait cette réalité désastreuse qu’il refuse de contempler. Ainsi encore Hirohito, jusqu’alors prisonnier des obligations d’étiquette, semble-t-il appréhender le monde que nous connaissons, avec une innocence, une joie toute enfantine. Il faut le voir, chez MacArthur, ouvrir une porte pour la première fois, cette tâche étant d’ordinaire réservée à ses fidèles serviteurs, ou profiter de l’absence de son hôte américain pour moucher les bougies de l’Ambassade !
Le dictateur nippon, sous l’œil réactionnaire de Sokourov, est décrit comme un idiot dostoïevskien, poète – il compose des haïkus – sinon pacifiste, du moins opposé à l’orgueil national qu’il rend d’ailleurs coupable de la débâcle, et infantile. Devant ses serviteurs et généraux médusés, Hirohito, à un discours intransigeant, préfère la métaphore de la capitulation : « Parfois le poisson-chat se cache dans les profondeurs, parfois le papillon ferme ses ailes… ». Face à l’inéluctable, l’Empereur pressent la nécessité de se défaire de sa « divinité » : il renonce volontairement à être le descendant du Soleil – il s’éclipse. Loin de l’exercice hagiographique, et cependant guère plus critique, Le Soleil s’attache à l’extinction d’un Dieu qui, littéralement, n’appartient pas à notre monde (de même que L’Arche russe, fameux film tourné lui aussi en vidéo, et en un seul plan magistral, interrogeait l’identité russe, Le Soleil s’intéresse à l’âme nippone). D’où, en dernière analyse, la pertinence de la vidéo, qui transporte le personnage, admirateur de Chaplin et de stars hollywoodiennes, dans un espace filmique totalement étranger et anachronique – hanter le présent numérique, tel est le projet de Sokourov. Comparés à Hirohito/Issei Ogata les autres personnages, à commencer par MacArthur et ses GI’s, semblent tous caricaturaux : l’Empereur ne se meut pas dans la même réalité. Ainsi ce dernier ouvre-t-il sans cesse la bouche en silence, agité d’un tic nerveux, comme un poisson, ou comme si son univers intérieur excédait cette réalité désastreuse qu’il refuse de contempler. Ainsi encore Hirohito, jusqu’alors prisonnier des obligations d’étiquette, semble-t-il appréhender le monde que nous connaissons, avec une innocence, une joie toute enfantine. Il faut le voir, chez MacArthur, ouvrir une porte pour la première fois, cette tâche étant d’ordinaire réservée à ses fidèles serviteurs, ou profiter de l’absence de son hôte américain pour moucher les bougies de l’Ambassade !
Involontairement sans doute – le cinéaste n’a jamais caché sa nostalgie pour l’ordre ancien, ni son admiration pour le personnage –, Sokourov dresse ici le portrait d’un despote irresponsable, esthète terrifié, réfugié dans son univers intérieur tandis que son peuple, qu’il refuse de voir, crève dans les ruines d’un Japon exsangue. Pour le réalisateur au contraire, Hirohito aurait par le sacrifice de sa divinité, permis à son pays de se remettre sur pied. Mais dans les Cahiers du cinéma, Stéphane Delorme note pertinemment que cette défense révisionniste de Hirohito est « démentie par les dernières images du film : gambadant avec son épouse, l’Empereur va rejoindre ses enfants, abandonnant au contraire complètement son pays pour un repli en famille […] ». Hirohito se fait même confirmer par un scientifique, que l’aurore boréale que son illustre grand-père, l’Empereur Meiji, prétend avoir vue au-dessus du palais, ne saurait lui apparaître : Hirohito n’est pas un dieu immortel, mais un homme ridicule, doté d’un corps chétif, exhalant une mauvaise haleine, et guère plus remarquable en vérité que le spécimen de crabe qu’il examine attentivement à l’abri de son bunker. Doit-on pour autant condamner Sokourov pour cette vision de Hirohito, très conforme à l’opinion nationaliste qui prévaut au Japon ? Certes non. « Le chef d’œuvre, écrivait Tarkovski, a une vie et des lois qui lui sont propres. Il crée une émotion ou un éblouissement esthétique, peu importe que nous soyons d’accord ou non avec la conception générale qui la sous-tend. C’est que les chefs d’œuvre naissent souvent de la lutte de l’auteur contre ses propres faiblesses, qu’il ne parvient pas toujours à vraiment éliminer »[6]. Ainsi du Soleil, dont le pouvoir de fascination tient aussi à son ambiguïté fondamentale. Moloch montrait déjà quels abîmes séparaient Adolf Hitler, grotesque petit homme gouverné par sa morbidité, et les actes innommables perpétrés sous sa férule. Dans Le Soleil, le pouvoir est encore soumis à l’étroitesse d’un individu plus faible que démiurge. Tandis que la junte militaire à court d’arguments parle d’envoyer des chiens-kamikazes détruire l’ennemi, l’Empereur – celui-là même, ne l’oublions pas, qui autorisa l’utilisation d’armes chimiques sur des civils chinois – choisit le déshonneur, la capitulation, le bien-être familial main dans la main avec l’Impératrice. C’est justement cette fragilité, cette délicatesse indécente, cette lâcheté aussi – et cette impunité –, qui font du Hirohito de Sokourov un personnage plus terrifiant, et à bien des égards plus dérangeant, que le Hitler bouffon de Moloch.

[1] « L’image numérique est fantastique » in Les cahiers du cinéma n°610, mars 2006. Table ronde présentée par Emmanuel Burdeau, avec Bertrand Bonello, Caroline Champetier, Gilles Gaillard, Eric Gautier, Barbet Schroeder.
[2] Permettez-moi de vous recommander avec enthousiasme, l’interprétation des 6 Suites pour violoncelle seul, par Anner Bylsma, chez Sony Classical.
[3] Mère et fils, dont nous attendons d’ailleurs avec une impatience grandissante une édition DVD française…
[4] A. Tarkovski, Le Temps scellé (éd. des Cahiers du cinéma, « Petite bibliothèque », 2004), p. 53.
[5] Un film très douteux et manifestement anti-japonais, Camp 731, réalisé en 1987 par Tun Fei Mou, montrait ces tortures de manière très réaliste. Les spectateurs de L’étrange festival s’en souviennent encore…
[6] A. Tarkovski, op. cit., p. 52.


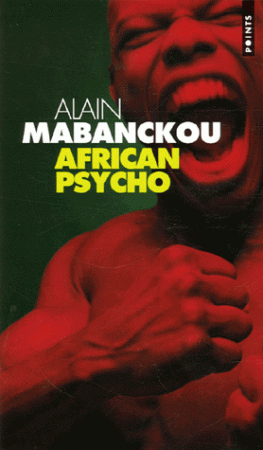


 L’apparente complexité de ce récit plus qu’elliptique – voire lacunaire –, est atténuée par l’utilisation de noms aisément mémorisables – Perle, Rubis, Jade… –, étroitement liés aux dominantes chromatiques de chaque appartement que nous visitons au gré des fréquentations des personnages masculins. De cette façon, le spectateur n’est jamais rejeté à l’extérieur du film, comme dans les œuvres précédentes de Hou qui imposaient une forte distanciation ; il est au contraire happé par son unité esthétique, captif de son ambiance feutrée, terriblement dépaysante et cependant immédiatement confortable – aux antipodes cependant du confort uniforme, formaté du cinéma dominant. Entièrement tourné en intérieurs, Les Fleurs de Shanghai brille en effet de prime abord par la splendeur et l’opulence de ses décors, par l’élégance de ses costumes et par la picturalité de sa photographie, mis en valeur par la profondeur de champ. En dépit de la subtile et quasi constante mobilité de la caméra, les plans paraissent ainsi toujours parfaitement composés, jouant à merveille des foyers lumineux – le plus souvent des lampes à huile, parfois une fenêtre filtrant la lumière déclinante du soir – et de tous les éléments à l’intérieur du cadre – y compris les acteurs eux-mêmes, modèles dont les états d’âme, enfouis sous un épais vernis social, nous émeuvent moins que leur présence miraculeuse. Il ne serait pas exagéré d’affirmer que chaque image du film est semblable à un tableau de grand peintre, même si, comme nous allons le voir, c’est le film dans son ensemble, exploitant toutes les possibilités du cinématographe, qui finit par composer une œuvre exceptionnelle.
L’apparente complexité de ce récit plus qu’elliptique – voire lacunaire –, est atténuée par l’utilisation de noms aisément mémorisables – Perle, Rubis, Jade… –, étroitement liés aux dominantes chromatiques de chaque appartement que nous visitons au gré des fréquentations des personnages masculins. De cette façon, le spectateur n’est jamais rejeté à l’extérieur du film, comme dans les œuvres précédentes de Hou qui imposaient une forte distanciation ; il est au contraire happé par son unité esthétique, captif de son ambiance feutrée, terriblement dépaysante et cependant immédiatement confortable – aux antipodes cependant du confort uniforme, formaté du cinéma dominant. Entièrement tourné en intérieurs, Les Fleurs de Shanghai brille en effet de prime abord par la splendeur et l’opulence de ses décors, par l’élégance de ses costumes et par la picturalité de sa photographie, mis en valeur par la profondeur de champ. En dépit de la subtile et quasi constante mobilité de la caméra, les plans paraissent ainsi toujours parfaitement composés, jouant à merveille des foyers lumineux – le plus souvent des lampes à huile, parfois une fenêtre filtrant la lumière déclinante du soir – et de tous les éléments à l’intérieur du cadre – y compris les acteurs eux-mêmes, modèles dont les états d’âme, enfouis sous un épais vernis social, nous émeuvent moins que leur présence miraculeuse. Il ne serait pas exagéré d’affirmer que chaque image du film est semblable à un tableau de grand peintre, même si, comme nous allons le voir, c’est le film dans son ensemble, exploitant toutes les possibilités du cinématographe, qui finit par composer une œuvre exceptionnelle. Le film alterne ensuite les scènes plus ou moins intimes, où s’expriment les désirs et frustrations des individus, et les scènes de groupe comme celle que nous venons de décrire. Il n’est cependant plus question, comme dans
Le film alterne ensuite les scènes plus ou moins intimes, où s’expriment les désirs et frustrations des individus, et les scènes de groupe comme celle que nous venons de décrire. Il n’est cependant plus question, comme dans  La bande-son, enfin, n’est pas moins remarquable. Les voix des personnages nous parviennent ouatées, comme murmurées à l’oreille, seules au monde comme la voix de l’hypnotiseur, indépendamment de la place des acteurs par rapport à la caméra. La musique surtout, presque omniprésente mais le plus souvent dissimulée en arrière-fond, parfois inaudible, parachève l’œuvre du maître. « La musique, répétitive et lancinante, écrit Alain Bergala dans son excellente analyse, participe à ce décollage du spectateur, convié à se dédoubler entre le je qui voit et le je qui entend, et qui a compris dès le début du film qu’il n’a plus qu’à se laisser bercer par le roulis narratif, à attendre passivement le retour de ces figures qui tissent très lentement quelques fils d’une histoire sans commencement ni fin, dont M. Hong, à la fois omniprésent et hors-jeu, serait la navette ».
La bande-son, enfin, n’est pas moins remarquable. Les voix des personnages nous parviennent ouatées, comme murmurées à l’oreille, seules au monde comme la voix de l’hypnotiseur, indépendamment de la place des acteurs par rapport à la caméra. La musique surtout, presque omniprésente mais le plus souvent dissimulée en arrière-fond, parfois inaudible, parachève l’œuvre du maître. « La musique, répétitive et lancinante, écrit Alain Bergala dans son excellente analyse, participe à ce décollage du spectateur, convié à se dédoubler entre le je qui voit et le je qui entend, et qui a compris dès le début du film qu’il n’a plus qu’à se laisser bercer par le roulis narratif, à attendre passivement le retour de ces figures qui tissent très lentement quelques fils d’une histoire sans commencement ni fin, dont M. Hong, à la fois omniprésent et hors-jeu, serait la navette ».