Eternity Express de Jean-Michel Truong - Mille déserts vides et froids (27/05/2005)

« En cette nuit de Noël, les diables verts accrochèrent quatre cents vieilles femmes à leur sinistre tableau de chasse. Dans les semaines qui suivirent, deux mille six cents « terroristes » furent déportées vers ces camps du Laogai d’où l’on ne revenait pas. Le 1er mars, matées, les survivantes avaient repris le travail.
– C’était le prix à payer pour la modernisation du pays, avait expliqué Xuan […]. Dans une économie concurrentielle, c’est ça ou disparaître… Nous sommes en guerre, Jonathan, et à la guerre, certains sont parfois sacrifiés pour que le plus grand nombre vive. Cette nécessité, confusément, le plus grand nombre la reconnaît et l’accepte, et c’est pourquoi, lorsque certaines personnes périssent, le plus grand nombre se tait. D’ailleurs, tu verras, avant l’été plus personne ne se souviendra de ces folles. »
Jean-Michel Truong, Eternity Express
 L’occident croule sous ses anciens. L’Europe, déjà ébranlée par les Krachs boursiers de la netéconomie et de l’Eternity rush (boom économique autour d’une illusoire immortalité), ne peut plus faire face à ce déferlement démographique sans précédent, à ces papyboomers devenus trop encombrants, tels des déchets nucléaires partout indésirables. Acculée, l’Union, charnier vivant, n’a d’autre choix que de sous-traiter leur prise en charge : c’est l’avènement des lois dites de « décentralisation du troisième âge ». Concrètement, les vieillards sont envoyés en Chine, délocalisés pourrait-on dire, où ils finiront leurs jours - croient-ils - dans des villages idylliques bénéficiant de tout le confort permis par la science. Jonathan, médecin désabusé, fait partie du premier convoi en direction de Clifford Estate, l’un de ces paradis enclavés. A bord du transsibérien, entre l’Alsace et le désert de Gobi, des liens se nouent et se défont entre les voyageurs, mettant au jour la vacuité de leurs semblables, leur médiocrité – à tous autant qu’ils sont –, tandis que Jonathan a tout loisir de se plonger dans ses troubles souvenirs. Peu à peu, à la manière d’un puzzle, les pièces s’assemblent et l’image qu’on entraperçoit est celle, ô combien atroce, de la société que nous construisons aveuglément. Nous : c’est-à-dire vous, c’est-à-dire moi.
L’occident croule sous ses anciens. L’Europe, déjà ébranlée par les Krachs boursiers de la netéconomie et de l’Eternity rush (boom économique autour d’une illusoire immortalité), ne peut plus faire face à ce déferlement démographique sans précédent, à ces papyboomers devenus trop encombrants, tels des déchets nucléaires partout indésirables. Acculée, l’Union, charnier vivant, n’a d’autre choix que de sous-traiter leur prise en charge : c’est l’avènement des lois dites de « décentralisation du troisième âge ». Concrètement, les vieillards sont envoyés en Chine, délocalisés pourrait-on dire, où ils finiront leurs jours - croient-ils - dans des villages idylliques bénéficiant de tout le confort permis par la science. Jonathan, médecin désabusé, fait partie du premier convoi en direction de Clifford Estate, l’un de ces paradis enclavés. A bord du transsibérien, entre l’Alsace et le désert de Gobi, des liens se nouent et se défont entre les voyageurs, mettant au jour la vacuité de leurs semblables, leur médiocrité – à tous autant qu’ils sont –, tandis que Jonathan a tout loisir de se plonger dans ses troubles souvenirs. Peu à peu, à la manière d’un puzzle, les pièces s’assemblent et l’image qu’on entraperçoit est celle, ô combien atroce, de la société que nous construisons aveuglément. Nous : c’est-à-dire vous, c’est-à-dire moi.
Après le clonage dans Reproduction interdite, après l’intelligence artificielle dans Le successeur de pierre – deux livres sur lesquels je reviendrai sans doute – et Totalement inhumaine, Jean-Michel Truong s’attaque donc au vieillissement de la population. Ses textes, on le comprend vite, participent tous d’une même réflexion philosophique sans pour autant ressasser les mêmes obsessions ; son Œuvre, essai et romans confondus, d’une rare cohérence, compose une pensée en mouvement dont la pierre angulaire demeure ce malaise dans la civilisation, ce sentiment d’horreur que lui inspire notre histoire, cet avenir proche qu’il pressent désastreux ; ces démons qu’on appelle des « hommes ».
Reproduction interdite et Le successeur de pierre montraient comment la société, impersonnelle, finit toujours par assimiler des pratiques qu’elle a d’abord réprouvées. De fait, Jean-Michel Truong revient brièvement dans Eternity Express sur l’inanité de la distinction opérée actuellement entre clonage thérapeutique et clonage reproductif : accepter le premier, avance-t-il, c’est accepter que tôt ou tard, le second s’imposera naturellement. Et le pire, voyez-vous, le pire, c’est que j’entrevois – mais je n’ose y croire – qu’il a raison, que la promesse d’une vie prolongée par transfusions sanguines et transplantation d’organes à partir de clones, que les enjeux financiers vertigineux, écarteront nos objections éthiques, morales, philosophiques, du revers de la main. Je persiste à croire, comme je l’écrivais dans mon manifeste Des choses et des fantômes, que dans certaines sociétés, dont les nôtres, occidentales, l’image même du clone, même diminué génétiquement, empêchera toute exploitation industrielle légale. Hélas ! Lire la prose de Jean-Michel Truong guérit de toute naïveté. Dans son livre, l’euthanasie légale ne serait à son tour que le premier pas – le plus important – vers une politique de régulation de la population par le contrôle des naissances, mais aussi, vous l’aurez deviné, par le contrôle des décès ! Dans Le successeur de pierre déjà, où l’humanité des nantis ne subsiste plus qu’isolément, sous la protection hautement technologique de cocons artificiels dont les éléments vitaux sont à la merci du règne informatique, la mort était littéralement programmée selon certains paramètres sociaux bien précis. Impensable ? Erreur ! Aujourd’hui l’euthanasie est acceptée par plusieurs pays – l’utilitarisme, la réification générale, guettent. De réformes – notez combien les néolibéraux raffolent de ce terme – en réajustements, la décision finale glissera progressivement du cercle proche des malades, comme nous l’admettons chaque jour davantage en France – moi-même, en écrivant ces lignes, je me rends compte (j’en ai la nausée) que je n’y suis pas viscéralement opposé : je suis un monstre ! –, à une hiérarchie de plus en plus éloignée. En d’autres termes, demain, ou après-demain, la décision de débrancher les fils qui maintiennent votre parent en vie, échoira à un fonctionnaire ou, pire, à un directeur commercial en blouse blanche. La démonstration est certes contestable, mais elle fait indubitablement peur, très peur en vérité, car ce que prédit l’auteur, Cassandre averti des biotechnologies, n’est rien moins que l’extermination planifiée des vieillards occidentaux qui représentent une charge financière trop lourde pour leurs descendants… Son Eternity Express, autant vous prévenir, est un sinistre convoi de la mort, et Clifford Estate, cet Eden en terre de Chine promis à nos ancêtres par les brochures publicitaires, est un camp de concentration à visage humain. Il existe bien une solution au problème des retraites ou du financement du soutien aux personnes invalides, tenez-vous le pour dit : la solution FINALE !
Pour parvenir à ses fins, Truong développe une passionnante dialectique par le biais des dialogues effrayants entre Xuan et Jonathan. Xuan, alias Monsieur Ho (Monsieur Ho, soit dit en passant, était aussi le surnom du communiste vietnamien Ho Chi Minh…), fait figure d’épouvantail : parrain tout-puissant, nietzschéen de la pire espèce, il prône « l’amour du plus lointain » professé par Zarathoustra – celui-là même que je chéris au même titre que l’amour du prochain – c’est-à-dire, selon Xuan, la raison du plus grand nombre – une pensée anti-humaniste, utilitariste, inhumaine –, la pérennité coûte que coûte, à n’importe quel prix. Jonathan, en bon humaniste occidental, paraît horrifié par le cynisme pragmatique de son ami, mais s’avère beaucoup plus complexe que Xuan : comme le juge-enquêteur de Reproduction interdite, Jonathan véhicule à l’insu du lecteur toute la problématique du livre. Extrêmement ambigu, il est encore une fois cet individu lambda – quel que soit son statut social (nous sommes tous égaux devant la Mort) – dont les convictions éthiques et morales, parce qu’elles ne reposent sur aucune réflexion en profondeur, parce qu’elles relèvent surtout du prêt-à-penser et de la doxa intellectuelle, finissent par être balayées par un système anthropophage – et, lui, froidement mathématique. Cette dialectique est si prépondérante – au détriment du Verbe, nous allons le voir – qu’elle évoque le Gorgias de Platon plus que les dystopies d’Huxley (et ne parlons pas d’Orwell !) – même si le résultat, je suppose, est similaire. C’est d’ailleurs bien cette philosophie en action – Truong n’aime rien tant que « philosopher à coups de marteau » – qui rend Eternity Express à la fois si facinantt et si décevant. Fascinant, parce qu’il repousse une nouvelle fois les limites de nos certitudes, parce qu’au-delà de ses carences littéraires – dont l’auteur se contrefiche –, il sème un immarcescible doute dans nos esprits pétris de stupides certitudes. Et décevant, parce qu’après la maestria de Totalement inhumaine, essai redoutable, j’attendais un véritable roman, une œuvre qui constituât en elle-même une réponse plutôt qu’une simple réaction, or la trame d’Eternity Express, cet ultime voyage, à bord du transsibérien, de quatre cents insupportables vieillards pleins d’espoir, sert avant tout de prétexte à sa dramatique démonstration. Les péripéties dont le train est le théâtre cinétique sont relativement anodines et masquent délibérément l’enjeu réel du périple, tout en égrenant périodiquement quelques informations capitales sur le narrateur, seul dépositaire de l’abjecte vérité.
Eternity Express se lit d’une traite, comme un roman de gare – en partance pour l’Enfer –, mais hormis dans sa dernière partie – excellente –, seuls quelques passages marquent vraiment les esprits. Il est regrettable que Jean-Michel Truong, dont j’admire l’acuité de vision, n’ait pas encore tout à fait réussi, au travers d’un évident travail d’épure stylistique, à atteindre une plénitude formelle à la hauteur de ses ambitions. Son style n’est pas en cause, fluide, efficace, mais le roman aurait pu se passer sans dommage, j’en suis convaincu, de quelques excès pamphlétaires et didactiques qui ont le double inconvénient de briser l’élégance de l’ensemble et d’interdire tout sentiment d’empathie envers les passagers (ce qui constitue la force, au contraire, de Chromozone, 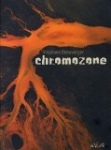 un formidable roman de science-fiction publié aux éditions de la Volte, sur lequel je reviendrai prochainement). A trop vouloir aller à l’essentiel, l’auteur en a oublié d’écrire un vrai roman… Souvent, il s’égare dans des dialogues redondants et trop explicatifs qui nuisent au rythme du récit. Peut-être a-t-il souhaité éviter des polémiques similaires à celles suscitées par ses précédents ouvrages, réaffirmer haut et fort que s’il renie l’humanisme des lumières – une évidence –, s’il croit que notre espèce est fondamentalement mauvaise (une offense, écrit Stéphane Beauverger, l’auteur de Chromozone), il n’en reste pas moins profondément révolté par les exactions commises au nom du politiquement correct. Ceci expliquerait sans doute pourquoi Xuan, sorte d’incarnation du Mal, est dépourvu de cette épaisseur qui nimbait le Nitchy du Successeur d’un insaisissable voile de sentiments contraires. Le discours cynique de Xuan fascine au plus haut point – comment ne le serais-je point, fasciné, moi qui suis tout aussi nietzschéen que son démon chinois ? – mais Truong le définit explicitement comme le Diable en personne ; le Diable, c’est-à-dire l’Homme dans toute son ambiguïté fondamentale, archétype monolithique en qui est concentrée toute la logique socio-économique actuelle et, selon toute vraisemblance, à venir. La facilité avec laquelle Truong – qui maîtrise à la perfection les arcanes du cynisme absolu – parvient à se glisser dans la peau de ce type de personnages est par ailleurs assez troublante : sa connaissance et sa pratique de la philosophie n’y sont sans doute pas étrangères, et son Xuan rappelle le Vautrin de Balzac, à la fois ennemi et tentateur.
un formidable roman de science-fiction publié aux éditions de la Volte, sur lequel je reviendrai prochainement). A trop vouloir aller à l’essentiel, l’auteur en a oublié d’écrire un vrai roman… Souvent, il s’égare dans des dialogues redondants et trop explicatifs qui nuisent au rythme du récit. Peut-être a-t-il souhaité éviter des polémiques similaires à celles suscitées par ses précédents ouvrages, réaffirmer haut et fort que s’il renie l’humanisme des lumières – une évidence –, s’il croit que notre espèce est fondamentalement mauvaise (une offense, écrit Stéphane Beauverger, l’auteur de Chromozone), il n’en reste pas moins profondément révolté par les exactions commises au nom du politiquement correct. Ceci expliquerait sans doute pourquoi Xuan, sorte d’incarnation du Mal, est dépourvu de cette épaisseur qui nimbait le Nitchy du Successeur d’un insaisissable voile de sentiments contraires. Le discours cynique de Xuan fascine au plus haut point – comment ne le serais-je point, fasciné, moi qui suis tout aussi nietzschéen que son démon chinois ? – mais Truong le définit explicitement comme le Diable en personne ; le Diable, c’est-à-dire l’Homme dans toute son ambiguïté fondamentale, archétype monolithique en qui est concentrée toute la logique socio-économique actuelle et, selon toute vraisemblance, à venir. La facilité avec laquelle Truong – qui maîtrise à la perfection les arcanes du cynisme absolu – parvient à se glisser dans la peau de ce type de personnages est par ailleurs assez troublante : sa connaissance et sa pratique de la philosophie n’y sont sans doute pas étrangères, et son Xuan rappelle le Vautrin de Balzac, à la fois ennemi et tentateur.
Jonathan en revanche, dont l’auteur ne dévoile le passé douteux que par bribes éparses, se révèle autrement plus retors. C’est sur lui que se cristallisent les véritables enjeux. Si le personnage de Reproduction interdite prenait peu à peu conscience du caractère pusillanime de son comportement avant de faire preuve d’un courage salutaire, Jonathan effectue le trajet inverse, et bien que son rôle – qu’on devine important – dans la tragédie révélée demeure longtemps obscur pour le lecteur, il se laisse manifestement porter par les événements, en observateur clinique ; si son ambition, sa vénalité et sa volonté de puissance affleurent parfois, Jonathan cache bien son jeu. Surtout, son itinéraire idéologique épouse parfaitement celui de la société occidentale tel que décrit par Truong. Les révélations finales, dont la brutalité laisse pantois, ne sont pourtant guère surprenantes au regard de l’habitus de Jonathan et de ses pairs, dont toutes les actions peuvent se résoudre en définitive à de simples calculs mathématiques. Jonathan, simplement, est un faible. Personnage presque ballardien, Jonathan ressemble comme deux gouttes d’eau au Charles Prentice de La Face cachée du soleil ou au Paul Sinclair de Super Cannes, romans dont la parenté avec Eternity Express est plus profonde puisque dans les trois cas, le séjour paradisiaque attendu – une station balnéaire, un complexe scientifico-financier, un village de retraite – se mue en cauchemar climatisé sous la main d’un démiurge visionnaire.  Le journaliste de La Face cachée du soleil est poussé, comme Jonathan, à commettre l’irréparable sous l’influence d’un illuminé. J.G. Ballard et Jean-Michel Truong partagent une même vision du monde où le libre arbitre des individus ne suffit pas à assurer leur liberté – un monde où les seules armes dont disposent ceux qu’il faut bien se résoudre à nommer les résistants sont la réflexion individuelle (la méditation ?) et une rigueur éthique exemplaire. Mais chez Ballard cet aspect est escamoté, assimilé par le récit lui-même jusqu’à en devenir extrêmement ambigu et apolitique – en bref, une véritable œuvre littéraire –, comme dans son dernier roman Millenium People, tandis que chez Truong le discours, souverain, ne s’embarrasse pas de détours : le Verbe est privé de sa majuscule, sacrifié sur l’autel du signifié, du sens. Truong ne nourrit pas la littérature, il propage des mèmes antiviraux. Pour autant, Eternity express n’est pas qu’un vulgaire pamphlet : Truong n’y défend pas les opprimés, il ne s’attaque à personne en particulier, il n’est même pas vindicatif : il étudie les rouages d’un système et nous confie froidement ses conclusions. Et croyez-moi – si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous êtes désormais convaincus –, celles-ci ne sont pas des plus réjouissantes...
Le journaliste de La Face cachée du soleil est poussé, comme Jonathan, à commettre l’irréparable sous l’influence d’un illuminé. J.G. Ballard et Jean-Michel Truong partagent une même vision du monde où le libre arbitre des individus ne suffit pas à assurer leur liberté – un monde où les seules armes dont disposent ceux qu’il faut bien se résoudre à nommer les résistants sont la réflexion individuelle (la méditation ?) et une rigueur éthique exemplaire. Mais chez Ballard cet aspect est escamoté, assimilé par le récit lui-même jusqu’à en devenir extrêmement ambigu et apolitique – en bref, une véritable œuvre littéraire –, comme dans son dernier roman Millenium People, tandis que chez Truong le discours, souverain, ne s’embarrasse pas de détours : le Verbe est privé de sa majuscule, sacrifié sur l’autel du signifié, du sens. Truong ne nourrit pas la littérature, il propage des mèmes antiviraux. Pour autant, Eternity express n’est pas qu’un vulgaire pamphlet : Truong n’y défend pas les opprimés, il ne s’attaque à personne en particulier, il n’est même pas vindicatif : il étudie les rouages d’un système et nous confie froidement ses conclusions. Et croyez-moi – si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous êtes désormais convaincus –, celles-ci ne sont pas des plus réjouissantes...
Comme Reproduction interdite, Eternity Express est aussi une variation autour de l’holocauste. L’éternité du titre, délicieusement ironique, est bien sûr celle à laquelle aspirent les passagers refusant l’échéance inéluctable de la mort ; elle est surtout celle, moins romantique, qu’ils acquièrent au terminus, au cœur des gigantesques fours crématoires de Global Waste basés à Clifford Estate ! Truong a cependant eu l’intelligence de faire coïncider son récit avec le parcours du train : les seules connaissances de ce qui attend les compagnons de Jonathan – aussi antipathiques soient-ils – et du rôle abject de Jonathan se suffisent à elles-mêmes. Le propos de l’auteur, d’une rigueur exemplaire, se situe au-delà de toute description : les faits, rien que les faits, comme dans Reproduction interdite encore – qui reste son meilleur roman à ce jour –, ou comme dans un livre d’histoire. A mille lieues des ridicules gesticulations du grand cirque médiatique, Jean-Michel Truong clos son récit avec rage et pudeur, et non sans désespoir. Le souvenir rémanent de Jonathan, ce Mengele ordinaire – vous ?... moi ?...), m’a longtemps hanté, sans doute parce que ce que suggère l’auteur a trop d’accents de vérité pour être négligé, et parce que le dénouement, témoignant de son grand talent, et rompant avec le didactisme souvent artificiel des deux premiers tiers, renoue avec la fiction en tant que telle – avec la littérature – sans pour autant délaisser ses ambitions discursives. Au temps pour ma critique de forme, quasi inopérante.
La faille d’Eternity Express, toutefois, réside peut-être dans son extrême pessimisme – Truong ne ménage aucune échappatoire. Aucun personnage, aucun individu de notre race maudite ne trouvant grâce à ses yeux – sinon un couple d’antiquaires un peu terne et les ouvrières de Shuang-Feng massacrées avant les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, mais seulement, pour ces dernières, sous la forme d’un groupe anonyme et emblématique –, la légitimation du propos devient alors problématique : pour critiquer la politique fasciste (communiste ?) de Xuan et de l’Union (la primauté du collectif sur l’individuel), Truong raisonne lui aussi à un niveau collectif, empêchant le roman d’atteindre complètement son but, le rendant aussi froid en définitive que ses personnages : à quoi sert de crier au feu, je vous le demande, quand l’on est déjà à moitié carbonisé ?... Nul doute que certains interpréteront ce parti pris discutable comme un aveu, celui d’une pensée anti-humaniste qui ne dit pas son nom, comme ce fut le cas avec Totalement inhumaine. Ils feront remarquer qu’Eternity Express peut dès lors se lire comme une nouvelle justification du Successeur, comme une énième démonstration de l’échec définitif d’une humanité depuis longtemps suicidée. Mais a contrario, on pourrait rétorquer que ce que Truong signifie par cette noirceur absolue, ce qu’il sous-entend, c’est justement que nos combats, notre empathie, ne doivent pas être soumis à des critères quelconques – je ne suis pas un code statistique, ai-je envie de hurler –, mais que toute l’humanité, aussi détestable soit-elle, mérite notre considération. La manière éminemment réfléchie dont Truong a traité son sujet, ce refus héroïque des concessions, cette emprise de la rigueur intellectuelle sur le pathos, prouvent définitivement que sa vision prophétique d’une intelligence « totalement inhumaine » était bien le fruit d’une analyse qui ne doit rien à la provocation. Le remarquable travail d’épure effectué par l’auteur n’a rien de fortuit : débarrassée des affèteries littéraires, sa nouvelle prose du transsibérien approche une certaine vérité transcendante qui me pétrifie d’effroi. Je regarde mon fils, et je tremble, parce que je ne veux pas d’un univers sans hommes. Je ne veux pas – suprême égoïsme – d’un univers sans moi et mes semblables.
Il semble, au final, que la force d’évocation d’Eternity Express excède ses contradictions. Au cynisme post-moderne, Truong oppose un cynisme antique, celui encouragé par Peter Sloterdijk et qui consiste en ce retournement ironique à l’œuvre dans le roman, de l’ordre de la guérilla intellectuelle ; ce qui fait son prix en définitive, c’est bien cet hyperréalisme halluciné, cette rectitude, cette rage réprimée ; ce doute glacial et poisseux qui nous étreint au fil de la lecture et qui ne nous lâche plus jusqu’à l’apocalypse finale.
Et le doute, toujours. Sommes-nous tous damnés ? « Ça n’est pas encore fini », préféré-je répondre, comme le Valushka des Harmonies Werckmeister, le chef d’œuvre de Béla Tarr.

Jean-Michel Truong, Eternity Express (Albin Michel, 2003), 299 pages.
23:55 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer