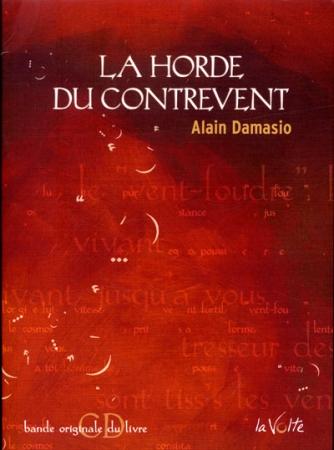Sebastiao Salgado, Antarctica, 2005 (Genesis)
« L’écriture a pour seule fin la vie, à travers les combinaisons qu’elle tire. »
G. Deleuze, Dialogues (avec Claire Parnet)
« We are such stuff as dreams are made on »
(« Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les rêves »)
W. Shakespeare, La Tempête
Du mouvement, donc. Mais être vivant, c’est également être lié. Les exemples de narration polyphonique sont innombrables dans l’historie littéraire, y compris dans les genres de l’Imaginaire, mais si les meilleurs d’entre eux sont parvenu à donner vie à leurs narrateurs, à leur créer des os et une chair, aucun, à notre connaissance – sinon peut-être William Faulkner – n’avait su faire vivre un groupe et chacun de ses membres, en mettant leurs liens en lumière, en faisant ainsi entendre leurs voix tissées ensemble, qui ne sont autres en définitive que celles, intérieures, d’Alain Damasio lui-même. La polyphonie de La Zone relevait moins de cette « ontologie du lien » que d’une chorale, à l’image du concerto philosophique de Capt. Le danger était que les personnages fussent uniquement définis par leurs fonctions (ne dit-on pas « un Golgoth » comme s’il s’agissait d’un nom commun ?) ou leur psychologie. Mais un travail stylistique inouï les singularise en même temps qu’il les unit. Chaque personnage possède son style propre, son rythme vital. Maître des agencements, champion de l’architecture des écarts, Alain Damasio utilise à plein le champ lexical (précision, expressivité, harmonie, équilibre…), syntaxique (déconstruction, variété, mise en relief…), rythmique (balancements itératifs ou fantaisistes, accélérations, décélérations, inflexions et ruptures…), voire purement phonétique (assonances, allitérations, juxtaposition de mots courts, secs, cassants, aux « plosives sourdes et sonores » – Golgoth –, ou au contraire de mots doux, aux consonnes liquides et aux voyelles arrondies – Aoi) ou encore visuel (masse des mots, utilisation des jambages pour prolonger la ligne ou la briser, tirets longs pour les incises, qui font fuser la phrase ou la font au contraire – après une courte pause – ralentir…). Prenez Golgoth, qualifié par Caracole, au début du livre, de « percute-souffle » (p. 519). Avec ses consonnes plosives, « percute » produit des sons très proches du sens du mot qui, littéralement, percute, de même que le mot « souffle » évoque phonétiquement ce qu’il désigne (prononcez-le à voix haute). Et ce n’est pas tout : visuellement, les deux « f » et le « l » de « souffle » forment une muraille verticale que viennent effectivement percuter les précédents phonèmes… Rares sont les littérateurs – et plus rares encore parmi les créateurs de mondes de la science-fiction – à exploiter avec une telle constance les infinies possibilités de la langue.
Les noms de personnages eux-mêmes sont signifiants, et rendent admirablement compte de leur, quoi ? caractère ? de leur vif plutôt, des forces qui les animent et qui les lient. Ainsi le nom du traceur, au langage dur, rocailleux, argotique, évoque-t-il non seulement le Golgotha, lieu du Calvaire et de la Crucifixion, mais aussi son origine étymologique (Golgotha est la forme grecque de l’araméen gulgota, crâne), ou encore les Goths tenus pour des barbares… Alain Damasio n’est pas sans savoir, au demeurant, qu’un certain nombre de ses lecteurs ont vibré aux exploits de Goldorak contre les Golgoths de Véga... Pietro della Rocca, le noble de la horde, c’est littéralement Pierre de la Roche, de la Falaise. Sa qualité ? La probité. Son symbole ? Celui, immuable, du nombre pi ! Pour Caracole – qui rime avec Éole, dieu des vents –, dont le glyphe comprend une apostrophe qui, en linguistique, peut marquer un changement de prononciation d’un mot, tout est limpide : la caracole est une série de voltes et de demi-voltes… Caracole, un volté ? Ça vous étonne ?...
Plusieurs hordiers portent des noms géologiques ou aérologiques, comme Talweg (ligne de plus grande pente d'une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux courantes : Talweg, le géomaître, n’est-il pas celui qui choisit le meilleur tracé pour la horde ?), Steppe, Horst (compartiment resté haut entre des failles) et Karst (paysage façonné dans des roches solubles carbonatées), Oroshi (vent d’hiver japonais fort, froid et sec) ou Erg Machaon. Attardons-nous un instant sur ce dernier. En plus d’être un désert de dunes éoliennes, l’erg, du grec ergon (travail) est une unité de mesure d’énergie, ce qui sied parfaitement à notre maître d’arme (qui peut parfois évoquer Duncan Idaho du cycle de Dune, quand Te Jerkka, par son parlé un peu primitif, rappelle bien sûr le célèbre Maître Yoda de Star Wars). On trouve également dans les comics américains un Erg, mutant qui absorbe l’énergie de ses adversaires, comme le fait le protecteur de la horde dans son duel contre Silène. Nous pourrions encore parler des mots au préfixe « erg », comme « ergonomie », « ergologie », « ergot », qui trouveraient tous quelque accointance avec le personnage de Damasio. Par ailleurs, un machaon est un papillon, auquel renvoie bien sûr l’aile delta avec laquelle Erg – dont le glyphe attitré est, vous le devinez, un delta grec majuscule – se déplace.
Voyons aussi Oroshi Melicerte, dont les noms évoquent, pêle-mêle, et tant pis pour nos sources : un vent et un monstre japonais, un dieu marin (frère d’un certain Learchos !) dans la mythologie romaine, une pièce inachevée de Molière… Son glyphe, une croix ou un « X » (Chi ou Khi, en grec) peut, si nous tirons la corde – tirons-la –, évoquer le Qi, mot chinois qui peut se traduire par « fluide », « énergie » ou « souffles »… Mieux, dans la culture spirituelle chinoise, le Qi est un peu l’équivalent du vif (peut-être en est-il aussi à l’origine) : il englobe tout l'univers et relie les êtres entre eux ; dans un organisme vivant, il circule à l'intérieur du corps par des méridiens (les « nœuds » du Vif) qui se recoupent tous dans le « centre des énergies » ! Oroshi, c’est le Chi en or (oro, « or » en espagnol), le vif puissant et précieux de l’aéromaîtresse. Au fait, aéromaîtresse ?... Oroshi serait-elle l’amante du vent ? N’est-elle pas précisément fécondée par Sov et Caracole, autochrone tissé de vents ?...
Le nom du scribe Sov Sevcenko Strochnis résiste un peu mieux à l’onomastique. Écartons toute référence au footballeur ukrainien Chevtchenko – même si nous avons déjà entendu Alain Damasio dresser un portrait caracolien d’un célèbre avant-centre milanais –, et abandonnons le Strochnis, qui ne nous évoque rien. Pour Caracole, Sov est Philosov le sage, Sovageon le sauvage. Mais Sov = sauf… Sov fait figure d’exception. Tous les hordiers seront dispersés par la neuvième forme du vent, tous sauf Sov, qui, seul, atteindra la fin du roman, sain et sov… Le glyphe de Sov est une parenthèse (qui se ferme sans qu’une autre ait été ouverte), qu’on peut également envisager comme un fin croissant de lune, symbole pour les Musulmans de résurrection ! Voué à renaître, Sov ?... Nous pourrions aussi, avec un peu d’imagination ou d’audace, creuser le triptyque SOV, Sujet-Objet-Verbe, qui nous renvoie à l’écriture, fonction première du scribe…
*
Et malgré tout, c’est la horde elle-même le véritable héros du livre. Comme au rugby, le Pack vaut plus que la somme de ses individualités. C’est une équipe, avec son pilier et ses ailiers, qui doit aller au bout d’elle-même, se dépasser pour vaincre l’adversaire (la neuvième forme ?). Ce n’est certes pas un hasard si les vifs de la horde se regroupent autour de Sov, le soviet (conseil en russe), l’homme du lien. Nous l’avons dit, le lien chez Damasio est essentiel. Il est, avec le mouvement, l’une des principales forces de vie. Sans sa narration polyphonique, sans sa caractérisation totale des vingt-trois hordiers chacun noué aux vingt-deux autres – quoique, en fait, les narrateurs principaux ne sont pas si nombreux –, La Horde du contrevent ne serait qu’un roman d’aventures philosophique particulièrement bien écrit. C’est son « ontologie du lien » qui, servi par une grande maîtrise stylistique, le hisse au rang de chef d’œuvre et soulève l’enthousiasme : être lié, c’est exister ; être délié, c’est disparaître.
Alain Damasio, c’est un peu Tolkien, ou Simmons, doué – toutes proportions gardées – de la poésie pure d’un Mallarmé. Jamais hermétique cependant, jamais même « difficile », sa prose sensuelle, qu’il faut lire à voix haute pour en jouir pleinement, favorise au contraire notre immersion. Après un temps d’adaptation à la narration « polyphrénique », pour reprendre un terme de son cru, et au travail poétique de la langue, La Hordedu contrevent se lit comme un conte initiatique ou un planet opera métaphysique qui vous fait rêver et ravage vos méninges. Pour parler comme Sartre, sa littérature est un langage conquérant qui nous introduit « à des perspectives étrangères, au lieu de nous confirmer dans les nôtres » (Qu’est-ce que la littérature). En témoigne le superbe et ludique duel verbal entre Caracole et Sélème à Alticcio, qui comprend des épreuves de « palindrome dialogué », de « monovoyelle en O », et de « stylibre » sous sa forme capizzano (en variante « solo sur syllabe »). L’affrontement est splendide, et rappelle par bien des aspects les parties d’échecs entre Karpov et Kasparov dans les années 80, ici remplacés par Sélème et Caracole : mémoire contre fantaisie, rigueur contre génie… Notons que la nouvelle « Les Hauts Parleurs » mentionnait déjà un certain Spassky, homonyme d’un ancien champion d’échecs... Mais nous espérons avoir démontré que la langue n’est pas seulement un terrain de jeu pour Alain Damasio : elle est une porte grande ouverte sur un monde transfiguré qui n’est jamais, on s’en doute, qu’un miroir du nôtre.
*
Qu’est-ce que le vif ? La huitième forme du vent, peut-être, à moins qu’il ne s’agisse des chrones. Le vif est souffle vital, pas esprit. Le vif, ce n’est pas l’âme. Pour Lerdoan, un philosophe fréole : « Le vif, c’est ce qui t’a fait, c’est l’étoffe dont sont tissées tes chairs, Caracole. C’est la différence pure. L’irruption. La frasque. Quand le vif jaillit, quelque chose, enfin, se passe – » (p.400) Pour Oroshi :
« Le vif est la puissance la plus strictement individuelle de chacun. Il tient du néphèsh, ce vent vital qui circule en nous, qui nous fait ce que nous sommes. Rien ne peut s’y mêler. Il est pur, insécable et automoteur. Il peut seulement se disperser si sa vitesse vient à décliner, il peut s’ajouter à un autre vif, mais pas fusionner… » (p. 264)
En d’autres termes, le vif est mouvement & lien.
« Ma conviction [dit encore Oroshi] est que le vif est une force pure, directement tirée du chaos. Il surgit du et par le chaos ; et d’une certaine façon, il surgit face et contre le chaos, pour en affronter la dislocation explosive. Le vif est vraisemblablement la première force consistante et automotrice. L’apparition du vif ne fait qu’une avec celle de la vie organisée, à la fois parce que la vie ne peut surgir du chaos qu’en apportant en quelque sorte une plus-value de consistance à un ensemble dilapidé de forces et de matériaux ; et à la fois parce que l’énergie nécessaire à cette consistance, l’énergie qui va opérer les densifications, les articulations et assurer le lien, l’énergie qui va tout aussi bien enfler des vides, des fentes, truffer la matière, intercaler les forces, aménager les intervalles qui aèrent et donc cohèrent le vivant, cette énergie ne peut venir que d’une force terrible, aussi ténue soit-elle, qui est le vif. Le vif sort proprement du chaos, au double sens qu’il en est issu et qu’il s’en détache. Il affronte de fait les forces d’un magma brut indompté dont il s’extrait et qu’il réorganise […] par le rythme. La riposte du vif au chaos, c’est le rythme. » (p. 55)
Les vifs sont des flux qui entrent en conjonction avec d’autres, ils sont déterritorialisés (cf. l’épigraphe du roman, tiré de Mille plateaux de Guattari et Deleuze : « Seulement on n’est jamais sûr d’être assez fort, puisqu’on n’a pas de système, on n’a que des lignes et des mouvements. »). Le vif, c’est cette force qui fait de nous des êtres vivants, des forts au sens nietzschéen, hommes et femmes qui jamais ne basculent dans l’abîme et dansent sur sa crête. Le vif, c’est ce feu qui anime les plus fous, les plus créatifs d’entre nous. Le vif, c’est ce que n’anime pas l’homme sans volonté, esclave de son quotidien de répétitions sans différences. La Horde du contrevent est une lecture magique, en même temps qu’une grande leçon de vie.
*
Comprenez en effet qu’en dépit de sa solide charpente théorique, et de son interprétation ambiguë du Surhomme nietzschéen, ce qui l’emporte à la lecture est bien l’émotion, sublime, née de l’impérieuse nécessité de réinventer sa propre vie, non par une quête effrénée de la « nouveauté », mais, en toute conscience, par la constante activation du vouloir, en toutes choses – en amour comme en littérature ; et bien sûr de l’incroyable force du lien à l’œuvre parmi les hordiers, par-delà l’espace et le temps.
« Je ne m’en sortis pas en les oubliant. Je ne vainquis pas ma solitude en m’égocentrant pour aller puiser d’un noyau hypothétique, qui me fût propre, l’envie personnelle de continuer à exister. Mon corps ne surmonta pas la neuvième forme en se tranchant, au pli de mes poignets, la myriade de mains qui caressaient, qui serraient encore ces rameaux d’autres poussées dans la Horde, et les nuques, les épaules, les ventres et les visages, ce fut profondément le contraire : je m’en sortis à la force du nœud, à la corde à mémoire, par la fureur interne d’une restitution perpétuelle de tout ce qui restait vivant d’eux en moi et que j’avais su conserver dans la plénitude de leur déroulé. […]
Je m’en sortis parce que je compris, du cœur de mon effondrement, que toute la Horde n’était encore debout sur la lande que par ma faculté active à la faire vivre. La solitude n’existe pas. Nul n’a jamais été seul pour naître. La solitude est cette ombre que projette la fatigue du lien chez qui ne parvient plus à avancer peuplé de ceux qu’il a aimés, qu’importe ce qui lui a été rendu. Alors j’ai avancé peuplé, avec ma horde aux boyaux, les vifs à un pas et une certitude : l’écroulement de toutes les structures qui m’avaient porté jusqu’ici – la recherche de l’origine du vent, les neufs formes, l’Extrême-Amont, les valeurs et les codes de ma Horde – ne m’enlevait pas, ne pourrait jamais m’arracher, pas même par leur mort, ce qui ne dépendait, authentiquement, que de moi : l’amour enfantin qui me nouait à eux. » (p. 5)
C’est ainsi peuplés de nos proches et de nos morts, inextricablement noués à leur existence, que nous avançons nous aussi. L’idée n’est pas neuve, mais fut rarement illustrée avec une telle beauté.
*
Nous pourrions continuer longtemps. Nous pourrions vous parler du vif encore, la huitième forme du vent peut-être (à moins qu’il ne s’agisse des chrones), qui est souffle vital, l’intempestif en acte, une « force pure, directement tirée du chaos », qui fait de nous des êtres vivants, qui nous fait voltiger sur la crête de l’abîme. Nous pourrions vous parler des trois dernières formes du vent (la septième : le vent liquide ; la huitième : le chrone ou peut-être le vif ; et la neuvième : la mort-vive, l’essoufflement, l’anti-vent qui délie, la perte d’énergie, le silence de l’écrivain, l’arrêt du livre)… Nous pourrions vous dire que les romans d’Alain Damasio sont la métaphore de ses propres métamorphoses, que La Zonedu Dehors est le récit de son devenir-lion, de l’écrivain révolté, et que La Horde est le récit de son devenir-enfant, et nous pourrions alors nous demander ce que pourrait bien être sa prochaine métamorphose (pas le silence rimbaldien, quand même ?) avec Les Furtifs, son prochain livre. Nous le pourrions en effet.
Mais…
Le vent souffle où il veut.

Caspar David Friedrich, Le voyageur contemplant une mer de nuages, vers 1818.