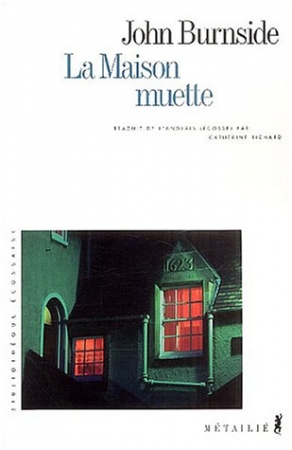
Voici une critique, légèrement revue, initialement publiée sur le défunt site Mauvais Genres – et que, à mon grand étonnement, je retrouve sur le site du collectif Bellaciao auquel collaborent ou ont collaboré (est-ce un hasard ?) Alain Soral, Marc Alpozzo, Alina Reyes ou encore Serge Rivron, et qui soutint il y a quelque temps mon ami Cesare Battisti, auteur de Dernières cartouches et de Avenida Revolución, toujours recherché par les autorités pour être extradé en Italie où il est passible de prison à perpétuité pour des actes commis (ou non) pendant les années de plomb…
John Burnside est un poète Ecossais plusieurs fois primé dans son pays. La Maison muette, parue chez Métailié en 2003, était son premier roman – un coup de maître – ; quatre ont suivi depuis, mais hélas, seul le dernier en date (Living nowhere, 2003) a été traduit : Une vie nulle part paraîtra le 26 août, toujours chez Métailié. Servi par un style chirurgical (rendons hommage à la traductrice Catherine Richard, excellente), Luke, le narrateur de La Maison muette, nous livre le récit de ses expériences monstrueuses sur deux bébés, avec un détachement absolu. Dès les premières lignes, le malaise s’installe, tenace :
« Nul ne pourrait dire que ce fut un choix de ma part de tuer les jumeaux, pas plus qu'une décision de les mettre au monde. Ces événements s'imposèrent l'un et l'autre comme une nécessité inéluctable, un des fils dont est tissée la toile de ce que l'on pourrait appeler le destin, faute d'un mot plus approprié... un fil que ni moi ni personne n'aurait pu ôter sans dénaturer le motif entier. En revanche je décidai de procéder aux laryngotomies, ne serait-ce que pour mettre un terme à leur chant continuel (si tant est qu'on puisse appeler cela un chant), ce hululement qui saturait mes journées et pénétrait mon sommeil par la moindre fissure de mes rêves. Sur le moment, toutefois, j'aurais dit qu'il s'agissait d'un acte logique, d'une étape de plus dans la recherche que j'avais entreprise presque quatre ans auparavant.., la seule expérience éminemment importante que puisse mener un être humain : trouver le siège de l'âme, ce don unique qui nous différencie des animaux ; le trouver en instaurant tout d'abord une carence et ensuite, plus tard, en procédant à une destruction logique et nécessaire. Je fus surpris de la facilité avec laquelle je pus opérer sur ces deux êtres à demi dégrossis. Ils existèrent dans un autre monde : celui des rats de laboratoire, ou l'espace mouvant et dénué de fonction du véritable autisme.
Cette expérience est maintenant terminée. »
La précision de la langue – dont l’auteur use comme d’un scalpel esthétique – crée les conditions idéales pour une plongée en apnée dans l’esprit froidement mécanique du narrateur. Tout ce qui lui est extérieur est écarté, si bien que même les pistes psychanalytiques ont plus une valeur poétique (le fantôme de sa mère malade, en fait décédée) qu’explicative. Le titre complet du livre est La Maison muette (roman de chambre) – en l’occurrence, si l’action est en effet resserrée sur quelques lieux symboliques, il s’agit plutôt d’une chambre noire, où nous serait dévoilé page après page l’espace intérieur du narrateur. Et l’auteur, pour ce faire, refuse l’artifice narratif, travaillant non pas comme « conteur » mais comme écrivain à part entière. Totalement immergé dans les processus mentaux de Luke, le lecteur n’a d’autre choix que d’adopter son point de vue, d’attendre fébrilement les résultats de l’expérience, aussi abjecte soit-elle, et de suivre attentivement la démarche intellectuelle qui aboutit au résultat annoncé dans les lignes reproduites ci-dessus.
Luke, inconscient de l’immoralité de ses actes, nous décrit la séquestration puis la mutilation de jumeaux en bas âge comme s’ils étaient de simples spécimens ; comme si, en définitive, il niait totalement leur humanité. Il agit comme un entomologiste dénué d’émotions qui sectionnerait les antennes d’un insecte pour observer son comportement. Cette insupportable distanciation, pourtant, n’est pas gratuite : l’expérience à laquelle il se livre vise justement à localiser le siège de l’âme, à vérifier que, conformément à l’histoire d’Akbar le Moghol que lui racontait sa mère, un enfant est incapable de développer un langage hors de tout contact humain (Akbar fit construire la Maison muette pour y enfermer des nouveaux nés entourés de serviteurs muets ; les enfants ne parlèrent point, preuve selon Akbar que le langage est acquis, contrairement à l’âme, qui serait, elle, un don divin).
Pour autant, John Burnside n’a pas omis d’aménager une échappatoire – de délivrer, du moins, un indice de l’humanité intrinsèque du narrateur, en dépit de sa monstruosité – : je veux parler bien sûr de ses relations avec les femmes, dans lesquelles subsiste parfois chez lui une étincelle d’empathie. Mais on devine que la véritable intention de l’auteur était davantage esthétique ; sa démarche est en effet révélée et légitimée par Luke lui-même : on comprend que l’écriture, pour John Burnside, est cette même tentative, pareillement amorale, de défier l’ordre du monde en figeant la vie par les mots, en immergeant son récit dans le langage. Tentative vouée à l’échec bien sûr ; l’auteur ne fait-il pas dire à son narrateur : « Ce qui me tracasse à présent, c’est l’idée que le langage puisse faillir : l’expérience s’étant achevée de façon si peu concluante, je ne peux m’empêcher d’imaginer que l’ordre qui semble inhérent aux choses n’est qu’un concept, que tout risque de sombrer dans l’anarchie, quelque part dans les longues étendues blanches de l’oubli. » Ce passage, qui m’évoque la triste déficience symbolique du schizophrène pour qui sujet et objet sont indifférenciés, laisse entrevoir l’œil ironique du poète, dont l’activité créatrice est conçue comme une modeste proposition d’ordonner l’univers – et ainsi, par sa nature d’artiste, d’anéantir à jamais l’essence magique de son imaginaire.
La maison muette – John Burnside ; traduit par Catherine Richard, Métailié, 2003, 199 pages, 16€.

